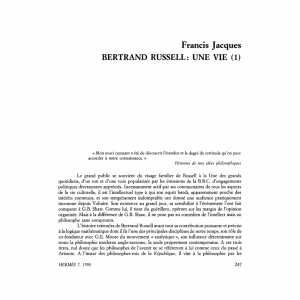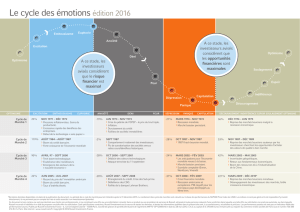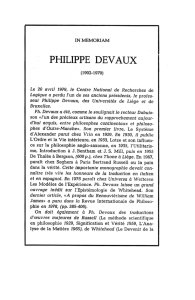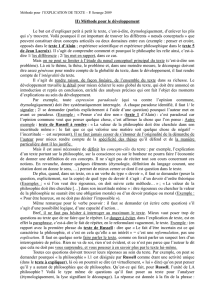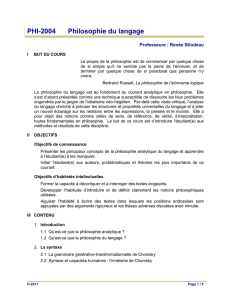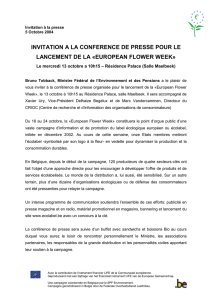1 - TEL (thèses-en

1
RUSSELL ET LA QUESTION DES
FONDEMENTS.
ÉTUDES D’HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE DES
MATHÉMATIQUES AU TOURNANT DU XXe SIÈCLE
Note de Synthèse
présentée par Sébastien GANDON
en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches
Jury
Nicholas Griffin (Prof., McMaster University, Canada)
Gregory Landini (Prof., The University of Iowa, USA)
Alain Michel (Prof., Aix)
François Schmitz (Prof., Nantes)
Elisabeth Schwartz (Prof., Clermont II) – directrice
Hourya Sinaceur (DR, IHPST-CNRS)
27 Novembre 2009
Université Baise Pascal, Clermont

2

3
TABLE DES MATIÈRES
I/ NOTE DE SYNTHÈSE 5
1/ Avant propos 5
2/ Du Tractatus à autre chose 8
3/ Le contexte mathématiques des Principles 12
4/ La question des fondements de la géométrie à la fin du XIXe 17
5/ Histoire, philosophie, mathématiques 24
6/ Perspective I : l’édition de la correspondance Russell/Whitehead 32
7/ Perspective II : le sens du logicisme russellien 36
8/ Perspective III : enjeux et histoire des géométries finies 43
9/ Conclusion 51
10/ Bibliographie 54
II/ RECAPITULATIF DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 57
(2000-2009)

4

5
“When a theory has been apprehended logically, there is often a long and
serious labour still required in order to feel it: it is necessary to dwell upon it,
to thrust out from the mind, one by one, the misleading suggestions of false but
more familiar theories, to acquire the kind of intimacy which, in the case of a
foreign language, would enable us to think and dream in it, not merely to
construct laborious sentences by the help of grammar and dictionary.”
Russell, On Knowledge of External World, 136.
1/ Avant Propos
Le dossier d’habilitation se compose de trois documents : un mémoire inédit, intitulé
« Relations et quantités chez Russell (1897-1913) », auquel je ferai référence dans la suite
sous le nom de (M) ; deux volumes regroupant certains des travaux déjà publiés ou à paraître,
intitulés « Études d’histoire et de philosophie des mathématiques au tournant du XXe siècle »,
que je désignerai par (A1) et (A2) ; enfin la présente note de synthèse accompagnée d’un
récapitulatif de mes activités de recherche de 2000 (ma thèse a été soutenue fin 1999) à 2009.
Le but de cette note est de présenter une vue synoptique de mon parcours scientifique et des
résultats obtenus depuis la thèse, ainsi que de décrire les nouvelles perspectives. Le mémoire
(M) joint au dossier constitue une partie autonome, dotée d’une introduction et d’une
conclusion indépendante. S’il sera bien évidemment question des recherches exposées dans ce
manuscrit, la présente note doit être avant tout considérée comme une introduction et un guide
à la lecture des articles contenus dans les deux volumes (A1) et (A2). Deux parties la
composent. Dans les sections 2 à 5, j’expose les résultats des travaux déjà menés. Les sections
6 à 8 donnent des indications sur mes orientations actuelles, sur les axes qui vont gouverner
mes futures recherches. Le reste de cet avant-propos est consacré à un chronogramme de mes
recherches, chronogramme rendu nécessaire par le fait que la date de publication des articles
ne reflète pas celle de leur rédaction. Je me réfère aux textes de (A1) et (A2) en donnant le
numéro sous lequel ils apparaissent dans les volumes, et pour faciliter la lecture, je redonne la
liste de ces textes à la fin de cette section
1
.
J’ai eu la chance, après ma thèse soutenue en 1999, d’être élu en 2000 maître de conférences
au département de philosophie de l’université Blaise Pascal. Cela m’a permis de préparer,
dans les meilleures conditions, la révision de mon mémoire de doctorat pour sa publication en
2002. Durant la même période, j’ai co-organisé avec E. Schwartz et A. Petit un colloque sur
Carnap – le texte 1.3 est extrait de la conférence que j’ai prononcé à cette occasion. L’article
1.1, extrait d’une conférence que j’ai prononcée à McMaster University en 2005, date en
réalité de la même période de l’immédiate après thèse, qui a été essentiellement consacrée à la
rédaction de Gandon 2002.
J’ai assuré la direction du département de philosophie de Clermont de 2002 à 2004. J’ai
profité de cette situation, peu propice aux déplacements, pour lire en détail les parties des
Principles consacrées à la géométrie et me mettre au niveau à la fois en mathématiques et en
1
J’ai souhaité ne pas surcharger la bibliographie placée à la fin de la présente Note. À quelques exceptions près, je n’ai donc
pas mentionné les références des titres que je cite déjà dans le mémoire (M) et les volumes (A1) et (A2). Le lecteur peut se
reporter à ces documents en cas de besoin.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
1
/
65
100%