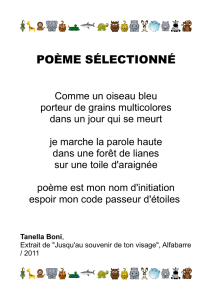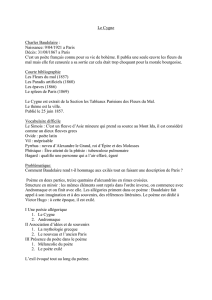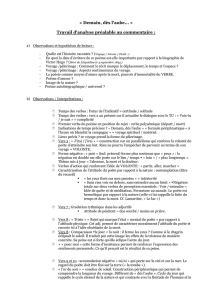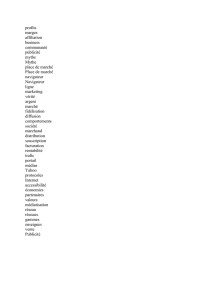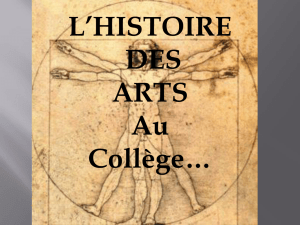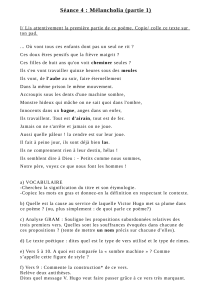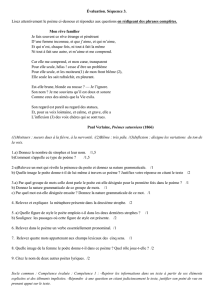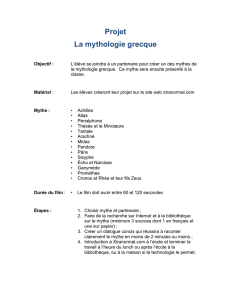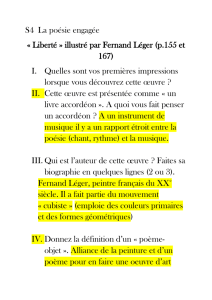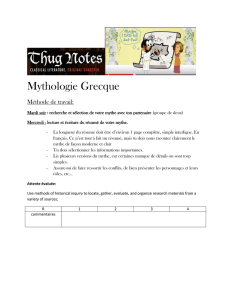bibliographie

Du poème au mythe – incursion dans la poésie rimbaldienne
Conferenţiar universitar doctor Crina-Magdalena ZĂRNESCU
Universitatea din Piteşti
Ce qui nous intéresse dans cette approche c’est le rapport du mythe à la création et non pas
l’étude du mythe en soi du point de vue philosophique, psychanalytique ou anthropologique bien
que les études d’un Lévi-Strauss, d’un Dumézil ou d’un Gilbert Durand nous aient beaucoup aidée
à avancer certaines prises de position. Rimbaud que Jean Cocteau définissait comme un mystique
sauvage, réitère dans le poème « L’Aube » du recueil « Les Illuminations » le geste primordial de
la création du monde. Que ce poème soit une preuve consciente ou pas du retour ab origine, une
identification délibérée avec une entité démiurgique, on ne saurait le dire. Mais, l’enjeu, à notre
avis, n’est pas autant le choix conscient d’un mythe fondateur que la transcription enthousiaste
d’un état d’émerveillement qu’un adolescent éprouve face à une nature en train de s’éveiller.
L’artiste dans le sens général de créateur ne saurait se dispenser des ressources inépuisables
qu’offre le mythe à la faveur duquel il peut s’« extraire » des contingences spatio-temporelles pour
accéder à un espace originaire, immuable et atemporel. A un regard « panoramique » sur la
littérature française on se rend bien compte que les écrivains se sont ressourcés aux vérités
inépuisables que l’imaginaire mythique offrait. Pour les écrivains du XVIIe siècle et XVIIIe siècle
le retour au mythe offrait des repères ontologiques exemplaires tandis que pour la nostalgie
romantique la possibilité de recouvrer un certain état propre aux horizons lointains.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle cette démarche devient plutôt intérieure, visant à
refaire par la purification du vocable l’espace devenu invivable parce que suffoqué par la routine
langagière, les clichés et les automatismes verbaux. Pensons à Baudelaire, à Mallarmé ou à
Rimbaud !
Le recours au mythe suit donc cette voie qui le mène d’une extériorité concrète –dont le but
était d’édifier un monde moderne, le monde des héros et d’une noblesse laïque – à une intériorité
organique, presque viscérale, censée offrir une vision plus juste, voire même essentielle, sur les
structures de réflexion.
Le comportement mythico-poétique pourrait être défini comme un état à la faveur duquel un
individu (en l’occurrence le poète, ou plus exactement l’artiste) tente d’accéder par les voies de
l’imaginaire, à une métamorphose de statut qui lui permettrait de s’affranchir de toute détermination
et de vivre dans un temps devenu irréversible. Voilà ce qui explique cette recherche incessante d’un
auteur de ce qui est caché, mystérieux, essentiel et, donc fondamental comme la Parole originelle.
Ce qui nous intéresse dans cette approche c’est le rapport du mythe à la création et non pas
l’étude du mythe en soi du point de vue philosophique, psychanalytique ou anthropologique bien
que les études d’un Lévi-Strauss, d’un Dumézil ou d’un Gilbert Durand nous aient beaucoup aidée à
avancer certaines prises de position. Rimbaud que Jean Cocteau définissait comme un mystique
sauvage, réitère dans le poème « L’Aube » du recueil « Les Illuminations » le geste primordial de la
création du monde. Que ce poème soit une preuve consciente ou pas du retour ab origine, une
identification délibérée avec une entité démiurgique, on ne saurait le dire. Mais, l’enjeu, à notre
avis, n’est pas autant le choix conscient d’un mythe fondateur que la transcription enthousiaste d’un

état d’émerveillement qu’un adolescent éprouve face à une nature en train de s’éveiller. La valeur
d’un poème réside justement dans la force des images qui le font vivre. Or, tout le poème que nous
allons analyser refait par des images percutantes une attitude immémoriale de quiconque assistant
au lever du soleil s’identifie par ses gestes au créateur universel qui transmue la nuit en jour,
l’ombre en lumière, le silence en bruits frais et humides, l’immobilité en mouvance. L‘exubérance
juvénile du poète-enfant, son élan presque érotique d’embrasser la nature, les mains levées, comme
dans une cérémonie du sacre invoquant les pouvoirs divins et qui rappellent les pratiques
immémoriales des chefs de tribus aztèques, renvoient aux rituels apolliniens, aux extases mystiques
du Moyen Age ou aux schèmes de l’ascension de la religion chrétienne, repérables aussi dans la
mythologie indienne.
J’ai embrassé l’aube d’été.
Rien ne bougeait encore au front des palais. L’eau était morte. Les campes d’ombres ne
quittaient pas la route du bois. J’ai marché, réveillant les haleines, vives et tièdes, et les pierreries
regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit.
La première entreprise fut, dans le sentier déjà rempli de frais et blêmes éclats, une fleur
qui dit son nom.
Je ris au wasserfall blond qui s’échevela à travers les sapins : à la cime argentée je
reconnus la déesse.
Alors, je levai un à un les voiles. Dans l’allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l’ai
dénoncée au coq. A la grand’ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un
mendiant sur les quais de marbre, je la chassais.
A un premier regard, on identifie les hypostases mythiques que l’attitude du poète revêt,
gouvernées par les thèmes de la solarité, du retour, de la nomination, du dévoilement et du réveil
subsumés au grand mythe de la quête de l’absolu par la remontée à l’origine qui assure ainsi le
passage d’un statut profane à un statut sacré. Des séquences telles : front, ailes, cime, levai,
clochers, dômes, créent une suite connotative portant sur le schéma ascensionnel qui constitue le
centre d’intérêt de tout rituel consacrant la régénération de la nature, dont on a déjà mentionné
l’importance. Force nous est d’attirer l’attention sur l’épaisseur des symboles qui se renvoient l’un
l’autre des suggestions sémantiques censées dissoudre toute linéarité de signification en une
pluralité significative.
Il nous faut par la suite, repérer et relever la convergence isomorphe de certains symboles
porteurs d’une même charge sémantique, responsable de l’unité « mythématique » du poème.
L’heure indicible, première du matin
1
inaugure la naissance du jour, le moment où la
lumière reconquiert les territoires rendus amorphes par l’obscurité. Le renouveau du monde se
rattache donc à l’ascension de la lumière. Elle joue dans toutes les mythologies du monde un rôle
essentiel, d’autant plus que la Parole divine, le Logos, est associée à la lumière. Donnons la parole à
Gilbert Durant qui précise : Dans les cinq premiers versets de l’Evangile platonicien de Saint Jean,
la parole est explicitement associée à la lumière « qui luit dans les ténèbres », mais l’isomorphisme
de la lumière et de la parole est bien plus primitif et universel que le platonisme johannique.
Constamment les textes upanishadiques associent la lumière, quelquefois le feu, et la parole, et
dans les légendes égyptiennes, comme chez les anciens Juifs, la parole préside à la création du
monde. Les premières paroles d’Atoum comme de Yaveh sont un « fiat lux ». Jung montre que
l’étymologie indo-européenne de « ce qui luit » est la même que celle du terme signifiant « parler »,
cette similitude se retrouvant en égyptien. »
2
Il n’est pas dépourvu d’importance à signaler l’analogie entre le titre du poème et celui de
tout le recueil, « Les Illuminations ». Cette profonde relation sémantique entre l’aube comme
1
cf. « Lettre à E.Delahaye », juin, 1872
2
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, 1992, p.173

(r)éveil du jour et illumination désigne dans la mystique orientale l’éveil spirituel. Il s’ensuit que
l’isomorphisme de la lumière et de l’éveil/élévation va donner le chiffre manifeste de la
transcendance.
Dans la relation isomorphe signalée un peu plus haut, on remarque que le vecteur commun
est l’esprit ascensionnel identifiable à la progression du jour. Le symbolisme du front, par exemple,
renvoie à toute une psychologie archétypale par laquelle la tête/ le chef aboutit à la valorisation du
ciel et des sommets. …un grand poète civilisé pour qui l’image du front, symbole de l’élévation
orgueilleuse, de l’individuation par-delà le troupeau des frères et en face de la personne divine
elle-même, est si fréquente que l’on a pu parler à son sujet d’un véritable « complexe du front ».
3
Le poète reconnaît la déesse, métaphore légèrement érotisée de l’aube, mais aussi du
transcendant, de l’intangible, de la perfection, à la « cime argentée » des sapins – l’arbre impérial
dont le sommet atteint les cieux. Le soleil levant dans son ascension céleste commence par éclairer
les sommets de montagnes, le front des palais, les cimes des arbres, Il va de soi que le regard du
poète – qui embrasse l’aube d’été dans une effusion érotique - suit la même évolution immémoriale
du soleil dans le ciel. Ses yeux, des luminaires, qui s’identifient donc à la lumière solaire font
(re)naître successivement tous les éléments d’une nature dépersonnalisée par l’obscurité. Ils
animent les pierreries qui commencent à voir. L’œil, symbole et attribut divin, se retrouve au centre
des schémas de l’ascension et des structures transcendantes. La mythologie – fait remarquer
G.Durand – confirme également l’isomorphisme de l’œil, de la vision et de la transcendance
divine.
4
Il n’est pas hasardé de relever le sémantisme qui valorise la parenté entre œil/regard –
main/index en évoquant ainsi la double relation rattachant nominateur au nominé, créateur à la
chose créée.
On n’est pas loin du syncrétisme fondamental où œil – parole – lumière figurent le geste
primordial de la création par la rythmique ascensionnelle.
J’ai marché, réveillant les haleines, vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes
se levèrent sans bruit.
Cet isomorphisme ouvre un deuxième niveau dans le rituel de la création – la nomination.
La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui
me dit son nom.
En désignant les choses par le geste nominateur c’est les investir de la vie, c’est les
rattacher à une existence consciente.
Le troisième volet du mythe de la quête de l’absolu s’ouvre sur le geste des mains levées.
Les quelques verbes-noyaux qui sous-tendent le réseau mythique inaugurent chacun les étapes de la
création : embrasser, marcher, désigner, rire, lever/agiter les bras, suivant explicitement une ligne
qui dissout l’horizontalité de l’intention dans la verticalité de l’acte créateur. Par contre, la création
rituelle des gestes fondateurs qui identifiait poète et lever du jour/l’aube est remplacée à la fin par
une brutale séparation qui aboutit au drame de l’altérité/impuissance, assumé consciemment: l’idéal
de perfection reste intangible. Cette chute dramatique vers la fin est évoquée par la retour à
l’horizontalité, métaphorisé à l’aide des séquences telles courir comme un mendiant, quais de
marbre qui annoncent le décalage entre les deux plans, irréel/ subjectif soutenu par le verbe fuir,
verbe de l’évanescence, nominateur de l’intangibilité et le plan réel/concret. Le caractère fuyant,
intangible est cerné aussi par l’image de la chute d’eau, le wasserfall. L’appel à un terme allemand
rend encore plus prégnante la suggestion de chimérique, d’illusoire. Ici, on a affaire, comme dans
toute écriture poétique, d’ailleurs, à un « polarisant » sémantique qui enrichit par la superposition
des sens la portée du poème. La séquence wasserfall engendre une suite isotopique gouvernée par
le symbolisme de l’eau qui ajoute des connotations nouvelles au schéma sémantique initial. La
densité sémantique de ce mythème qui est repérable dans la limpidité de l’eau lustrale renvoie à
3
Op.cit., p.158
4
Idem, Ibid ,p.171

« l’eau vive », à « l’eau céleste » et se retrouve dans les « Upanishads » que dans la Bible ou dans
les traditions celtiques ou romaines
5
; la fraîcheur et la féminité idéalisée (frais et blêmes éclats)
porte sur le schéma de la plongée et de retournement des valeurs, de la mère et de la bien-aimée.
6
G.Bachelard a souligné à plusieurs reprises l’analogie entre l’eau et la pureté, l’eau étant,
selon lui, la matière, par excellence, (…) qui donne des sens précis à une psychologie prolixe de la
purification.
7
Elle renvoie, par ailleurs, à tous les rituels de purification, d’ablution, qui précédaient
les grands événements, marquant l’existence des communautés humaines. Il va de soi que l’une des
connotations les plus fréquentes est la rénovation, la re-naissance : On plonge dans l’eau pour
renaître rénové.
8
Ces considérations s’ouvrent sur l’isotopie du renouveau, de la renaissance qui est un éveil
spirituel et qui enrégimente sous le même signe, la lumière, l’eau et même le feu supposé être
engendré par le soleil. Il n’est pas dépourvu d’importance de signaler que c’est la lumière celle qui
fait surgir les propriétés bénéfiques de l’eau.
9
Ces éléments apparemment dispersés dans le tissu symbolique que propose l’écriture
poétique sont sémantiquement rattachés à l’idée centrale du poème qui entraîne dans un
mouvement centripète toutes les possibilités combinatoires des métaphores en action.
La multiplication synergique des effets visuels et auditifs crée l’image de l’aube qui par sa
féminité même justifie le geste d’amour du poète, mais qui s’avère être de par son ambiguïté,
inaccompli.
Le verbe qui clôt le poème, chasser doit être compris et interprété par le biais des deux sens
que le dictionnaire mentionne : poursuivre et courir après comme dans une chasse à l’amour. Mais,
à part une certaine connotation érotique dont parle aussi G.Durand
10
, la chasse revêt un aspect
métaphysique (Pascal) qui n’est pas loin de l’idée de prouesse, d’exploit qui rendait une certaine
grandeur au chevalier courtois.
A la grand’ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant
sur les quais de marbre, je la chassais.
Entre le verbe chasser et courir s’établit une réversibilité sémantique amplifiée par l’aspect
itératif qui s’insinue à la faveur des contaminations fortuites à l’intérieur de l’espace poétique et qui
confère au verbe courir une nuance légèrement inchoative par cette suggestion même de poursuite
recommencée et indéfiniment répétée.
L’imparfait des verbes qui porte en subsidiaire la marque du non-accompli, d’action
« poursuivie » ne fait que réverbérer cette signification majeure. Puisque tout rituel n’est que la
répétition des actes primordiaux, fondateurs. « L’entreprise » à laquelle le poète s’adonne, car
c’est, en effet, un acte conscient qui se consomme sur deux plans à la fois, de la réalité tangible,
immédiate et d’une réalité surhumaine, mais qui plonge ses racines dans l’imaginaire collectif,
retrace le mouvement principal du poème, rythmé par la verticale solaire de la création.
Dans ce texte littéraire, le poète remplit une double hypostase. D’un côté, il joue le rôle de
l’artiste-créateur, de l’autre, il s’identifie à l’individu archétypal, en parcourant les mêmes étapes
qui échelonnent l’itinéraire initiatique : écart-ravissement-renaissance - hypostases qui lui
permettent à la fois de se situer dans une position transcendant sa condition et de revivre dans un
horizon inaltéré des événements autrement invivables.
Il n’existe pas des textes littéraires, ou, en effet, très peu, qui ne situent pas leur fiction dans
une perspective mythique, qu’il s’agisse des mythes anciens ou modernes. Au fait, le mythe
renferme l’idée de création par la répétition ce qui a fait G.Durand affirmer que le mythe est le plus
5
cf. Mircea Eliade, Traité d’Histoire des religions, Payot, 1949, p.172
6
G.Durand, op.cit
7
Idem
8
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, José Corti, 1989, p.181
9
Idem
10
G.Durand, op.cit., p.160

proche de la musique.
11
Il s’ensuit que les structures mythiques potentialisent encore plus la
musique souterraine qui ranime un texte poétique par la magie « évocatoire » qu’elles « insufflent »
aux vocables.
L’Aube est loin d’être le seul poème de Rimbaud qui se prête à une lecture « mythique »,
mais c’est un texte exemplaire susceptible de valoriser l’idée que Rimbaud est le premier poète qui
ait réussi à faire le verbe retrouver sa solitude, sa force magique, son sens dans l’acception
médiévale du terme.
12
Cette joie primesautière, cette façon non maquillée de ressentir l’éveil de la
nature et surtout de le transcrire telle quelle amènent le lecteur à trouver d’autres clés d’aborder la
poésie rimbaldienne. Etre à l’écoute d’une œuvre d’art c’est toujours opérer plus ou moins
profondément, selon la disposition et le degré d’accueil où l’on se retrouve, affranchi de toute
détermination spatiale ou temporelle, le passage par lequel on accède à la communication avec
l’autre du texte ou avec un autrui anonyme et universel bien qu’absent.
BIBLIOGRAPHIE :
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, José Corti, 1989, p.181
Jean Cocteau, Les trois fuites de Rimbaud, Gloires de la France, Librairie académique, Perrin, 1964
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, 1992, p.173
Mircea Eliade, Traité d’Histoire des religions, Payot, 1949, p.172
11
Idem, ibidem, p.413
12
Jean Cocteau, Les trois fuites de Rimbaud, Gloires de la France, Librairie académique, Perrin, 1964
1
/
5
100%