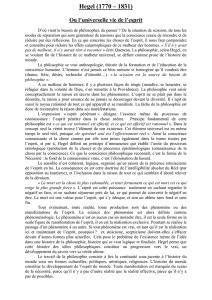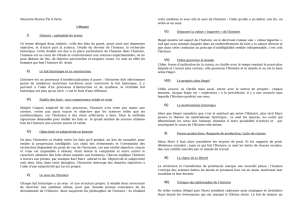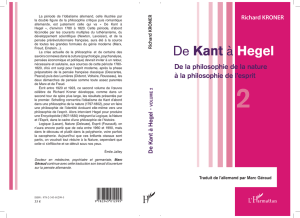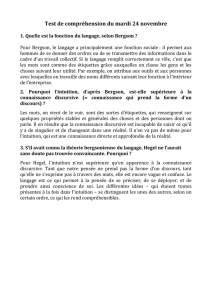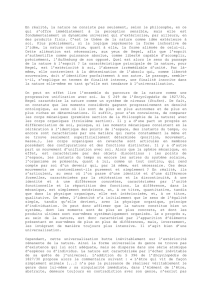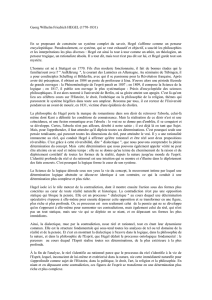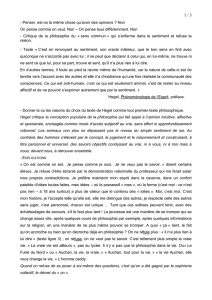Hegel et l`Etat

1
Aldric Massot - Groupe 2
Eric Weil, Hegel et l’Etat (cinq conférences suivies de Marx et la Philosophie du Droit),
Paris, Vrin, 1994.
La philosophie comme oiseau de Minerve ou l’aporie
d’une critique ‘circonstanciée’ de Hegel
Les Principes de la philosophie du droit sont l’œuvre la plus connue, et réputée la plus
lisible de Hegel. Pour autant, le seul consensus qui se dégage de l’histoire de sa réception est
frappé du sceau de la critique, souvent passionnée, mais qui n’arrive qu’à renforcer la portée
philosophique de l’oeuvre, irréductible à toute vulgarisation ou simplification. Pour éviter
d’analyser en profondeur le système de pensée hégélien, la polémique prend corps à partir de
formules souvent absconses car isolées de leur contexte, telles que : « ce qui est rationnel,
c’est ce qui est réel ; ce qui est réel, c’est ce qui est rationnel », ou « la philosophie est son
temps conçu dans la pensée », ou encore « [la tâche de la philosophie est de] reconnaître la
raison comme la rose dans la croix de l’expérience présente ».
Ces trois maximes issues de la Préface semblent pourtant pointer, voire provoquer une
tension entre le temps présent (c’est-à-dire pour Hegel la Prusse réformée en profondeur après
la défaite d’Iéna), et la réflexion philosophique, ou plutôt théorétique. La tentation de ne voir
dans l’ouvrage qu’une leçon de totalitarisme étatique est forte, de Marx, qui
s’emporte : « Hegel va presque jusqu’à la servilité. On le voit totalement contaminé par la
misérable arrogance du fonctionnaire prussien, [et] son étroit esprit bureaucratique »
1
, à Karl
Popper, qui déplore la perversion des consciences individuelles par l’autorité arbitraire du
pouvoir politique.
Dès lors, le projet d’Eric Weil, digne héritier de Rudolph Haym qui recense les
critiques adressées à Hegel dans son livre de 1857 Hegel et son temps, est non pas d’expliquer
le texte ou d’établir une contre-critique (ce qui n’aurait pour effet que d’entretenir la
polémique), mais plutôt de replacer la philosophie hégélienne de l’Etat dans la perspective
scientifique qui est la sienne, c’est-à-dire de rendre hommage au texte, qui se suffit à lui-
même. De même que l’on ne saurait reprocher à Einstein ‘l’invention’ de la bombe atomique,
on ne peut accuser Hegel de légitimer à travers la Prusse du début du XIXème siècle les
1
Marx, Œuvres philosophiques, traduction Molitor, tome IV, p.254

2
visées de Guillaume II, voire celles d’Hitler. Au contraire, il faut tenter de dégager le ‘corps
glorieux’ de leurs découvertes, en montrant que les critiques même n’amènent qu’à entrevoir
une richesse et une efficience toujours plus grandes.
Pour ce faire, il est intéressant d’analyser, en replaçant Hegel dans son temps, les
critiques adressées à sa théorie de l’Etat, comme autant de contresens qui permettent
d’aborder plusieurs aspects de « l’idéalisme historique », qui servent eux-mêmes de
fondements pour comprendre en quoi Hegel est le philosophe de l’Etat moderne.
L’image d’Epinal qui est associée à Hegel est celle d’un homme pour qui « l’Etat est
tout, et l’individu rien ». Il est en effet fasciné par la « belle totalité grecque », qui réunit les
consciences individuelles au sein d’une même organisation, mais aussi par Fichte, qui assigne
à la Prusse une mission salvatrice. Des esprits malins, tels que ceux des libéraux, ont voulu
percevoir ici les germes du totalitarisme et du nationalisme conquérant. Et pourtant, dès 1830,
Hegel est peu apprécié du gouvernement prussien et des conservateurs, et en 1870, c’est Marx
et Engels qui s’attachent à défendre sa mémoire : Hegel serait-il irréductible aux contingences
politiques et passionnées du XIXème siècle ?
Lui-même n’est cependant pas exempt de prise de parti, et il est d’ailleurs pertinent de
remarquer que sa pensée évolue au cours de ses différentes affectations, de Tübingen à Iéna
puis Berlin, comme si se rapprocher du centre de la Prusse lui permettait d’atteindre le centre
de sa pensée. Une autre image bien connue le montre saluant de sa fenêtre « l’Esprit du
monde » sur son cheval à Iéna, sous les traits de Napoléon. Il considère en effet la Prusse en
voie de réforme comme un modèle de liberté, tandis qu’il constate l’échec de la Révolution
française. C’est ainsi qu’il se conforme à l’esprit de son temps.
Néanmoins, il ne semble pas s’y conformer par pur conservatisme, mais plutôt par
‘conviction’ philosophique, si tant est que l’on puisse parler de conviction en ce domaine :
Hegel n’est pas le philosophe de la Prusse (au sens où il légitimerait cet Etat en tirant tout
simplement sa théorie de ce qui existe déjà), mais la Prusse est une étape historique du
développement philosophique : en ce sens on peut comprendre ce qu’est l’idéalisme
historique.
La seconde série de critiques s’adresse non plus à l’homme dans son temps, mais à ses
thèses. Cela permet d’exposer plus en profondeur ce qu’entend Hegel par Etat. Ses détracteurs
insistent sur ce qu’Eric Weil nomme les « horreurs » des Principes de la philosophie du

3
droit : la société subordonnée à l’Etat, la monarchie comme constitution parfaite, le devoir
suprême du citoyen qui est la loyauté envers l’Etat… Or, il ne faut pas oublier que « quand on
parle de l’idée d’Etat, il ne faut pas se représenter des Etats particuliers (…); il faut regarder
l’idée, ce Dieu réel (…) ». Une critique valide des Etats ne saurait donc être établie avant de
se demander ce qu’est l’Etat. Il s’agit pour Hegel d’établir une théorie de l’Etat non pas idéal
ou rêvé, mais tel qu’il est (non pas tel qu’il existe, mais la manière dont il est informé par
l’Idée, c’est-à-dire la raison). Ce sont les fondements ontologiques de la politique qui sont
recherchés, hors du bruit et de la fureur des passions, car cette quête philosophique permet de
ne pas tomber dans un fatum désespérant, constitué par une succession d’évènements dénués
de tout sens et justifiant toute violence.
Dans cette optique, la politique est la science de la volonté raisonnable qui produit une
liberté efficace, c’est-à-dire une réalisation historique de la liberté. Dès lors, Idée, raison et
liberté sont synonymes, cette dernière n’étant pas, comme on le trouve par exemple dans la
Déclaration des droits de l’homme de 1789, la liberté de l’individu égoïste, mais celle de
l’homme qui veut la liberté de l’homme dans une communauté libre. Soit, pour reprendre la
terminologie hégélienne, « la volonté libre qui veut la volonté libre », au sein de l’Etat. A ce
point, on peut rappeler l’accusation de « totalitarisme étatique » : dire cela, c’est oublier que
ce vers quoi tend l’Etat, c’est la liberté accomplie de l’homme. D’où la fascination pour la cité
grecque, dont Hegel remplace l’harmonie naturelle par le rationnel, ou « l’idée morale ».
Ainsi, la famille, la société puis l’Etat sont les formes concrètes de la vie morale
progressivement élaborée, non pas chronologiquement, mais logiquement, puisque le principe
rationnel de l’Etat informe déjà le plus petit groupement humain. C’est ainsi que l’idée d’Etat
est non pas une abstraction, mais la forme la plus concrète de la liberté, « dans laquelle tout
être raisonnable peut reconnaître sa volonté propre raisonnable ». A l’inverse de la « volonté
générale » de Rousseau (qui n’explique pas comment l’on passe de la sphère individuelle à la
sphère publique, d’où une dichotomie entre l’homme et le citoyen), selon Hegel l’Etat n’est
pas une organisation qui limite ou enferme, mais une transcendance des intérêts individuels,
satisfaits.
Il est alors possible de se demander pourquoi Hegel voit dans la Prusse des années
1815-1820 le ‘modèle’ de l’Etat de liberté. Pour lui, l’Etat, est une monarchie
constitutionnelle, athée (car l’Etat réalise rationnellement ce qui constitue le contenu de la
religion sous forme de sentiment), absolument souverain à l’intérieur comme à l’extérieur, et
où le corps des fonctionnaires joue un grand rôle. Ce qui choque ici et prête à la critique est le
principe monarchique. Mais si on l’envisage du point de vue de l’Etat tel que posé supra, le

4
Prince n’est qu’un fiat, une « pointe de la décision formelle » : celui-ci n’a aucune latitude
puisqu’il incarne la souveraineté ; il ne peut agir qu’en vue de ce que l’Etat comprend comme
étant son intérêt. Le prince se contente de dire « oui » ou « non », mais il ne gouverne pas.
Or, et c’est ici que vient se loger une autre critique, ce n’est pas non plus la
souveraineté populaire qui fonde l’Etat, car « le peuple, pris sans son Prince et sans
l’organisation du tout qui s’y rattache nécessairement et immédiatement, est la masse informe
qui n’est plus un Etat (…) ». En effet, le peuple ne sait pas ce qu’il veut en tant que volonté
raisonnable (dès lors Hegel s’oppose au pangermanisme où le peuple se donne un Etat, et à
toute forme de nationalisme ethnique). Le rôle essentiel revient aux fonctionnaires qui, ne
jouant aucun rôle dans la politique, sont tout dans l’organisation de l’Etat. Celui-ci ne
‘défend’ nullement la société, bien qu’il n’y ait pas d’Etat sans société ; mais l’Etat organise
la société sur le mode de la raison. A l’inverse de l’optique libérale, l’Etat n’est pas cette
instance qui garantit la sécurité et la propriété ; à l’inverse de l’optique nationaliste, il n’est
pas non plus l’expression d’un peuple ethniquement défini. Il est un « Dieu vivant », qui se
rénove perpétuellement.
Sachant cela, comment affirmer que Hegel est le philosophe de la Prusse ? Si l’Etat
parfait était advenu, il n’y aurait plus d’histoire, plus rien à faire : pour que soient
définitivement évacuées toutes les craintes concernant l’Etat totalitaire, policier, Moloch pour
ainsi dire (craintes peu fondées, on vient de le voir), il faut en dernier lieu montrer de quelle
manière l’Etat vit historiquement.
L’histoire selon Hegel est celle de la marche de l’Esprit (ou de la raison) qui se réalise
dans le monde. Donc, à un moment donné, « un peuple donné réalise de façon naturelle ou
inconsciente la forme la plus parfaite du moment, celle qui représente la pointe du progrès et
de la liberté ». C’est le cas de la Prusse en 1820, qui est la forme parfaite de l’Etat moderne,
mais qui par le fait même qu’elle puisse ainsi être analysée, est déjà en voie de dépassement,
en passe d’avoir vécu « ce que vivent les roses, l’espace d’un matin… ». La justification
philosophique de la Prusse inscrite dans l’histoire universelle est par là même sa mort, car la
philosophie est « oiseau de Minerve, qui ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit ».
Par ce biais, on peut éclairer ce qui apparaît comme étant un conservatisme, un
quiétisme politique : Hegel sait que les évènements dont il ne saisit pas forcément la ‘logique’
participent du progrès de l’histoire universelle. Cela ne signifie pas qu’il faille adopter une
attitude résignée, bien au contraire : ce sont les passions, les intérêts individuels des « grands
hommes » tels Napoléon, qui permettent de réaliser inconsciemment la marche de l’Esprit :

5
ainsi se trouve transcendée la traditionnelle opposition entre passion et raison, puisque ce sont
les élans des subjectivités qui portent la raison vers sa substantialité.
De même, l’homme du quotidien, pensant travailler librement à son intérêt personnel,
travaille pour la « fortune universelle », organisée par l’Etat. Celui-ci doit intervenir dans la
sphère économique, car le prolétariat « est un mal aussi longtemps que l’Etat ne saura ou ne
pourra imposer une organisation rationnelle, en vue de la réalisation de la liberté, de la
reconnaissance de tous par tous ». On voit ici clairement la rupture avec Ricardo, et les
prémisses de Marx. Le progrès s’effectue concrètement par crises, puisque si l’Etat doit être
plus fort que la société, en fait il est plus faible qu’elle, d’où ce dépassement continuel de
l’Etat par lui-même, par son travail sur la société, dont le but ultime est la satisfaction de tous
dans et par l’Etat. L’avenir n’est alors pas l’Etat maître de l’homme (le spectre du
totalitarisme est effacé), mais l’homme qui sera homme se voulant homme, non malgré l’Etat
(l’optique libérale est dépassée), mais dans l’Etat, en vue de la liberté la plus absolue, où
l’individualité est aux dimensions de l’universel.
Eric Weil ajoute à ses cinq conférences un Appendice concernant Marx, dont il pointe
l’intime parenté avec Hegel, même si pour Marx la dialectique de l’Etat se réalise dans
l’histoire par l’action révolutionnaire d’une élite éclairée, qui assume le rôle du « grand
homme », et qu’il élabore en science, en technique les principes philosophiques de Hegel.
Si bien sûr on ne saurait accuser Hegel des avatars du communisme au XXème siècle
pour les mêmes raisons qui empêchent de le considérer comme le père du national-socialisme,
il semble pourtant, lorsque l’on revient au texte même des Principes de la philosophie du
droit, que les luttes entre Etats (les guerres) soient un ‘moteur’ fondamental de la réalisation
de l’Esprit. Si lorsqu’un Etat disparaît, il est sublimé car est ‘sauvé’ en lui ce qui est (et a
toujours été) rationnel, il n’en reste pas moins que cette mise à nu dialectique de son ‘corps
glorieux’ s’effectue au prix d’une grande violence.
Cette philosophie téléologique, où l’on perçoit clairement une foi dans le progrès
propre au XIXème siècle, est-elle encore compréhensible de nos jours, après les deux conflits
mondiaux ? Comment, dans « l’ère du soupçon », saisir les enjeux d’ une pensée systémique,
un idéalisme historique ?
La principale vertu de l’ouvrage d’Eric Weil est, loin de gloser sur l’ensemble de la
pensée de Hegel (car au-delà de l’Etat, il y a les arts, les activités spirituelles), d’avoir, comme
il l’indique lui-même, tenté d’éveiller la curiosité d’un lecteur sorti de son « sommeil
 6
6
1
/
6
100%

![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)