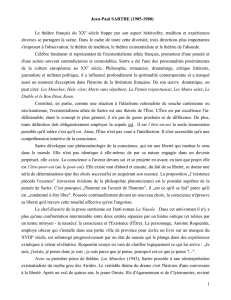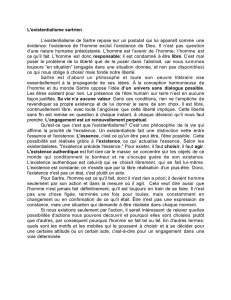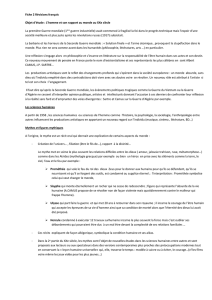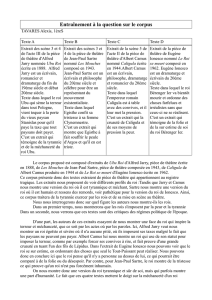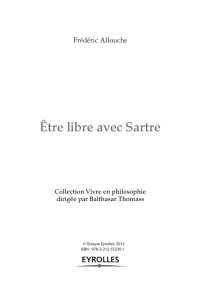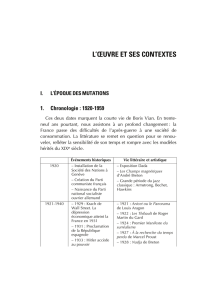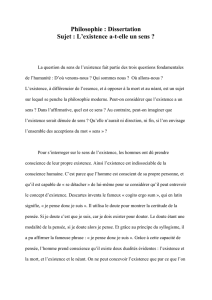II- Thèmes et concept philosophiques dans les pièces de Sartre et

6
II- Thèmes et concepts philosophiques dans les pièces de
Sartre et de Camus :
1-Présentation :
Le théâtre de Sartre apparaît comme la partie de son oeuvre la plus facile d'accès. On y
retrouve la quasi totalité des thèmes relatifs à sa pensée.
Quant à la passion de la quête théâtrale qui anime Camus, elle prend ses assises dans la
double réflexion éthique et esthétique particulière à sa pensée.
Je tenterai d’en définir les contours à travers une étude de quelques une de leurs pièces.
Sartre n'est pas venu au théâtre sous l'effet d'une passion de la scène ou d'une vocation
impérieuse, mais pour toucher de la manière la plus directe et la plus efficace un large public,
comme l'exigeaient les impératifs de la littérature engagée.
Acteur ou directeur de troupe dans les années 1936-1938, metteur en scène ou adaptateur
scrupuleux des pièces les plus diverses, dramaturge original enfin, avec Caligula, Le
Malentendu, L’Etat de Siège, et Les Justes, Camus a eu avec le théâtre tous les rapports
possibles, du plus concret au plus intellectuel. Le théâtre lui est apparu comme une forme
d'expression privilégiée, à plus d'un titre: il est « un art de chair, qui donne à des corps
vibrants le soin de traduire ses leçons », disait déjà le Manifeste du Théâtre de l'Équipe en
1937.
Les quelque dix pièces que Sartre a écrites de 1943 à 1965 ont connu à vrai dire des fortunes
diverses: les plus appréciées du public ont souvent été les moins ambitieuses, celles que
l'auteur avait conçues et rédigées dans la hâte, comme Huis Clos (1944) ou La Putain
respectueuse (1946). Deux seuls échecs véritables, tous deux liés à des œuvres dont
l'engagement politique était assez agressif: Morts sans sépulture (1946) et Nekrassov (1955).
Mais aussi, pour ses trois tentatives les plus hardies et les plus complexes, un accueil souvent
mitigé: Les Mains sales, Le Diable et le Bon Dieu, Les Séquestrés d'Altona, desservis en
général par des mises en scène timides, ont à la fois passionné et écrasé les spectateurs. Il n'en
demeure pas moins que l'auteur dramatique, fidèle à l'esprit de sa première tentative, a
toujours voulu « réaliser l'unité de tous les spectateurs ». C'est ce qui explique que ses pièces,
loin de rompre avec les lois du genre, s'y conforment avec beaucoup d'entrain.
Le théâtre de Camus a été diversement jugé, et assez durement dans l'ensemble. Un style qui,
peut-être, était un peu trop élevé, des personnages et des situations plus délibérément
symboliques que ceux des récits ont pu contribuer à dérouter le spectateur et la critique.
L'originalité de ce théâtre, qui n'est pourtant pas douteuse, tient en fait beaucoup moins aux
formes qu'aux thèmes, et à la permanence d'un même projet: le drame sartrien évoque des «
libertés qui se choisissent dans des situations », et plus précisément « le moment qui engage
une morale et toute une vie ». Après Les Mouches qui montrent une conscience se découvrant
elle-même dans la révolte, l'engagement et la violence, après Huis Clos qui évoque le
problème des relations avec autrui, et de l'impossibilité d'y échapper, Les Mains sales (1948)
mêlent le problème moral de la fin et des moyens au problème historique du communisme
soviétique.

7
Commençons par Les Mouches, de Sartre, première chronologiquement puisqu’elle date de
1943.
2-Les Mouches :
Seule oeuvre qualifiée de drame par Sartre, la pièce Les mouches fut créée le 3 juin 1943 et
fut mise en scène au théâtre de la Cité par Charles Dublin.
Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre revient dans Argos, sa ville natale d'où il a été
chassé âgé dès son plus jeune âge, ses parents ayant été assassinés par Egisthe, l’amant de
Clytemnestre. Il a voyagé et a appris que l’opinion est subjective et n'est pas vérité, d'où sa
"liberté d'esprit". En revenant dans sa ville, il s'aperçoit cependant que cette liberté ne lui a
justement pas permis de se constituer en tant qu'identité. Ses paroles attestent de ce que rien
ne lui appartient: "Je suis libre, Dieu merci. Ah! Comme je suis libre .Et quelle superbe
absence que mon âme ! Je vais de ville en ville, étranger aux autres et à moi-même !"
Tout ce qui relève de la cité qui devrait être sienne lui est inconnu puisqu'il n'y a pas vécu, il
conçoit alors le désir de se donner ce droit de cité :"Si je pouvais m'emparer, fut-ce par un
crime, de leurs mémoires, de leur terreur et de leurs espérances pour combler le vide de mon
coeur, dussé-je tuer ma propre mère…" Ces dernières paroles sont prononcées sans réelle
intention de les réaliser, ce qui va toutefois arriver par l’intervention d'Electre sa soeur. Celle-
ci, restée à Argos, a vécu dans la rancoeur et le désir de la vengeance. Elle a ainsi subi les
mouches, symbole du remords envoyé par les dieux aux habitants de la ville ; ainsi tous ont
payé pour le crime d'Egisthe et de sa complice Clytemnestre.
Cette implication du texte rappelle que la pièce les Mouches fut jouée pour la première fois
sous l’occupation allemande, le gouvernement de Vichy ayant mis en place une politique de
culpabilisation. Dès qu'il prend connaissance du rêve de sa soeur, il ne veut plus que le
réaliser. Egisthe ne cherchera d'ailleurs pas à se défendre puisque comme il le dit lui même:
"Qui suis-je, sinon la peur que les autres ont de moi? "Jupiter ne se satisfait pas de ce crime,
qui contrairement à celui d'Egisthe sera celui d'un homme libre: "Qu'ai-je à faire d'un crime
sans remords, d'un meurtre insolent…Je hais les crimes de la génération nouvelle: ils sont
ingrats et stériles comme de l'ivraie". Si Egisthe a fait peser la culpabilité, qui relève de la
mauvaise foi puisqu'il nie ses responsabilités, si Egishte donc fait peser la culpabilité de son
crime sur tout Argos, Oreste est le seul à assumer la responsabilité du sien et, comme il ne
s'en repent pas, les dieux n'ont pas d'emprise sur lui. Sa soeur, au contraire, à la suite de l'acte
qu'elle n'avait fait que souhaiter ("j'ai rêvé ce crime") choisit sa culpabilité. Comme le dit
Jupiter," Mais tu n'as jamais songé à les réaliser…Tu n'as pas voulu le mal: tu n’as voulu que
ton propre malheur…Tu as joué au meurtre".
Electre reste donc soumise aux dieux, elle ne prend pas conscience de sa liberté, il en est
tout autrement de son frère: il se dit "libre", cette "liberté" a fondu sur lui « comme la
foudre »… « Par delà l'angoisse et les souvenirs. Libre. Et d'accord avec moi », s'il ne l'est, en
effet pas avec sa sœur,"Je ne suis pas coupable, et tu ne saurais me faire expier ce que je ne
reconnais pas pour un crime" dit-il à Jupiter dans la scène trois de l'acte trois. Bien qu'il ait
essayé de convaincre Electre de ne pas "se haïr", "ses souffrances viennent d'elle, c'est elle
seule qui peut s'en délivrer: elle est libre".
Condamné à être libre, Oreste "ne peut suivre que son chemin et chaque homme doit inventer
son chemin." Pour Sartre chaque homme détermine la valeur de ses actes car Dieu n'existe
pas.
Dans "Qu’est-ce que la littérature?" (Situations II), Sartre explique "Les héros sont des
libertés prises au piège comme nous tous. Quelles sont les issues? Chaque personnage ne sera
que le choix d'une issue et ne vaudra pas plus que l'issue choisie. En un sens, chaque situation

8
est une souricière, des murs partout: je m’exprime mal, il n'y a pas d'issue à choisir. Une
issue, ça s'invente. Et chacun, en inventant sa propre issue, s'invente soi-même. L'homme est à
inventer chaque jour". Ce qui fait qu' Oreste n'est pas seulement En-Soi, c'est cette liberté qui
est le pouvoir que détient la conscience de se soustraire aux déterminations naturelles. Par
elle, il se fait Pour-soi dont "la loi d'être, comme fondement ontologique de la conscience,
c'est d'être lui-même sous la forme de présence à soi, (L' Etre et le Néant, partie II).
Si l'on en revient au choix d'Oreste, qui après avoir délivré la ville de son tyran, la quitte
cependant, c'est que sa liberté n'a de sens que pour lui puisqu'elle ne concerne que lui. Il ne
veut pas dépendre des autres: "je veux être un roi sans terre et sans sujets".
Il apparaît donc que ce qu’il enviait, n'était pas la situation des gens d'Argos mais
simplement la personnalité singulière qu'elle leur confère. Il veut SA situation propre par SES
propres actes. Il se fait exister par un acte, censé les libérer tous, mais qui le libère seul. Les
gens d’Argos, saisissent son acte mais Oreste est le seul à savoir qu'il est libre puisque ses
critères n'engagent que lui d'où ses paroles: vous ne pouvez ni me châtier, ni me plaindre, et
c'est pourquoi je vous fais peur !"
En quittant Argos, Oreste affirme encore sa liberté "Pour-soi", et considère comme
inessentielle son existence "pour- autrui": il est seul.
Selon Sartre lui-même "la liberté n'est pas je ne sais quel pouvoir abstrait de survoler la
condition humaine: c'est l'engagement le plus absurde, le plus inexorable. Oreste parcourt son
chemin, injustifiable, sans excuses, seul, comme un héros."
D’abord portée sur l’être de l'en-soi mais prenant un certain recul par rapport à lui, la
conscience est alors rapport à l’être qu'elle n'est pas (pour-soi), ainsi elle se rend responsable,
comme celle d'Oreste. "Le pour-soi ne peut soutenir la néantisation sans se déterminer lui
même comme un défaut d'être. Cela signifie que la néantisation ne coïncide pas avec une
simple introduction du vide dans la conscience. (…), mais c'est le pour-soi qui se détermine
perpétuellement lui-même à n'être pas l'En-Soi." (L’ Etre et le Néant, « 'Etre- pour- soi »
chap.I).
3- Huis-Clos- Caligula- Le Malentendu :
La même année en 1944 sont représentées Huis-Clos de Sartre, Caligula, et Le Malentendu de
Camus.
Huis-Clos :
Cette pièce fut rédigée en seulement deux semaines en 1944; son succès fut immédiat.
Interdite par la censure en Angleterre, elle remporta cependant le prix de la meilleure pièce
étrangère aux Etats-Unis en 1947.Un ami de Sartre lui avait suggéré d'écrire "une pièce facile
à monter qu'on pût promener à travers la France". Il lui vient alors l'idée de monter un drame
très bref, constitué d'un seul décor et ne comportant que deux où trois personnages. Il pense à
une forme différente de Huis-clos de celle que nous connaissons : sa première intention était
de réunir des gens murés dans une cave pendant un long bombardement. Ce n'est qu'après cela
qu'il imagine des personnages réunis en enfer pour l'éternité.
On peut également retenir qu’il proposa à Albert Camus la mise en scène ainsi que le rôle de
Garcin, cependant ce dernier fut remplacé après la première tournée.
Les personnages de Huis-Clos montrent envie, détachement, inimitié, ils sont à la fois
bourreaux et victimes ; ce sont des êtres humains qui tout en étant morts éprouvent des

9
sentiments et parlent, à ce titre, ils continuent pour le spectateur et le lecteur d'être vivants.
Il convient d’interroger cette situation où Sartre situe l'action en enfer alors même qu’il est
athée.
Si l’on examine de plus près les caractères présentés dans Huis-Clos, on s'aperçoit qu'ils nient
leur liberté (ils sont donc de mauvaise foi) et sont soumis au jugement des autres libertés, c'est
ce qui précisément constitue cet enfer ; chacun est démuni devant les autres car n'osant
assumer ce qu'ils ont été durant leur vie pas plus que leur situation présente. Estelle se refuse
en effet à les qualifier de morts, préférant le terme d' "absents"." L’existence même de la mort
nous aliène dans notre vie au profit d'autrui" écrit Sartre. En effet en tant que sujet, autrui me
pose en objet et tend à m'enfermer dans une essence.
Contrairement aux choses, l'homme vit sans qu'une essence lui impose un modèle à suivre: "il
existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et se définit après", ainsi l'homme est
d'abord dans le monde où il se construit librement. Tout homme est en situation mais la
situation ne détermine pas la conduite. En effet, en projetant ses intentions sur la situation
c'est l'homme qui transforme celle-ci en motif d'action. Les personnages de Huis- Clos ont
choisi, à l'exception d'Estelle, de mourir à un moment donné, et ont fait souffrir ceux qui les
entouraient. Comme Inès le dit "Il y a des gens qui ont souffert pour nous et cela nous amusait
beaucoup". Contrairement à elle, en se demandant : "Où est la faute? Garcin montre sa
mauvaise- foi de même qu'Estelle lorsqu'elle dit « je me demande si ce n’est pas une erreur »
"tous deux sachant pertinemment leurs crimes n'avoueront leur culpabilité que par la suite.
Inès est la seule à ne pas nier sa responsabilité : elle prend conscience de ce qu'ils sont "entre
assassins" et s'adressant à Estelle "Nous sommes en enfer, ma petite, il n'y a jamais d'erreur et
on ne damne jamais les gens pour rien" et plus loin "le bourreau, c'est chacun de nous pour les
deux autres."
"L'enfer, c'est les autres" d' autant plus lorsque l’on ne peut plus contribuer au sens de sa
propre vie. En effet pour "le monde des vivants", l’existence du personnage ne se réduit plus
qu'à l'essence que chacun s'est constituée par ses actes au cours de sa vie. Ils sont livrés au
jugement des autres libertés : sur Terre les camarades de Garcin le traitent de lâche et c'est le
regard d’Inès qui désormais décidera: "Tu es un lâche, Garcin, un lâche parce que je le veux!
Et pourtant, vois comme je suis faible, un souffle; je ne suis rien que ce regard qui te voit, que
cette pensée incolore qui te pense. Allons, tu n’as pas le choix: il faut me convaincre. Je te
tiens."
Cette expression d'Inès rappelle des expressions de l'Etre et le Néant comme "ma chute
originelle, c'est l’existence de l'autre" ou "le conflit est le sens originel de l'être- pour-
autrui".L' enfer de Huis-Clos apparaît comme l'enfer de la vie avec autrui qui est indissociable
de l’existence dans le monde.
Pour dépasser cela, il faut se faire libre par son projet car la conscience d'être objet ne peut se
faire que dans et par l'existence d'autrui (le pour-soi dans la mauvaise- foi se pose en objet).
Les personnages dans Huis- Clos refusent d'affronter les conditions de leur existence par une
entreprise qui leur est propre, ils sont à la fois dans le monde et hors du monde, vivants et
morts même dans la vie, ils se réduisent à des objectités pour d'autres consciences qui les
caractérisent, les étiquettent en quelque sorte, alors qu'ils ne peuvent plus changer le sens de
leur vie en ajoutant ou en y refaisant certains actes.
Cet aspect est explicite dans ce passage de l'Etre et le Néant : "la vie morte ne cesse pas pour
cela de changer et, pourtant elle est faite. Cela signifie que pour elle les jeux sont faits et
qu'elle subira désormais ses changements sans en être aucunement responsable. Rien ne peut
plus lui arriver de l'intérieur, elle est entièrement close, on ne peut plus rien faire entrer mais
son sens ne cesse point d'être modifié du dehors. Etre mort, c'est être en proie aux vivants."
Ainsi, être mort, c'est être soumis à des interprétations d'autrui qui donne à la vie du mort un
sens qui n'est pas le sens, ce sens vient d'actes que l'on décide mais que l'on ne peut dénigrer.

10
Les paroles ne seraient que des justifications vaines par rapport au choix fait antérieurement.
Comme il est dit dans le chapitre I de la partie 4 de l'Etre et le Néant : "le choix de la
délibération est organisé avec les mobiles et les motifs que je choisis moi-même la décision
est prise elle n’a d'autre valeur que celle d'une annonciatrice".
Caligula :
Caligula, conçu dès 1938, publiée en 1944, et joué en 1945, et Le Malentendu, écrit à la fin de
la guerre mais dont L'Étranger annonçait déjà le sujet, illustrent à la scène les thèmes de
l'absurde.
Sans doute Caligula pourrait-il être un fragment détaché du Mythe de Sisyphe. La démence
de cet empereur relève de la logique de l'absurde: il ne peut admettre l'idée que les hommes
meurent et qu'ils ne sont pas heureux. Il veut se prouver qu'il est libre, et puisqu'il en a les
moyens, il va le prouver aux dépens des autres. Il prend « le visage bête et incompréhensible»
des Dieux et du Destin, comme s'il voulait provoquer les hommes et les appeler à la révolte.
Ce frère de Sisyphe finit par faire rouler sur eux son rocher, et s'exalte de son entreprise de
destruction, passant de l'absurde au nihilisme. Il meurt conscient de son échec: « Je n'ai pas
pris la voie qu'il fallait, je n'aboutis à rien. Ma liberté n'est pas la bonne. » La pièce, qui reste
très schématique, vaut par l'ascétisme rigoureux que l'auteur a recherché dans la construction
dramatique et l'écriture des dialogues.
À s'arrêter à la surface des choses, on peut s'étonner de trouver dans Caligula tant d'affinités
avec la tragédie traditionnelle. Dans celle-ci, en effet, le spectateur s'identifie immédiatement
avec le héros, se forge avec lui ou, si l'on préfère, par son intermédiaire, un destin, affronte la
mort. Or il est bien évident qu'un personnage comme Caligula, en soi, n'invite pas à
l'identification. L'empereur fou, cependant, tel que le présente Albert Camus, reste bien un
héros tragique - même au sens traditionnel- car s'il est criminel et s'il déchaîne l'injustice, il est
lui-même la première et l'ultime victime de sa démesure, de son hypertrophie passionnelle. La
passion dont il s'agit ici est celle de la lucidité.
Le Malentendu :
Le Malentendu qui, sous des allures de sombre mélodrame, va sans doute plus loin. Jan,
l'exilé qui revient auprès de sa mère et de sa sœur, devenues hôtelières, ne sait pas qu'elles ont
pris 1 'habitude de tuer leurs clients pour les dépouiller. Il ne se fait pas reconnaître et se
montre incapable même de se faire entendre d'elles sans ambiguïté. Un vieux serviteur,
apparemment muet et simulant la surdité, symbole, pour certain critiques, d'un Dieu
impassible et malveillant, se refuse à dire les quelques mots qui dénoueraient le drame, et ne
dévoile l'identité du voyageur qu'après le meurtre. « Pendant qu'il cherchait ses mots, on le
tuait. » Tel aura été le sort de Jan. « Tout le malheur des hommes, commente Camus, vient de
ce qu'ils ne prennent pas un langage simple. » Dès cette œuvre, on sent l'écrivain désireux de
passer d'une expression de la solitude à un langage de la communauté, des monologues
héroïques à la mise en œuvre d'un véritable dialogue entre les hommes.
Le Malentendu est bien une tragédie, écrite dans le prolongement immédiat de L'Étranger.
Martha appartient, comme Caligula, à la race de ces héros modernes, de ces iconoclastes qui,
dans un même mouvement, sollicitent l'adhésion, jusqu'à l'identification, du spectateur et la
rendent impossible parce que les excès, auxquels ils s'abandonnent, ne sont pas ceux que
provoque à la longue l'acharnement des dieux, ne sont pas l'aboutissement fatal d'une passion
exaspérée, mais, dès le départ, extériorisent seulement une insurmontable volonté de
destruction.
Il s'agit bien, ici, des rapports de l'homme et de l’absolu, de sa tentative apparemment vaine
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%