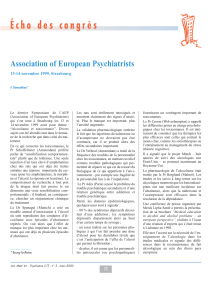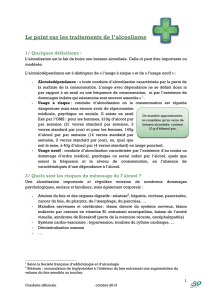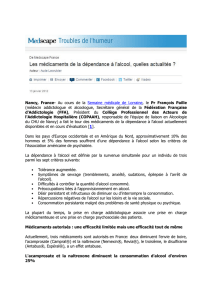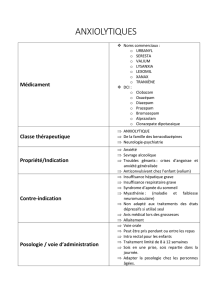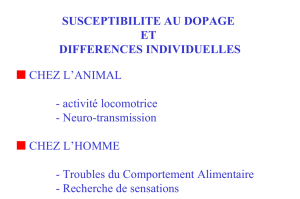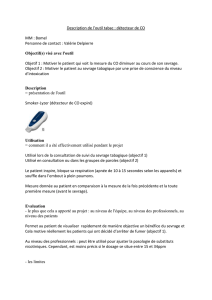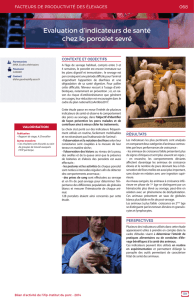Texte de présentation sur alcoolisme et Campral

Texte de présentation sur alcoolisme et Campral
Canada, septembre 2007
1. Neurobiologie de l’alcoolisme et action du Campral :
Les divers problèmes de santé liés à l’alcool représentent un souci majeur de santé
publique. Dans toutes les régions du monde, de 5 à 8 % de la population présente un
problème important de santé lié à la consommation problématique d’alcool. Le coût
pour la société est important, l’handicap pour les personnes est toujours lourd. Les
pathologies sont diverses, elles atteignent autant les fonctions physiques, dans la
plupart des systèmes (digestif, nerveux, osseux, hématologique, etc..), que la sphère
psychologique de l’individu avec des troubles tels que l’anxiété, la dépression, des
problèmes relationnels à autrui, et aussi, de graves difficultés sociales avec parfois
une déchéance profonde.
On distingue les états de consommation excessive. Ici le médecin prodiguera des
conseils au patient pour réduire sa consommation d’alcool et le patient en est
capable. Dans d’autres cas, il s’agit d’un état de dépendance envers l’alcool et des
perturbations psychologiques et biologiques en sont la cause. Le patient doit être
aidé par une cure de désintoxication, ensuite il doit bénéficier d’une aide
psychologique et si possible pharmacologique pour maintenir une abstinence envers
l’alcool. La dépendance est en effet, en grande partie, le résultat du troubles
neurobiologiques.
Les alcoologues étaient donc à la recherche d’un traitement pharmacologique qui
puisse corriger les troubles à la base de la dépendance physique envers l’alcool. En
fait, rappelons que toutes les grandes pathologies mentales, telles par exemple les
troubles psychotiques, la schizophrénie en particulier, les troubles de l’humeur telles
les dépressions majeures, ont vu leur traitement évoluer favorablement dès qu’on a
disposé des premiers médicaments actifs : neuroleptiques et antidépresseurs qui eux
ont permis aux interventions psychothérapeutiques et psychosociales d’être
appliquées tout en se dégageant de la pression neurobiologique induite par la
pathologie. Dans le cas de l’alcoolisme, jusque récemment, on n’avait la possibilité
d’utiliser que des médicaments intervenant sur les troubles associés à l’alcoolisme : si
le patient paraissait déprimé, on donnait des antidépresseurs en espérant qu’il
boirait moins ou qu’il arrêterait de boire ; lorsqu’il paraissait anxieux, on lui donnait
des anxiolytiques, etc… Avec les traitements aversifs utilisant du Disulfiram, il
s’agissait d’une tentative de déconditionner le patient de ce qu’on pensait être une
expérience positive, c’est à dire du plaisir ressenti sous l’effet de l’alcool. Ainsi, on a

2
tenté d’induire un conditionnement d’une expérience désagréable, lorsque le patient
prend de l’alcool avec du Disulfiram. Ceci est à la base des cures, dites de dégoût.
L’efficacité est évidemment très limitée car on ne touche évidemment pas le
mécanisme de base de la dépendance biologique et « l’homme est ainsi fait » qu’il se
conditionne facilement à des expériences agréables et non pas à des expériences
désagréables, sauf si l’on fait continuellement des cures de dégoût, ce qui est
évidemment difficile sur le plan éthique.
Avec les médicaments bloqueurs des récepteurs morphiniques, telle la Naltrexone.
L’objectif est d’intervenir sur les récepteurs opioïdes intervenant dans les
mécanismes de récompense, mécanismes communs à l’action de toutes les
substances addictives. Toutefois, ceci ne représente pas le mécanisme de base
fondamentalement impliqué dans l’alcoolisme avec dépendance.
Par contre, toutes les études, dont je vais faire un survol, indiquent clairement que
l‘acamprosate (homotaurinate de calcium) touche un des mécanismes de base
responsable de la dépendance à l’alcool.
L’histoire de l’Acamprosate ne manque pas d’intérêt. En 1977, je terminais mon
doctorat en psychiatrie (Ph. D .) en développant les méthodologies d’évaluation de
l’alcoolisme. J’ai été sollicité pour mettre ces méthodologies à disposition du
laboratoire pharmaceutique qui développait l’Acamprosate. Avec un autre chercheur
belge, le professeur Philippe DEWITTE, nous avons ainsi commencé, lui en
expérimentation animale, moi-même en essai clinique, les premières évaluations
après que le professeur LHUINTRE, en France, avait montré dans une étude ouverte
qu’un effet positif se révélait chez des patients alcooliques prenant de l’Acamprosate,
après la cure de sevrage. Devant des premiers résultats très encourageants, à la fois
en expérimentation animale et chez l’homme, j’ai eu l’occasion de créer un
groupement de recherche clinique européen en y associant une quinzaine de centres
de recherche universitaires dans 8 pays d’Europe occidentale ; ainsi se créait « La
Plinius Mayor Society » Avec les diverses équipes de recherche européennes, nous
tenions 3 à 4 réunions d’évaluation et de discussion scientifique par an et avons
collecté une banque de données fort importante avec la collaboration de cliniciens,
de chercheurs fondamentaux, de statisticiens, d’économistes, etc.. Entre 1996 et 1998,
le produit a été mis sur le marché en Europe, aux Etats Unis en 2004 et actuellement,
il apparaît ici au Canada (D2).
Nous avons ainsi pu au cours de ces 20 dernières années présenter des résultats
particulièrement intéressant et montrer par de multiples études de suivi, l’efficacité,
l’efficience et la sécurité d’emploi de l’Acamprosate. Nous avons aussi, grâce à cela,

3
énormément progressé dans les méthodologies des études cliniques, aussi en
recherche fondamentale et aussi en pharmaco-économie de l’alcoolisme.
Les méthodologies d’évaluation des traitements de l’alcoolisme ne sont pas simples.
L’évolution de cette maladie se fait par phase avec souvent des reprises d’alcool et
des rechutes. Dans des études cliniques, on peut homogénéiser une série de données
comme l’âge, le sexe, la durée de l’alcoolisation. D’autres facteurs, beaucoup moins
identifiables, interviennent aussi, tels sont par exemple le support apporté par
l’entourage, le degré d’impulsivité de la personne, l’importance de la décision intime
du patient pour arrêter de boire. Ceci implique des fonctions cognitives supérieures,
etc… Il faut donc le plus possible pouvoir mettre les patients évalués dans des
conditions naturelles de vie pour que l’on puisse suivre l’évolution de ces
caractéristiques particulières.
Abordons le mécanisme d’action de l’Acamprosate (D3).
D4 : L’Acamprosate est cliniquement un N-acétyl homo taurinate et est similaire à
celle des acides aminés et autres ligands qui font intervenir les récepteurs dits
NMDA et le glutamate.
D9 : Après une consommation aiguë d’alcool, alcool qui est essentiellement une
substance sédative du système nerveux central, il y a une potentialisation de l’effet
neuro-inhibiteur et de sédation via des transmetteurs telle que la taurine, et aussi le
système gaba. Après une consommation chronique, le système nerveux central
s’adapte par mécanisme d’homéostase à cet état de sédation en stimulant le système
antagoniste, excitateur, le système glutamatergique. Il y a de ce fait sécrétion accrue
de substances dites neuro-amines excitatrices. Dans un premier temps, ceci sert à
contrecarrer l’effet de sédation de l’alcool ; ensuite, cette excitation se fera aussi en
l’absence d’alcool, c’est à dire lorsque le patient diminue ou arrête de boire. Ceci se
marquera sur le plan clinique par des signes d’excitation accompagnant le syndrome
de sevrage (nervosité, tremblements, etc…). Le patient découvre rapidement que ces
signes de manque se stabilisent par une nouvelle consommation d’alcool et le cercle
vicieux s’installe.
D10 : De fait, lorsque l’on administre de l’Acamprosate, celui-ci, par son effet
glutamatergique, équilibre la sédation excessive apportée chroniquement par l’alcool
et le patient n’a plus le sentiment de devoir prendre de l‘alcool, le rééquilibrage se
faisant par le Campral. En quelque sorte, les amines neuro-excitatrices sont inhibées
dans leur sécrétion par le Campral. On comprend ainsi que le patient ne ressentant
plus d’effets de manque de type excitateur, il ne cherche pas nécessairement à
reprendre de l’alcool pour se sentir bien.

4
D17 : Un autre processus est à considérer. Toutes les substances pouvant donner lieu
à dépendance, comme l’alcool, ont en commun une sensibilisation du « Circuit
neuro-anatomique dit de la récompense » ; circuit sensible au mieux être, aux
sensations de plaisir. Ce circuit comprend en particulier l’aire ventro-Tegmentale,
(VTA) ; le nucléus arqué ; le nucléus accumbens. Ce circuit est aussi en relation avec
le cortex pré-frontal qui lui impulse un contrôle.
D18 : Avec une consommation chronique d’alcool, comme avec les autres drogues, il
y a une sécrétion accrue d’opioïdes endogènes (Bêta endorphines). Celles-ci activent
d’une part le système GABA-ergique et donne un sentiment de sédation et de
détente et de plaisir et d’autre part, le système dopaminergique (qui donne une
sensation d’excitation et de désinhibition). Si ces mécanismes se passent, par
exemple sous l’effet de l’alcool, à petites doses et peu fréquemment , c’est-à-dire,
avec une « consommation raisonnable », cela donne sur le plan humain « et de façon
raisonnable » un sentiment de détente et de désinhibition relativement agréable.
Dans le même temps, le lobe pré-frontal (rappelez-vous qu’il est connecté aussi au
circuit de la récompense) où se passe les réflexions, les ajustements cognitifs et
affectifs et finalement nos décisions d’action ; ce lobe pré-frontal est capable de
commander par un mécanisme de contrôle, le fonctionnement du circuit de la
récompense. En quelque sorte, le message du lobe préfrontal au circuit de la
récompense est : si l’on ne boit pas trop et pas trop fréquemment, la sensation
agréable persiste ; si, au contraire, on boit beaucoup et souvent, cette belle mécanique
se dérègle : trop de sédation ou trop d’excitation. Cela devient désagréable et
générateur de troubles . Le circuit de la récompense commence à « tourner un peu
fou » et il échappe progressivement au contrôle du lobe pré-frontal. On verra plus
loin aussi que ce même lobe pré-frontal sous l’effet d’une alcoolisation chronique,
présente aussi une détérioration des cellules nerveuses meurent, son efficacité de
contrôle faiblit. Ceci explique en grande partie, l’apparition de la « perte de
contrôle », un des signes classiques dans l’état de dépendance à l’alcool.
D19 : Des recherches complémentaires ont mis en évidence l’intervention de
multiples neurotransmetteurs et récepteurs dans le processus de dépendance. On
comprend ainsi que plusieurs types d’intervention pharmacologique ont été testés et
utilisés dans l’alcoolisme : les bloqueurs des récepteurs opioïdes avec la naltrexone,
les médicaments sérotoninergiques tels certains antidépresseurs, des médicaments à
action neuroleptique, pour agir sur l’excès de sécrétion de dopamine etc.…

5
L’Acamprosate, comme on vient de le voir, par son action de régulation sur la
fonction glutamatergique rééquilibre les déséquilibres engendrés par la sédation trop
grande de l’alcool et le mécanisme compensatoire d’excitation du cerveau.
Pour être complet, il faut ajouter que des études génétiques se poursuivent
évidemment en ce qui concerne les facteurs de risque de l’alcoolisme. De multiples
localisations sur divers gènes ont été identifiées, mais tout ceci n’a pas encore donné
lieu à des applications cliniques.
Pour terminer ce survol neurobiologique, il reste à faire brièvement deux
remarques :
1ère remarque :
On peut démontrer en expérimentation animale, l’action de l’Acamprosate sur
l’excitation suite à un sevrage d’alcool.
De fait, en général, les animaux n’aiment pas l’alcool. Il faut choisir des souches de
rats, génétiquement sélectionnés à être prédisposés à prendre de l’alcool, et atteindre
chez ceux-ci une alcoolisation artificielle telle que l’arrêt de prise d’alcool produise
des signes de manque. Seulement, dans ces conditions, le rat se conditionne à
reprendre de l’alcool pour éliminer les signes de sevrage. Si on laisse le libre choix à
ces rats entre de l’eau et de l’alcool, au cours du temps, la consommation d’alcool
diminue progressivement (D26).
Chez le rat, à la suite d’un conditionnement forcé de prise d’alcool et après qu’on ait
atteint un état de dépendance physique envers l’alcool, on note au sevrage, comme
chez l’homme, d’importants signes d’excitabilité anormale. On voit ici (D27) que si
l’on donne de l’Acamprosate, ces signes d’hyper motilité deviennent nettement plus
faibles que si on ne donne pas d’Acamprosate. Ceci montre un effet d’atténuation
des signes de sevrage.
2ème remarque :
En clinique, il est d’usage de proposer, en cas de rechute, des sevrages dès que
possible pour éviter des complications et des conditionnements à la boisson, de plus
en plus profonds.
D28 : Si on administre de l’Acamprosate chez des animaux subissant des sevrages
successifs (ici 4 sevrages), on les protège contre la mort cellulaire qui entraîne aussi
mort d’animaux. Ceci a été démontré sur des cultures de tissus d’hippocampe : à
chaque sevrage successif il y a nécrose cellulaire de plus en plus importante (figure
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%