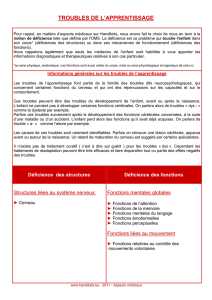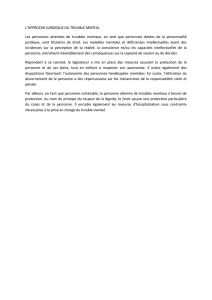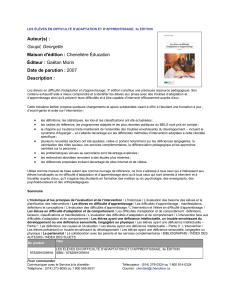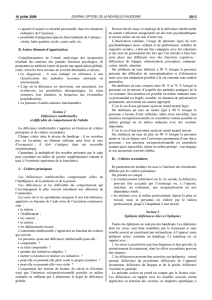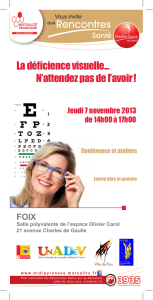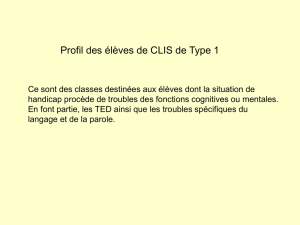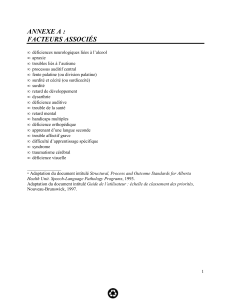la rééducation des p.. - patrickjjdaganaud.com

LA RÉÉDUCATION DES PERSONNES
DÉFICIENTES VISUELLES
ET
DÉFICIENTES MENTALES
des repères
pour mieux comprendre
La rééducation des patients déficients visuels et déficients mentaux
[Méthodologie]
Présentation de [la population étudiée]
[Analyse des résultats]
[Situation en début de prise en charge]
[Evolution de l'autonomie des patients]
Spécificité de la rééducation]
[Faible progression à forte incidence et difficile diagnostic différentiel]
[Modalité de la prise en charge]
[Evaluation et action interdisciplinaire]
[Prise de conscience des déficiences]
Pour en savoir plus
[Diagnostic différentiel du retard mental]
[Etiologie du retard mental]
Classifications internationales (CIM 10, CIH)
[Des déficiences visuelles]
[Des déficiences mentales]
Bibliographie
[Déficiences visuelles]
[Déficiences mentales]
Méthodologie

La population de référence de cette étude est constituée par la cohorte des
patients adultes, reçus dans l'établissement (CRFAM Unitée 1) depuis fin 1997,
soit 812 personnes atteintes d'une déficience visuelle initiale ou acquise et
éventuellement associée à d'autres déficiences (auditive, motrice, intellectuelle ou
comportementale).
A cette population de référence est comparé un groupe de 49 personnes adultes,
identifiées au moment de leur hospitalisation (soit depuis fin 1987), comme
présentant une déficience intellectuelle et pour lesquels ce diagnostic s'est révélé
exact au décours de la prise en charge rééducative. Il s'agit en fait pour la
plupart, de patients présentant un retard mental primaire, dont le diagnostic à
été préalable ou concomitant à celui de la déficience visuelle.
Présentation de la population étudiée
La proportion de personnes hospitalisées et présentant une déficience mentale
clairement identifiée lors de l'hospitalisation en plus de la déficience visuelle,
représente donc plus de 6 % de l'ensemble des patients reçus.
Il convient toutefois d'ajouter à ces chiffres, les patients ayant une atteinte de
leur efficience intellectuelle secondaire et non reconnue comme telle ou évoquée
de manière spontanée lors de leur hospitalisation (détérioration intellectuelle
d'origine toxique et conséquences déficitaires de troubles psychotiques, ou
d'atteintes neurophysiologiques pour la plupart).
Ainsi une [précédente étude] mettait en évidence que près de 7 % des
patients hospitalisés dans l'établissement étaient identifiés comme
présentant des troubles psychotiques.
La pratique quotidienne montre en outre la fréquence (non chiffrée
actuellement) des détériorations suite à un alcoolisme ancien et/ou à une
intoxication plus spécifique (méthanol ou alcool frelaté par exemple).
Enfin, parmi la population de référence, on remarque que, dans 32 % des
cas, l'atteinte visuelle est liée ou associée à une atteinte cérébrale. Une part
significative de ces sujets cérébro-lésés voient leur efficience
temporairement ou durablement limitée .
L'accroissement de quelque années de l'âge moyen de la population étudiée est à
relativiser. En effet, cette population des déficients mentaux, se répartit à peu
près également autour de cette moyenne de 31 ans. En revanche, la population de

référence n'a pas cette répartition normale (Gaussienne) autour de la moyenne,
mais une répartition bimodale. Ainsi, on observe d'une part des sujets
majoritairement jeunes (maximum entre 21 et 25 ans), pour une part importante
masculins, non voyants et cérébro-lésés, et d'autre part des sujets plus âgés
(maximum entre 36 et 40 ans), majoritairement malvoyants dont la pathologie
est le plus souvent d'origine ophtalmique.
Cette population de référence n'est donc aucunement représentative de
l'ensemble des déficients visuels français qui, pour la majorité d'entre eux, ont
plus de 60 ans et sont moins lourdement handicapés ou multihandicapés.
On constate une forte prédominance de situation de dépendance parentale (et/ou
institutionnelle) des patients. Cette dépendance est le plus fréquemment une
dépendance primaire et non consécutive à une modification de l'efficience ou des
conditions de vie (comme cela est souvent le cas pour les personnes cérébro-lésées
ou présentant une détérioration mentale).
La durée de prise en charge moyenne est plus élevée pour les patients qui
présentent des troubles mentaux associés à leur atteinte visuelle. Il est à noter
que cet allongement, tant de la durée de rééducation que de la durée moyenne de
séjour, s'accompagne d'une plus grande variabilité de cette durée (écart type
plus élevé). Cela sans que cette population ait un nombre moyen de séjours
significativement plus élevé que celui de la population de référence.
Cette observation est à croiser avec ce qui est mis en évidence par ailleurs. En
effet, si la durée moyenne de prise en charge est plus longue, le nombre de
séances proposées aux patients durant leur prise en charge est à peu près le
même. Ce qui montre que les patients déficients intellectuels se voient proposer
un nombre moyen de séances de rééducation moins important par semaine que
celui de la population de référence. Si la durée est plus longue, la fréquence des
prises en charge est moins élevée.
Les chiffres concernant la situation professionnelle lors de l'hospitalisation sont à
analyser avec prudence dans la mesure où ils prennent en compte la situation
professionnelle des patients au moment du début de leur rééducation.
Sans activité professionnelle : 23 % des déficients mentaux 76 % de la population
totale
CAT, IME : 51 % des déficients mentaux 5 % de la population totale
Ouvriers, employés non qualifiés : 26% des déficients mentaux 11% de la
population totale

Pour la plupart des patients déficients intellectuels, l'atteinte visuelle est
ancienne ou congénitale et l'hospitalisation dans notre établissement a été
préparée sur le moyen terme. La situation professionnelle, quand elle
existe, est (ou s'est) adaptée aux deux déficiences des sujets. Aussi, le
besoin de rééducation s'est fait jour progressivement et à été préparé par -
ou avec - la famille, l'institution et l'équipe rééducative, sans remettre en
cause ou déstabiliser la situation professionnelle.
A l'inverse, dans la population de référence, nombre de personnes doivent
faire face brutalement aux conséquences d'une déficience visuelle. Leur
activité professionnelle n'est pas nécessairement compatible avec les
conséquences fonctionnelles de cette déficience nouvelle. Aussi, nombre
d'entre eux le jour de leur hospitalisation sont en situation d'inactivité
professionnelle temporaire (arrêt maladie) ou prolongé (mise en
invalidité). Ce qui explique, pour partie, le faible taux de patients en
activité lors de leur hospitalisation, dans notre population de référence.
Il est à noter que les patients déficients intellectuels qui sont en mesure
d'effectuer une rééducation pour compenser les conséquences de leur déficience
visuelle, font partie des déficients mentaux les plus légers et donc les mieux
intégrés au niveau professionnel, même si pour la plupart ils sont dans des
établissements spécialisés.
On remarque la part importante des déficiences visuelles congénitales,
héréditaires ou intégrées dans une pathologie générale, parmi les patients
présentant une déficience intellectuelle. Les pathologies générales sont quant à
elles, dominées par les syndromes de Laurence-Moon-Bardet-Biedl (7 cas sur 8,
le cas restant étant une névrite optique suite à une syphilis tertiaire). Il faut de
plus noter qu'un nombre significatif de patients présentent une déficience
visuelle relative (malvoyance correspondant à une acuité visuelle inférieure à
3/10 (0,3), mais égale ou supérieure à 1/20 (0,05) du meilleur oeil avec correction
selon les catégories de déficience visuelle 1 et 2 de la CIM-10).
Analyse des résultats
A) Situation en début de prise en charge
Des écarts importants s'observent quant aux niveaux moyens d'autonomie

présents en début de rééducation. En effet, les patients déficients intellectuels se
caractérisent par une indépendance beaucoup plus faible de vie quotidienne
alors qu'ils disposent d'une maîtrise des déplacements plutôt meilleure et de plus
de potentiel visuel utilisé et/ou utilisable.
Cette différence est à considérer avec d'autant plus d'attention qu'elle recouvre
en fait deux évolutions différentes.
Pour les déficients intellectuels, leur mode de vie est le plus généralement
établi et relativement stable, du fait de l'ancienneté de leurs troubles
intellectuels (et visuels pour un grand nombre).
Or, pour la population de référence, la situation est opposée. La déficience
visuelle est récente quant à sa survenue, son aggravation ou ses
conséquences fonctionnelles et sociales. De ce fait, si des éléments
d'indépendance de la vie quotidienne sont partiellement conservés,
l'aisance de déplacement et l'utilisation efficiente de la vision sont
fortement atteints au moment de l'hospitalisation.
L'écart constaté entre ces deux populations souligne les limites adaptatives des
déficients intellectuels. Leur état visuel est plus ancien et en moyenne moins
sévère que pour l'ensemble de la population. Leur moins bonne adaptation ou
autonomie ne peut donc pas ou peu être imputée à des phénomènes
psychologiques (dépression réactionnelle à une baisse récente de vision) ou
physiologiques (sidération perceptive suite à la baisse brutale d'une des
modalités sensorielles par exemple).
B) Evolution de l'autonomie des patients
Les résultats obtenus à l'issue de la rééducation par les patients présentant une
déficience intellectuelle mettent en évidence la difficulté du processus de
rééducation fonctionnelle pour cette population. En effet, avec une durée de prise
en charge en moyenne plus longue et un nombre moyen de séance par prise en
charge équivalent, les évolutions possibles sont, en moyenne toujours,
significativement plus faibles. Il est tout particulièrement intéressant de
remarquer que les deux domaines qui évoluent le plus difficilement sont le braille
et l'utilisation de la vision.
Le braille, pour les patients qui maîtrisent l'écrit, est un support connu et
parfois ancien mais fréquemment utilisé de manière réduite. Il s'avère
souvent peu perfectible du fait des limitations cognitives de ces sujets.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%