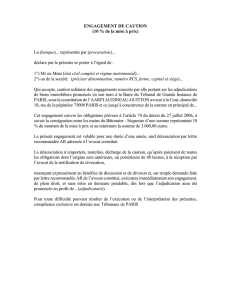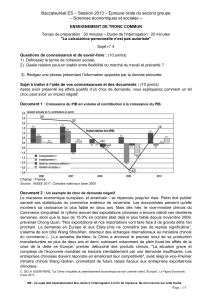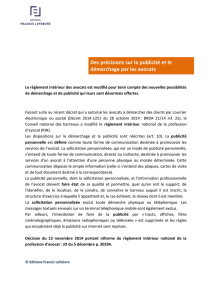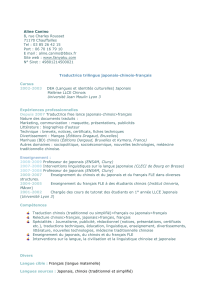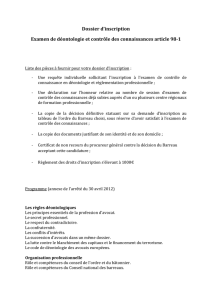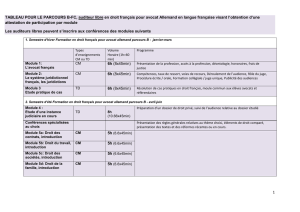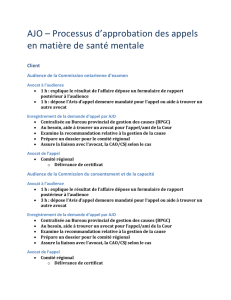Chapitre I - Weihsien

1
Chapitre I
A dix-neuf ans, j'ai la même coiffure qu'à sept. J’étais alors un Petit Octobre
de Moscou; ma mère vivait encore et elle me coiffait tous les matins avant de
m'envoyer à l'école. Depuis qu'elle est morte, j'ai abandonné le ruban que je
n'arrivais pas à nouer toute seule. Mes cheveux châtain clair, longs et soyeux,
coupés au ras des épaules, coiffés avec une raie sur le côté, sont retenus par une
barrette. Le souvenir de ma mère ne me quitte jamais. Sa mort et notre fuite
pour rejoindre la Chine m'ont marquée pour toujours, mais l’angoisse qui
m'habitait pendant que nous nous sauvions à travers les marécages et hantait
mes nuits au couvent s'est estompée.
Je suis heureuse de vivre et sûre de mon pouvoir de séduction. Les garçons me
font la cour, les hommes se retournent sur mon passage. En traversant la rue
Victoria, je me dis que la vie est pleine de promesses.
Ce matin, j'ai décidé de mettre une jupe droite en coton bleu ciel et un
chemisier en soie assorti. Une ceinture en cuir beige, placée près des hanches,
met en valeur ma taille longue et fine. La rue est calme. Il est neuf heures du
matin. Accroupis devant le grillage du parc, les tireurs de pousse-pousse,
récemment rebaptisés « conducteurs de cyclo-pousse », bavardent entre eux
tout en surveillant la porte d'entrée de l'Astor House. Ils sont prêts à bondir
dès qu'un client apparaît. Je m'arrête pour voir si Liu est parmi eux. Il
m’aperçoit, saisit son véhicule et s'approche en pédalant à toute allure.
- Shan nar-qu? (où allons-nous?), me demande-t-il.
- Wang-de jia (chez Wang).
Je monte et nous partons en direction de la Taku Road, la rue commerçante de
la concession anglaise. C'est ici, dans un étroit passage malodorant, encombré de
vendeurs ambulants et de mendiants, qu'habite Wang le tailleur.
Je connais Wang depuis cinq ans. Il avait quatorze ans, le même âge que moi,
lorsqu'il est venu chez nous pour la première fois. A l'époque, on l’appelait Xiao
Wang, le Petit Wang. Son patron, le tailleur Zhao, l'avait amené pour lui
apprendre à faire des essayages. Zhao avait déjà une importante clientèle
étrangère qui lui apportait des journaux de mode : Vogue, Harpers' Bazaar ou
Good Housekeeping. Il avait la réputation de savoir copier à la perfection tous
les modèles, même les plus sophistiqués.

2
Il n'était pas facile pour un paysan pauvre de trouver une place d'apprenti chez
un tailleur. Wang devait sa bonne fortune à son frère aîné et à la fête du
Printemps.
- Le Ciel nous a envoyé le tailleur Zhao, disait son frère, devenu le chef de la
famille depuis la mort de leur père. Si le tailleur Zhao n'était pas venu chez nous
à Yang Tsun *(1) pour acheter un cochon à l'occasion de la fête du Printemps, je
n’aurais pas pu lui parler de toi.
Wang était nourri mais ne touchait aucun salaire. Il venait travailler à
bicyclette car le village de Yang Tsun était situé à quinze kilomètres de Tientsin.
Un jour, il nous avait annoncé qu'il venait de se marier et s'était installé à son
compte. Il proposa de nous faire des prix d'ami. Nous sommes devenus ses
clients.
Tientsin, aujourd'hui Tianjin, se trouve à cent kilomètres de Pékin et son nom
se traduit par « le gué du ciel ». Baptisée ainsi en 1604, à l'époque des Ming, elle
a été fortifiée pour protéger le chemin qui conduit au Ciel. C'était autrefois une
ville laide et sale. Des gravures anciennes montrent ses rues tortueuses,
encombrées de bêtes et de gens, et ses maisons basses, presque toutes en terre.
Comme partout en Chine, les habitants de Tientsin (900 000 au début du siècle)
vivotaient en murmurant meyou fazi (on n'y peut rien). Cinq siècles avant notre
ère, le grand maître Confucius avait déclaré qu'il était normal qu'il y eût des
riches et des pauvres, des heureux et des malheureux, des beaux et des laids,
des jeunes et des vieux. « Le Ciel et la Terre et les dix mille choses sont unis »,
avait-il dit. Par conséquent chacun devait rester à sa place pour sauvegarder
l'harmonie de l'Univers.
A mon arrivée au Gué du Ciel avec mon père, en 1931, Tientsin n'est plus un
village laid et sale mais une ville industrielle où les étrangers ont imposé leurs
lois. Depuis 1858, date d'un traité signé à Tientsin, ils y possèdent des
concessions. Chaque concession a sa municipalité, sa police, son armée, ses
douanes, ses banques et ses écoles. Chez les Français, même les immeubles ont
été construits sur le modèle national. Les platanes viennent de France. La
concession anglaise, la plus importante, ressemble à la City de Londres. Les
Anglais n'y vivent pas. Ils ont construit leur quartier résidentiel un peu à l'écart
du centre, à proximité de leur champ de courses et d'un Country Club où les
pelouses sont aussi vertes qu'en Angleterre. Nous habitons à côté de l'hôtel
Astor House, un deux pièces que mon père loue à M. Powell, l'un des

3
propriétaires du magasin de tissus et de prêt-à-porter Moyler & Powell. Je dors
sur un canapé dans le cabinet dentaire de Clara. La cuisine est au fond d'un grand
couloir et nous partageons la salle de bains avec deux autres familles russes.
C'est presque un appartement communautaire comme celui où je vivais, ruelle
des Petits-Pains à Moscou, la terreur en moins. Olga Ivanova, un professeur de
piano, et sa fille Larissa logent en face de nous. Un peu plus loin, dans le même
couloir, il y a mes amis Sacha et Boris dont le père est comptable chez
l'imprimeur Serebrennikoff.
Malgré des revenus modestes, chaque famille russe a un « boy à tout faire ». Le
nôtre, que mon oncle en rentrant de Paris a baptisé François, fait la cuisine, le
ménage, la lessive et le repassage. Il s’exprime en « pidgin english », une sorte de
petit nègre utilisé par les domestiques de la concession pour communiquer avec
les étrangers.
Le responsable du chauffage collectif, le « stove-man », fait marcher le poêle à
charbon du couloir. La nuit, il dort à côté, enroulé dans son manteau ouatiné, et
ne rentre chez lui, au village, qu'au printemps.
Liu pédale lentement. Il essaie de se frayer un chemin en évitant les flaques
d'eau. Les cris des vendeurs de wutoh, les petits pains à base de farine de maïs,
des vendeurs de patates douces, le caquetage des poules entassées dans des
paniers suspendus à des palanches, tous ces bruits sont assourdissants mais j'y
suis habituée. Personne ne fait attention à nous. Je ne suis pas la première
Européenne à se rendre dans cette ruelle. Nous nous arrêtons devant une porte
en bois laquée rouge. Je frappe. Une voix féminine crie :
-Qui est là?
-Une cliente étrangère.
La porte s'ouvre immédiatement. Liu sort sa pipe et s'installe sur le siège du
pousse-pousse pour m’attendre.
- Huang ying, xiao-die (soyez la bienvenue, mademoiselle), me dit Wang.
Je lui demande des nouvelles de sa famille. Il répond que tout le monde va bien
et que ses enfants sont partis rendre visite à son frère à la campagne. Dans
l'unique pièce qui lui sert à la fois d'atelier et de pièce à vivre, sa femme

4
actionne une machine à coudre avec ses pieds bandés. Des tissus de toutes les
couleurs, des numéros de Vogue et Harper's Bazaar traînent sur les chaises. Des
modèles en taffetas, en soie et en satin sont étalés sur le kang, le lit chinois où
dort toute la famille. Je lui dis que j'ai besoin d'une robe de soirée pour le
surlendemain en montrant le modèle que j'ai dessiné moi-même. Je lui donne le
tissu que j'ai apporté, du voile de coton blanc. Wang examine le modèle et répond
que la robe sera prête à la date voulue. L'essayage n'est pas nécessaire car il
connaît mes mensurations. Je le remercie. François le cuisinier le paiera comme
d' habitude, à la livraison.
Liu s'est endormi. Je le réveille doucement et nous repartons vers la rue
Victoria.
Hitler a occupé la Pologne, mais au Gué du Ciel la vie continue comme avant. La
boîte de nuit, le Maxim's, est pleine tous les soirs. Anglais, Allemands, Français,
Belges, Américains et Russes y partagent les mêmes tables. Ils parlent de la
guerre comme si elle se passait sur une autre planète et ne les concernait pas.
L'Europe, c'est loin. « Profitons de la vie », semblent se dire les habitants des
concessions.
Les lampes en porcelaine à abat-jour posées sur les tables diffusent une
lumière douce. L'orchestre américain joue Jalousie. Tout autour de la piste de
danse, les Européens dînent ou boivent des « highballs », un mélange de whisky et
de Coca-Cola. Des boys chinois en tuniques blanches circulent entre les tables.
J'ai posé la tête sur l' épaule de Sacha. Nous dansons serrés l'un contre
l'autre. Son costume sombre va bien avec ses cheveux blonds. Il me chuchote à
l'oreille qu'il aime ma peau, la douceur de mes seins et ma taille fine. Il me dit
que je suis belle en robe longue. Je sais que celle que je porte, en voile de coton
blanc avec ses minuscules manches ballon et son col Claudine, me va bien.
Nous connaissons presque tous les couples qui s'enlacent. Je souris à Olive
Evans et à son fiancé danois Tage Schmith. Je dis bonjour aux Allemands Didi et
Fink Will qui sont venus, comme d'habitude, avec les ravissantes sœurs Jannings,
Gudrun et Gisela, les nièces de l'acteur Emile Jannings. Rudy Thogersen
embrasse Joan Croft dans le cou pendant qu'ils dansent. Elle a fermé les yeux.
Le public est exclusivement européen. Les Chinois ne sont pas interdits chez
Maxim's mais en dehors de quelques-uns occidentalisés, ils préfèrent les boîtes

5
chinoises telles que le St. Anne's où on trouve des « taxi-girls », de très belles
jeunes filles en robes fendues jusqu'aux cuisses. On peut les inviter à danser
après avoir acheté des tickets à la caisse. Chaque ticket donne droit à une danse
mais, pour être agréable à leur clientèle, les patrons des cabarets proposent
souvent douze tickets pour le prix de dix. Certaines boîtes disposent de « sing-
song girls », des taxi-girls qui sont en même temps chanteuses. Les tickets qui
permettent de les inviter coûtent plus cher. Officielle ment, ce ne sont pas des
prostituées mais on peut toujours s'arranger en payant. Vers minuit, en sortant
de chez Maxim's, nous allons tous en bande finir la soirée au St. Anne's.
Aujourd'hui, je sais que le Hasard utilise des voies détournées. Il faut
apprendre à les déchiffrer. Pour m'envoyer celui que je devais rencontrer, le
Hasard a soulevé une tempête au large de Manille, obligeant le cargo japonais qui
le transportait à accoster à Taku Bar, un avant-port de Tientsin.
L'homme qui descend du cargo n'a jamais entendu parler de Tientsin. Il est
français et il vient d'être démobilisé. Il voulait se rendre à Harbine où ses
parents possèdent une propriété. Les Japonais le débarquent dans un port
crasseux, au milieu d'une foule chinoise indifférente. Pas de douane en vue, pas
de milice non plus. Il n'a que quinze dollars dans la poche de son imperméable
clair. Il a relevé le col car le vent est froid. Il se demande ce qu'il va faire
lorsqu'il aperçoit un drapeau tricolore qui flotte au vent. Il se dirige vers le
drapeau en espérant qu'il ne s'agit pas d'un mirage et se trouve devant trois
militaires français dont un sous-officier. Ils sont très étonnés de le voir là. Le
sous-officier lui explique que Taku Bar est à soixante kilomètres d'une grande
ville, Tientsin. Il ajoute que le poste français est une conséquence de
l'extraterritorialité et que dans les concessions de Tientsin les étrangers ne
sont justiciables que de leurs propres juridictions. Il lui offre un pastis puis le
conduit à la gare où il lui achète un billet pour Tientsin. En descendant du train,
le voyageur est accosté par un vieux Chinois portant une casquette sur laquelle
est écrit « Astor House ». Le Chinois prend sa valise et lui dit en anglais :
- Good morning, sir, this way please.
Il le fait monter dans le bus de l'hôtel comme si c'était prévu depuis longtemps.
Quelques instants plus tard, l'homme à l'imperméable clair est à quelques
mètres de chez moi (mais je ne le sais pas encore), dans l'hôtel le plus luxueux
de la ville. Il prend une chambre à dix dollars.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%