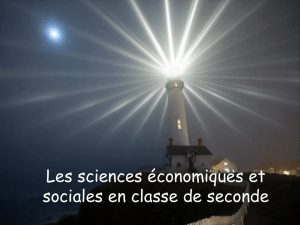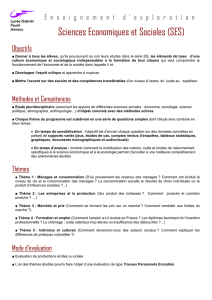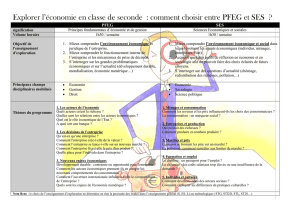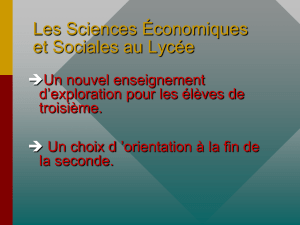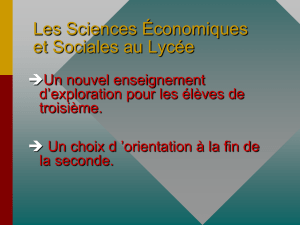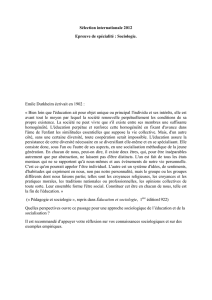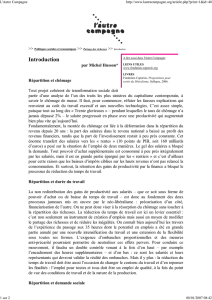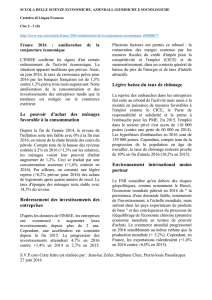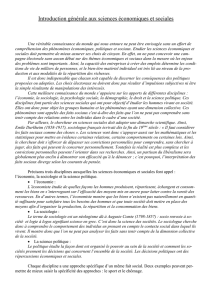Introduction : Lien marchand, lien social et lien politique : Objectif

Introduction : Lien marchand, lien social et lien politique :
Objectif : leur montrer que la vie en société n’est pas une évidence et
n’est possible qu’en raison des multiples liens qui enserrent
les individus. Ces liens peuvent être observés grâce aux
sciences sociales qui multiplient les perspectives sur un
même objet.
On va pour commencer essayer simplement de comprendre ce qu’on va faire pendant toute
cette année et l’année prochaine. En gros, le problème que l’on se posera cette semaine est de
savoir ce que sont les sciences sociales et à quoi elles servent. Cela nous permettra de poser
dans le même temps les différences entre les différentes sciences sociales, c'est-à-dire
principalement entre la sociologie et l’économie qui sont les deux grands pans de
l’enseignement.
Objectif : observer, sous divers angles complémentaires, ce qui permet aux hommes de
vivre ensemble.
A. Les sciences sociales, différents points de vue sur un même fait social : l’exemple des
crises :
Pour commencer, on va essayer de voir ce que peuvent faire les sciences sociales quand elles
s’intéressent à quelque chose comme une crise. A priori, parler d’une crise, c’est s’intéresser
uniquement au fonctionnement de l’économie. Mais est-ce suffisant ? Malheureusement non.
Pour parler des crises, il y a tout un ensemble de manières différentes, de points de vue
différents, que l’on peut adopter. C’est ce que l’on va essayer de voir dans cette introduction.
Activité de sensibilisation.
Pour comprendre cette idée de complémentarité des points de vue pour bien comprendre ce
qu’est un objet quelconque, comme les crises économiques, et bien nous allons faire une sorte
de petit jeu.
Soit baisser les volets et faire éteindre la lumière, pour utiliser une lampe de poche sur un
bilboquet. Soit le mettre dans un sac et s’arranger pour sortir un bout après l’autre. Soit faire
sortir trois volontaires qui vont faire les cobayes pour décrire un objet global.
Comme vous le constatez, l’objet est un bilboquet, mais pour bien décrire un bilboquet, il faut
décomposer l’objet en trois parties, la boule, le piquet et la corde.
Et bien, pour une crise, c’est pareil, c’est en multipliant les points de vue que l’on va pouvoir
observer et décrire correctement ce qu’est une crise.
Mise en place de la notion de fait social :
Mais pourquoi on va s’intéresser à une crise, qu’est-ce qui rend légitime cette interrogation ?
Comme on s’intéresse à des phénomènes de société, on doit bien prendre garde à deux choses.
Un fait social est une manifestation de la réalité humaine qui a une dimension collective
et revêtant une certaine régularité : la famille, la télévision, le cinéma, la musique, les
conflits…
Attention : il ne faut pas confondre un fait social et un problème social. Le problème
social est un phénomène de société qui pose question à la collectivité (l’alcoolisme, la
délinquance juvénile, le chômage…).
Beaucoup de faits sociaux ne sont pas des problèmes sociaux (la mode, les vacances…).
Les crises disposent de ce caractère régulier et collectif, ce qui explique pourquoi les SES s’y
intéressent. Maintenant, nous allons voir comment les SES le font.
A votre avis, comment peut-on parler des crises en utilisant les Sciences Economiques et
Sociales ? Perspective économique, sociologique, politique, historique…
1. Produire, distribuer et dépenser : l’économie :
On va travailler dans un premier temps de manière économique, ce qui paraît évident, les
crises. En travaillant sur les documents, on se rendra compte que l’analyse d’une crise

comporte les trois dimensions qu’on a cité en titre de la partie, à savoir la production, la
distribution et la dépense (ou consommation).
Pour comprendre la crise économique, on peut d’abord prendre le point de vue général. Voir
ce qu’il se passe en matière de richesse pour le pays. C’est ce que l’on va faire avec le premier
document.
Document 1 – La production de richesses en France (en milliards d’euros courants) :
965,2
994,7
956,3
79,3
79,0
86,2
295,2
304,2
311,9
338,6
351,5
345,1
20,2
21,0
22,2
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
1 600,0
1 800,0
2 000,0
2007 2008 2009
ISBLSF
Ménages y compris
entrepreneurs individuels
Administrations
publiques
Sociétés financières
Sociétés non financières
(SNF)
Source : INSEE, Comptes nationaux, 2010
Question 1 : Faites une phrase donnant la signification du chiffre 956,3.
Question 2 : Que constate-t-on au niveau de la production totale de richesses de France en 2009 par rapport à
2008 ?
Question 3 : D’où provient cette baisse ?
Question 1 : Phrase-type : Selon l’INSEE, en France, en 2009, les sociétés non financières
ont produit 956,3 milliards d’euros de richesses.
Question 2 : La production totale de richesses est moindre en 2009 qu’en 2008. Elle
passe de 1750,5 milliards d’euros à 1721,7 milliards d’euros.
Question 3 : Cette baisse est principalement due aux baisses des productions des
ménages (entrepreneurs individuels), des sociétés financières et des sociétés non
financières.
On a vu par ce document que les richesses produites sont moindres lors d’une crise. Mais quel
impact cela a-t-il ? Comment ces richesses produites se répartissent dans l’économie ?
Document 2 – Une modification de la répartition des richesses en temps de crise :
« Les conséquences sociales de la crise se diffusent surtout à travers les failles du marché du travail. Perdre son
emploi, c'est perdre les revenus d'activité qui lui étaient associés. Et même si le système de protection sociale
français prévoit des filets de sécurité, ces revenus de remplacement ne permettent pas de garder le même niveau
de vie. Sans compter qu'ils ne sont pas éternels.
« Or, depuis le début de la crise, 600 000 emplois ont été détruits, principalement dans l'industrie, même si la
construction et les services ont également été touchés. Ces pertes ont eu un impact considérable sur le chômage :
plus de 900 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en deux ans. Et pour la première fois depuis dix ans, le
taux de chômage a atteint la barre symbolique des 10%.
« Tous les Français n'ont pas été également affectés, en témoigne le confortable taux de fréquentation affiché par
les stations de ski cet hiver. En réalité, ceux qui trinquent le plus sont ceux qui étaient déjà fragilisés avant la
crise : les jeunes, les peu qualifiés, les précaires… Autrement dit, ceux qui n'étaient guère familiers des remonte-
pentes ». Source : L. Jeanneau, « La bombe sociale », Alternatives Economiques, n°290, avril 2010
Question 1 : Combien de ménages ont été touchés directement par la crise économique sous la forme d’une
perte d’emploi ?
Question 2 : Tous les types de ménages ont-ils eu les mêmes risques de subir cette perte d’emploi ?
Question 1 : Environ 600 000 emplois détruits, et 900 000 personnes de plus qui
recherchent un emploi.
Question 2 : Une partie seulement de la population a été concernée par ces destructions
d’emploi (rappel, 22 millions d’emplois en France). Ce furent surtout les jeunes, les

personnes possédant de faibles niveaux de diplôme et les personnes concernées par des
contrats dits « précaires ».
Maintenant qu’on a vu le côté production et distribution (répartition des revenus) dans la
crise, on peut s’intéresser aussi au côté de la consommation. C’est ce que l’on va faire avec un
troisième type de document.
Document 3 – Les évolutions de la consommation des ménages en France (en %) :
Avec ces différents documents, on a observé une approche économique de la crise. On peut
maintenant définir l’économie. La science économique est la science qui étudie les activités
de production, de répartition (de distribution) et de dépense (de consommation)
auxquelles se livre l’homme afin de se procurer les biens et les services nécessaires à la
satisfaction d’un certain nombre de ses besoins, dits économiques.
2. Etre influencé par les autres : la sociologie :
Passons maintenant à une deuxième science, la sociologie.
Quels types de liens peut-on faire ressortir de ces différentes étapes de la vie
économique ? (lien entre le producteur et ses salariés, lien entre les salariés eux-
mêmes, lien entre le vendeur et son client, etc.).
Dans le même temps, on se rend compte que derrière une activité économique, même
très générale, se trouve tout un ensemble de liens sociaux. Ces liens sociaux vont avoir
un impact sur les comportements des individus.
On va en prendre deux exemples.
Document 4 – Les effets sociologiques d’une crise économique :
« Est-ce que les générations arrivant à l’âge adulte durant une dépression économique ont des croyances socio-
économiques différentes des générations nées durant une période de croissance ? Nous étudions la relation entre
les dépressions et les croyances [avec la méthode appropriée]. Nous montrons ainsi que les individus grandissant
durant les périodes de dépression ont en moyenne plus tendance à croire que le succès dans la vie dépend plus de
la chance que des efforts personnels, à défendre les politiques de redistribution d’un Etat-Providence, mais sont
dans le même temps moins confiants dans les institutions publiques. Ces effets apparaissent être des effets de
long terme, puisque ces croyances perdurent après la dépression ».
P. Giuliano & A. Spilimbergo, « Grandir durant une crise: les croyances et la macroéconomie »,
IZA Discussion Paper n°4365, Août 2009
Question 1 : Faites une phrase donnant la
signification du chiffre -0,1 (sur la première
ligne).
Question 2 : Repérez les postes de
consommation les plus touchés par la crise.
Source : G. Consalès, « En 2009, la
consommation des ménages résiste malgré la
récession », INSEE Première n°1301, Juin
2010.
Question 1 : Phrase-type : Selon
l’INSEE, en 2009, en France, la
consommation effective des ménages a
diminué de 0,1% par rapport à 2008.
Question 2 : carburants, lubrifiants
(-17,4) ; appareils électroniques et
informatiques (-13,4) ; chauffage,
éclairage (-5) ; fruits et légumes (-2,9)
; lait, fromages et œufs (-1,5) ;
médicaments (-1,4) ; achats de
véhicules (-1,2) ; poissons et
crustacés (-0,7).

« Les représentations de la pauvreté ne sont pas figées dans le temps, et elles varient à la fois selon les pays,
c’est-à-dire selon les perceptions politiques et culturelles, et selon la conjoncture économique et sociale. […] Par
ailleurs, l’explication de la pauvreté par la paresse est nettement plus répandue dans certains pays que dans
d’autres, notamment en Grande-Bretagne. Mais il existe aussi, indépendamment du pays, un effet propre du
chômage. Selon que celui-ci augmente ou diminue, la probabilité de l’explication de la pauvreté par la paresse
diminue ou augmente sensiblement. La population semble prendre conscience, en période de crise et de pénurie
d’emplois, que si les pauvres ne trouvent pas d’emploi ce n’est pas de leur faute ».
S. Paugam & M. Selz, « La perception de la pauvreté en Europe depuis le milieu des années 1970 »,
Economie et statistique n°283-284-285, 2005
Question 1 : Quelles croyances se développent durablement pendant les périodes de crise économique et
d’augmentation du taux de chômage ?
Question 2 : Comment expliqueriez-vous ce développement ?
Question 1 : La pauvreté et le chômage n’est pas le fruit de la paresse mais du hasard.
L’Etat-Providence est positif en redistribuant partiellement les richesses. Les
institutions publiques en général ne sont pas cependant pas efficaces pour gérer
l’économie.
Question 2 : Le fait de voir au quotidien, notamment dans son entourage, des difficultés
concrètes apparaître à cause de la crise, conduit les individus à changer leur manière de
considérer le chômage et l’action des pouvoirs publics.
On voit donc bien avec cet exemple que la crise a une dimension sociale que l’on peut
observer grâce à la sociologie. A partir de ces différents exemples, on peut alors définir un
peu plus précisément ce qu’est la sociologie. La sociologie est la discipline qui étudie
comment les sociétés se constituent, s'organisent et se transforment, mais aussi les
modalités d'interaction entre individus et groupes sociaux dont celles-ci se composent.
3. Etre dans un rapport de pouvoir : la science politique :
Maintenant qu’on a vu la dimension économique et sociale d’une crise, on peut se rendre
compte qu’une a également une dimension politique qui peut être interrogée en tant que telle.
Nous allons en prendre un exemple contemporain, voir dans quelle mesure une crise
économique peut avoir une dimension politique qui peut être analysée comme telle.
Document 5 – Les rapports de force dans les entreprises en temps de crise :
« Un emploi contre des sacrifices. Les salariés de General Motors Strasbourg ne sont ni les premiers, ni sans
doute les derniers, à accepter ce type de deal. Précédents.
« Bosch, Vénissieux (Rhône). Afin de pérenniser leur usine, les salariés ont, en 2004, accepté de travailler 36
heures hebdomadaires contre 35 sans contreparties salariales, la perte de 6 jours de RTT, une moindre
majoration des heures de nuit... Aujourd'hui, un plan de 150 départs volontaires est à l'oeuvre.
« Hewlett-Packard (Isère). Afin de faire baisser de 1 200 à 900 le nombre de suppressions de postes, les salariés
ont renoncé, il y a quatre ans, à une dizaine de jours de congé. 750 nouveaux licenciements sont désormais
attendus.
« Goodyear, Amiens (Somme). En 2007, le groupe annonce un plan de réorganisation de ses deux sites
d'Amiens-Nord et Sud, soit la suppression de 450 emplois en échange de gros investissements. L'accord est
refusé sur le premier site et accepté sur le second. La direction veut à présent céder une partie de l'activité
d'Amiens-Nord.
« Continental, Clairoix (Oise). En 2007, les 1 120 salariés avaient accepté un retour aux 40 heures, contre un
maintien de l'activité du site jusqu'en 2012. Mais, dès 2009, la fermeture de l'usine est annoncée ».
C. Bamberger, « Quand l’histoire se répète », Le Nouvel Observateur, 29 juillet 2010
On voit alors bien qu’une crise a également une dimension politique qui peut être étudiée par
les politistes. On peut alors définir la science politique comme la science qui étudie les
relations de pouvoir dans la société, dans la sphère politique et les interactions entre le
politique et le reste de la société.
B. Les sciences sociales et la complémentarité des points de vue : l’exemple de la
musique :

Tout ce qu’on vient de faire partait du principe que la complémentarité des points de vue sur
un même objet permet de bien le décrire. On va dans quelle mesure ceci est vrai avec une
mise en pratique de cette complémentarité des points de vue.
On va faire l’expérience de décrire différents styles musicaux uniquement par des
caractéristiques économiques, sociologiques et politiques. Logiquement, on devrait
pouvoir retrouver les styles correspondants sans même citer d’exemples. Dans certains
cas litigieux, on va présenter quelques exemples.
Activité de mise en pratique à la fin, avec transparent : Leur demander de recopier différents
exemples pour qu’ils comprennent bien.
Leur donner trois caractéristiques d’une musique, une sociale, une politique, une économique,
et leur faire retrouver à laquelle on pensait à la base. Prévoir à chaque fois les exemples, à
montrer en dernier en cas de non découverte.
Economique
Social
Politique
Exemple
Musique
Grande
distribution
Passage sur les
radios
nationales, type
NRJ
Apolitique
Michael Jackson
Lady Gaga
Madonna
Pop
Production par
les petits labels
Public
revendiquant une
certaine culture
musicale
Apolitique
Arcade Fire
Foals
Bon Iver
Indé
Entouré d’un
important
merchandising
vestimentaire
Originaire des
Caraïbes
Contestataire
Bob Marley
Tiken Jah Fakoly
Reggae
Pas de
distribution et
de production
particulière
Chanté lors des
matchs de
football
Conservateur
La Marseillaise
La Brabançonne
Hymnes
nationaux
Production et
distribution
essentiellement
française
Entendu par
toutes les
catégories
sociales
françaises
Apolitique
Christophe Maé
Benabar
Variété
On voit donc qu’une complémentarité de points de vue est le meilleur moyen pour décrire un
phénomène humain dans toute son extension.
C. De la complémentarité des points de vue au tissage social :
Pour autant, tout ce qu’on vient de dire n’est pas seulement quelque chose d’abstrait qui ne
renverrait qu’à un point de vue sur la société.
Quand on regarde un phénomène humain quelconque, comme une crise ou la musique et ses
différents sous-genres, on se rend bien compte que ses dimensions économique, sociale et
politique sont constitutives du phénomène et non pas seulement une manière de le regarder.
Avec les différentes dimensions qui entourent un même phénomène humain, on se retrouve
donc pris dans tout un ensemble de liens qui forment la société. C’est cet ensemble de liens
qui font que nous arrivons à vivre ensemble.
Les différentes dimensions d’un phénomène humain sont autant de liens qui relient les
individus entre eux. Ce sont ces différents liens économiques, sociaux et politiques qui
permettent à la société d’exister et aux hommes qui y vivent de cohabiter. Ce sont ces
différents liens que les SES étudient.
1
/
5
100%