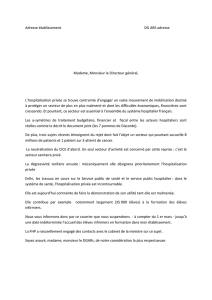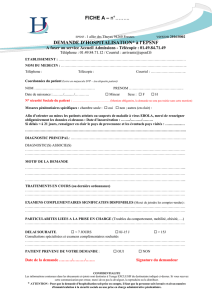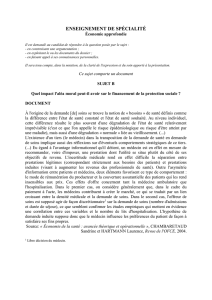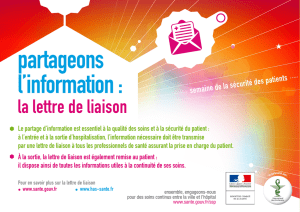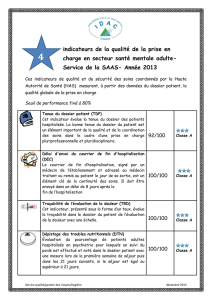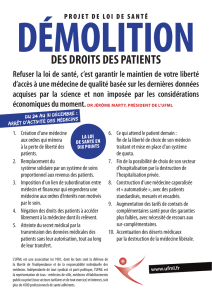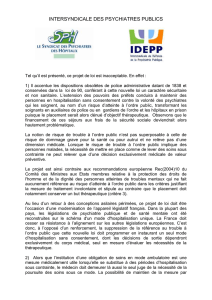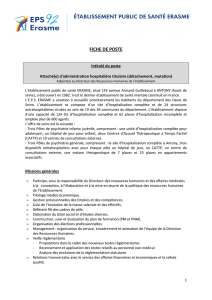MODULE DIGESTIF

1
La prévention des carences affectives liée à l’hospitalisation de
l’enfant
Hospitalisation : séparation avec les parents
I)Que représente la maladie pour l’enfant ?
- 1877 : Premiers écrits sur les représentations de la maladie chez l’enfant.
- 1915 : 1ère représentations de l’hospitalisme
- 1920 : Un enfant ne devrait jamais être séparé de ses parents lors d’une hospitalisation
- 1949 : Les nourrissons de 6 mois à 1 an sont perturbés lors de la séparation avec
leurs parents de plusieurs semaines voire plusieurs mois
- 1955 : les 3 phases : protestations, désespoir et dépression
L’enfant se fait une idée du bien et du mal très tôt. L’enfant ne comprend que lorsqu’il a vécu
donc la maladie il la connaît.
ATTENTION : il faut toujours dire la vérité à un enfant
Il faut tenir compte de l’âge de l’enfant, de son développement, de son environnement,
de sa situation économique et sociale.
- A la naissance : enfant fragile, totalement dépendant de ses parents, il faut être dans la
communication
- Jusqu’à 4 mois :une situation non satisfaisante est angoissante.
- Jusqu’à 2 ans : l’enfant est capable de supporter une certaine dose d’angoisse à
condition qu’il soit dans un cadre rassurant
- Après 2 ans et jusqu’à 6 ans : l’enfant met en relation la maladie et sa responsabilité
Ex : j’ai mal au ventre parce que j’ai mangé trop de chocolat
- Adolescence : Il va craindre pour sa vie (la mort est en suspend)
II) L’hospitalisation
L’hospitalisation est un choc traumatisant car il y rupture avec le milieu familiale et la
période la plus vulnérable est avant 6 ans.
Les différents stades par lesquels passent les enfants hospitalisés de manière brutale :
- La protestation : enfant qui hurle, crie, parce qu’il ne comprend pas la situation. Peut
durer quelques heures, quelques jours… L’enfant refuse les contacts. Il est hostile à

2
toutes manifestations d’approche. Il pleure parce qu’il veut ses parents (s’ils arrivent
l’enfant se calme)
- Le désespoir : Phase de découragement. Il donne l’impression de s’adapter à la
situation et la détresse ressurgit lorsque les parents réapparaissent.
- La dépression : C’est un stade de refus. L’enfant refoule ses sentiments : régression
des acquisitions, dans le développement psychomoteur. Régression normale lors d’une
hospitalisation, tout redevient normal au retour à la maison. Au moment de la visite
des parents, l’enfant va les ignorer.
Tout ceci va dépendre des conditions de l’hospitalisation, de sa durée, de l’âge de
l’enfant, de sa relation avec ses parents et de la disponibilité de ces derniers.
Plus l’enfant est préparé de ses parents, plus les troubles seront importantes. Plus les
hospitalisations sont longues et/ou répétées, plus les répercutions sont importante
Les enfants présentent des séquelles lors d’hospitalisation de longue durée :
- Psychopathologiques : Troubles alimentaires (anorexie simple ou mentale On peut
avoir recours à la nutrition parentérale), troubles digestifs (vomissements, diarrhées,
constipation), troubles du sommeil (insomnies précoces surtout si l’hospitalisation se
fait d’urgence et que l’enfant n’est pas préparé), troubles du développement (retard à
la marche…), instabilité, hyper-excitation, régression dans l’acquisition du langage,
dans la propreté.
Ces signes sont pathologiques parce qu’ils se trouvent en dehors de toute clinique, il n’y a pas
de causes pathologiques
- Liées au retour à la maison : Indifférence, manque de confiance envers les parents,
caprice, colère…
- Troubles psychologiques lointains : Difficulté à créer des relations, immaturité
L’hospitalisme : c’est une manifestation de traumatisme intense liée à la séparation
avec les parents. L’enfant est prostré dans son coin, il n’appelle plus, tourne le dos à tout le
monde, s’arrête de manger. Il s’enfonce dans la dépression. L’enfant doit rentrer le plus tôt
possible à domicile.
III) Le rôle des équipes soignantes dans la prévention des carences affectives
Soigner en tripartie : relation entre l’enfant, les parents et les soignants
On ne peut pas supprimer la détresse d’un enfant hospitalisé, mais on peut la diminuer
en ayant des qualités d’accueil, d’information et de relation.
Cohérence de soin entre les différents soignants, but commun à tout le personnel.

3
1) L’accueil
Le premier contact avec l’enfant et ses parents est important : Il doit être chaleureux,
rassurant, personnalisé.
Il faut se présenter à l’enfant en donnant son prénom et en l’appelant par son prénom.
Il faut connaître les habitudes de vie de l’enfant pour essayer de les respecter au
mieux. Il faut respecter ses habitudes alimentaires. Permettre aux parents de rester le plus
longtemps possible avec l’enfant, si possible jusqu’à son endormissement et lui dire que l’on
s’en va.
2) Donner des informations
Il faut questionner l’enfant et les parents sur ces habitudes de vie et donner des
informations sur les habitudes du service. Présenter les lieux, le fonctionnement du service.
Il faut se présenter à chaque parent et enfant et même au téléphone Relation de
confiance
Ne pas mentir à l’enfant. Les informations rassurent et établissent un climat de
confiance.
L’écoute est importante (écouter les questions des parents et toute l’équipe doit avoir
la même réponse). Expliquer aux parents l’importance de leur visite (l’enfant qui pleure est
normal).
3) Avoir des relations les plus adéquates possibles avec les parents et l’enfant
- Entrer en relation avec un nourrisson par le toucher, le regard, le sourire.
- Jouer, chanter c’est soigner
- Il ne faut pas prendre la place des parents
- Sectoriser les services : il faut essayer que la prise en charge se fasse par la même
personne pendant au moins 8 heures et non avoir une multitude de visage pour
différents soins. Mais pas de référents car ce n’est pas possible, il n’y a pas assez de
personnel et le référent a tendance à être un substitut maternel.
- Un enfant passif et trop calme est un enfant qui sombre dans la dépression
- Réserver son attention à l’enfant, entrer en contact avec.
- Important pour les enfants scolarisés de pouvoir continuer.
Par le dialogue : il permet de rassurer, même un nourrisson. Réserver toute son attention à
l’enfant. L’enfant comprend très vite et très tôt ce qu’on lui dit. (intonation, idée générale)

4
4) La patience
Un enfant crie, pleure, hurle, proteste… il faut de la patience pour supporter les cris pendant 8
heures. Un enfant qui refuse notre contact, est difficile à supporter. Il faut le laisser venir tout
seul et ne pas le forcer. Pour l’alimentation, c’est pareil : patience.
Utiliser correctement le dossier de soins : Pour pouvoir être cohérent… Faire les
transmissions ciblées.
Toute l’équipe est concernée par la détresse d’un enfant, il n’y a pas de hiérarchisation. Un
enfant trop calme est aussi un enfant en danger.
IV) Les alternatives à l’hospitalisation
- Hospitaliser un des 2 parents avec l’enfant mais il y a un manque de place dans les
services et c’est payant (non remboursé par la sécurité social et est cher : environ 90€
par jour.)
- Hôpital de jour : l’enfant vient en RDV dès le matin et repart le soir, une fois tous ces
examens terminés (Scanner, EEG, ECG, bilan sanguin…)
- HAD (hospitalisation à domicile) n’existe pas en pédiatrie en alsace. Il n’y a pas de
puéricultrices libérales et les IDE qui vont à domicile ne veulent pas le faire par
manque de formation vers les enfants
- Soins ambulatoires : ce fait beaucoup pour les chimiothérapies, pour certaine
injection. C’est considéré comme un acte médical donc pas de rémunération
supplémentaire pour le personnel soignant
1
/
4
100%