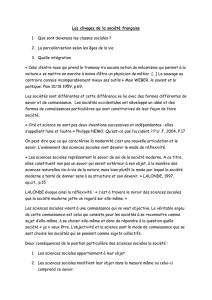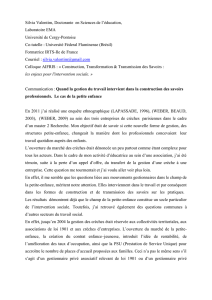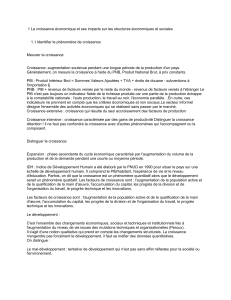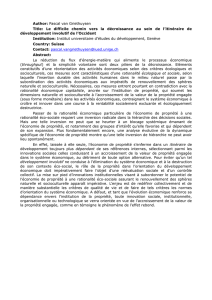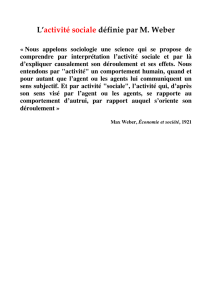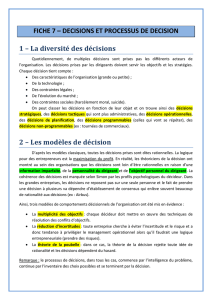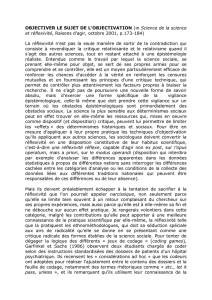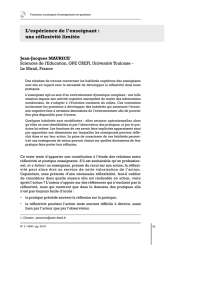Le monde de l`expertise

En guise de conclusion : les métamorphoses de l’expertise.
L’expert entre « intérieur » et « extérieur ».
Sans doute est-ce une des caractéristiques de l’Etat moderne que de s’être fondé sur le
développement de ce qu’on appelle aujourd’hui l’expertise. Impossible en effet de saisir le
développement de l’Etat sans prendre en compte l’énorme production cognitive qui en est
constitutive ; sans s’attacher également à mesurer le poids des savoirs qui, à l’image des
connaissances statistiques ou des connaissances hygiéniques, dès le 18e siècle, occupèrent une
place privilégiée au sein des dispositifs administratifs. Comment saisir aujourd’hui les
politiques publiques ou l’action publique sans s’interroger sur les savoirs qu’elles mobilisent
et, de ce fait, sur les acteurs qui les détiennent ou sur les formes dans lesquelles ils sont
générés ? Comment nier que les politiques économiques, la place qu’elles prennent au cœur
de l’action d’Etat, soient intimement liées au statut de la science économique - du moins
d’une de ses versions – et à la capacité qu’elle a eue de s’imposer comme science « dure » et
de trouver des relais institutionnels extraordinairement puissants, en particulier dans les
institutions internationales ?
Max Weber a donné à cette configuration alliant pouvoir et savoir son concept, celui de
« domination rationnelle-légale », insistant sur le fait que l’Etat moderne s’est constitué –
parallèlement d’ailleurs à la sphère économique- en s’appuyant sur un usage systématique
d’une forme particulière de rationalité, la rationalité en finalité à laquelle Weber identifiait
d’ailleurs la seule rationalité vraiment digne de ce nom. L’usage de cette rationalité, Weber le
situait avant tout au sein de l’administration. Il voyait le système administratif-bureaucratique
comme le prototype, le type idéal, de ce qu’il y a lieu d’entendre par domination rationnelle-
légale.
Weber nous apprenait toutefois peu de choses sur les formes et les lieux de production des
savoirs mobilisés par l’administration. En effet, depuis que les sciences ont commencé de
devenir des sources de la gestion d’Etat, leurs lieux de production n’ont cessé d’être
multiples, oscillant entre l’extérieur et l’intérieur et générant de multiples figures de
l’expertise.
On pourrait d’ailleurs penser que la figure même de l’expert s’est construite au cœur de cette
tension entre extérieur et intérieur. Contrairement à celui qui joue la seule scientificité, qui se
cantonne dans le monde des savoirs universitaires ou autres, l’expert est celui qui n’hésite pas
à proposer l’opérationnalisation de ses compétences et à offrir ses services au politique.
Jouant aux marges d’une extériorité qu’il pourra néanmoins faire valoir pour conserver une
image de « scientificité et d’indépendance », nécessaires à sa crédibilité, l’expert se distingue
de ce que j’appellerai ici le « fonctionnaire éclairé » sur lequel pèsera volontiers la suspicion
d’être trop « dedans » pour être suffisamment « savant » et réellement « indépendant ».
L’expert est celui que l’on vient consulter parce qu’il est suffisamment dehors pour offrir la
caution d’indépendance qui sied à la scientificité, mais suffisamment à proximité pour que
l’on puisse être convaincu que ses propositions seront opérationnalisables, qu’elles
n’apparaîtront pas comme des savoirs éthérés tels que peuvent en produire les « savants » ou
les « intellectuels ».
C’est dire à quel point la question de l’expertise est intrinsèquement attachée à cette question
du dedans et du dehors. A quel point, elle soulève parallèlement la question de la capacité de

l’Etat et de ses appareils administratifs de générer lui-même, en son sein, des dispositifs de
production d’une connaissance pouvant bénéficier d’un fort degré de scientificité et de
légitimité ; et celle des relations entre ce même Etat et les lieux « extérieurs » de production
des savoirs « exploitables », notamment mais de moins en moins exclusivement l’Université.
En soumettant à la réflexion la question de l’externalisation de l’expertise, nous ne pensions
donc pas mettre au jour un phénomène inédit. La question de l’expertise s’inscrit en soi au
cœur de cette tension entre « intérieur » et « extérieur ». Mais c’est précisément parce que
cette tension est constitutive du statut même de l’expertise qu’il nous semblait nécessaire de
réfléchir aux mutations dont elle est l’objet aujourd’hui, dans le contexte récent de la fin du
20e siècle et du début du 21e.
Etat réflexif et crise de l’expertise
Pour cerner ce contexte, de nombreux éléments pourraient être avancés. J’en citerai deux qui
me semblent importants, bien que leurs effets ne soient nullement convergents mais
contribuent plutôt à complexifier la question.
Le premier touche à l’évolution de l’Etat et de nos sociétés, dans leur ensemble d’ailleurs,
vers davantage de réflexivité. Le point est souligné par de nombreux auteurs. Peut-être est-ce
A.Giddens qui le défendit avec le plus de force, mais on en trouve somme toute déjà
clairement l’affirmation dans les travaux où Durkheim nous parle de l’Etat qu’il identifie au
cerveau d’une société qu’il compare alors à un organisme, parlant comme on sait, à propos
des sociétés modernes, de « solidarité organique ».
Le concept de « réflexivité » est polysémique. En un premier sens – qui était celui mis en
avant par Giddens- il vise à suggérer que nos sociétés s’appuient de plus en plus souvent pour
construire leur futur sur des dispositifs au travers desquels elles se donnent les moyens de se
connaître elles-mêmes. Cette première hypothèse est somme toute aujourd’hui devenue
banale. C’est pourquoi, quittant Giddens, je me tournerai plutôt, pour avancer dans mon
argumentation, vers les travaux de Scot Lash. Celui-ci rappelle que le concept de réflexivité
est un « vieux » concept philosophique, qui eut, jadis, dans la philosophie kantienne, un rôle
fondamental. Kant opposait en effet ce qu’il appelait les « jugements déterminants » aux
« jugements réfléchissants ». Si les premiers consistaient classiquement à partir de l’universel
pour en déduire le particulier, les jugements réfléchissants étaient ceux qui, à partir du
particulier saisissaient l’universel. Pour Kant, le jugement esthétique en était le prototype.
Pour lui, l’œuvre d’art était belle parce que, bien que particulière, elle avait la capacité
d’évoquer à son récepteur une Idée de la raison. Mais pour Kant, au-delà de la seule question
de l’esthétique, ce qui était en jeu dans la réflexivité c’était essentiellement la « faculté de
juger ».
Pour Lash, la montée de la réflexivité correspond donc aussi au déclin d’une certaine forme
de rationalité, qu’il identifie à la rationalité déterminante, et dont on peut trouver les
exemplifications les plus nettes dans les modèles scientistes ou positivistes du savoir, tels que
nous les avons hérité du 19e siècle mais tels qu’ils se déploient encore largement aujourd’hui.
Dans cette propension à penser le savoir scientifique sur le mode hypothético-déductif, ou
encore de lui affubler une prétention à la validité qui s’imposerait forcément au jugement.
La gestion d’Etat aujourd’hui peut de moins en moins s’appuyer sur les formes de la
scientificité à laquelle nous avait habitué une première modernité : celle d’une expertise sûre

d’elle-même, entendant donner des leçons aux politiques, s’exprimant au nom du Vrai. Le
passage à l’ère de la réflexivité est celle aussi du déclin de cette forme d’expertise,
s’exprimant au nom d’une science revendiquant eu égard à sa méthode et à son extériorité une
position de surplomb susceptible de clore les débats. La montée de la réflexivité correspond
aussi à une suspicion portée à l’assurance scientifique ou du moins à l’image de la science
telle que nous l’avions héritée du 19e siècle.
Les travaux de M. Callon et de B.Latour ont fortement insisté sur ce qu’on pourrait appeler à
la fois une crise et une pluralisation de l’expertise. Aujourd’hui, les situations se multiplient
en effet dans lesquelles les discours des experts se font résolument « cacophoniques ». Et cela
alors même que les enjeux soulevés par l’expertise se trouvent dramatisés : vache folle,
OGM,… Les avis des experts se pluralisent, requérant de plus en plus cette « faculté de
juger » en régime d’incertitude, à laquelle en appelait Kant. C’est là également une des thèses
défendues par U. Beck dans ses travaux sur la société du risque.
A cela s’ajoute un processus non négligeable que l’on désigne souvent en parlant d’une
montée de la société civile. Là, au sein du monde des associations, a commencé à se
développer un potentiel d’inventivité cognitive tout à fait original qui est loin d’être sans effet
sur ce que nous entendons par expertise. L’effet fut au moins triple. D’une part, il s’est agi de
montrer en quoi les formes dominantes d’expertises pouvaient être liées à des lieux de
pouvoirs, à des groupes d’intérêt, à des logiques de domination… Les exemples seraient
nombreux. On peut penser à la dénonciation de discours économique dominant par les
associations altermondialistes, Attac notamment. D’autre part, ces mouvements ont pu mettre
à l’agenda à la fois politique, mais aussi intellectuel, toute une série de concepts qui ont,
ensuite été repris et théorisé par les spécialistes des sciences de la société. Pensons ici au
thème de l’exclusion porté au départ par des associations comme ATD-Quart-monde. Enfin,
Le monde associatif a produit ses propres experts, pouvant, le cas échéant concurrencer les
experts patentés. Là, les formes et les limites de l’expertise, s’en sont trouvé éclatées. La
confrontation à des situations s’est de plus en plus imposée comme une source d’expertise
tout à fait légitime et mobilisable politiquement, en particulier lorsque les publics intéressés se
sont donnés les moyens de cette expertise.
Bref, le monde de l’expertise est aujourd’hui un monde complexe, traversé par de multiples
tensions, au sein duquel l’idée même d’expertise est l’objet de controverses.
Le monde de l’expertise
Alors que le monde l’expertise se pluralisait, alors que les images de la science se
problématisaient, de nouveaux intervenants sont apparus ces derniers temps.
a) C’est tout d’abord le monde des consultants privés. Surfant sur la vague du management et
de la managérialisation de l’administration publique, ils cherchent actuellement à occuper un
espace disponible. Celui de la commande publique, alors que la commande privée connaît
souvent dans leurs domaines une certaine saturation. Leurs atouts sont importants. Ainsi
prétendent-ils offrir de nombreux avantages : des savoirs directement opérationnels qui se
présentent comme des outils de décision ; une extériorité et des références qu’ils présentent
comme des gages de scientificité ; une efficacité dans le travail acquise par une grande
professionnalisation. Et, peut-être, surtout une grande docilité à l’égard de leurs
commanditaires.

b) Ce sont ensuite les multiples instances d’avis de consultation… créées, financées… par les
pouvoirs publics eux-mêmes et qui ont en charge des missions réflexives. Ce sont aussi ces
nombreuses instances qui, d’abord simplement associatives, se sont vues progressivement
confier, au regard de leur professionnalisme et de la reconnaissance obtenue par ailleurs, des
missions de service public. Entre le conseil, l’action sociale et l’expertise, ces multiples
instances forment une mouvance qui nourrit l’action publique.
Une tendance à l’externalisation
Comme je l’ai montré, le phénomène d’externalisation de l’expertise n’est pas nouveau,
même s’il prend aujourd’hui des formes inédites. Des lieux essentiels de production du savoir
–notamment les universités- existaient bien avant que les appareils administratifs ne se
développent. Toujours se sont donc organisées des transactions entre les milieux du savoir et
ceux du pouvoir. Le développement considérable des appareils administratifs s’est d’ailleurs
accompagné globalement d’un processus d’internalisation de l’expertise, les appareils d’Etat
se dotant des moyens de recueillir les données nécessaires à leurs pratiques administratives
(notamment les Instituts de statistiques, d’épidémiologie,…) ainsi que d’instances de
production de connaissances directement utiles (le Bureau du Plan…).
Il reste toutefois que l’on assiste aujourd’hui à des processus d’externalisation d’une ampleur
suffisante pour que le phénomène soit interrogé. Celui-ci est à la fois spécifique et général.
Spécifique, parce qu’existent manifestement certains domaines privilégiés d’externalisation
dans lesquels s’engouffrent des bureaux privés : ce sont principalement ceux qui gravitent
autour du management, de la gestion des ressources humaines, de l’audit ou de la consultance.
Le mouvement de managérialisation des administrations publiques s’est en effet accompagnée
très naturellement d’offres de services de bureaux privés en vue de promouvoir des formes de
gestion calquées sur celles du privé. En Belgique, la réforme Copernic dont l’horizon était
manifestement la transposition des logiques de management présentes dans le secteur privé
vers le secteur public, s’est, comme le montre l’article de V. Triest, accompagnée d’un appel
massif à l’expertise privée que ce soit pour la conception de nouvelles structures
organisationnelles, pour des activités de communication, ou pour l’organisation de procédures
de recrutement. Là l’externalisation a clairement pris les traits de la privatisation.
Toutefois le processus d’externalisation a une portée bien plus large, donnant alors naissance
à des solutions institutionnelles variables, dans lesquelles la privatisation ne fait figure que de
cas extrême.
Ainsi, la nouvelle gestion publique, mais aussi l’émergence de nouvelles questions ou de
nouveaux acteurs ont-elles généré de nombreux dispositifs bénéficiant par rapport aux
administrations classiques d’une extériorité plus ou moins grande. Ainsi, les processus
d’évaluation des politiques publiques ou les observatoires qui participent clairement de
l’avancée de la réflexivité nécessitent-ils, en quelque sorte par nature, un statut d’extériorité
(lié aux formes ou aux positions organisationnelles, à leur composition…) qui seul peut leur
conférer les garanties d’indépendance nécessaires à leur légitimité.

Sans doute est-t-il aussi plus polymorphe qu’il n’a jamais été.
1
/
5
100%