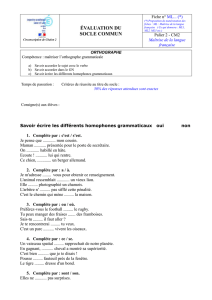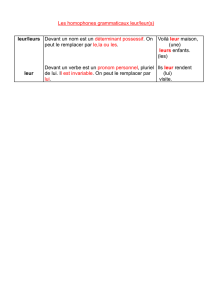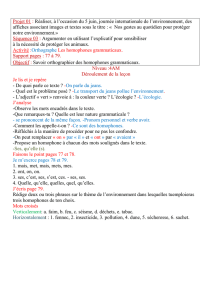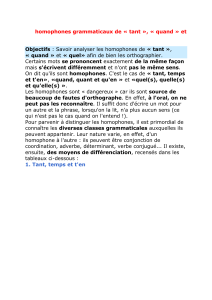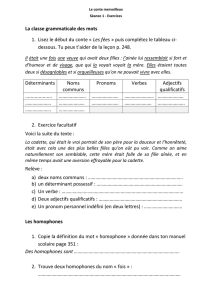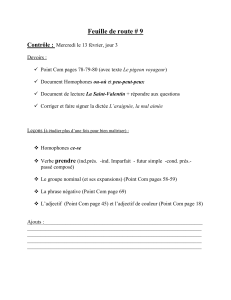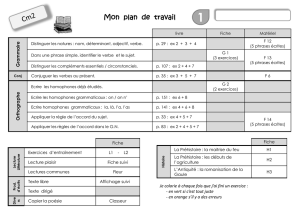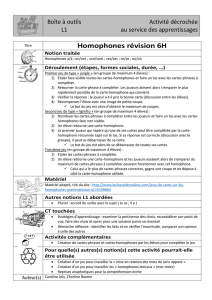Document

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007
Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 1/8
orthographe du CE1 au CM2
LES HOMOPHONES
1. L'homonymie et la polysémie
● Deux mots identiques (prononciation et orthographe) sont déclarés homonymes quand leurs
définitions n'ont aucun trait sémantique commun, ce qui entraine des synonymes différents,
des antonymes différents, des traductions différentes dans une langue étrangère, des
constructions linguistiques qui peuvent être différentes, des entrées différentes dans le
dictionnaire.
Exemples : le livre – la livre ; faire la grève – sur la grève ; le calcul – des calculs
● S'ils ont la même prononciation mais une orthographe différente, ils sont seulement
homophones.
Exemples : le saint – le sein – le seing – ceint
cent – sans – s'en – le sang – sens (dans « sens dessus dessous »)
● S'ils ont la même orthographe mais une prononciation différente, ils sont seulement
homographes.
Exemples : Les poules du couvent couvent – Ces fils sont pour la mère ou pour le fils ?
● On ne parle pas d'homonymie mais d'ambiguité quand le phénomène touche une expression
ou une phrase entière.
Exemple : La petite brise la glace / La petite brise la glace (verbe souligné).
● On parle de polysémie quand un même mot peut avoir plusieurs sens qui découlent les uns
des autres ; dans ce cas, les lexicographes qui fabriquent les dictionnaires décident de ne
faire qu'une seule entrée. On va retrouver des traits sémantiques communs entre les divers
sens, même si les mots ont des emplois différents. Exemple :
caisse 1) grande boite utilisée pour l'emballage
2) cylindre d'un instrument à percussion
3) coffre dans lequel on dépose de l'argent ; bureau où se font les paiements ; fonds
qui sont en caisse ; établissement où l'on dépose des fonds
Il peut être assez délicat parfois de savoir si on est devant un cas d'homonymie ou un cas de
polysémie: c'est le dictionnaire qui tranchera : une entrée = polysémie ; plusieurs entrées
(successives en cas d'orthographe identique ; éloignées pour les hétérographes) = homonymie.
2. les homophones et le lexique
Il n'y a pas de raison de travailler spécifiquement les homophones lexicaux ; mais il est important de
souligner la différence orthographique quand elle existe. Comme elle est souvent accordée à une
caractéristique de la famille de mots, c'est important à retenir comme moyen de trancher le doute
orthographique.
Exemples : le sang (sanguin) ; cent (une centaine) ; sans sucre
l'air et un air de musique (tous les autres mots de la famille commencent par aér-) ;
l'aire du carré et l'ère géologique (mots sans famille : les pauvres !)
le temps (la tempête) ; une piqure de taon ; il tend (tendre) son arc ; tant va la cruche
à l'eau...(autant)
si les poules... ; la note si ; une scie (scier) ; ci-dessus (ici) ; comme ci, comme ça
(ceci)
3. Les homophones et l'orthographe
informations pour le maître

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007
Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 2/8
Si les homographes posent un problème en lecture, les homophones en posent un en orthographe.
La langue française est très riche en homophones. S'il y a un domaine qui est particulièrement
touché par le phénomène de l'homophonie, c'est celui de la morphologie écrite du verbe.
Exemples : aime, aimes, aiment ; aimai, aimais, aimait, aimaient....
Or les manuels anciens ou récents ne traitent de l'homophonie qu'à propos de certains mots outils et
de quelques formes verbales seulement, probablement parce qu'ils s'agit de mots parmi les plus
fréquents..
a) Peut-on déterminer la liste des homophones à savoir orthographier en fin de cycle 3 ?: NON
Remarquons d'abord qu'il n'y a aucune liste exhaustive dans les programmes 2002, ; on ne trouve
qu'un début de liste (p.69 du BO hors-série n°1 du 14 février 2002) : « et/est ; ces/ses/s'est/c'est ;
etc. ». Même chose dans le brouillon du document d'accompagnement trouvé sur la toile (p.62) :
« c'est/ses/ces/sais/sait/s'est ; a/à/as/ah ; est/es/et/ai/eh/haie... et les autres homophones fréquents. ».
Et ces deux débuts de listes ne traitent pas de la morphologie verbale...
Sachons que la circulaire de 1977 sur l'enseignement de l'orthographe (Haby) demandait une
distinction acquise en fin d'école primaire pour a/à et on/ont, et une distinction en cours
d'acquisition pour ses/ces/c'est/s'est. Faut-il réellement avoir des ambitions supérieures à celles de
1977 sachant que les erreurs les plus fréquentes touchent les accords en nombre et en genre et les
finales des verbes en /E/ ?
b) Si on veut traiter des homophones fréquents pour prévenir les erreurs, il faut choisir entre les
démarches suivantes :
Deux conceptions s'affrontent. La première consiste à rapprocher les homophones pour
mieux les distinguer ; la seconde vise à les traiter séparément pour ne pas les confondre.
Examinons les arguments développés :
A) Rapprocher les homophones pour les distinguer
partir de la phonologie
B) Séparer les homophones pour ne pas les confondre
partir de la syntaxe
Les élèves qui commencent à écrire au cycle 2
n'ont pas encore mémorisé l'image
orthographique de tous les mots qu'ils utilisent.
On admet qu'en cas d'orthographe inconnue et
de non possibilité de copier le mot, ils
« inventent » l'orthographe en se basant sur la
prononciation, dans une opération inverse de la
lecture, leur faisant trouver une graphie à partir
d'une phonie. Un élève peut alors écrire
systématiquement mai (comme dans maison)
aussi bien pour mes que met ou mais.
Sans évidemment nier les erreurs
orthographiques des élèves du cycle 2, les
tenants de cette position considèrent que la
solution viendra de l'ancrage progressif de
chaque orthographe dans la structure syntaxique
correspondante et dans sa signification : si on
repère la structure syntaxique et si on tient
compte du sens, il n'y a aucune raison pour
rapprocher et confondre a et à (Gaston a fait une
dictée à l'école.)
On part donc de cette confusion de départ pour
faire des leçons sur les homophones permettant
ainsi aux élèves de constater qu'il y a plusieurs
orthographes et de savoir comment choisir la
bonne.
Les auteurs qui font ce choix se divisent encore
Les efforts consisteront donc à affiner la
conscience grammaticale des élèves et à faire
mémoriser l'orthographe de ces mots-outils
invariables chacun dans la construction
syntaxique qui lui est propre.

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007
Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 3/8
entre ceux qui présentent les homophones par
couples (les plus nombreux) et ceux qui
soutiennent qu'il faut les présenter tous à la fois
(voir le texte de Delsol cité en référence).
La manière va différer entre :
La manière va différer entre :
1) une démarche traditionnelle illustrée par la
plupart des manuels du CE2 à la 4ème de
collège : établir une procédure, généralement
une substitution (par exemple, avait à la place de
a), pour choisir entre les formes orthographiques
recensées ; appliquer immédiatement avec
quelques exercices à trous.
L'expérience montre que cette forme
d'enseignement qui vise la solution en occultant
le problème ne donne pas de grands résultats :
certains élèves font des erreurs dès les exercices
d'application qui suivent la leçon ; d'autres qui
réussissent les exercices n'appliquent plus la
règle en dictée ou dans leurs écrits.
Les manuels anciens et actuels présentent
généralement les homophones en couples, ce qui
incite les élèves à jouer à pile ou face dans les
exercices à trous ou à mettre l'autre forme à leur
disposition si une faute est signalée.
voir les extraits de manuels ci-dessous
1) une conception qui pense que l'analyse
grammaticale explicite de la phrase avec
l'étiquetage des différentes catégories permet de
régler le problème de l'orthographe.
Le rapport Bentolila de novembre 2006 sur la
grammaire correspond à ce point de vue ; p.21 :
« Il conviendra d'éviter de présenter des
ensembles d'homophones tels que sont/son,
c'est/ces/ses car cela introduit un doute
orthographique là où la grammaire n'en laisse
planer aucun ».
2) une démarche d'ORL : traiter le choix de la
bonne graphie comme une situation problème ;
trouver des moyens de distinguer les différents
cas qu'on classe et qu'on conserve comme outils
pour écrire et corriger par la suite.
Ici, on privilégie la réflexion et la prise de
conscience de l'existence d'une difficulté :
Voir, par exemple, la position de Michelle Ros-
Dupont qui critique l'opposition par deux des
homophones, insiste sur la correspondance entre
graphie et sens et propose le recours à une
situation problème de choix d'une graphie
(p.103-111 de son ouvrage « Observation
réfléchie de la langue »).
Voir également les propos de Catherine Brissaud
(n°440 des Cahiers pédagogiques p.47) qui
critique les manuels, prône une attitude réflexive
et recommande progressivité et patience pour
2) une conception ancienne, compatible avec les
démarches de l'ORL, qui consiste à penser que
la mémorisation implicite des structures
syntaxiques, et de l'orthographe des mots-outils
invariables dans ces structures, se fera par la
répétition et l'analogie.
C'est la position de Carole Tisset : « Nous
pensons qu'il faut absolument les séparer et
montrer, pour chacun, le mode de
fonctionnement et le sens en les appareillant non
à des homophones, mais à des équivalents
syntaxiques (p.210-213 de son ouvrage
« Observer, manipuler, enseigner la langue »).
voir ci-dessous
C'est aussi celle plus ancienne de Noelle Rollant
(guide méthodologique des fichiers CE2 et CM
Orthogammechez Nathan, p.24) : « Nous

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007
Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 4/8
l'accession à une certaine maitrise.
risquons, en proposant aux enfants ces
rapprochements d'homophones, de les
confronter à des difficultés qu'ils n'avaient peut-
être même pas soupçonnées ! C'est pourquoi il
convient de traiter séparément chaque
logogramme, mais en relation avec la catégorie
grammaticale à laquelle il appartient et en
liaison avec le contexte sémantico-syntaxique
dans lequel il apparait. »
Des exemples d'extraits de manuels :
Il faut reconnaître que les manuels actuels ont tendance à donner pour chaque couple
d'homophones une phrase exemple (on se rapproche de B2), une procédure de substitution à
appliquer sans réfléchir (typiquement A1), une explication avec la catégorie grammaticale (plutôt
B1). Exemples :
● Facettes CM1 (Hatier 2006) memento p.17
a
Le Petit Poucet a tout compris.
a : c'est le présent du verbe avoir, à la 3ème personne du
singulier. On peut le remplacer par l'imparfait (avait).
à
Le Petit Poucet écoute à la porte.
à est un mot qui sert à relier d'autres mots. C'est une
préposition.
ont
Les crapauds ont un pouvoir magique.
ont : c'est le présent du verbe avoir, à la 3ème personne du
pluriel. On peut le remplacer par l'imparfait (avaient).
On
On réalise une bande dessinée.
on peut désigner plusieurs personnes, ensemble ou
isolément. On emploie souvent on pour nous.
● Littéo CM1 (Magnard 2004) manuel p.214 (aide-mémoire)
a
3ème personne du singulier du verbe avoir au présent
Il a une voiture.
On peut le mettre à l'imparfait : avait.
à
Prépositionqui qui permet de faire des relations avec les
mots.
une tasse à café
penser à Noël
ont
3ème personne du pluriel du verbe avoir au présent
Elles ont peur.
On peut le mettre à l'imparfait : avaient.
on
Pronom personnel
On s'amuse bien.
La proposition de Carole Tisset :
La préposition à est introduite dans un corpus de groupes du nom avec complément (ces termes ne
sont pas nécessairement prononcés), puis dans des phrases avec compléments de verbes et de
phrase. Donc le mot à est associé à des structures syntaxiques, il est comparé à d'autres mots
comme de, en, vers, par, pour... ; son sens et son rôle dans la phrase sont discutés. A aucun moment
il n'est rapproché du mot a.

Groupe ORL Passy (74) les homophones année scolaire 2006-2007
Fichier rédigé par Françoise Drouard 13-12-2006 MDL C3 ORL fichier 18 page 5/8
Le choix qui est fait ci-dessous est de ne pas faire exister les homophones en tant que catégorie
à étudier. Chacun des mots qui possède un ou plusieurs homophones se trouve mis en réseau non
avec ses homophones mais avec les mots qui ont une fonction et une place comparables aux
siennes, dans la phrase. En cycle 3, à l'occasion des phrases du jour (phrase dictée avec
orthographe à trouver ; phrase donnée avec orthographe à corriger ou à justifier), on pourra
rencontrer des mots qui possèdent un ou plusieurs homophones et activer ces réseaux à chaque
occasion.
Exemple de traitement de quelques homophones fréquents :
CE1
CE2 et CM1
CM2 ou collège
On relève dans les textes lus des
expressions ou des phrases qui
servent de modèles pour écrire.
On corrige des phrases rédigées et
on les ajoute aux listes.
On enrichit les listes ouvertes et on
les restructure. On en ouvre d'autres
en travaillant (observation,
classement, manipulation) sur des
corpus établis par l'enseignant. On
fabrique des outils pour écrire et
corriger.
On continue ce qui a été
commencé, on élargit à
d'autres exemples plus
complexes, on met les
étiquettes et on formule
explicitement.
a, est,
c'est, sait,
met...
Liste de phrases simples avec un
verbe à la 3ème personne du
singulier
Conjugaison des verbes avoir et
être
Phrases interrogatives avec « est-ce
que... ? »
Phrases avec présentatif :
« c 'est... »
À continuer et à utiliser pour
travailler
- en conjugaison ;
- sur les types de phrases
as, es,
sais..
Rencontre possible dans des
dialogues ou pour écrire à un
proche
Liste de phrases simples avec un
verbe à la 2ème personne du
singulier
Conjugaison des verbes
ont, sont,
Liste de phrases simples avec un
verbe à la 3ème personne du pluriel
À continuer et à utiliser pour
travailler en conjugaison ; repérage
Une proposition de travail pour les homophones grammaticaux au cycle 3
C'est la position que j'adopte :
il faut associer étroitement le sens et la forme ;
il faut rapprocher ce qui est comparable et renforcer ainsi le raisonnement par analogie
qui est si puissant dans l'apprentissage implicite de la langue ;
démarrer des collections que l'on complétera au fur et à mesure permet de revenir
régulièrement sur ce qu'on étudie (on sait tous combien il est important de répéter pour
faire mémoriser l'orthographe) ;
ces collections servent d'outils pour écrire et corriger : leur consultation pour faire des
exercices d'entrainement ou pour nettoyer un texte ou corriger une dictée fait partie de la
répétition qui renforce l'apprentissage ;
ces collections peuvent servir de corpus à réorganiser et à résumer par une étiquette ou
une règle en fin de cycle 3 ou au collège, si la compétence orthographique est déjà
installée, au moins partiellement, chez les élèves.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%