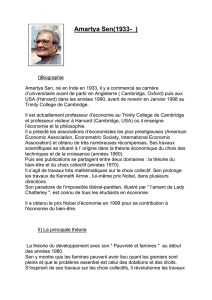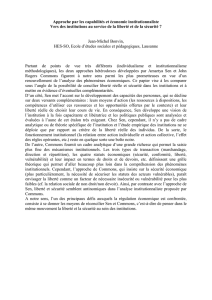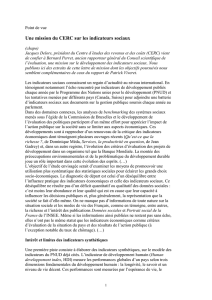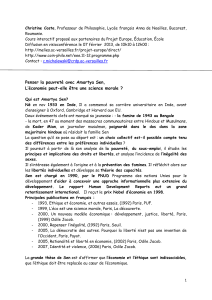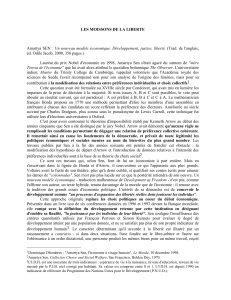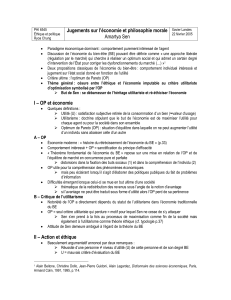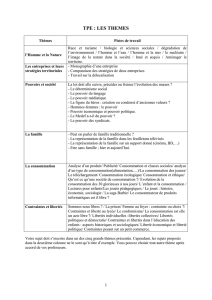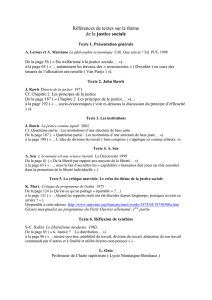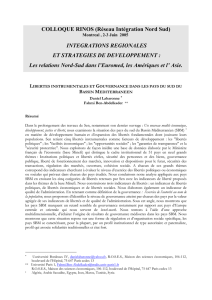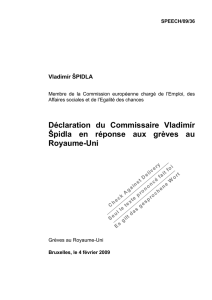Sen A.

Sen A. (1999), Un Nouveau Modèle Economique. Développement,
justice, liberté, Odile Jacob, 2003.
Amartya SEN : sa vie, son œuvre. Fiche réalisée par Anne-Charlotte
MOUGENOT.
Chapitre 2 : Les Fins et les Moyens du développement. Fiche réalisée par
Sarah ZOUAK.
Chapitre 3 : La liberté et les fondements de la justice. Fiche réalisée par
Chloé LESCARRET.
Chapitre 4 : La pauvreté comme privation de capacités. Fiche réalisée par
Laura DAVY.
Chapitre 5 : Marché, État et opportunités sociales. Fiche réalisée par Laura
GERON.
Chapitre 7 : Famines et autres crises. Fiche réalisée par Lola DUBOSC.
Chapitre 8 : Le rôle actif des femmes et le changement social. Fiche
réalisée par Camille GUEUCIER.
Chapitre 9 : Population, ressources alimentaires et liberté. Fiche réalisée
par Marie TAMARA.
Chapitre 10 : Culture et droits de l’homme. Fiche réalisée par Sébastien
HERVO.
Amartya SEN: sa vie, son œuvre.
Fiche réalisée par Anne-Charlotte MOUGENOT.
I/ Courte biographie et parcours professionnel de Sen
Amartya Sen est né le 3 novembre 1933 à Santiniketan, en Inde. Il a d’abord
étudié les mathématiques et la physique à Presidency College à Calcutta, puis la
philosophie et l’économie à Trinity College. Après avoir enseigné l’économie à
Trinity, London School of Economics puis Oxford, et jusqu’en 1998 il a été
professeur d’économie à la prestigieuse université d’Harvard. De 1998 à 2004, il a
été directeur du Trinity College à l’université de Cambridge.
Son implication internationale est notamment marquée par sa contribution à
la fondation en 2003 du « Collegium international éthique, politique et

scientifique », association qui s’engage à apporter des réponses intelligentes et
appropriées aux nouveaux défis de l’humanité.
En 1998, Sen est lauréat du prix Nobel d’économie pour sa contribution à
l’économie du développement et du bien-être.
En 1999, il reçoit le Ratna, la plus haute distinction civile indienne.
En 1999 il est fait citoyen d’honneur du Bangladesh par le Premier Sheikh
Hasina en reconnaissance de ce qu’il a accompli en gagnant le Prix Nobel, et étant
donné que les origines de sa famille se trouvaient au Bangladesh. C’est également
en 1999 qu’il publie Un nouveau modèle économique (dont le titre original est
Development as freedom), où il reprend en douze chapitres les idées principales de
six conférences qu’il a données. Il y étudie la fonction de certaines libertés
instrumentales importantes et de leurs interconnexions (parmi lesquelles les
opportunités économiques, les libertés politiques, les dispositions sociales, les
garanties de transparence et la sécurité protectrice).
II/ Principaux travaux de Sen
Sen est présenté comme un économiste du développement. Pourtant, telle
n’était pas sa prétention initiale. Ce sont les questions concrètes du développement
qui ont renforcé sa conviction qu’il fallait penser l’économie en prenant en compte
les libertés individuelles : considérer Amartya Sen comme un économiste du
développement, c’est accepter que les questions éthiques sont pertinentes pour
juger des questions de développement.
Son étude porte à la fois sur la famine, la théorie du développement humain,
l’économie du bien-être, les mécanismes fondamentaux de la pauvreté, les
inégalités entre les hommes et les femmes et sur le libéralisme politique.
On peut distinguer deux moments dans les travaux de Sen.
D’une part, du début des années 1970 jusqu’au milieu des années 1980, il
enrichit la théorie du choix social (élaborée par l’économiste américain Kenneth
Arrow en 1963, qui a pour objet d'analyser la relation entre préférences
individuelles et décisions collectives et de déterminer s'il est possible de dériver des
préférences individuelles les préférences collectives) et aux questions d’inégalité.
Sen a montré sous quelles conditions le théorème d’impossibilité d’Arrow (démontré
en 1951, selon lequel aucune règle de choix social ne satisfait l’universalité,
l’unanimité, l’indépendance des alternatives non disponibles, la transitivité et
l’absence de dictateur) pouvait se résoudre. En 1981, dans Poverty an famines: an
essay on entitlements and deprivation, il montre que la famine n’est pas seulement

due au manque de nourriture mais aussi aux inégalités provoquées par les
mécanismes de distribution.
D’autre part, de 1980 à nos jours, il approfondit son analyse de ces
questions éthiques avec la philosophie politique et morale. Dans son article
«Equality of what », il propose une approche par les capabilités (qui désignent la
liberté réelle qu’a un individu de choisir une façon de vivre dans une situation
donnée) : sa conception d’une société juste est une société qui doit offrir à chacun
un même ensemble étendu de capabilités. Le projet de cette approche est de relever
les défis laissés par le welfarisme et le libertarisme, et de proposer un espace
d’évaluation de certaines questions normatives en mettant en avant les questions
nécessaires à de tels jugements (le bien-être individuel n’est pas fondé sur l’utilité
mais sur la liberté individuelle). Or une théorie de la justice doit inclure des
considérations d’agrégation mais aussi de distribution.
Enfin, Sen a inventé des méthodes pour mesurer la pauvreté qui permettent
d’obtenir des informations essentielles pour améliorer la condition des pauvres : il a
ainsi contribué à la mise au point de l’indice de développement humain.
Ainsi, Amartya Sen défend « une approche particulière du développement,
conçu comme le processus d’expansion des libertés substantielles dont les
gens disposent. La liberté y apparaît à la fois comme le but et comme un moyen
du changement.» L’analyse du développement exige une approche qui intègre les
rôles respectifs des diverses institutions (administration, associations, structures
législatives, judiciaires ou liées au fonctionnement du marché) et leurs interactions.
La formation des valeurs, l’émergence et l’évolution d’une éthique sociale sont aussi
des composantes du processus de développement.
III/ Quelques citations extraites d’Un nouveau modèle économique
« Surmonter ces handicaps –privations en tous genres, misère et
oppression, non-respect des droits des femmes ou de leur rôle, détérioration de
notre environnement…- est une tâche centrale pour le développement. Je
montrerai dans ces pages que nous devons prendre en pleine mesure le rôle des
libertés –et des libertés de toute sorte- pour combattre ces maux. »
« Nous ne devons pas perde de vue que notre liberté d’action est
nécessairement déterminée et contrainte par les possibilités sociales, politiques
et économiques qui s’offrent à nous. »
« La liberté apparaît comme la fin ultime du développement, mais
aussi comme son principal moyen. Le développement consiste à surmonter

toutes les formes de non-libertés, qui restreignent le choix des gens et réduisent
leur possibilité d’agir. La suppression de ces non-libertés est, selon la thèse
défendue ici, constitutive du développement. »
Dans la préface, Sen expose ainsi l’idée des libertés individuelles comme
élément essentiel du développement.
Chapitre 2 : Les Fins et les Moyens du développement
Fiche réalisée par Sarah ZOUAK
Sen distingue deux attitudes contradictoires dans le processus de
développement.
Le développement vu comme un processus brutal (« sang, sueur, larmes »),
où il faille une rigueur et une discipline au moment présent, pour pouvoir espérer
plus tard des aides sociales pour le peuple. Et le développement au sens de
processus essentiellement compréhensif, tel la promotion des échanges, pour par
exemple, pouvoir se développer au niveau social.
Sen rejoint plutôt l’idée d’un développement vu comme un processus
essentiellement « compréhensif ». Où le développement serait un processus
d’expansion des libertés réelles dont les personnes peuvent jouir.
Il définit l’expansion des libertés comme fin première, (« rôle constitutif ») et
également comme moyen principal pour accéder au développement (« rôle
instrumental »).
Le « rôle constitutif » concerne la liberté substantielle, facteur important pour
l’amélioration de la vie des êtres humains. Il entend par liberté substantielle, les
capacités élémentaires, c'est-à-dire le fait qu’il n’y ait pas de problème de famine, de
malnutrition ou au contraire qu’il y ait une libre expression dans le pays par
exemple.
Ici le développement s’accompagne de l’expansion des libertés fondamentales
et se ramène en même temps au processus même d’expansion des libertés.
Ainsi après en avoir fait la distinction, dans ce chapitre Sen se penche plutôt
sur l’efficacité de la liberté comme moyen. Il se demande comment différents
éléments liés à la liberté, nous amène au développement. Et insiste sur les
interactions entre les cinq différents types de libertés qui par divers chemin
entraînent le développement.

Pour expliquer de phénomène instrumental, il nous expose cinq types de
libertés, sur lesquelles il faut se concentrer individuellement, mais également en
établir les liens, pour une meilleure compréhension, car elles se complètent.
Sen distingue les libertés politiques, qu’il définit comme l’ensemble des
possibilistes offertes aux individus, aussi bien pour choisir entre divers partis
politiques, pour voter, ou encore pour déterminer qui gouverne et selon quel
principe. Les facilités économiques qui représentent les opportunités offertes aux
individus d’utiliser les ressources économiques à des fins de consommation, de
production ou d’échanges. Les opportunités sociales, c'est-à-dire les dispositions
prises par une société en faveur de l’éducation, de la santé ou d’autres postes et qui
accroissent les libertés qu’ont les personnes pour mieux vivre. Les garanties de
transparence, qui permettent de lutter contre la corruption ou l’irresponsabilité
financière par exemple. Et enfin la sécurité protectrice qui subsiste aux personnes
les plus vulnérables.
Ces libertés précédemment développées améliorent la capacité des individus
et entretiennent des relations de réciprocité permettant leur propre renforcement.
Ainsi la création d’opportunités sociales tel le développement de l’éducation
publique, ou des services de santé, entraînent une baisse du taux de mortalité et de
meilleures conditions de vie. Et cette baisse du taux de mortalité, améliore les
conditions de natalité, qui eux mêmes renforce le développement de l’éducation.
C’est en ce sens qu’on peut parler d’interconnexions et de complémentarités
entre ces différentes libertés.
Il illustre cela en prenant le cas du développement d’opportunités du Japon,
notamment pour l’éducation. Ainsi, au Japon, la qualité de ses ressources
humaines, dépendant de l’éducation ou de la santé, a permis le développement
économique. Sen nous explique que le « développement humain », n’est pas
seulement réservé aux pays riches. Que différents chemins mènent au
développement, et selon les facteurs qui nous permettent celui-ci, une
interconnexion renforce le plus souvent le processus.
Sen développe ensuite, les multiples disparités entre la Chine et l’Inde, qui
sont dans un processus d’ouvertures de leurs économies, et présentent leurs
différences en terme de maturités sociales (taux d’alphabétisation, conditions
sanitaires, démocratie, famine…).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%