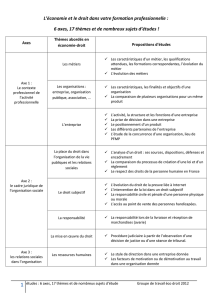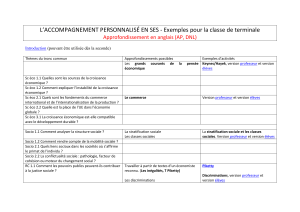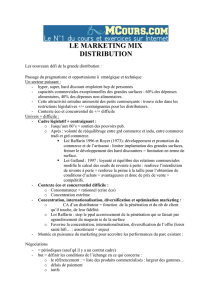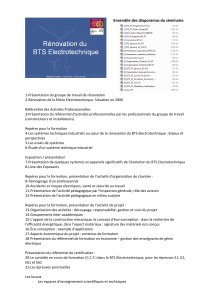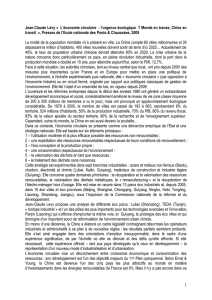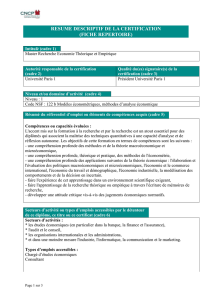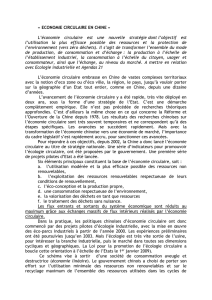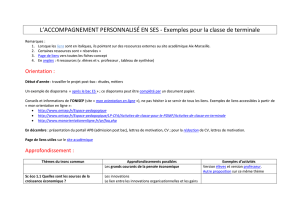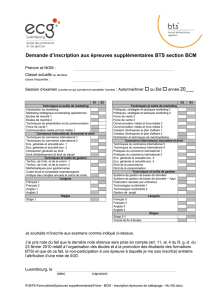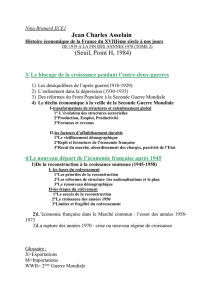Le marché des biens et services

1
Le marché des biens et services
Principes d’analyse économique du sport
I. Première approche de l’économie du sport
1) Définition de l’économie du sport
A. L’économie en générale :
Comprendre le comportement des différents agents.
3 notions :
- Ressources rares
Ménage → revenus de leur travail limité, ressources limitées
Entreprises → facteur de production (travail et capital)
Collectivités → impôts (taxes et cotisations divers…)
Pour chacun il y a une rareté des ressources.
- Choix : Comme il y a une rareté des ressources il va falloir faire des choix
Pour les ménages → panier de consommation (différent en fonction des ressources)
Pour les entreprises → production (biens et services)
Pour les collectivités → choix entre différents projets.
- Rationalité (= homoeconomicus)
Pour les ménages → maximiser l’utilité
Pour les entreprises → maximiser le profit
Pour les collectivités → maximiser l’utilité sociale (cad mieux pour l’ensemble de la pop°)
B. L’économie du sport :
2 approches :
- Secteur économique :
Le sport ce développe, et engendre des transactions, il soutend certains marchés.
- Analyse éco :
Analyse des relations entre les différents acteurs et du fonctionnement de cette économie et de son
comportement. Ce n’est plus de quantifier des flux, c’est de comprendre comment fonctionne l’éco du
sport. On va analyser les dépenses des ménages…
Pour cela on va s’aider des modèles fait par des économistes. On va se servir comme dans une boite à
outils.
Cf livres : « Que sais-je ? Eco. Du sport » W. Andreff, J.F. Nys ; « Analyse économique du sport » J.J. Huguet, J. Bourg
C. Emergence de l’analyse éco du sport
Depuis longtemps il y a de l’argent dans le sport.
En 1950 apparition de l’analyse éco du sport .
Le sport moderne est apparu grâce à la puissance de l’éco ds la société. Avec le développement des
médias ds le sport en 1970 le sport se rapproche de l’éco. Ainsi de part sa dimension éco plus importante,
les économistes se sont intéressés au sport.
En 1956, ROTTENBERG donne la 1ere analyse sur le sport pro aux States.

2
Entre les années 1950-1970 en Europe (Allemagne, Italie et France), on s’intéresse à l’économie du sport
en réaction à la dimension marchande de la société montée en puissance de l’économie avec l’arrivée
massive d’argent dans le sport.
Pour la France, 1977 C. HALENFANT-DAURIAC écrit sur le « Compte Satellite du Sport ».
→ au niveau de l’organisme INSEE, ils ne considéraient pas le sport comme secteur éco. à part entière. Il
était rattaché à d’autres secteurs.
Solution → il fallait rechercher dans chaques secteurs la part du sport. Pour chiffrer on va mesurer
différentes valeurs (PIB sport…), c’est l’agrégat.
Comme on utilise les mêmes façons de chiffrer les comptes que l’INSEE, on peut donc comparer par
autres chiffres de l’INSEE. En 1979 le sport représente 1%.
On a ensuite créé des observatoires éco. du sport.
Résonnement ≠ de celui de l’INSEE par le calcul de l’éco du sport.
1998-2000 : orientation du MSJS vers une cellule statistique. Ils établissent un indicateur de cadrage du
sport.
1994 : sur le plan européen, on a un rapport de Wladimir ANDREFF pour le conseil de l’Europe.
☺aujourd’hui il existe le Livre Blanc du sport en Europe, il donne les orientations du sport en Europe
pour les prochaines années.
Au plan régional, les Conseils économiques et sociaux régionaux ont commandé des études sur le poids
éco du sport dans la région. Comme membre il y a le CROS (c’est eux qui ont demandé cette étude).
1977 : Di Ruzza et Gerbier écrivent un livre sur le ski pro. et sa relation avec l’éco, « Ski en crise ».
1977-1978 : création du Centre de Droit et d’Ėconomie du Sport (CDES).
D. Principales thématiques en éco du sport.
Aux USA l’éco du sport se résume au sport pro.
En Europe tout ce qui concerne le sport relève de l’éco du sport.
→ ≠ thématique :
- Eco. public du sport
on va essayer de comprendre les subventions des collectivités (par exemple)
- Eco. de la conso sportive
on va analyser la conso. des biens et services par la pratique.
- Sport et développement éco. régional
on va voir l’influence de l’impact éco. d’un événement sportif sur un territoire.
- Eco. industrielle du sport
on va s’intéresser à analyser les ≠ marchés des biens et services, et la stratégie des entreprises.
- Eco. du travail sportif
C’est principalement sous l’angle de travail pro.
- Eco. internationale du sport
on va essayer d’analyser le commerce international de la France et les stratégies des firmes
internationales.
E. Les principaux chercheurs en économie du sport.
Europe :
S.KESENNE (Belge)
S.SZYMANSKI (Anglais)
W.ANDREFF (français, père de l’économie du sport), économie politique
J.F. NYS (Français), économie santé des services, il fait le lien entre le sport et la santé.
J.F. BOURG (Français), analyse le marché des sports.

3
J.F. GOUGUET (Français), analyse étude éco. régionale et urbaine.
C. SOBRY (Français), socio éco. du sport.
J.F. RAZE (Français), étude sur les lieux propices d’implantation des structures.
D. CHARRIER (Français), socio du sport.
I.A.S.E. (Association Internationale de Sport et d’Ėconomie)
Il y a des réunions qui permettent d’envisager des collaborations entre économistes. C’est ainsi
qu’apparaît les premières comparaisons entre éco Europe/USA…
Différentes revues J.S.E. (plan internationale), RJES (plan français), REMS (revues européenne de
management du sport)…
F. Les ≠ niveaux d’analyse éco du sport
On peut les regrouper suivant 2 niveaux :
a. Micro économie
On se place sur un point de vue individuel. Elle permet d’observer des phénomènes au niveau des unités
élémentaire de production (entreprises) ou de conso (le ménage), elle s’attache à analyser des quantités
individuelles.
L’individualisme méthodologique consiste à analyser la conso de chaque individu.
L’instrument au centre de cette approche est le marché.
Plus le prix est élevé, plus la quantité est grande.
On va ensuite faire l’analyse de la demande des consommateurs.
Le prix est faible → le consommateur va en conso d’avantage.
Le marché c’est le lieu de rencontre de l’offre et de la demande.
Au point E se qui est mis sur la vente par les entreprises est acheté par les conso.
L’offre est trop importante par rapport à la demande → on va avoir un retour vers le point E (qui est un
point d’équilibre) b. Macro économie
Elle permet d’observer des phénomènes au niveau des groupes de sujet éco. (individus ou firmes réunient
en catégories homogènes), elle porte sur la quantité globale appelée aussi agrégats.
Le holisme s’oppose à l’individualisme
Il faut partir de la société pour caractériser les individus.
Le circuit éco
On a des groupes (ménages, entreprises) ou agents éco.
Μ ↔ Ε le circuit éco étudie les flux entre les ≠ catégories d’agents éco.
c. Méso économie
Des chercheurs de l’INSEE qui ont mis cette approche, qui est ente les 2 autres. C’est une approche par
filières (6 ou 7).
G. Les difficultés rencontrées par les chercheurs
Le problème de la définition du sport
La difficulté liée au manque d’information sur le sport. Trop peu de statistiques. Il n’existe pas de
base de données sur l’éco du sport.

4
II. Le circuit économique
Il s’agit de s’efforcer de donner une vue d’ensemble de l’activité éco. à partir du concept de circuit éco. A
l’arrière plan des multiples actes quotidiens de la vie éco., il y a une réalité essentielle, tous les actes
s’ordonnent pour constituer un circuit éco.
La vie éco d’une société adopte un processus circulatoire comparable à la circulation du sang dans le
corps humain.
La description du circuit éco exige que soient regroupés auparavant les agents éco : se sont les secteurs
institutionnels. Chacun d’eux regroupe des agents ayant un comportement analogue caractérisé par une
fonction principale (F.P.) et des ressources principales (R.P.).
1) les secteurs institutionnels
Secteurs institutionnels
Fonctions principales
Ressources principales
Sociétés et quasi-sociétés non
financières SQSNF
Production de Biens et
Services à l’exclusion de
services non financiers
destinés à la vente = B & S
marchands (c.a.d qu’ils vont
être vendus sur le marché à
un prix sup au coût de
revient)
Résultats de la vente
Institutions de crédits
(Banques ) ;(opérations
financières = objet même de
leurs activités)
Centraliser les capitaux
disponibles et les redistribuer
en finançant l’éco :
collecter
transformer
répartir les
disponibilités
financières
Intérêt et dividendes (actions) perçus.
Entreprises d’assurances
Assurer : garantir un
paiement en cas de
réalisation d’un risque
Primes contractuelles
Administrations publiques
(A.pu), (fournissent des
services ne faisans pas l’objet
habituellement de
transactions, ils apparaissent
gratuits aux utilisateurs. Ces
services sont appelés non
marchand par opposition aux
services marchand (ceux-ci
relèvent des sociétés).
Il y a 3 niveaux d’A.pu :
centrales (état,
ministère, DRDJS...)
locales (conseil
régional, général,
EPCI, communes)
Produire des services
non marchands pour
l’ensemble de la
collectivité.
Effectuer des
opérations de
redistribution des
revenus et de la
richesse nationale.
Versements obligatoires (impôts, taxes
en tout genre)

5
de sécurité sociale)
Administrations privées
(organisme privés sans but
lucratif = secteur associatif)
Produire des services non
marchands réservés à des
groupes particuliers de
ménages (licenciés,
adhérents)
Contributions volontaires (Adhésions,
cotisations)
Ménages (= l’ensemble des
individus en tant que
consommateurs, mais aussi en
tant que producteurs
(entrepreneurs individuels))
Consommations et en tant
qu’entrepreneurs individuels,
produire des B & S
marchands non financiers
Rémunérations
Transferts (redistribution des
richesses d’A.pu en aides,
subventions…)
Revenus de la vente
(entrepreneurs individuels)
Reste du monde (retrace les
opérations entre unités
résidentes et unités non
résidentes)
Le circuit éco qui s’établit entre ces différents secteurs institutionnels est extrêmement complexe et pour
comprendre la logique du circuit nous allons le simplifier à l’extrême dans un premier temps.
2) Le circuit éco simplifié en éco non monétaire
On va simplifier le circuit éco. de 2 manières :
Point de vue des secteurs institutionnels, on considère que l’éco. se compose de 2 groupes
d’agents éco :
- le groupe des entreprises
- le groupe des ménages
Point de vue ??????????? les opérations décrites concernent seulement l’intérieur du territoire
national, on parle d’éco fermée
D’autre part uniquement les opérations de productions et de consommation sont prises en compte, on
écarte provisoirement l’épargne et l’investissement.
a) Le circuit éco dans une éco non monétaire
Les flèches mentionnées sur le schéma concernent uniquement les flux réels, c’est à dire des B&S.
1 facteurs de production (force de travail)
Entreprises
Ménages
4 Dépense Nationale
3 Revenu National
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%