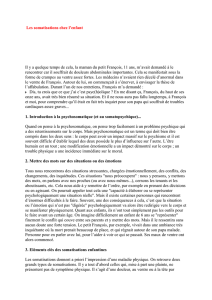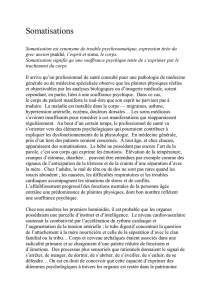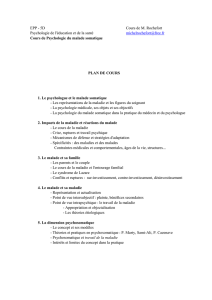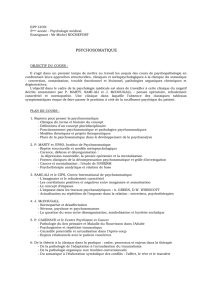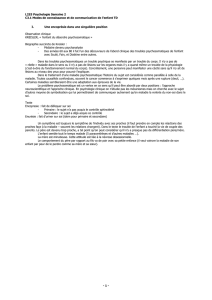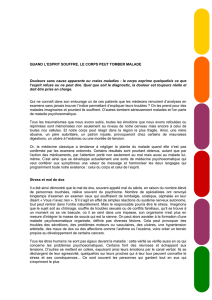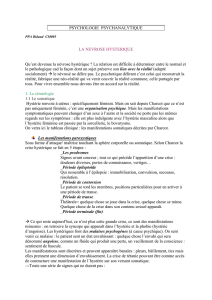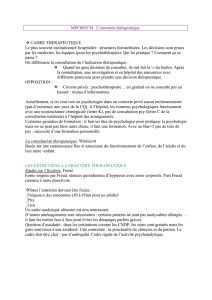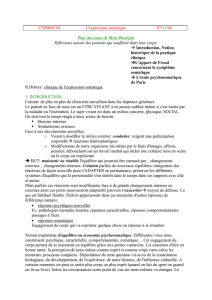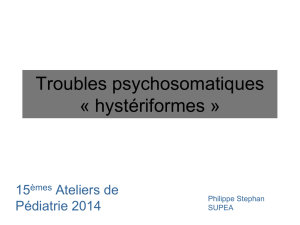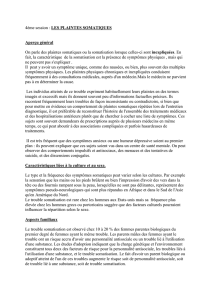Anne Lise LEBEAU – Les somatisatons

AL Lebeau : Somatisations
AFDG – Lettre de Psychogériatrie - 2011 Page 1
Les somatisations
Lebeau Anne-Lise
5
Points clés :
La personne âgée se plaint énormément de douleurs physiques Ces douleurs
physiques sont en réalité des liés à des troubles psychiques on appelle cela les
somatisations. Or on les rencontre énormément chez la personne âgée.
10
MOTS CLEFS: Psychisme- soma- conflits- souffrance.
Qu’est ce que la somatisation ? Ce
15
concept de « somatisation » est récent,
en effet il n’apparaît pas dans les
dictionnaires avant les années 1980. De
façon simple, la somatisation peut se
définir de la sorte : c’est un trouble
20
psychique qui se transforme en trouble
somatique. Dans la même lignée, Le
petit Robert la définit ainsi : « rendre
somatique un trouble psychique ». De
façon plus approfondie, la somatisation
25
rend compte d’un processus par lequel
l’expression du conflit psychique se fait
dans et par le corps. L’être humain n’a
pas un corps et un esprit, il est tout
entier un être psychosomatique.
30
De ce point de vue ce sont des
traumatismes que le sujet n’a pas pu se
représenter qui viennent se jouer dans
le corps. Il faut savoir que la
somatisation touche tout le monde, elle
35
n’a pas d’âge. Elle touche aussi bien le
nourrisson, l’enfant, l’adulte ainsi que le
sujet âgé. Nous somatisons tous un jour
ou l’autre ; par exemple, lorsque nous
sommes confrontés à un oral d’examen,
40
nous contractons bien souvent des
maux de ventre ou des diarrhées. Mais
lorsque les somatisations deviennent
permanentes, le sujet va alors
développer un mécanisme de
45
dénégation qui est en lien avec le fait
que la somatisation représente un mode
de défense du Moi. Le processus de
somatisation fait irruption lorsque le
sujet est incapable de traiter
50
mentalement les conflits qui pèsent sur
lui. (1).
Selon Yves Ranty, il existerait trois
grandes catégories de somatisations :
les somatisations fonctionnelles, les
55
somatisations conversionnelles, et les
somatisations lésionnelles. D’après lui,
les somatisations fonctionnelles « sont
des perturbations des fonctionnements
somatiques, en règle générale
60
réversibles et ne s’accompagnant pas
de lésions des organes. » (1). Les
somatisations conversionnelles sont
représentées par l’hystérie de
conversion. Cette dernière est définie
65
par Yves Ranty « comme étant une
névrose où le conflit psychique se
transpose dans l’innervation somatique

AL Lebeau : Somatisations
AFDG – Lettre de Psychogériatrie - 2011 Page 2
en donnant des symptômes moteurs
(paralysies, contractures) ou sensitifs
(douleurs, anesthésies). » (1). Enfin, les
somatisations lésionnelles sont traduites
par Yves Ranty comme étant un groupe
5
d’affections où il existe des lésions
organiques, mais dans lesquelles les
facteurs psychiques sont non seulement
favorisants mais aussi déterminants. »
(1).
10
Historique :
L’histoire des somatisations
L’homme depuis toujours se sert de
son propre corps pour transmettre ses
15
émotions (désirs, peur, désespoir,
violence) ; de nos jours on dira
simplement qu’il somatise. Comme le
souligne Yves Ranty, les somatisations
existent depuis la nuit des temps. Elles
20
sont déjà présentes à l’aube du monde
mais nommées différemment selon les
cultures et les époques qu’elles ont
traversées. Ainsi on parle d’esprits dans
les sociétés primitives, d’humeurs et
25
d’atrabile durant l’antiquité Grecque, de
possessions par les démons avec la
période biblique, d’envoûtement au
Moyen Âge. Les traitements de ces
somatisations changent aussi beaucoup
30
et sont largement influencés par les
avancées de la médecine. (1)
La théorie des Humeurs d’Hippocrate
(IVème avant JC) est reconnue pour
être à l’origine de la médecine
35
psychosomatique. En effet, pour
Hippocrate, la santé repose sur un
équilibre des humeurs nommée la
crase. Il existe de ce point de vue quatre
humeurs : le flegme, le sang, l’atrabile et
40
la bile, qui correspondent aux quatre
éléments de la nature : air, terre, eau,
feu. Elles correspondent aussi aux
qualités : froid, chaud, humide, et sec
ainsi qu’aux organes : cerveau, cœur,
45
rate, foie. Ainsi la maladie ou dyscrasie
provient soit d’un excès, soit d’une
insuffisance, soit d’un déplacement
d’une humeur, ce qu’explique bien Yves
Ranty. Claude Galien (I siècle après JC)
50
reprend la théorie des quatre humeurs
d’Hippocrate, selon lui ces dernières
représentent également quatre
tempéraments : sanguins (personne
chaleureuse et aimable), flegmatiques
55
(personne lente et apathique),
mélancoliques (personne triste et
déprimé) et enfin colériques (personne
emportée et prompte à réagir)
60
La psychosomatique ;
les différentes théories :
Freud s’est beaucoup intéressé à
l’hystérie particulièrement au début de
sa vie. C’est notamment à partir de
65
l'étude de l’hystérie, ainsi que des
travaux sur les paralysies et sur
l’aphasie, qu’il découvre la dynamique
de l’inconscient. Dans son œuvre
Études sur l’hystérie (2), il expose sa
70
théorie selon laquelle l’origine de
l’hystérie est à rechercher dans les
conflits infantiles refoulés dans
l’inconscient. Les symptômes de
l’hystérie sont le résultat de la
75
transformation, de la conversion d’une
excitation corporelle en innervation
somatique.
Freud souligne deux formes
d’hystéries : l’hystérie d’angoisse dont le
80
symptôme majeur est la phobie, les
troubles fonctionnels étant la
manifestation somatique d’angoisses
non représentées, et l’hystérie de
conversion où les représentations
85
sexuelles refoulées s’expriment par le
corps. Par conversion Freud entend une
transposition d’un conflit psychique et

AL Lebeau : Somatisations
AFDG – Lettre de Psychogériatrie - 2011 Page 3
une tentative de résolution de celui-ci
dans les symptômes somatiques
(moteurs : paralysie ou sensitifs :
anesthésie ou douleurs localisées).
Freud a donc beaucoup travaillé sur la
5
conversion hystérique où, comme on
vient de le voir, le corps exprime des
représentations refoulées. Toutefois,
pour Freud, le trouble ou symptôme
somatique seul est dénué de sens ; en
10
effet, selon lui il attaquerait le corps et
ainsi pourrait le conduire jusqu’à sa
perte. Rosine Débrayage explique que
c’est une logique du corps située
topiquement hors psyché.
15
Ainsi, même si Freud ne s’est pas
beaucoup intéressé à la
psychosomatique, il en paraît tout de
même son investigateur.
20
Georg Groddeck, médecin et
psychanalyste allemand, est aussi un
psychothérapeute original pour son
temps : il ouvrit un sanatorium à Baden
Baden en 1900 où ses méthodes de
25
traitements étaient plutôt atypiques pour
l’époque. En effet ses traitements
étaient fondés sur l’hydrothérapie, le
régime alimentaire, les massages ainsi
que sur des entretiens entre soignants
30
et soignés. On comprend donc qu’il a
très vite admis l’importance du corps
dans la thérapie et le fait que le soma et
la psyché soient complètement liés.
C’est pourquoi il est souvent désigné
35
comme le père de la psychosomatique.
Il invente le concept du ça que Freud
reprendra quelques années plus tard
dans sa deuxième topique en 1920.
C’est dans son œuvre, Le livre du ça
40
(3), qu’il présente son concept du ça
dans une correspondance fictive. « Le
ça est un principe vital, universel et
unificateur animé d’une force
symbolisante, un message codé qui
45
obéit aux même lois que le rêve. » (4).
« Le ça vit l’homme ; c’est la force qui le
fait agir, pense, grandir, être bien
portant et malade en un mot qui le vit. »
(3). Le ça est une instance qui décide
50
de tout chez le sujet, qui « décide du
vêtement que l’on portera aujourd’hui ou
demain. » (3)
Il entretiendra une correspondance
pendant de nombreuses années avec
55
Freud. Dans sa première lettre à Freud
du 27 mai 1917 il écrit : « La conviction
s’était arrêtée en moi que la distinction de
l’âme et du corps est uniquement une
distinction de mots, non pas d’essence ;
60
que le corps et l’âme sont quelque chose de
commun ; qu’il s’y trouve un ça, une force
par laquelle nous sommes vécus cependant
que nous croyons vivre.[…] en d’autres
termes, j’ai refusé d’emblée la séparation de
65
maux du corps et maux de l’âme ; j’ai tenté
de traiter l’être individuel en soi, le ça en
lui. » (5)
Pour lui, il n’existe pas de maladie
psychique pas plus que de maladie
70
physique car corps et âme tombent
malades conjointement. Il a donc
largement contribué à ouvrir une voie
psychosomatique.
75
Frantz Alexander est à l’origine de la
théorie de la spécificité, et de la
correspondance qui définit qu’à chaque
émotion correspond un symptôme
spécifique (par exemple la migraine
80
correspondrait à l’obsession).
Comme Freud, cet auteur différencie
la maladie somatique de la conversion
hystérique. Cette dernière n’a pas de
lésion anatomique mais pour lui le
85
symptôme à une valeur symbolique. La
somatisation en revanche est en deçà
du symbolique. Cela rend compte d’un
processus par lequel l’expression du
conflit se fait dans et par le corps.
90

AL Lebeau : Somatisations
AFDG – Lettre de Psychogériatrie - 2011 Page 4
Ce sont des traumatismes que le sujet
n’a pas pu se représenter tandis que
dans la conversion il y a eu
représentation.
A Chicago, là où il s’est installé après
5
avoir beaucoup voyagé, il développe
l’un des principaux courants du
freudisme américain connu aujourd’hui
sous le nom d'École de Chicago.
L'École de Chicago (dont les origines
10
remontent aux années 1930) a mis
l’accent sur l’existence d’un lien
structurel entre certaines personnalités
et des maladies organiques ; par
exemple il semble y avoir une
15
« fréquence des traits dépressifs chez
les gens souffrants de la vésicule
biliaire. » (6). A cette époque, il semble
que tous les efforts soient centrés sur le
souci d’établir des liens entre maladies
20
et personnalités.
D’ailleurs, à cette même période
Flanders Dunbar, élève et ancienne
analysée de Frantz Alexander, a décrit
des profils de personnalité. Elle décrit
25
par exemple le profil psychologique des
diabétiques qu’elle établit à partir de six
rubriques qui sont les suivantes :
hérédité, état de santé antérieur, vie
familiale, attitudes hors de la maison,
30
comportement individuel, réaction à la
maladie. (7). Mais Alexander réfutait
cette notion de profils de personnalité ;
cependant il a souligné une corrélation
entre somatisations et types de conflits
35
psycho-émotionnels qu’il a appelée
« constellation Psychodynamique ».
Pour chaque situation émotionnelle de
base existe un syndrome de
modifications corporelles, c’est à dire de
40
réactions psychosomatiques (le rire, les
pleurs, le changement du rythme
cardiaque).
La théorie du stress à été élaborée
45
en 1956 par le médecin physiologiste
canadien Hans Selye et exposée dans
son ouvrage Le stress de la vie(8).
Néanmoins cette théorie a été facilitée
par les recherches antérieures de
50
Walter Cannon (1871-1945). Selye
définit le concept de stress comme étant
un état de tension aiguë de l’organisme,
obligé de mobiliser ses défenses pour
faire face à une situation menaçante. Le
55
mécanisme physiologique de défense
est désigné par le syndrome général
d’adaptation (SGA). En s’inspirant de
Walter Cannon, il mentionne trois
phases d’adaptation générale de
60
l’organisme qui sont :
La phase d’alarme ; la phase de
résistance ; et enfin la phase
d’épuisement. Avec ce concept de
maladie de l’adaptation, il influence
65
largement les recherches suivantes.
Enfin, Pierre Marty prône l’abandon
de la dichotomie psyché/soma
impliquant que l’individu humain doit
70
être appréhendé comme un tout ; « une
totalité complexe dont l’équilibre général
résulte d’une infinité d’ajustements,
variés et variables dans le temps. » (7).
Il fonde en 1958 l'École de Paris avec
75
ses collègues Christian David, Michel
Fain, Michel de M’Uzan, Léon Krersler
et Michel Soulè. Pierre Marty apporte un
nouveau point de vue sur la
psychosomatique notamment avec son
80
concept de mentalisation. C’est une
idée qui reposerait sur la façon dont
l’individu gère ses excitations. Marty est
aussi à l’origine du concept de la
pensée opératoire qui deviendra vie
85
opératoire quelques années plus tard.
Le concept de vie opératoire est un
mode de pensée linéaire. Quelque
chose au niveau du fantasmatique est

AL Lebeau : Somatisations
AFDG – Lettre de Psychogériatrie - 2011 Page 5
court-circuité. Le sujet va se centrer sur
le concret, le factuel, l’actuel. On
observe également chez ce sujet une
pauvreté de la rêverie. « Les activités
fantasmatiques et oniriques permettent
5
d’intégrer les tensions pulsionnelles et
protègent ainsi la santé physique
individuelle. La pensée opératoire qui met
en évidence la carence fonctionnelle de ces
activités va naturellement de pair avec des
10
perturbations somatiques. » (9).
De même on lui doit le concept de
dépression essentielle emblématique de
la théorie psychosomatique. C’est une
dépression sans signes
15
psychopathologiques visibles. On
emploie souvent le terme de
« dépression silencieuse », et
effectivement cette dépression passe
inaperçue. On la repère après coup et
20
on constate qu’elle a précédé les
troubles somatiques. Le risque de
dépression essentielle et donc de
somatisation existe, a minima, chez tout
un chacun.
25
Ainsi le symptôme corporel est donc
la traduction d’une souffrance psychique
non mentalisée, traduction d’un
traumatisme tardif qui fait écho à des
traumatismes anciens en les
30
réactualisant.
Faire parler son corps plutôt que dire,
exprimer sa souffrance est quelque
chose qui est présent depuis l’aube des
temps. Et tout cela s’explique par le fait
35
que l’être humain est un être tout entier
psychosomatique. Or, pendant
longtemps, on a cru en la dichotomie
psyché/soma et ce n’est que récemment
que l’on a compris le lien indissociable
40
du corps et de l’esprit ; ainsi tout paraît
plus clair et plus saisissable.
REFERENCES:
45
1- Ranty, Y, (1994), Les Somatisations,
Paris, l'Harmatan Ed, 292p.
2- Freud, S, (1867), Études sur
l'hystérie, Paris Presses Universitaires
50
de France Ed 2002, 254 p.
3-Groddeck, G, (1923), Le livre du ça,
Paris, Gallimard Ed, 326p.
4-Kamieniecki, A, (1994), Histoire de la
psychosomatique, Paris, Presses
55
Universitaires de France Ed, 128 p.
5-Groddeck, G, (1977), ça et moi, Paris,
Gallimard Ed, 235 p.
6-Alexander, F, (1950), La médecine
psychosomatique, Paris, Payot Ed,
60
335p.
7-Debray, R, Dejours, C, Felida, P,
(2005), Psychothérapie de l’expérience
du corps, Paris, Dunod Ed, 170p.
8-Seyle, H, (1962), Le stress de la vie,
65
Paris, Gallimard Ed,400p.
9- Marty, P, (1990), La
psychosomatique de l’adulte, Paris,
Presses Universitaires de France Ed,
127 p.
70
1
/
5
100%