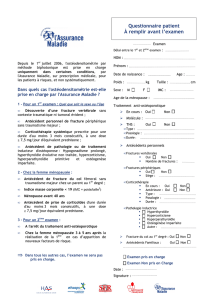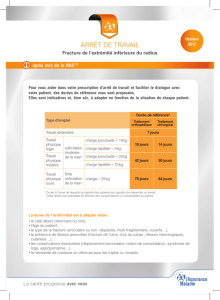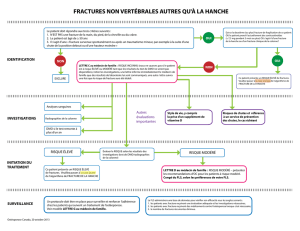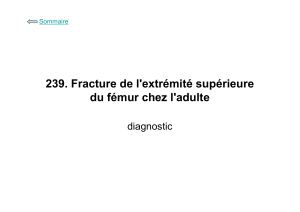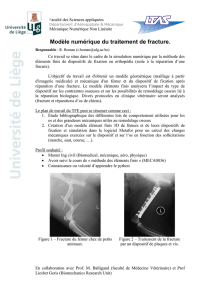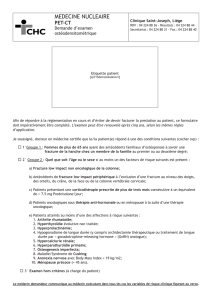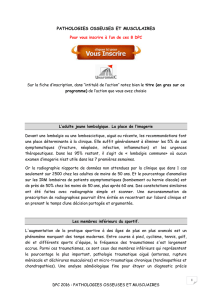UV_506_TRAUMATO_SPE_EQUIT

1
TRAUMATOLOGIE
UV 506
TRAUMATOLOGIE
SPECIFIQUE
Equitation
P. PILARDEAU

2
DE L’EQUITATION
L’équitation compétitive comprend trois épreuves, le dressage réalisé dans un manège de 60 m
x 20 m, le saut d’obstacle et le concours complet réalisé en extérieur sur des obstacles fixes.
A ces épreuves comptant pour le championnat, il faut ajouter l’équitation de loisir (promenade,
randonnée, chasse à courre, polo, horse-ball, rodéo..) et de travail (corrida à cheval, gardien de
troupeau, nomadisme…).
La traumatologie habituellement rencontrée dans ce domaine a pour origine les chutes ou les
rencontres brutales avec le cheval (coup de tête ou de cul), et les lésions microtraumatiques
secondaires aux mouvements très spécifiques du cheval lors de la marche (déplacement en 8 de
chiffre), du trot (succession de mouvements verticaux plus ou moins rapides) et du galop
(mouvements antéro-postérieurs sensiblement asymétriques).
La traumatologie dépendra donc du cheval (race) et/ou du cavalier (niveau de pratique).
= Cheval
Certaines races sont connues pour leur caractère fantasque et leur difficulté à accepter
à toute heure les consignes du cavalier. Les chevaux arabes et les poney shetlands sont réputés pour
leur caractère parfois ombrageux. Les étalons et les juments en chaleur sont sujets à de brusques accès
d’excitation , parfois peu compatibles avec le maintien d’une position classique.
De la race, dépend également le “ confort ” sur le cheval. Les chevaux long-jointés
(selles français, barbes, arabes sont particulièrement souples, tandis que les camarguais, les anglo-
normands, cobs, doubles poneys sont court-jointés et donc très raides.
Cheval court jointé Cheval long jointé
= Cavalier
Le niveau de pratique du cavalier joue également un rôle fondamental dans le risque de chute
d’une part, mais aussi sur les pathologies en rapport avec les contractions musculaires secondaires au
stress.
1 - Pathologie en rapport avec la biomécanique du couple cavalier/cheval
Les mouvements répétitifs des membres supérieurs et inférieurs, mais aussi du bassin pour
donner l’impulsion et diriger le cheval sont à l’origine d’une pathologie microtraumatique variée dont
on retiendra : le kyste synovial du poignet, la capsulite sacro-iliaque, la coxarthrose de hanche,
l’induration périnéale et la maladie de Scheuermann.,
+ Kyste du poignet
Le kyste du poignet correspond à un épanchement de liquide synovial dans un espace clos
constitué d'une gaine ou d'une capsule articulaire.

3
= Etiologie
Le kyste survient le plus souvent de façon inopinée, chez une cavalière jeune, sportive. Il est
rarement possible de retrouver la cause déclenchante de cette lésion (stage intensif, changement
d’enrennement, cheval difficile...).
= Diagnostic
. Examen clinique
Le kyste est placé sur la face dorsale du poignet (la localisation palmaire est exceptionnelle).
Sa consistance est ferme et son volume très variable (d'un noyau d'abricot à un noyau de pêche). Cette
tuméfaction est indolore dans la majorité des cas, mais sa taille peut se révélée gênante lors de la
flexion dorsale du poignet. Pendant les phases inflammatoires le kyste peut être chaud et rouge mais
son aspect n'évoque jamais celui d'un abcès).
. Examen radiologique
L'échographie montre clairement le contenu liquidien de cette cavité et sa limitation par la
gaine d'un tendon.
= Traitement
. Ecrasement. Le plus efficace est l'écrasement par surprise lors de l'examen. Cette
rupture traumatique brutale par pression du pouce laisse persister pendant plusieurs jours une solution
de continuité capsulaire permettant l'évacuation du liquide synovial. Les récidives sont exceptionnelles
après cette manœuvre.
. Ionisations. On utilise de la calcitonine placée au pôle plus de l'électrode. Ce
traitement a pour objectif de traiter la membrane synoviale, et notamment les processus d'excrétion et
de réabsorption de cette membrane.
. Chirurgie. Elle consiste en une exérèse capsulaire large ou en une synoviectomie
suivant la lésion concernée. Le risque majeur après cette intervention est la récidive du kyste.
. Ponction/infiltration. Ce type de traitement est inefficace.
+ Capsulite des sacro-iliaques
= Etiologie
La capsule enfermant l'articulation sacro-iliaque, ainsi que les ligaments qui la renforcent
peuvent être l'objet de stimulations microtraumatiques répétées du fait de l'activité physique. L’écart
facial a minima réalisé sur la selle en équitation, potentialisé par le trot assis est suffisant pour
déclencher cette pathologie. Il s’agit de mouvements associant des déplacements suivant un axe
vertical (amplitude physiologique), et des contraintes latérales. La sommation de ces deux types de
mouvements crée des phénomènes de torsion, particulièrement préjudiciables à ces articulations. Les
sacro iléites post traumatiques (réceptions brutales lors d’un saut), bien que possible, sont d’une moins
grande fréquence.

4
= Diagnostic
. Examen clinique
La cavalière, consulte pour des douleurs postérieures, latérales et hautes du bassin.
L'interrogatoire montre le caractère inflammatoire de ces douleurs qui s'accompagnent presque
systématiquement d'un déverrouillage matinal. L'examen du sujet debout de dos, met en évidence des
douleurs à la palpation des deux sacro-iliaques (l'atteinte unilatérale est exceptionnelle). Les
mouvements de flexion et surtout d’hyperextension du tronc sont douloureux, de même que les
rotations effectuées jambes légèrement ouvertes. A l’examen, la simple pression des doigts en regard
des articulations sacro-iliaques provoque la douleur et confirme le diagnostic. Les douleurs sacro-
iléales sont plus fréquentes chez les femmes (sacrum plus horizontal que les hommes). Le surpoids
joue un rôle important dans l’apparition de ces douleurs (encaissement de forces plus importantes lors
du simple déplacement bipède).
. Examen radiologique
La radiographie présente peu d’intérêt, si ce n’est pour mesurer de profil l’inclinaison du
sacrum par rapport à l’horizontal, et s’assurer que le processus n’a pas engendré l’apparition précoce
d’une arthrose sacro-iléale. Il est important de demander au radiologue des incidences sacro-iliaques.
Ces dernières enfilent parfaitement l'articulation. A un stade précoce les radiographies sont strictement
normales. A un stade plus tardif, l'interligne apparaît flou et irrégulier, avec parfois des signes
débutants d'arthrose.
= Traitement
Le traitement nécessite une mise au repos jusqu'à disparition des douleurs. Le traitement
comprend deux parties essentielles, la première consiste à diminuer l’inflammation locale par la
pratique d’ultrasons, d’infrarouges, de massages superficiels et/ou d’anti-inflammatoires non
stéroïdiens par voie buccale, la seconde à diminuer les microtraumatismes en perdant du poids, mais
aussi en changeant son type de monte (privilégier la monte en suspension au trot et au galop).
Chez le cavalier professionnel, on pourra équiper le cheval de protections en Podiane entre
le sabot et le fer (en ferrant à froid naturellement).
+ Coxarthrose de hanche
La constitution d'une coxarthrose uni ou bilatérale est un phénomène particulièrement fréquent
chez le cavalier. La littérature donne à ce phénomène chez ces sujets une fréquence deux à trois fois
plus importante que dans la population sédentaire.
= Etiologie
Il peut s'agir d'une étiologie micro ou macrotraumatique.
. Macrotraumatique
La coxarthrose peut s'installer après une fracture du cotyle ou une atteinte de la tête fémorale
secondaire à une chute.
. Microtraumatique
C'est l'origine la plus fréquente. On distingue les atteintes sur hanche saine de celles réalisées
sur une hanche dysplasique (défaut de couverture, coxa valga), ou pathologique (épiphysiolyse,
ostéonécrose).

5
L'installation de cette arthrose débute précocement (35 à 45 ans). Elle s'aggrave d'autant plus
vite que l'activité en cause est continuée.
= Diagnostic
. Examen clinique
Le diagnostic est, soit posé de manière fortuite à la suite d'une radiographie du bassin, soit
évoqué devant des douleurs de hanches. Dans ce dernier cas le cavalier consulte pour des douleurs de
type mécanique, survenant à la monte ou pendant son activité et se prolongeant de plus en plus
longtemps après son arrêt.
L'examen recherche un trouble statique (longueur des membres inférieurs, genu varum). Les
amplitudes articulaires sont souvent faiblement réduites à ce stade, mais douloureuses en fin de course
(rotations externe et interne, flexion).
. Examen radiologique
L'examen radiographique du bassin et des hanches confirme le diagnostic. Il peut montrer:
. Une ostéophytose périphérique simple, sans remaniements osseux
importants. Cette ostéophytose, dite en collerette, peut se manifester très précocement chez les
footballeurs et les activités pratiquées en charge (force athlétique).
. Un pincement de l'interligne, souvent accompagné d'une réaction osseuse du
cotyle (densification, ostéophytes).
. Une atteinte dégénérative plus évoluée comprenant des remaniements
osseux, des géodes et une perte des principales caractéristiques physiologiques de l'articulation.
= Traitement
Il n'existe pas de traitement radical de la coxarthrose autre que la prothèse totale de hanche.
Cette dernière permet la reprise de l’activité.
Avant cette alternative la progression de la maladie arthrosique peut être freinée par:
. La monte de chevaux souples
. La mobilisation en piscine de l'articulation
. La pratique d'une kinésithérapie destinée à lutter contre l'enraidissement, la fonte
musculaire et d'éventuels phénomènes inflammatoires.
+ Induration périnéale
= Etiologie
Les indurations périnéales sont des tuméfactions douloureuses apparaissant chez le cavalier
pratiquant régulièrement son activité. Inconnues chez l'enfant dont le poids est insuffisant pour
provoquer ce type de callosité, elles se rencontrent chez l'adolescent avec une relative fréquence.
= Diagnostic
L'examen clinique met en évidence au niveau du périnée (rarement dans l'axe) une
tuméfaction calleuse, sensible à la pression, faiblement ou non inflammatoire.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%