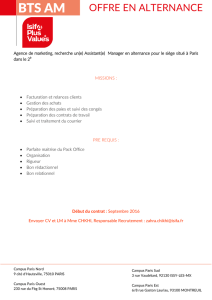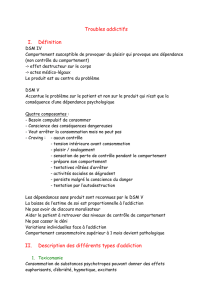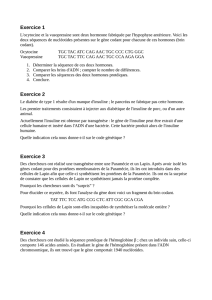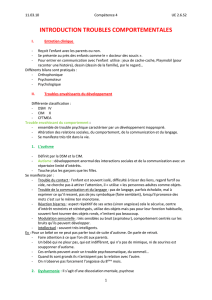Mardi 17 octobre 2006

L
L’
’i
in
nc
cl
lu
us
si
if
f
La veille des personnes ayant des incapacités
Mardi 17 octobre 2006
Numéro 246
Aujourd’hui en veille
o Plan d’action de la Ville de Montréal sur l’accessibilité universelle
o Vivre avec un trouble grave de comportement
o Critique du DSM à l’événement DSM-V
o La vie après un traumatisme crânien
o Manifestation à Gallaudet University
Plan d’action de la Ville de Montréal sur l’accessibilité universelle
La Presse publie aujourd’hui une lettre de madame Marie-Andrée Beaudoin, membre du
comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement social et
communautaire. Celle-ci répond à l’article publié le 27 septembre dernier sous le titre
« Montréal toujours inopistalier aux handicapées ».
Madame Beaudoin reproche à l’auteure de l’article de laisser entendre que la Ville de
Montréal n’a rien fait entendre pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant des
incapacités. Selon l’auteur, la réalité est toute autre. Pour illustrer son propos, elle cite
initiatives que son administration a mis en œuvre depuis les dernières années ;
investissement de 4m$ pour rendre accessible universellement les bâtiments municipaux,
mise en place du site « accès simple », formation des directions d’arrondissements à
l’accueil des personnes ayant des incapacités. Malgré les initiatives, madame Beaudoin
convient que du chemin reste à faire.
Dans une réplique à cette lettre, Sara Champagne souligne que, bien qu’elle n’ait pas
reniée les efforts de la Ville de Montréal, elle a voulu donner la parole à un représentant du
Regoupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain qui lançait un défi de
marcher à Montréal les yeux bandés. De plus, elle rappelle que seulement 1 édifice sur
10 répond aux besoins des personnes ayant des incapacités.
Une vision orientée
La Presse,.lundi 16 octobre 2006, p. A20
Par Marie-Andrée Beaudoin
(Édition papier seulement)
Vivre avec un trouble grave de comportement
Paru mardi 17 octobre 2006 sur Cyberpresse.ca/La Presse

Le mardi 17 oct 2006
On peut intervenir pour atténuer l'impact des troubles graves du comportement
Montréal
Des stratégies d'intervention et des outils visant à atténuer l'impact des troubles graves du
comportement seront exposés aujourd'hui (mardi) lors d'une conférence tenue à Montréal.
Dans le cadre de cette conférence présentée au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau,
des experts expliqueront qu'il est possible de vivre avec un trouble grave du comportement
si les intervenants et les personnes concernées travaillent à réduire son intensité, sa
fréquence et son impact.
Ils exposeront ce qu'ils ont appris de la clientèle en déficience physique, notamment chez
les victimes de traumatisme cranio-cérébral.
On estime que de 50 à 98 pour cent des victimes de tels traumatismes présentent des
troubles du comportement.
Dans la majorité des cas, ces troubles sont qualifiés de majeurs en raison de leur
chronicité, de leur persistance et de leur intensité.
Le trouble grave du comportement est un processus complexe résultant d'une interaction
entre des facteurs personnels, des changements que la personne a subis et des
changements dans son environnement causant des émotions fortes, du clivage, de
l'épuisement et un important investissement de ressources.
Denis Godbout, neuropsychologue, affirme que les personnes qui en souffrent font
habituellement face à un rejet social ou à un refus de services, qu'elles sont une menace
pour l'intégrité d'autrui ou pour elles-mêmes, qu'elles font face à des procédures judiciaires
et que leurs comportements nécessitent un encadrement très serré.
Paru mardi 17 octobre 2006 sur CNW - Telbec
A l'attention du directeur de l'information et aux rédacteurs de la chronique santé:
Vivre avec un trouble grave du comportement : Difficile mais possible
MONTREAL, le 17 oct. /CNW Telbec/ - Selon l'Organisation mondiale de la
santé, plus de 25% de la population mondiale va souffrir un jour ou l'autre de
troubles mentaux ou de comportements. Ces troubles peuvent être liés à des
diagnostics de santé mentale, neurologique ou plus largement physique. Dans le
cadre de la conférence présentée aujourd'hui, les experts du Programme pour
les personnes présentant un trouble grave du comportement (TGC) exposeront
davantage ce qu'ils ont appris de la clientèle en déficience physique (leur
spécialisation), notamment chez les victimes de traumatisme cranio-cérébral
(TCC) ayant des TGC. La question du processus d'interaction produisant le TGC

et l'approche de collaboration pour y faire face seront explorés, illustrés
par un exemple d'application du processus clinique en quatre étapes. Des
stratégies d'intervention et des outils cliniques seront présentés afin
d'atténuer l'impact des TGC et intervenir adéquatement dans ce contexte.
Problématique du TGC
De 50% à 98% des victimes de TCC présentent des troubles du comportement.
Dans la majorité des cas, ces troubles sont qualifiés de majeurs en raison de
leur chronicité, de leur persistance et de leur intensité. Le TGC est un
processus complexe résultant d'une interaction entre des facteurs personnels,
des changements que la personne a subis et des changements dans son
environnement causant des émotions fortes, du clivage, de l'épuisement et un
important investissement de ressources. "Les personnes ayant un TGC font
habituellement face à un rejet social ou à un refus de services, sont une
menace pour l'intégrité d'autrui ou pour elles-mêmes, font face à des
procédures judiciaires et leurs comportements nécessitent un encadrement très
serré" explique Denis Godbout, neuropsychologue. La présence du TGC réduit
ainsi la qualité de vie de la personne comme celle de son entourage et devient
un obstacle majeur à la réalisation de ses habitudes de vie.
Vivre avec un TGC : possible ou non ?
Les intervenants spécialisés du Programme pour les personnes présentant
un TGC du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau travaillent étroitement et en
soutien dans l'élaboration des plans de services individualisés gérés par les
établissements tels les CLSC, CHSLD, centres de réadaptation, organismes
communautaires, etc. Leur approche en est une de collaboration allant de
l'évaluation initiale, de la formulation des hypothèses causales en vue
d'élaborer des interventions et de mesurer l'évolution de la personne. "Vivre
avec un TGC devient possible si tous travaillent à réduire l'intensité, la
fréquence et l'impact du TGC. Le mot "tous" implique les intervenants, les
proches et bien entendu la personne atteinte" précise Michel Deschênes,
psychologue.
Selon le protocole de recherche sur la définition du TGC auprès des TCC,
le TGC est un ensemble d'actions ou une séquence d'actions dont le contexte,
la fréquence, la durée, la latence, l'intensité et les impacts sont tels
qu'elles mettent en danger la santé, la sécurité ou la propriété de la
personne et/ou celle de son entourage.
Depuis le 1er avril 2006, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau est
mandataire du Programme pour les personnes présentant un TGC. Le Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau est affilié à l'Université de Montréal, membre du
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal
métropolitain et est agréé par le Conseil québécois d'agrément.
Renseignements: Marie-Claude Roussin, conseillère aux communications,
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, (514) 527-4527, poste 2300, Cell. :
(514) 704-2602

Critique du DSM à l’évennement DSM-V
Paru lundi 16 octobre 2006 dans Le Devoir
L'entrevue - La normalité, cette obsession
La professeure Paula J. Caplan met en doute la valeur scientifique des diagnostics
psychiatriques et s'en prend à une société folle des médicaments
Isabelle Porter
Édition du lundi 16 octobre 2006
Mots clés : Québec (province), Culture, normalité, michel foucault, folie
Québec -- Pour le philosophe français Michel Foucault, auteur d'Histoire de la folie à l'âge
classique, le concept de folie était un outil de contrôle social, une manière de stigmatiser la
différence, bref une source d'aliénation pour quiconque ne cadre pas avec l'ensemble.
Quarante ans plus tard, le débat est loin d'être enterré.
En témoigne la tenue à Québec la semaine dernière de l'événement culturel DSM-V+ au
cours duquel des chercheurs et des journalistes s'en sont pris au Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, ce fameux DSM publié par l'Association des psychiatres
américains (APA) dans lequel on recense, depuis 50 ans, les différentes maladies
mentales et leurs symptômes. Les futurs psys l'étudient à l'université : c'est un peu la bible
de la profession.
Or, dans ses cours à la Harvard University, la professeure Paula J. Caplan enseigne
justement à ses étudiants à se méfier du DSM. Elle a d'ailleurs consacré sur la question un
ouvrage à succès intitulé They say you're crazy : How the World's Most Powerful
Psychiatrists Decide Who's Normal.
Mais pourquoi s'en prendre au DSM ? Parce qu'il est très influent, plaide-t-elle, et que l'on
se base sur cela pour formuler des diagnostics et surtout prescrire des médicaments. «Le
problème, c'est que l'APA et les auteurs du DSM définissent ni plus ni moins ce qu'est une
maladie mentale aujourd'hui, ce qu'est la normalité. Tout ça dans le contexte d'une société
nord-américaine de plus en plus psychiatrisée où les gens cherchent des explications
psychiatriques à pratiquement tout.»
Mme Caplan reproche aux auteurs du DSM de définir des maladies sans bases
scientifiques suffisantes. «Ce dont nous parlons, c'est de la médicalisation des problèmes
émotionnels. Du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Mais personne
n'a démontré que la majorité de ces problèmes partaient du cerveau. Si vous êtes déprimé,

ça va affecter votre cerveau, mais ça ne veut pas dire que c'est causé par quelque chose
qui cloche dans votre système neurologique.»
Pour la professeure, la présence du syndrome prémenstruel dans le DSM est l'exemple
suprême de cette dérive : «Le SPM est un bon exemple de la faiblesse scientifique des
catégories qui se trouvent dans le DSM. On recense des symptômes, on leur donne des
noms de maladies et on prescrit les médicaments qui vont avec.» Pour comprendre le
SPM, il faut d'abord considérer le contexte, fait-elle remarquer.
«C'est très dur pour une femme à bien des égards. Lorsque vous êtes sur le point d'avoir
vos règles, il y a des changements hormonaux et bien sûr que c'est inconfortable. Si vous
avez d'autres soucis, c'est tout simplement la goutte qui fait déborder le vase. Le plus utile
pour les femmes concernées, c'est souvent de parler avec d'autres femmes, d'exprimer
leurs colères, de s'échanger des trucs pour aller mieux.»
Pour appuyer ses dires, Mme Caplan se fonde sur sa propre expérience de consultante
pour la rédaction du dernier DSM. «Aucune étude sérieuse ne démontre que les femmes
ont tendance à être plus déprimées, fâchées ou anxieuses avant leurs menstruations
davantage qu'à tout autre moment. Les artisans du dernier DSM le savaient lors de la
rédaction de cette version et, en dépit de cela, ils ont recommandé que le SPM reste dans
le livre.»
La multiplication des maladies mentales
Le DSM a certes pris de l'expansion avec les années. Entre la première édition (1952) et la
plus récente (1994), le nombre de maladies mentales recensées est passé d'une centaine
à près de 300. Du syndrome post-traumatique à des troubles anxieux comme la phobie
sociale, les afflictions définies sont de plus en plus précises.
La liste est-elle plus longue parce qu'on comprend mieux la psyché humaine ou serait-on
en train d'assimiler le moindre trait de caractère à une maladie ? Aux États-Unis, la
question est d'autant plus délicate que, contrairement à chez nous, les publicités pour les
médicaments sont légales.
Dès lors, les compagnies pharmaceutiques peuvent contribuer, par l'intermédiaire de leurs
promotions, à convaincre les gens qu'ils sont malades : «Vous êtes-vous déjà senti comme
ceci ? Si oui, parlez-en à votre médecin.»
D'emblée, plaide Mme Caplan, le problème fondamental réside dans le diagnostic. En
associant les patients à des maladies précises, on limite les traitements, croit-elle. «La
personne va consulter. Le praticien passe au travers du DSM, fait la liste des symptômes
et voit à quelle catégorie ils peuvent correspondre. Par conséquent, toute l'attention va sur
ce qui ne va pas. Le médecin ne cerne pas nécessairement la personne, et il se trouve que
bien des gens ne rentrent pas dans ces catégories.»
Bref, on va trop vite, dénonce-t-elle, et on prescrit trop. «Actuellement, le citoyen nord-
américain moyen travaille beaucoup plus d'heures qu'il y a dix ans. Tout le monde est très
occupé et les gens veulent de plus en plus des solutions rapides à leurs problèmes : la
bonne pilule. Oui, les médicaments sont efficaces chez certaines personnes, dans
certaines circonstances et lorsqu'on les utilise temporairement, mais il faut faire attention.»
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%