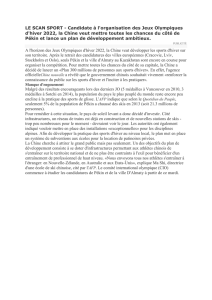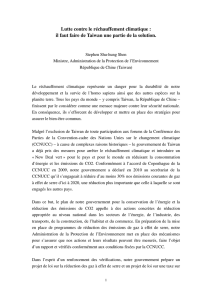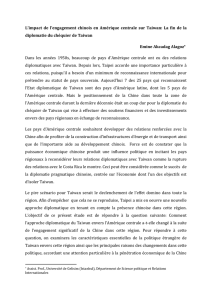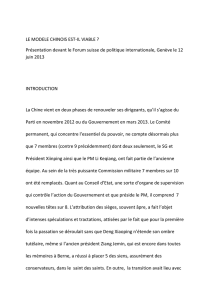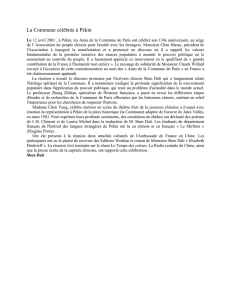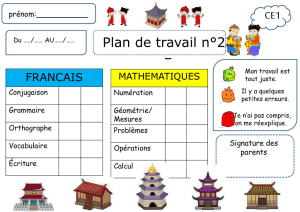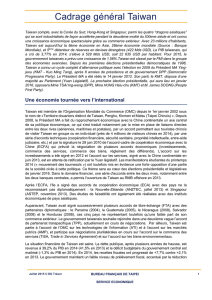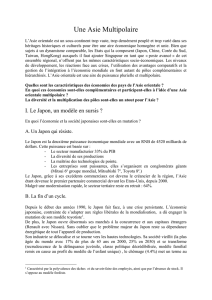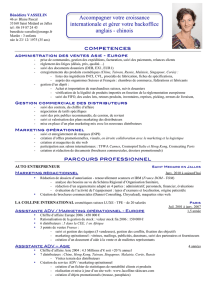washington-pekin-taipei : le triangle de verre

1
WASHINGTON-PEKIN-TAIPEI : LE TRIANGLE DE VERRE
POLITIQUE INTERNATINALE N° 88 - ÉtÉ 2000
Article de Robert A. MANNING
Ancien conseiller politique au département d'Etat (1989-1993).
L'élection à la présidence de Taiwan du candidat indépendantiste Chen Shui-bian, dans un climat de fortes
tensions orchestré par Pékin, a mis en lumière le danger d'un conflit majeur en Asie de l'Est. Le spectre d'une
confrontation nucléaire entre la Chine et les Etats-Unis est également venu rappeler que, contrairement à
l'Europe où, dix ans après la chute du Mur, la guerre est désormais impensable, l'Asie est devenue un foyer de
conflits potentiels dont trois, au moins, pourraient dégénérer en conflagration nucléaire: à la frontière
indo-pakistanaise; dans la péninsule coréenne; et à travers le détroit de Formose.
Face à la montée des menaces chinoises, Taiwan est devenu l'an dernier le principal abcès de fixation de la
région. Il est vrai que, dans le même temps, la tension entre les deux Corées est - au moins temporairement -
retombée, comme l'a confirmé l'annonce de l'ouverture de pourparlers entre Séoul et Pyongyang. La diplomatie
(et le versement, depuis 1995, de plus d'un milliard de dollars d'aide, notamment en nourriture et en carburant) a
contribué à apaiser les esprits, empêchant le régime nord-coréen à la fois de s'effondrer et d'exploser. Mais tout
risque de dérapage n'a pas disparu pour autant: un conflit impliquant l'usage d'armes de destruction massive
reste possible en Asie orientale. Une éventuelle détérioration de la situation en Corée - qu'on assiste à la débâcle
du Nord ou au déclenchement d'hostilités ouvertes de part et d'autre du 38e parallèle - , ou un embrasement du
détroit de Formose, aboutiraient à redéfinir le rôle de chacune des grandes puissances asiatiques (Etats-Unis,
Chine et Japon) et à redistribuer les cartes dans la zone Asie-Pacifique. Devoir choisir entre Washington et
Pékin: telle est la hantise des Etats de la région.
Taiwan comme métaphore
Il est tentant de voir dans la question de Taiwan la simple résurgence d'une ancienne guerre civile qui aurait été
gelée par la confrontation Est-Ouest: un problème de nation divisée, en fin de compte. Mais Taiwan est aussi à
maints égards une métaphore des dilemmes contemporains. L'essor des échanges commerciaux entre les deux
rives du détroit et l'accroissement des investissements taiwanais sur le continent cristallisent la tension entre la
mondialisation et le nationalisme; ils favorisent aussi l'éclosion d'une identité proprement taiwanaise. A travers
la rivalité Pékin-Taipei la Chine accède, pour la première fois dans l'histoire moderne, au statut de grande
puissance. Cette ferveur irrédentiste traduit la volonté de l'Empire du milieu de corriger l'injustice historique
que lui infligèrent au siècle dernier les impérialismes occidentaux et japonais. De ce point de vue, la question de
Taiwan contribue à obscurcir le jugement que l'on peut porter sur cette Chine émergente, qui apparaît tantôt
comme une puissance attachée au statu quo, tantôt comme un Etat révisionniste. Mais, dans le même temps,
Taiwan est le symbole harmonieux de la première alternance démocratique et pacifique qu'ait connue le monde
chinois depuis 5000 ans.
Plus inquiétant peut-être, Taiwan pourrait être le point de friction entre les valeurs et les intérêts américains et
chinois. Depuis l'établissement de relations sino-américaines, il y a trente ans, l'île demeure «la question
cruciale qui empêche la normalisation des relations entre les Etats-Unis et la Chine», pour reprendre les termes
du communiqué conjoint de 1972. Pour contourner l'obstacle, les diplomates ont dû déployer des trésors
d'habileté: «Les Etats-Unis - explique le communiqué - reconnaissent que tous les Chinois, de part et d'autre du
détroit de Taiwan, estiment qu'il n'existe qu'une seule Chine et que Taiwan est une partie de la Chine.» Les
Américains ne contestent pas cette position. Non pas qu'ils l'acceptent ou qu'ils la cautionnent nécessairement,
mais ils la «reconnaissent». De la subtile rhétorique des communiqués dépend parfois la guerre ou la paix ...

2
Aux yeux d'observateurs peu avertis il peut sembler étrange que la souveraineté sur Taiwan représente, pour la
Chine, une question aussi sensible dans la mesure où, pendant la majeure partie du XXe siècle, Formose a
toujours été une entité politique autonome par rapport au gouvernement de Pékin. En 1972, Mao Zedong
déclara à Richard Nixon que la Chine pouvait attendre la réunification cent ans (mais il ajouta que Pékin devrait
se battre contre les Etats-Unis pour y parvenir) (1). Taiwan est un élément essentiel de la pathologie du
nationalisme chinois. En se rendant maître de l'île, Pékin effacerait la dernière trace de 150 ans d'abaissement.
Taiwan est aussi le symbole psychologique de la domination américaine dans le Pacifique et de la vulnérabilité
de la Chine. La sensibilité chinoise n'a sans doute jamais été mieux exprimée que par cette déclaration de Zhu
De, le fondateur de l'Armée de libération du peuple (ALP), souvent citée par les dirigeants chinois: «Tant que
Taiwan n'est pas libéré, l'humiliation historique du peuple chinois ne sera pas lavée; tant que la mère-patrie n'est
pas réunifiée, la mission de nos forces armées populaires ne sera pas remplie» (2). Mais, pour Pékin, la question
de Taiwan touche aussi à un point crucial: la légitimité du Parti communiste.
Genèse d'une crise
Cette crainte de voir la situation dégénérer en conflit ouvert est liée à la démocratisation de Taiwan et à son
impact sur l'ensemble des pièces diplomatiques - les «trois communiqués» et le Taiwan Relations Act (TRA) -
qui fondent les relations sino-américaines et taiwano-américaines. Pour Pékin aussi bien que pour Washington,
la doctrine d'«une seule Chine» (énoncée dans le communiqué de 1972 et réaffirmée dans celui de 1979 lors de
la normalisation des relations entre les deux pays) avait tout d'une idée fixe. C'est sur ces deux documents,
complétés en 1982 par un troisième communiqué qui fixe des limites aux ventes d'armes américaines à Taiwan
(dans la perspective d'un règlement pacifique de la question), ainsi que sur le TRA de 1979, que repose la
politique américaine envers Pékin et Taiwan. Cette astucieuse fiction selon laquelle il n'existerait qu'«une seule
Chine» apporta la stabilité et la prospérité à près d'une génération. Pendant ce temps, Taiwan a été dirigé par des
exilés du Kuomintang (KMT), conduits par Chiang Kai-chek, auquel succéda son fils Chiang Ching-kuo. Tous
deux étaient convaincus qu'un jour ils partiraient à la reconquête de la mère-patrie et qu'ils réaliseraient la
réunification à partir de Formose. La notion d'une Chine «unique» représentait donc à leurs yeux une peinture
fidèle de la réalité. En ces temps de régime autoritaire, évoquer l'indépendance suffisait à vous envoyer en
prison.
Tout bascula lorsque, début 1988, Chiang Ching-kuo, enivré par les succès économiques de Taiwan, entama une
transition démocratique. Ce processus aboutit, en 1992, à l'accession à la tête de l'Etat de Lee Teng-hui - le
premier président taiwanais né sur l'île - puis, en 1996, à l'élection de celui-ci au suffrage universel direct.
Quant à l'arrivée au pouvoir de Chen Shui-bian, elle marque un événement rarissime dans l'histoire chinoise:
une alternance pacifique. Une alternance qui pourrait causer à Pékin bien des désagréments. Car le principal
facteur des tensions actuelles est là: que les Chinois le veuillent ou non, Taiwan est devenue une véritable
démocratie. A mesure que la liberté gagnait du terrain sur l'île, le fossé politique entre les deux rives du détroit
s'élargissait. Peu à peu, les dirigeants du Kuomintang, qui sont des continentaux arrivés sur l'île après la victoire
de Mao en 1949, ont cédé la place à des Taiwanais de souche. La démocratisation a renforcé le sentiment
identitaire taiwanais.
C'est pourtant une réalité que Pékin refuse de reconnaître officiellement et sur laquelle l'administration Clinton
elle-même préfère fermer les yeux afin de ne pas compliquer la construction d'un «partenariat stratégique» avec
la Chine. Tous deux continuent de s'en tenir à la doctrine traditionnelle d'«une seule Chine», dont les
présupposés sont aujourd'hui remis en question. Déjà forte de ses remarquables performances économiques, l'île
aspire désormais à une véritable reconnaissance internationale. Cette quête d'un nouvel espace d'expression sur

3
la scène mondiale - Taiwan ne veut plus être un fantôme - fait craindre à la Chine que l'île n'aille encore plus
loin et ne finisse par faire voler en éclats les derniers garde-fous qui la retiennent de déclarer officiellement
l'indépendance. C'est cette impulsion à laquelle Lee Teng-hui, par ses prises de position provocatrices, a tenté
de donner corps dans les années 90.
Sur le plan économique, en revanche, l'ouverture va bon train. Décidée par Chiang en 1988, celle-ci a permis de
nombreux contacts personnels et commerciaux, pour l'essentiel via Hongkong. Les vannes se sont lentement
ouvertes: à la fin de 1999, plus de 12 millions de Taiwanais s'étaient rendus sur le continent, quelque 30000
entreprises taiwanaises y avaient investi plus de 40 milliards de dollars et les échanges bilatéraux avaient atteint
près de 25 milliards de dollars. La Chine draine près de la moitié des investissements taiwanais à l'étranger et
environ 20% de ses exportations - des chiffres qui ont eu tendance à augmenter en 1999 alors même que les
tensions s'aggravaient et que la Bourse de Taiwan plongeait. Plus l'économie taiwanaise se développait et plus
elle devenait dépendante, pour le maintien de sa compétitivité, de la modicité des coûts de production en
vigueur sur le continent (main-d'oeuvre et immobilier). économiquement, la réunification était déjà une réalité.
Une «grande Chine» était en train de naître.
Mais la politique contraria cette évolution. Le facteur démocratique fit irruption à la mi-1995 lorsque le
président Lee Teng-hui demanda un visa aux autorités américaines afin de se rendre à une réunion d'anciens
élèves de la Cornell University, là où il avait fait ses études. Pékin émit alors une protestation et prétendit qu'en
accordant un visa à Lee, les Etats-Unis se rendraient coupables d'une violation du principe d'une seule Chine.
Au début, l'administration Clinton était d'accord avec cette interprétation. Elle expliqua au Congrès qu'accorder
un visa serait contraire à la ligne fixée jusqu'alors par les autorités. La plupart des instances où se définit la
politique étrangère américaine - le département d'Etat, le Pentagone et le Conseil national de sécurité - firent
également connaître leur opposition. Mais lorsque le Congrès se prononça, par 395 voix contre une, en faveur
de l'octroi du visa, l'administration changea subitement d'avis et accorda ledit visa alors même que le secrétaire
d'Etat Warren Christopher et d'autres hauts responsables de la diplomatie américaine avaient, à plusieurs
reprises, assuré du contraire leurs homologues chinois.
Cet incident provoqua une crise à laquelle Pékin répondit par des «exercices de tirs de missiles», lançant des
M-11 à capacité nucléaire à 25 km de Keelung et Kaoshiung, les deux plus grands ports de Taiwan. Washington
répliqua par l'envoi de deux groupes aéronavals. Jamais une telle armada battant pavillon américain n'avait été
déployée dans le Pacifique depuis la guerre du Vietnam. Cette répétition en costumes d'un conflit entre deux
puissances nucléaires montra à l'administration Clinton, volontiers encline aux simplifications moralisatrices, la
gravité de la question de Taiwan. La diplomatie de crise qui se mit en place, et qui devait conduire aux sommets
de 1997-1998, permit de consolider les relations sino-américaines - des relations qui, depuis la tragédie de la
place Tienanmen en juin 1989, avaient connu des hauts et des bas.
Vers la confrontation
Cette période de tensions connut son apogée avec l'interview accordée par Lee Teng-hui à la télévision
allemande en juillet 1999, dans un climat de pré-campagne électorale. Il y dévoilait sa théorie des «deux Etats»,
selon laquelle la Chine et Taiwan devaient désormais se considérer mutuellement comme deux Etats séparés. A
bien des égards, cette déclaration n'était qu'une énième version, certes un peu plus énergique, de la rhétorique
taiwanaise classique, à savoir que Taiwan ne négociera pas avec Pékin en tant que «province» chinoise, que l'île
jouit déjà d'une indépendance de facto et que, par conséquent, elle n'a nul besoin de déclarer officiellement son
indépendance. Mais elle était à double tranchant - comme on s'en rendit compte, lors de la campagne
présidentielle, quand il apparut que le candidat du Parti démocrate progressiste (PDP), Chen Shui-bian, dont le

4
programme prévoyait la tenue d'un référendum sur l'indépendance, avait de bonnes chances d'être élu.
L'hypothèse que Lee ait chauffé la place pour le PDP auquel il confiait la tâche de parachever formellement
l'indépendance éveillait à Pékin une crainte palpable.
Reste un mystère: pourquoi Lee a-t-il décidé de faire cette déclaration dont il ne pouvait ignorer qu'elle
déclencherait l'ire des dirigeants chinois? Peut-être a-t-il voulu laisser un héritage politique. Peut-être, aussi,
cherchait-il à enfermer les trois candidats dans une position politique populaire. Mais le facteur décisif a sans
doute été la peur de se voir contraint par l'administration Clinton à négocier avec Pékin. L'appréhension d'un tel
rapprochement se renforça lorsque les Etats-Unis firent du «partenariat stratégique» le but avoué de leur
diplomatie chinoise. Où cela mènerait-il Taipei?
Ce malaise diffus prit forme durant la visite de Bill Clinton en Chine en 1998. De passage à Shanghai, il déclara
que les Etats-Unis «ne soutenaient pas l'indépendance de Taiwan, ni la théorie des deux Chine, ni la politique
d'équidistance entre Taiwan et la Chine». «Je ne crois pas, ajouta-t-il, que Taiwan puisse devenir membre d'une
organisation internationale qui n'accueille en son sein que des Etats.» C'est ce que l'on a appelé les «trois non».
Jusqu'alors, aucun président américain ne les avait énoncés publiquement et encore moins sur le sol chinois.
Les deux parties concernées réagirent avec vigueur: à Pékin, on jubilait; à Taipei, on était affolé. A Washington,
on feignait de croire que rien n'avait changé dans la politique américaine. Le président et le secrétaire d'Etat,
disait-on, avaient déjà fait la même déclaration en privé auprès de hauts responsables chinois ...
Pourtant, ces quelques mots prononcés en public par le président américain à Shanghai ont bel et bien marqué
un changement de cap. En affirmant qu'il ne soutenait pas l'indépendance et qu'il déniait à Taiwan toute
vocation à faire partie d'organisations internationales qui n'acceptent dans leurs rangs que des Etats, Bill Clinton
se rangeait implicitement à la position de Pékin selon laquelle Taiwan ne serait qu'une province chinoise.
Après l'épisode de Shanghai, Lee forma une commission chargée de revoir le statut de Taiwan - dont les travaux
devaient déboucher sur la théorie des «deux Etats». De sources bien informées à Taipei, on rapporte que le
gouvernement taiwanais se sentait soumis à des pressions croissantes de la part de l'administration Clinton afin
d'entamer des pourparlers politiques avec Pékin sur des sujets sensibles pouvant conduire à la réunification: des
discussions bilatérales à un haut niveau avaient été programmées pour la fin octobre 1999. Pour les Taiwanais,
la récente volte-face américaine avait contribué à restreindre leur marge de manoeuvre diplomatique vis-à-vis
de Pékin. Lee savait que ses nouvelles déclarations allaient faire capoter le processus. Au moins avait-il réussi à
extraire intelligemment Taiwan du piège dans lequel il craignait qu'il ne fût enfermé.
Encore une fois, des considérations de politique intérieure ont poussé la Chine et Taiwan au bord du conflit. La
manoeuvre de Lee a eu pour effet de faire monter d'un cran la pression chinoise: en février 2000, quelques
semaines avant l'élection présidentielle, le Conseil des Affaires d'Etat de Pékin a publié un «Livre blanc» (3). A
première vue, ce document était le fruit d'un compromis entre les durs et les tenants d'une approche plus
modérée et patiente envers Taiwan. Imprégné d'un esprit de conciliation, il évoquait des négociations «sur des
bases équitables» et «la pleine prise en compte de la réalité politique de Taiwan». Mais la principale nouveauté
du texte consistait à étendre le champ des hypothèses pouvant conduire la Chine à imposer la réunification par
la force. Pékin avait toujours affirmé qu'en cas de sécession ou d'invasion étrangère de l'île, il réagirait par des
mesures radicales, y compris par le recours à la force. Le Livre blanc évoquait une troisième éventualité: «Si les
autorités taiwanaises refusent, sine die, le règlement pacifique de la réunification de part et d'autre du détroit par
la voie de la négociation.»

5
Depuis des mois, des rumeurs persistantes laissaient entendre que Pékin allait prendre une initiative en vue de la
réunification. Selon un article récent du Sydney Morning Herald, qui reprenait les conclusions des services de
renseignement américains, la Chine était en train de préparer un blocus de Kaoshiung, le plus grand port de
Taiwan, pour le mois de septembre (4). Après la rétrocession de Macao, l'île est en effet la dernière portion du
territoire chinois qui échappe encore à la souveraineté de Pékin. A la lecture du Livre blanc, on comprenait
qu'en l'absence de progrès sur ce dossier brûlant, une date limite pourrait être fixée. En fait, l'idée de forcer la
marche vers la réunification avait germé dans l'esprit des dirigeants chinois après le coup d'éclat de Lee sur les
«relations d'Etat à Etat». Le problème, c'est qu'il fallait alors envisager l'option militaire qui, compte tenu de
l'équilibre des forces en présence, paraît hautement problématique et extrêmement risquée pour la Chine
continentale. Pékin est confronté à un dilemme, que l'on pourrait appeler le «paradoxe du temps»: d'un côté, il
faut faire vite car l'émergence d'une identité taiwanaise lui fait craindre que les perspectives de réunification ne
s'éloignent au-delà du point de non-retour; d'un autre côté, le temps joue en sa faveur car, sur le plan militaire,
ce n'est que vers la fin de la décennie que le rapport des forces cessera de favoriser Taiwan. C'est dire combien
la situation est délicate pour la Chine. Fixer une date limite qu'elle ne pourrait pas tenir ne pourrait que
discréditer le Parti communiste et fragiliser le régime actuel qui apparaîtrait comme un tigre de papier. Le Livre
blanc reflète cette tendance à l'escalade verbale dont nombre d'analystes américains redoutent qu'elle ne
conduise Pékin à se mettre, par inadvertance, au pied du mur.
Equilibre des forces, scénarios de crise
Si un nouveau modus vivendi entre les deux rives du détroit n'est pas trouvé d'ici les prochains mois, la Chine
pourrait estimer qu'elle n'a pas d'autre choix que l'option militaire - et cela en dépit de tous les inconvénients
qu'elle comporte, qu'elle se solde par un succès (réaction internationale à une action militaire unilatérale) ou par
un échec. Mais quel est réellement l'état de l'armée chinoise et quelles sont les différentes possibilités qui
s'offrent à elle?
Depuis la fin des années 80, les plans de défense chinois sont passés de la guerre «totale», sur une grande
échelle, à la guerre «locale», menée avec des moyens technologiques sophistiqués sur des terrains d'opération
restreints, dans le détroit de Formose ou en mer de Chine du Sud (5). Mais les capacités de projection des forces
chinoises hors de leurs frontières restent très limitées. L'APL ne dispose ni de moyens amphibies suffisamment
robustes ni de la puissance aérienne adéquate pour conduire avec succès une invasion de Taiwan. L'emploi, par
les Américains, d'armes conventionnelles équipées de systèmes de guidage de précision pendant la guerre du
Golfe puis contre la Serbie a incité les Chinois à accélérer leur programme de modernisation. En 1999 et 2000,
les dépenses de défense ont crû plus vite que les 12% de hausse constatés au cours des dix années précédentes,
et l'accent a été mis sur la «guerre asymétrique» (la guerre électronique, les missiles de croisière perfectionnés,
le développement des armes laser). Il est vrai que le mode de calcul des dépenses militaires chinoises laisse la
plupart des experts perplexes. Officiellement, Pékin les évalue à 12 milliards de dollars (chiffres 1999). Mais si
l'on réintègre dans le budget toute une série d'activités annexes, on parvient à un montant d'environ 30-35
milliards de dollars par an (6).
Il ne suffit pas de comparer, catégorie par catégorie, les équipements militaires de Pékin et de Taiwan pour se
faire une idée exacte des forces en présence. Des facteurs aussi fondamentaux que la géographie, la topographie,
l'aptitude à lancer une attaque-surprise ou les capacités opérationnelles entrent également en ligne de compte. Il
convient aussi d'évaluer les capacités offensives par rapport aux capacités défensives (le ratio est de 3 à 1 pour
les forces terrestres). En la matière, la qualité prime sur la quantité, qu'il s'agisse des plates-formes aériennes et
navales de dernière génération ou des capacités opérationnelles et organisationnelles (commandement et
contrôle, renseignement, reconnaissance, interopérabilité des forces terrestres, aériennes et navales) (7).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%