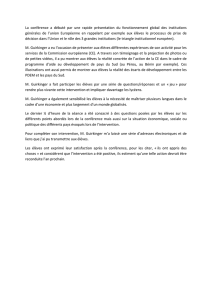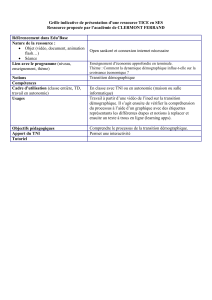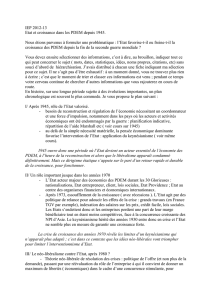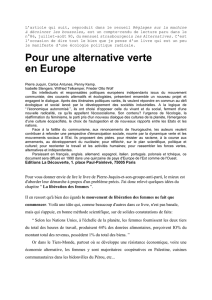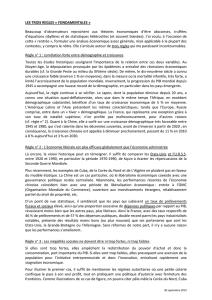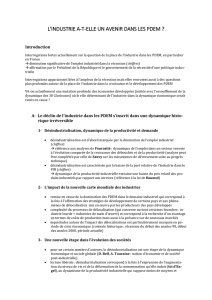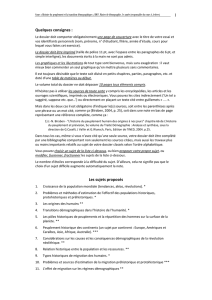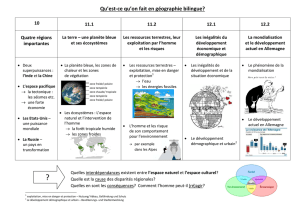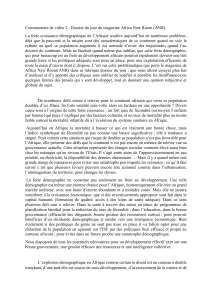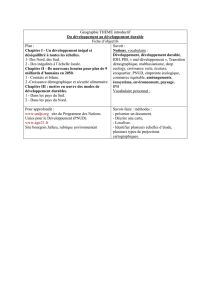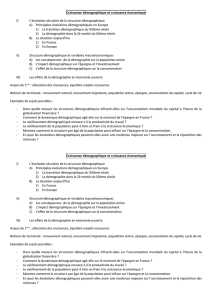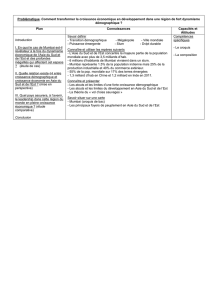L`évolution démographique des PDEM depuis 1945 a-t-elle

L’évolution démographique des PDEM depuis 1945 a-t-elle été un
frein ou un moteur de la croissance de ces pays ?
Premier mai 2004 : avec l’élargissement à 10 nouveaux pays de l’Union Européenne,
la population de l’Union passe de 380 à 480 millions d’habitants – un des arguments les plus
avancés par les partisans de l’élargissement pour mettre en évidence son caractère bénéfique,
tant pour les nouveaux entrants que pour les Quinze. La vitalité démographique, surtout quand
elle se caractérise par un rajeunissement de la population, est donc d’emblée et par un
consensus considérée comme un moteur important du développement économique et social
d’un territoire. Cette assertion est-elle vérifiée pour les PDEM depuis 1945 ? Leur évolution
démographique depuis 1945 a-t-elle été un frein ou un moteur des croissances économiques
nationales de ces pays ?
Si la destinée démographique des pays développés depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale est hétérogène, quelques tendances communes, parallèles à la remarquable
croissance connue par ces pays sur la période, se dégagent : achèvement de la transition
démographique et de l’urbanisation amorcées au XIXe siècle, vieillissement de la population,
soldes migratoires positifs, émergence de nouveaux modèles familiaux… Mais ces
phénomènes ont été plus ou moins marqués et rapides selon les pays, certains d’entre eux
(France, Etats-Unis) ayant de plus connu un baby-boom important dès avant la fin de la
guerre. Ces divergences peuvent-elles contribuer à expliquer les différents modèles de
croissance connus par les PDEM depuis 1945 ?
Si la vitalité démographique semble corrélée à la croissance des PDEM depuis 1945,
la relation de causalité entre les variables démographiques et économiques n’est pourtant pas
immédiate ; le lien qui existe cependant entre elles et les problèmes récents soulèvent la
question des politiques démographiques à adopter dans les PDEM pour favoriser les
croissances économiques nationales.
1. La vitalité démographique semble corrélée à la croissance des PDEM
depuis 1945
a) Quand baby boom rime avec boom tout court
Depuis 1945, tous les PDEM ont vu leur population augmenter de façon continue : le
taux de natalité français remonte ainsi à 21‰ dès 1942, et se maintient encore à 17‰ au
début des années 1970, en même temps que le taux de mortalité chute remarquablement grâce
aux progrès de la médecine et de l’hygiène, mais surtout à la généralisation de leurs effets.
S’y ajoute une immigration, de travail notamment, soutenue : en France, les immigrés
représentent 4 millions d’habitants en 1982. La population française passe ainsi de 40,5
millions à plus de 62 millions d’habitants aujourd’hui. Dans le même temps, ces pays
connaissent une croissance remarquable qui mérite l’expression de « Trente Glorieuses » qui
sera appliquée par Jean Fourastié à la période : le taux de croissance annuel moyen du PNB
par habitant dans les PDEM atteint 3,5%, un record historique. Avec le ralentissement de la
vitalité démographique après 1965, et surtout 1975, mais le maintien d’un solde natalité –
mortalité positif, la croissance se maintient, quoique moins forte elle aussi : de 1945 à 1998, le
PNB par habitant connaît un TCAM de 2,6%. La corrélation positive entre évolution
démographique et croissance économique nationale semble donc vérifiée pour les PDEM sur
l’ensemble de la période.
b) les facteurs explicatifs

Ainsi la « loi de population » de Thomas Malthus semble infirmée par l’histoire
économique des PDEM depuis 1945 : la croissance démographique qui les caractérise peut
être considérée comme un vecteur de leur croissance économique. En effet, elle s’est d’abord
traduite par un effet mécanique de croissance extensive : la hausse de la population résulte en
un accroissement de l’offre de travail, facteur de production essentiel, notamment pendant les
Trente Glorieuses caractérisées par un quasi-plein emploi et durant lesquelles l’extension du
marché du travail a permis de réduire les goulets d’étranglement. La croissance absolue est
également dopée par la vitalité démographique : à hausse du PIB/hab égale, par exemple
grâce aux gains de productivité, le pays qui connaît la croissance la plus forte est celui qui a la
croissance démographique la plus élevée. Aussi Harrod et Domar dans leur modèle de
croissance insistent-ils sur le rôle dans la détermination de la croissance effective du taux de
croissance naturel, composé des taux de croissance de la population active et des gains de
productivité. A cela s’ajoutent des effets indirects de la démographie sur la croissance : une
hausse de la population a également des conséquences sur la demande globale, à travers
l’augmentation de la consommation des ménages et des administrations publiques (le baby-
boom s’est traduit par une hausse sans précédent du budget de l’Education Nationale),
engendrant à son tour une hausse de l’investissement et un cercle vertueux de la croissance
conformément au mécanisme keynésien de l’accélérateur : la France, comme les autres
PDEM qui l’ont connu (Royaume-Uni, Etats-Unis, …), a durant le baby-boom des taux
d’investissement extrêmement élevés -23% en moyenne durant les années 1960.
c) aujourd’hui encore, cette corrélation positive est vérifiée (+ effets du vieillissement –
parler de la fin du travail !!!!! )
Les effets bénéfiques de l’évolution démographique sur les croissances économiques
nationales se sont complexifiés après 1980. Avec la baisse de l’indicateur conjoncturel de
fécondité partout dans les PDEM après 1970 (les ICF de la Grèce et de l’Italie sont de 1,25
enfant par femme, soit un taux très inférieur à l’indice théorique de renouvellement des
générations de 2,1), tous les PDEM sont aujourd’hui confrontés au vieillissement de leur
population. Dans l’Europe des Vingt-Cinq, 60 millions de citoyens ont aujourd’hui plus de 65
ans, un chiffre qui devrait atteindre 85 millions en 2020. En dépit des problèmes que pose ce
phénomène, il a dans l’immédiat un effet bénéfique sur la croissance car il induit des besoins
nouveaux et dope donc la demande des ménages, mais également l’emploi : le développement
des services aux personnes âgées, très exigeants en main-d’œuvre, ne pourrait-il, bien plutôt
que la création d’un « tiers secteur » associatif, être le remède à la Fin du travail prophétisée
par Jeremy Rifkin et permettre d’employer tous ceux que la troisième Révolution Industrielle
menace selon lui d’inactivité ? Cependant, on constate encore, empiriquement, une croissance
relativement plus élevée des PDEM connaissant une forte croissance démographique. Ainsi
des Etats-Unis, dont l’expansion de la population est dopée par l’immigration et par un ICF
relativement élevé pour un PDEM de 2,01 et qui est dans la décennie 1990 le pays développé
dont l’économie est la plus forte et la plus régulière, correspondant à sa croissance
potentielle : l’afflux d’une main-d’œuvre jeune et souvent qualifiée (le « brain drain ») permet
de faire jouer à plein les effets sur l’offre et la demande de biens et services.
L’évolution démographique qu’ont connue depuis 1945 les PDEM, et notamment
l’augmentation de leur population, semble donc constituer un moteur de leur croissance
économique ; mais l’Allemagne et surtout le Japon, en dépit de l’absence de baby-boom
après-guerre, ont connu durant les Trente Glorieuses une croissance bien supérieure à celle
des Etats-Unis, pourtant plus dynamiques démographiquement. Si elle est bien corrélée à la
croissance économique, la croissance démographique ne peut donc en être considérée comme
la cause déterminante, et en est partiellement une conséquence.

2. Cause (non nécessaire) ou conséquence ?
a) un facteur ni nécessaire, ni suffisant
Pour Carré, Dubois et Malinvaud, la croissance démographique n’explique qu’un demi
point sur les 5 de la croissance annuelle française durant les Trente Glorieuses. De plus, la
croissance démographique ne coexiste pas forcément avec la croissance économique, ainsi
que l’a montré l’exemple de l’Irlande, à la fécondité historiquement très élevée (ICF de 3,85
enfants par femme en 1970, soit un indice bien supérieur à ceux qu’ont connus les autres
PDEM au plus fort du baby-boom), mais qui n’a véritablement entamé le décollage qui lui
vaudra le surnom de « Tigre Celtique » qu’après son entrée dans l’Union européenne en 1973.
L’Irlande affiche aujourd’hui, en même temps qu’une croissance du PIB de 6,9% pour 2002,
un ICF de 1,97 enfant par femme, supérieur certes à la moyenne de l’UE, mais qui ne saurait
être qualifié d’élevé. En effet une véritable croissance économique doit être intensive,
reposant sur le progrès technique et les gains de productivité, plus qu’extensive –sans que les
deux dimensions s’excluent l’une l’autre : à cette condition seulement elle correspond à la
définition que donne Simon Kuznets de la croissance et s’inscrit dans un processus durable et
autoentretenu. A évolution démographique semblable, deux pays ont, comme le Portugal et
l’Irlande depuis 1945, pu connaître des destins économiques très différents : la démographie
n’a un effet autre que quantitatif (c’est-à-dire a priori instable et réversible en cas de
renversement de tendances, comme le montrent les observations de Malthus) que lorsqu’elle
est compatible avec les structures d’une économie ; aussi le « surplus » de population de
l’Irlande a-t-il longtemps été absorbé par les flux d’émigration avant que son économie soit à
même d’y faire face.
b) la croissance, facteur des changements démographiques (urbanisation, modèles
familiaux), et réciproquement ?
De surcroît, c’est précisément lorsque le boom économique semble permettre à
l’économie d’absorber une population active sans cesse croissante que commence à baisser
l’indicateur de fécondité : avec la croissance vient le développement, qui historiquement se
traduit par l’achèvement de la transition démographique – dans les PDEM, par la baisse du
taux de natalité. Les évolutions économiques ont souvent des conséquences démographiques :
ainsi le baby-boom en France est le résultat non seulement de la guerre, mais aussi de
politiques natalistes lancées dès les années 1930 face au déficit de naissances, donc de main-
d’œuvre potentielle. C’est également la croissance économique, à travers notamment la
« révolution agricole » des années 1950, permettant un déversement de la main-d’œuvre entre
les différentes branches, qui stimule le phénomène de tertiarisation de la population active
amorcé au XIXe siècle et l’urbanisation de la population des PDEM, laquelle à son tour
engendre de nouveaux besoins (en termes de logement, transports,…) et possibilités (création
de pôles dynamiques de croissance et formation de réseaux). La relation entre démographie et
croissance est complexe et indirecte, qualitative autant que qualitative : ainsi la féminisation
de la population active a permis une hausse de l’offre de travail et des revenus distribués,
favorisant la croissance ; mais elle s’est aussi traduite par une diminution de la fécondité qui
peut handicaper l’avenir économique – du moins l’influencer fortement. [Modèle du cycle
démographique d’Easterlin.]
c) une influence sur le mode de croissance – Allemagne, fondée sur l’exportation + csq
dans le temps
Ainsi de l’Allemagne : l’inexistence de baby-boom à la fin de la guerre, en réaction
sans doute aux politiques natalistes du nazisme, s’est avérée déterminante pour la mise en
place du modèle de capitalisme rhénan. L’économie allemande s’est en effet tournée très
rapidement vers une croissance fondée sur la compétitivité hors prix, donc le progrès
technique – moteur de croissance intensive par excellence- et le rôle majeur des exportations.
Le Japon a connu la même évolution à partir des années 1960, après avoir rattrapé le retard dû

à la guerre. Aussi ces deux pays ont-ils mieux résisté que les autres à la crise des années 1970,
celle-ci n’ayant pour eux pas coïncidé avec l’arrivée massive sur le marché du travail des
générations de baby-boomers. De plus, la croissance, moins inflationniste car moins
exacerbée par les goulets d’étranglement dus à la demande des ménages, qu’ont connue ces
pays pendant les Trente Glorieuses, leur a permis de maintenir, voire d’augmenter leurs parts
de marché à l’étranger. Aujourd’hui encore, la –faible- croissance allemande ne repose que
sur le dynamisme des exportations, c’est-à-dire sur la demande extérieure ; cette force de
l’économie allemande s’est donc partiellement transformée en faiblesse, l’économie étant
devenue dépendante de variables sur lesquelles elle n’a quasiment aucune influence. Ce
modèle de croissance différent, très efficace durant les décennies 70 et 80, a donc connu une
crise avec les années 1990, au Japon comme en Allemagne : la croissance stagne –
l’Allemagne a dépassé début 2005 le seuil de 5 millions de chômeurs, un record jamais atteint
depuis la dépression des années 30-, les tensions sociales se multiplient et le climat
d’incertitude n’encourage ni la reprise économique, ni la reprise démographique.
Cette évolution économique et démographique est d’autant plus grave que
l’Allemagne et le Japon sont confrontés à un problème de vieillissement de leur population –
l’Allemagne surtout, qui connaît un solde naturel négatif- et que l’immigration est à l’origine
de tensions politiques et culturelles qui interdisent d’y voir la panacée aux problèmes
démographico-économiques des PDEM. Dès lors, quelles politiques démographiques adopter
pour favoriser le retour à ou le maintien de la croissance ?
3. Les problèmes récents posent la question des politiques démographiques
a) Le problème des retraites
Le principal problème dû à l’évolution démographique auquel soient aujourd’hui
confrontés, et ce sans exception, les PDEM, est celui du financement des retraites
1
. D’après
les projections de l’Insee, la population en âge de travailler en France devrait diminuer de près
de 90 000 personnes par an dans les quinze prochaines années, le nombre de retraités
augmentant parallèlement. En 2015, il n’y aura que deux actifs pour un retraité en France, ce
qui pose le problème de la viabilité du système de retraites par répartition. Le recours à une
immigration massive ne ferait que retarder l’échéance du problème, d’autant plus sérieux que
le débat entre retraites par répartition et par capitalisation n’a que partiellement lieu d’être. En
effet les retraites par capitalisation sont également soumises aux évolutions démographiques :
le paiement des droits s’effectue notamment au travers de la vente de titres acquis – un
nombre important de retraités se traduira mécaniquement par des ventes massives sur les
marchés boursiers, donc une chute des cours et de la valeur des droits. De même, l’exigence
toujours croissante des fonds de pension en matière de rentabilité conduit à une
surreprésentation des dividendes dans les profits des entreprises, au détriment de
l’investissement productif et de la capacité de long terme d’une économie à assurer la
croissance. Quant à la retraite par répartition, elle se heurte à un déficit toujours croissant
d’autant plus préoccupant qu’elle concerne en majorité des pays ayant un taux de
prélèvements obligatoires déjà élevés. Ainsi, pour P. Rosanvallon (La nouvelle question
sociale), les retraités, « privilégiés des années 80 sous le double effet de la démographie et des
mesures sociales (…) devront être invités à partir de la fin des années 1990 à contribuer
davantage aux dépenses communes ».
b) L’inefficacité des politiques malthusiennes sur le marché du travail
1
60 millions de plus de 60 ans dans l’Europe des 25, 85 millions en 2020

C’est dans cette optique que s’inscrit la tendance actuelle dans les PDEM à relever
l’âge de départ à la retraite, d’autant plus justifiée que l’espérance de vie a considérablement
augmenté depuis la généralisation des systèmes de pension après la Seconde Guerre mondiale,
passant ainsi en Allemagne de 64 ans pour les hommes en 1950 à 75,5 ans en 2001 : les
départs à la retraite n’apparaissent plus comme un moyen de faire diminuer le chômage, mais
comme une menace pour le taux d’activité. Il est à cet égard significatif que l’Union
Européenne n’affiche pas une cible en termes de taux de chômage, mais de taux d’activité (70
%), condamnant ainsi les politiques malthusiennes sur le marché du travail qui n’ont d’effet
que statistique. L’emploi n’est pas un « gâteau » à taille fixe que l’on partage, mais une
variable qui s’ajuste à la population active (D. Cohen, Nos temps modernes) et permet de
stimuler la croissance : les pays scandinaves qui ont le taux d’activité le plus élevé de l’Union
Européenne sont ceux qui parviennent le mieux à concilier croissance soutenue et compromis
sociaux. Les politiques démographiques devraient donc cibler le maintien d’une activité
élevée, notamment à travers des incitations pour les catégories les moins actives : jeunes,
personnes au-dessus de 50 ans, femmes… mais de telles politiques, comme celles de
formation, fondamentales pour le développement et la diffusion du progrès technique au cœur
de la croissance, dépassent déjà le cadre du démographique, illustrant le lien étroit entre
évolutions économique et démographique.
c) De la nécessité des politiques natalistes et/ou d’immigration ? le problème de la
formation
Dans ces conditions, quel rôle accorder aux politiques volontaristes ? Les politiques
natalistes présentent l’inconvénient de n’avoir une incidence sur la croissance économique
qu’à moyen terme, un certain laps de temps s’avérant nécessaire avant que les mentalités
changent et que ces politiques n’aient des répercussions sur la fécondité. De plus, les
véritables effets de ces politiques, c’est-à-dire dans le meilleur des cas un certain
rajeunissement de la population, et notamment de la population active, ne sont sensibles qu’à
plus long terme et sont marqués par une relative incertitude quant aux résultats. Elles restent
cependant, dans des économies développées où le travail des femmes est valorisé, une
condition nécessaire à la reprise de la fécondité et au maintien de l’évolution démographique
comme moteur de la croissance économique : la diminution du nombre de places dans les
crèches et écoles maternelles d’Allemagne de l’Est après la réunification s’est traduite par une
baisse brutale de la fécondité. A court terme, les PDEM peuvent envisager de mener des
politiques actives d’immigration, comme ils l’ont fait durant les Trente Glorieuses, pendant
lesquelles l’immigration de travail a permis d’éviter que le taux de croissance naturel ne bride
la croissance économique effective. Les Etats-Unis, pays développé le plus dynamique depuis
une décennie, sont d’ailleurs la terre d’immigration par excellence. Mais ces politiques
doivent être ciblées pour optimiser la croissance économique, d’où par exemple l’initiative
allemande visant à accorder des visas à un certain nombre d’informaticiens indiens, ce qui
permettrait l’arrivée d’une main-d’œuvre jeune, très qualifiée et venant pallier une pénurie sur
le marché du travail – initiative qui se heurte hélas à une hostilité politique.
L’évolution des grandes variables démographiques depuis 1945 montre le rôle moteur
de la démographie dans la croissance économique des PDEM, à travers notamment la
croissance démographique, mais aussi le taux d’alphabétisation, l’urbanisation et la
tertiarisation croissantes… Ce rôle est aussi qualitatif, dans la mesure où la démographie a pu
influer sur les différents modèles de croissance adoptés par les PDEM.
Avec la complexification de l’évolution démographique et l’apparition ou le
développement de phénomènes aux effets contradictoires sur les croissances économiques
nationales –vieillissement de la population, mutations en profondeur des modèles familiaux-
le lien entre démographie et économie se détend et prend des formes nouvelles. Il appartient
 6
6
1
/
6
100%