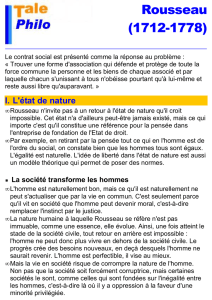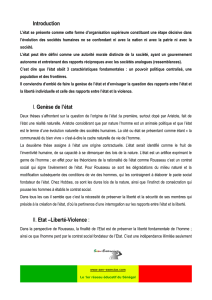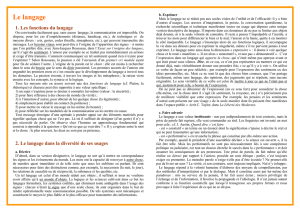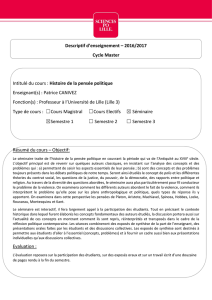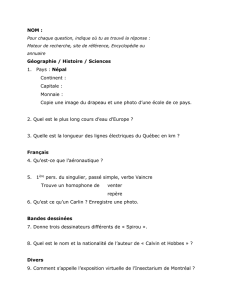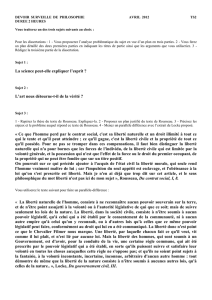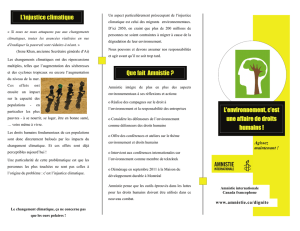Sortir de l`état de nature

Sortir de l’état de
nature
Comprendre la guerre civile c’est donc adopter le point de vue panoramique qui regarde avant
le politique, c’est-à-dire en amont de sa construction. Sous cette forme, l’hypothèse de l’état de nature
montre que ce n’est pas contre la guerre en général que s’édifie l’État, mais contre précisément la
guerre civile. Ainsi se formule l’impérieuse et ambiguë nécessité de sortir de l’état de nature.
Le terme de « sortie » reproduit la grande difficulté du saut qualitatif. Comment sortir d’un état
qui n’a pas commencé pour rentrer dans la cité qui tire sa naissance de ce qu’elle rejette ? Comment
se concrétise une hypothèse philosophique de ce genre ? Comment les hommes entrent-ils dans le
cours historique ? Rousseau critique Hobbes parce que son état de nature est belliqueux. En même
temps il le commente et par bien des aspects, notamment, pour ce qui nous occupe, à cause de la
place centrale de la guerre dans sa réflexion, il le poursuit comme son plus fidèle continuateur.
Là où Hobbes réfléchissait en termes de société « sans lois » et « avec lois », Rousseau
assume l’état de nature comme radicalement hypothétique opposé à la société dans l’histoire. En
effet, l’état de nature est selon lui paisible, non que les hommes soient bons ou sachent la distinction
du juste et de l’injuste, mais parce que la nature procure ses fruits en abondance, excluant la rivalité
des désirs, et surtout parce que les hommes sont dispersés et solitaires. À bien des égards cet état de
nature apparaît sans histoire(s).
Cependant, du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (DOI)
se dégage une atmosphère hostile ; cet état de nature, pour n’être pas franchement belliqueux, n’en
est pas pour autant pacifique. Le Discours se divise en deux parties, l’une consacrée à la description
de l’hypothèse, la seconde, qui nous intéresse davantage, à l’entrée dans la temporalité. Rousseau
dédouble l’état de nature et propose à cet effet un état intermédiaire, un sas de passage entre la pure
nature et la société. Il faut ménager l’instauration de l’histoire et « franchir un si grand intervalle »34.
L’état intermédiaire doit donc s’exprimer aussi en espace avant de rentrer dans la temporalité franche
de la société, il est inauguré par la propriété : c’est elle qui permet le saut qualitatif, c’est elle qui est
cause de la guerre. « Il s’établit entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit
perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres. La Société naissante fit place au
plus horrible état de guerre. » En ce sens, on ne sait pas véritablement si la guerre est le terme de
l’état de nature (mais peut-on parler de terme à ce qui n’a pas de commencement ?) ou le début de la
Société. En effet, Rousseau parle de la « Société commencée » dans la continuation du « “ premier ”
état de nature ». Plus on progresse dans le commencement de la société, plus le lexique du temps se
fait sentir et plus le vocabulaire de la guerre est présent. L’état de guerre est le mauvais
commencement de la société.
Rousseau n’est donc pas si éloigné de Hobbes, l’état de nature (le second pour Rousseau) a
nécessairement des germes belliqueux qui expliquent ce que la société démultiplie sous la forme de la
guerre réelle. Dès qu’il y a commerce entre les hommes, il y a guerre. Le reproche que Rousseau
adresse à Hobbes porte sur la définition de la nature humaine, il l’accuse de n’avoir pas écarté tous
les faits et d’avoir décrit un homme social sans société. Mais la constance est là qui établit dans les
deux cas que l’état de nature, quand il participe d’une guerre interindividuelle, décrit en fait la guerre
dans la société. Rousseau transforme les analyses de Hobbes en impératif : il faut que la guerre soit,
non dans la nature des hommes, mais dans un mauvais commencement de l’état social. Le bon
commencement sous la forme d’un impératif moral et juridique se trouve dans le Contrat Social, à bien
des égards suite du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
L’opus Que l’état de guerre naît de l’état social37 décrit le lien entre l’état de nature et l’état
intermédiaire de la société commencée dans la guerre. Dans la violence de l’état social, on reconnaît
le paradigme à l’œuvre dans la cité, à tel point que la guerre dans l’état social est une perversion de

l’idée même de société. En lui donnant la place centrale dans cette corruption à la naissance,
Rousseau « substitue l’état de guerre à l’état de nature comme référent paradigmatique » : « Nous
entrons maintenant dans un nouvel ordre de choses. Nous allons voir les hommes unis par une
concorde artificielle se rassembler pour s’entre-égorger et toutes les horreurs de la guerre naître des
soins qu’on avait pris pour la prévenir. » Là où Hobbes voyait encore la possibilité de se prémunir,
Rousseau affirme que la guerre « naît de la paix ».
Rousseau établit une morale à partir des prémisses hobbesiennes, il en déduit un impératif
après avoir très directement montré que toute la société était à refaire : c’est là que se situe la
nécessité de la conjuration de la guerre interne. Aussi en répétant qu’« il n’y a de guerre que d’État à
État », et que l’homme « ne devient soldat qu’après avoir été citoyen », il ne veut pas signifier que la
guerre civile n’existe pas, mais bien au contraire qu’il est absolument nécessaire que la guerre reste
« à l’extérieur », dans le sens où les hommes sont bien trop facilement portés à la guerre interne : « Il
n’y a donc point de guerre générale d’homme à homme ; et l’espèce humaine n’a pas été formée
uniquement pour s’entre-détruire. Reste à considérer la guerre accidentelle et particulière qui peut
naître entre deux ou plusieurs individus. »
Rousseau, alors même qu’il affirme son désaccord avec Hobbes sur l’état de nature belliqueux,
renforce le paradigme de la guerre interindividuelle pour exprimer toute forme de guerre. La
conjuration prend la forme de l’impératif moral, d’où l’idée naissante de confédération ou de société
des États. De sorte que le politique apparaît non seulement comme belliqueux mais aussi comme la
nécessaire sortie d’un état dont il est impossible de sortir.
C’est à la contradiction entre la nécessité de sortir de l’hypothèse de nature et l’impossibilité
d’en sortir que répond finalement la définition de la guerre civile. En ce sens la guerre civile serait
l’expression de l’impossibilité d’instaurer le politique alors même que les armes sont là pour le faire. Le
politique serait donc essentiellement belliqueux, selon le modèle de la guerre interindividuelle, et
l’homme, jamais totalement convaincu que l’appartenance politique passe par l’arrachement à l’état de
nature. La nécessité de refonder le politique passerait malheureusement par la destruction, par la
violence d’un état imaginaire, comme si tout à coup la complexité politique était si grande qu’il faille la
simplifier par les armes, renforçant par là l’inextricabilité de cette surenchère politique. La sortie
impossible de l’état de nature est alors, dans la perspective de la guerre civile, le désir de réduction du
politique à une origine imaginaire.
En ce sens, Hobbes dans le Béhémoth assimile l’état de nature à l’anarchie, c’est-à-dire à une
absence de loi brouillée par la prise d’armes, à un état de désordre qui est une perversion de la
finalité politique. L’anarchie ne signifie pas le rejet de l’autorité, mais l’effacement des lois communes.
Ainsi la barbarie de la guerre civile ne réside pas dans l’état de nature mais dans l’état de nature sous
le politique, dans le brouillage des liens politiques. La barbarie de la guerre civile, c’est le despotisme
et l’inégalité de maître à esclave qui la créent. « L’état de guerre subsistait nécessairement entre eux
par cela seul que les uns étaient les maîtres, et les autres les esclaves », là réside le fondement de la
guerre interindividuelle. Ce qui est anomie, absence de loi dans l’état de nature, est anarchie
pernicieuse dans l’état social. La transposition est toujours de mise et la guerre civile est une
traduction de l’état de nature.
L’anarchie peut ainsi nous faire comprendre pourquoi, avec la sortie de l’état de nature comme
saut qualitatif, la guerre civile est une « retombée » dans l’état de nature. Le cours temporel des
choses est définitivement brouillé : la guerre civile est un arrêt de l’histoire, un soubresaut de la guerre
interindividuelle qui reprend là où elle n’aurait pas dû intervenir. La retombée dans l’état de nature,
topos des écrits de la période, est une « “ reprise ” de l’état de guerre ». Cette rechute conjugue la
sortie impossible avec la permanence de l’état de nature dans toute assemblée humaine. Le réitératif
de la retombée dans l’état de nature ferme le cercle de la temporalité et de l’atemporalité, comme si la
guerre civile introduisait des moments de suspens. Le paradigme se déploie aussi dans les rapports
entre États : si ces rapports suivent le schéma de la guerre interindividuelle, alors il faut voir quel État
opprime quel autre pour comprendre la guerre interétatique. Ce mouvement de révolution, également
signalé dans le Béhémoth, indique selon Rousseau que « tout se ramène à la seule Loi du plus fort, et
par conséquent à un nouvel État de Nature différent de celui par lequel nous avons commencé, en ce
que l’un était l’État de Nature dans sa pureté, et que ce dernier est le fruit d’un excès de corruption. »
L’état de nature, quand il s’incarne dans la guerre civile, est bien une transformation de l’hypothèse

fictive et méthodologique, une corruption c’est-à-dire une transformation délétère et morbide, maladie
de la politique. On « retombe dans l’Anarchie des temps antérieurs ». Les désirs naturels
contradictoires sont mis à nu dans une violence politique qui réactive le droit naturel de conserver sa
vie et d’éviter la mort. Le paradigme est à nouveau déployé dans les rapports entre États puisque,
même quand nous nous trouvons dans un état social pacifique, nous sommes à l’état de nature entre
peuples, ce qui d’ailleurs fait dire à Rousseau que le droit des gens n’étant complété par aucune
contrainte, il n’abolit pas la permanence de la guerre. La guerre et la guerre civile naissent toujours de
cette contradiction que nous sommes à la fois à l’état de nature et à l’état social.
La guerre civile reflète donc un champ plus que politique de la cité voire de l’État en sa
naissance. L’État-Léviathan, l’institution de l’État sont des résolutions de l’impossible sortie de l’état de
nature. L’image de la guerre civile, l’illustration et le modèle qu’elle représente tout à la fois,
rencontrent une solution toute théorique qui épouse l’atemporalité de la division interne, du
déchirement incontrôlable. L’amnistie comme oubli des conflits est censée faire sortir de l’état de
nature, miroir et modèle de la guerre civile. L’avant-politique qui donne naissance au politique est
dépassé par une décision plus que politique dans le sens où elle est une surenchère : elle redonne
une naissance nouvelle à l’État. Les Grecs l’imposaient sous la forme du mè mnèsikakeîn, l’injonction
de ne pas se souvenir des maux, des mauvaises choses, injonction contradictoire en elle-même
puisqu’elle rejette dans le passé négatif et fait se souvenir de ne pas se souvenir. La compensation se
fait par l’oubli, le plus que politique dépassant la guerre civile par la surenchère dans la temporalité
contradictoire. L’amnistie est censée clore les guerres civiles, y mettre un terme artificiel en une
archidécision. La suspension pour l’avenir de toute sanction pénale est la forme contemporaine et
juridique de l’amnistie, pour autant elle n’a pas toujours été la seule. Solon avait légiféré pour que,
dans une guerre civile, tout citoyen prît parti, afin que l’égalité, même dans les malheurs, soit
respectée et que les uns ne soient pas tentés par des revanches en temps de paix. L’amnistie,
comprise comme concept salvateur opposé à l’état de nature comme guerre interindividuelle, est la
décision plus que politique d’oblitérer le chaos des citoyens ennemis, la volonté de recommencer
l’histoire et la société par l’oubli – ou plutôt l’interdiction de se souvenir – de l’origine violente.
Hobbes, dans le Béhémoth, y fait par deux fois allusion. La première occurrence est négative et
scandaleuse pour les deux interlocuteurs puisqu’elle est proposée par le roi mais que le Parlement
veut y inclure ses propres exceptions, détruisant par là le principe même de l’amnistie. La seconde est
plus positive puisqu’elle sanctionne la véritable fin de la guerre civile avec le rétablissement de
Charles II : le Parlement a rappelé le roi qui a immédiatement promulgué un Acte d’Amnistie, suivi
d’effets.
Cependant l’amnistie est une solution dont la valeur est strictement théorique, en quoi elle répond
parfaitement au schème de l’état de nature, étant elle-même un schème, une schématique dans un
temps qui est déjà celui de la paix. D’autre part, dans l’histoire des États, l’amnistie vient souvent
seulement compléter des procédures juridiques qui traduisent en justice ceux qui sont présumés
criminels, l’amnistie est une pratique déjà ancrée dans la paix, lorsque les hostilités sont déjà
terminées et les armes déposées. La sortie de la guerre civile est elle-même un moment oblitéré, situé
de manière très imprécise, presque par défaut. L’amnistie est bien davantage une procédure
d’effacement : on efface les faits de violence qui n’auraient pas dû advenir, tout comme les Athéniens
effaçaient littéralement de leurs planches les noms et les griefs, en les recouvrant à la chaux.
Théoriquement l’amnistie correspond à l’oubli de l’état de nature nécessaire pour rentrer dans l’État
pacifique et sécurisé, concrètement elle est bien difficile à mettre en place de manière pleine et entière
parce que précisément l’histoire a suivi son cours et qu’elle peut se manifester à tout moment dans
une nouvelle guerre civile. Hobbes manifeste lui-même la difficulté voire la contradiction inhérente à
cet oubli institué : il achève le Béhémoth avec l’amnistie mais il le commençait avec une dédicace
pour rappeler les horreurs de la guerre civile et les conjurer : « Rien ne peut être plus instructif en
faveur de la loyauté et de la justice que le souvenir de cette guerre, tant qu’il durera. ». La cohérence
de l’attitude de Hobbes va encore plus loin que cette apparente contradiction : il accepte la censure
que Charles II impose sur son livre : il a écrit (et bien entendu l’ouvrage circule) mais l’ouvrage est
littéralement oblitéré, momentanément effacé.
Ce que nous apprend l’état de nature, c’est que la cité constituée court toujours le risque d’être
sens dessus dessous. La cité à l’envers connaît un temps à rebours, paradoxe de la cité en guerre
contre elle-même. Les philosophes dans le temps de la guerre inventent un mimétisme entre la guerre

civile et l’état de nature. La nature des hommes serait donc de construire l’État et de s’y faire la
guerre, et inversement.
1
/
4
100%