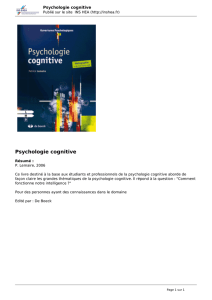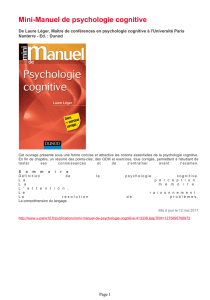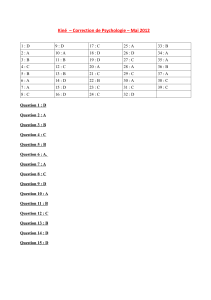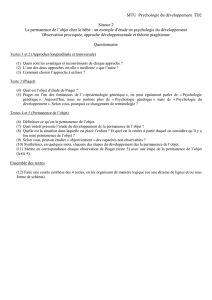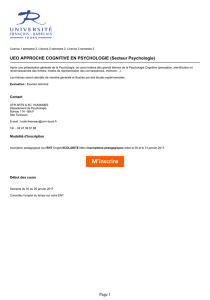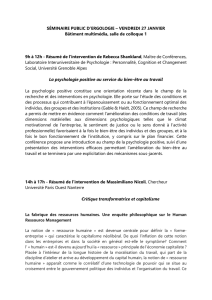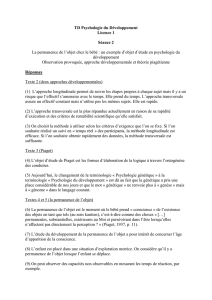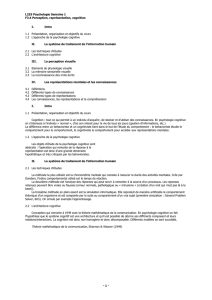piaget, milgram et festinger n`attendent-ils plus que

1
DISSONANCE COGNITIVE ET LANGAGE INCONSISTANT DE PIERRE JANET : RAPPROCHEMENT
Un commentaire critique de « Psychologie, Morale, Culture », de Manuel Tostain (PUG, 1999).
I. Saillot, PhD.
Institut Pierre Janet, Organisation Associée de la Société Française de Psychologie
23 rue de La Rochefoucauld – 75009 Paris, France
http://pierre-janet.com
tél (secrétar.) : + 33 (0)1 49 70 88 58 – fax : + 33 (0)1 42 81 11 17
e-mail: [email protected]
Décembre 2006
* * *
* * *
Ce livre – très agréable à lire – est une excellente contribution à la vulgarisation éclairée en
« psychologie morale », domaine encore trop peu exploré en France et en Europe comme le rappelle
d’emblée l’auteur, actuellement étudié principalement, outre Atlantique, par les spécialités cognitive et
sociale de la recherche en psychologie. Sans le moindre jargon technique, à des fins explicites et efficaces
de pédagogie envers le grand public, Manuel Tostain propose ici avec succès un panorama vivant et
détaillé des principales orientations depuis Piaget, qui par ses géniales investigations et son modèle
fondateur, peut être considéré l'initiateur des recherches contemporaines en matière de psychologie morale.
Après une intéressante présentation des ancêtres Hume et Kant, la première série d'études présentée dans ce
livre relève de la psychologie cognitive, qui analyse les raisonnements moraux (idées et jugements) des
sujets. L'approche piagétienne, c'est à dire cognitive, a été fondée par le psychologue genevois en rupture
avec l'approche « dynamique » l'ayant précédée, laquelle portait principalement sur le rapport entre les
actions et les paroles (idées, raisonnements) du sujet (Tostain ne rappelle toutefois pas cet important point
d'histoire). En ce qui concerne l'analyse des jugements spécifiquement moraux, Piaget n'étudie pas
d'actions réelles de ses sujets : tandis que dans le domaine cognitif il les mettait systématiquement à agir
(avec ses célèbres « tâches piagétiennes »), dans le domaine moral sa démarche consiste à les interroger
directement ou à leur faire commenter verbalement des historiettes à contenu moral (« C'est quoi, un
mensonge ? », « Pourquoi il ne faut pas tricher à l'école ? » ou bien « Juliette a volé des bonbons à sa
maman – qu'en penses-tu ? »). L’interprétation des réponses à ces scénarios lui permet alors de construire
toute une hiérarchie de « tendances morales » s'appuyant sur ses fameux stades cognitifs. La morale de
Piaget est fondée sur la rationalité, elle est une éthique de la justice conçue comme logique impartiale et
universelle. Kohlberg va reprendre ce modèle, systématiser son aspect cognitif et y développer l'importante
distinction entre convention et morale. C'est sous cette forme augmentée que la nouvelle hiérarchie
piagétienne va connaître une très large diffusion dans la recherche, restant selon Tostain, jusqu'à nos jours
encore la principale référence. De ce fait, elle va alors subir d'incessantes critiques (l’essence de la
recherche, et le meilleur hommage à un chercheur) jusqu'aux années 1990, où « l'approche psychosociale »
constituera cette fois – d'après l'auteur – une rupture majeure.
D'abord dès les années 1970, des critiques expérimentales invalident la séquence d'apparition des stades
moraux du modèle de Piaget et Kohlberg : Turiel montre que chez l'enfant les stades conventionnel et
moral apparaissent simultanément et non pas successivement. Les recherches ultérieures confirment que
« l'évolution de l'individu se caractérise, non pas par la succession de phases morales assez bien unifiées,
mais par l'émergence d'une pluralité de morales » (p. 87). Ensuite la notion de stades elle-même se voit
abandonnée (bien après l'invalidation biologique de son évolutionnisme spencéro-haeckélien d'origine,
auquel toutes les sciences humaines avaient succombé, y compris Pierre Janet) : « Les résultats de

2
différentes recherches ne corroborent pas cette idée d'une unicité de chaque phase morale » (p. 80). En
effet, d'une part des enfants du même âge adoptent de nombreuses morales différentes, d'autre part, ce qui
est plus essentiel encore, la variabilité des morales est même intra-individuelle : « en fonction des
moments, des situations, les individus ne réagissent pas de la même façon, et n'ont donc pas le même
niveau moral » (p. 128). Finalement, les critiques remettent en question, dans la hiérarchie de Piaget et
Kohlberg, l'idée que la conduite morale soit entièrement fondée sur la rationalité, ce qui occultait un pan de
la question : Turiel introduit le premier l'affectivité – ici, l'intuition – dans ce domaine de recherche, et des
auteurs ultérieurs, comme Kagan dans les années 80 ou Tostain plus récemment, insistent sur l'importance
de déterminations affectives, par exemple plaisir et peine, honte, culpabilité, dans la genèse de la morale
chez l'enfant, mais aussi dans les jugements moraux des adultes.
Dans les années 80, après les invalidations expérimentales, les critiques vont se faire plus fondamentales, et
porteront maintenant sur la nature même de la morale telle que l'envisageaient Piaget et Kohlberg, à savoir
une éthique de la justice : Gilligan montre que ces auteurs ont négligé la dépendance communautaire des
individus. En effet, de Piaget à Turiel, l'individu moral est censé être parfaitement autonome dans ses
décisions : la morale est individualiste, d'aucuns diront même « libérale », calquée sur l'idéologie de nos
sociétés occidentales. Cette survalorisation de l'autonomie explique que les enfants, les femmes, les classes
laborieuses et les sociétés traditionnelles obtiennent des scores biaisés de « basse moralité » sur les échelles
de Piaget et Kohlberg. Gilligan ouvre alors la première alternative à l'éthique de la justice, « la morale de la
sollicitude », une éthique interpersonnelle valorisant les conduites d'aide à autrui, restituant de meilleurs
scores aux catégories de population concernées. Fort de cette avancée, Schweder généralisera l'approche
aux sociétés traditionnelles : sa « psychologie culturelle » comble du coup la plupart des lacunes des
modèles l'ayant précédé. Selon Tostain, c'est avec lui que culmine la psychologie morale cognitive.
C'est alors que dans les années 90, un certain nombre de travaux – dont ceux de l'auteur – entament ce qui
constitue probablement la critique la plus radicale de ce qu’il reste des modèles moraux piagétiens et néo-
piagétiens précédents. D'après Tostain en effet, ces approches ont jusqu'alors toutes présenté « une
négligence des rapports entre morale et action » (p. 239), c'est ce qu'il appelle « l'idéalisme » de ces
chercheurs : les études sur la morale n'ont toujours porté que sur des « idées ». Mais en réalité, autant il
n'est pas inintéressant d'étudier les paroles et les raisonnements des sujets, autant les actions réelles ne
peuvent pas être négligées, car voilà où le bât blesse : il se trouve que dans bien des cas « le rapport causal
entre jugement moral et action n’est pas toujours évident », rappelle l'auteur p. 244. Cette observation altère
sensiblement, alors, la pertinence de l’étude d’une morale purement « imaginaire », jamais mise en actes
par les sujets. La « perspective psychosociale », c'est à dire la psychologie sociale et non plus seulement
cognitive, vient remédier à cet état de carence qui perdurait depuis 70 ans, et propose de s'émanciper du
cadre « idéaliste »-cognitif fixé par Piaget à l'étude de la morale, évitant pour la première fois « la
négligence, du moins à un niveau théorique, des situations réelles » (p. 238), et proposant l'étude des sujets
en train d'agir – leurs « conduites » dit l'auteur –, non plus seulement en train de penser. La deuxième série
de travaux présentés dans cet ouvrage relève donc de la psychologie sociale, l'angle adopté quittant
maintenant l'historique pour la discussion technique. La suite de ce commentaire procède de même.
Comme brièvement rappelé plus haut, la question des « conduites », c'est à dire le rapport des paroles aux
actions, constituait vers 1900 le domaine de la « psychologie dynamique », encore florissant au sein de la
recherche européenne dans la jeunesse de Piaget. Il reconnaîtra d’ailleurs son meilleur représentant, Pierre
Janet, comme son « vrai maître en psychologie » (Bulletin de la Société Alfred Binet & Théodore Simon,
1975). Or, bien qu'à la suite de Janet il envisage la psychologie comme l'étude des « conduites », Piaget
préféra l'angle cognitif à l'angle dynamique. Ce faisant et comme on ne le rappelle pas assez, il devenait
l'un des premiers et principaux promoteurs de la psychologie cognitive en Europe, avant même Bruner aux
États-Unis (comme le mentionne par exemple L. Nadel dans Encyclopedia of the Cognitive Sciences,
2003), ce dont il n'y aurait qu'à se réjouir... si ça n'était la disparition simultanée de la psychologie
dynamique au sein de la recherche, par conséquent de l'enseignement supérieur, ne lui restant dès lors plus
jusqu’à ce jour que le secteur privé, c'est à dire le marketing, pour se déployer hors tout cadre académique,
donc critique.
La prise en compte des « conduites » que prône si remarquablement Tostain n'est donc pas qu'un
amendement de plus aux modèles de morales ayant précédé, elle constitue peut-être les prémisses d'une

3
ouverture – au sein de la recherche, enfin – à une orientation « dynamique » de la psychologie, qui ne peut
être que prometteuse (en « morale » comme, en fait, dans bien d'autres champs actuellement, où la
nécessité de cette prise en compte commence à être reconnue), surtout si prochainement les chercheurs
s'enquièrent, en outre, d'un peu de bibliographie dans le domaine, qui pour être certes bien poussiéreuse,
recèle – comme on va le voir – quelques observations expérimentales et modèles théoriques qui ne seraient
pas sans pertinence et actualité pour la recherche en cours. Parce qu'il faut bien le dire, dans l'état présent
des nouvelles connaissances toutes récentes sur les « conduites », la « perspective psychosociale » que
recommande l'auteur nous laisse parfois un peu sur notre faim quand elle est poussée dans ses
retranchements : l'interprétation théorique de superbes investigations expérimentales ne semble pas
toujours à la hauteur du travail de terrain, et quelques-unes de ces extraordinaires expériences auraient
probablement à gagner de se voir confrontées aux modèles dynamiques qui attendent – patiemment –
depuis des décennies.
La belle et légitimement célèbre expérience de Milgram (1963), rappelée p. 248, reste difficile à interpréter
en termes de rapport des idées aux actions, c'est à dire de « conduites » : elle montre que parmi les sujets
qui infligent les chocs électriques à la personne-test, beaucoup agissent en fait à l'encontre de leurs propres
principes moraux, et – heureusement si l'on peut dire – en conçoivent un profond malaise. Mais une fois
établie l'influence de la soumission à l'autorité, on ne sait pas exactement interpréter en quoi cette autorité
conduit les sujets à trahir leurs convictions. Une non moins superbe expérience de Darley et Batson (1973),
rappelée pp. 247-248, ne trouve pas d'interprétation parfaitement satisfaisante, non plus, dans le cadre des
modèles actuels de « conduites » : elle montre que dans certaines conditions d'inquiétude (ici, on presse les
sujets, leur disant qu’ils sont en retard), des séminaristes délaissent sur leur passage un malade gémissant
alors même qu'ils viennent de prêcher le « dévouement » en conférence. Mais une fois établie l'influence de
cette inquiétude horaire, on ne sait pas exactement interpréter en quoi elle conduit les sujets à violer leurs
recommandations morales. Quand on interroge ces sujets à propos de la différence entre leurs actes et leurs
paroles, certains tentent de la minimiser par diverses « stratégies de légitimation ou de désengagement
moral » (p. 245), dont la moins célèbre n'est pas la « réduction de la dissonance cognitive » de Festinger
(1957). Bref jusqu'à présent les modèles théoriques permettent déjà d'établir, au moins – mais un peu
timidement –, qu'inquiétudes et contrariétés altèrent nos capacités à agir pour le mieux, et que, d'une
manière générale, nos conduites sont parfois sous « l'influence du contexte » (p. 247). Janet disait déjà, en
1909, que dans certaines circonstances, l'individu se retrouve « au dessous de lui-même ». Bien. Mais la
haute ingéniosité de ces remarquables « manips » modernes ne donne-t-elle pas envie d'en apprendre un
peu plus sur toutes leurs interprétations possibles ? Justement il se trouve qu'autour des années 1900,
l'incohérence entre le discours et les actions, mise en évidence par de scrupuleuses expérimentations
médico-psychologiques, était fort étudiée en psychologie dynamique, dans la recherche, et s'appelait le
« langage inconsistant » sous la plume et dans le laboratoire de Pierre Janet (entre autres). Un
rapprochement des plus passionnants reste à faire entre ce vieux « langage inconsistant » et la moderne
« dissonance », qui ne devrait pas interpeler que les historiens... loin de là. Il est assez probable, au
contraire, que quelques-uns des faits et hypothèses établis à l'époque devraient intéresser notre recherche
psychologique la plus actuelle, cognitive et sociale. Rappelons-en quelques brefs éléments.
Les faits. Une incohérence – plus ou moins profonde et étendue – entre la parole ordinaire et les actions
réellement effectuées par le sujet, était considérée à l'époque le cas le plus général de la conduite et de la
cognition normales. C'est bien au contraire le cas inverse (paroles et actes qui se correspondent) qui serait
rare : en effet dans la plupart des conversations, les « bavardages de salon » comme dit Janet, le lien avec
des actions possibles, effectuées ou à faire est soit inexistant (météo, insécurité, politique), soit erroné (« je
vais le frapper », « je vais faire un régime »). En pointant une défaillance du « rapport causal entre
jugement moral et action », la « perspective psychosociale » réhabilite fort judicieusement le langage
inconsistant, mais la question de sa généralité (prévalence dans la population) ne doit pas être négligée, et
donnerait il faut le parier de surprenants résultats. Comment était alors expliquée la généralité, qu’il
conviendrait de mesurer à nouveau, de cette « dissonance » ? Tout simplement parce que dans le cas
ordinaire, elle n'est pas perçue par le sujet (ni ses interlocuteurs, généralement du même échantillon
statistique) : il n'en souffre donc pas, ne cherche nullement à la réduire, et perpétue indéfiniment son
langage inconsistant. De ce fait, la psychologie dynamique prédit de façon antérograde que la « réduction
de la dissonance cognitive » pourrait bien ne pas être un cas très courant, la plupart des dissonances restant
sans réduction. Il faut noter ici qu'un courant de recherches modernes remet d'ailleurs en cause la généralité

4
de la réduction (donc, d'une certaine façon, celle d'un « langage consistant »). Par exemple à la suite de
Steele (The psychology of self-affirmation. Advances in Exp. Social psych.,1988), des études démontrent
que la réduction n’intervient que si l’estime de soi est menacée. Pour bien prendre en compte les conduites,
il serait intéressant de se demander, alors, dans quelle mesure l’estime de soi est vraiment menacée dans les
contextes les plus courants de la psychologie normale : la grande majorité des conversations ordinaires
(donc, l’essentiel de la cognition), n'a-t-elle pas lieu entre sujets qui se fréquentent régulièrement (famille,
amis, collègues) ? La prévalence du langage inconsistant (dissonance) s'expliquerait alors par une habitude
des sujets, qui augmenterait leur seuil de tolérance à l’auto-contradiction entre paroles et entre actions et
paroles, comme d’ailleurs d’autres seuils de vigilance (on pense par exemple à des cas démontrés : la
conduite automobile ou l’opération de machines d’atelier). Notons au passage que des études sur l'habitude
seraient toutes indiquées pour explorer les aspects dynamiques (lien paroles-actes) de la psychologie.
Les hypothèses. En psychologie dynamique, on expliquait à l'époque l’incohérence parole – actions par la
cause d'une fatigue, dont les premiers degrés ordonnent déjà bien des aspects de nos conduites
quotidiennes, et les degrés sévères vont de la psychasthénie (rigoureusement définie par Janet, et qu'on
pourrait rapporter à la « dépression », malgré l'absence de consensus sur ce terme moderne) à la démence
autiste ou schizophrène. Bien entendu chez Janet, la notion de « fatigue » est complexe, fait l'objet de longs
développements, et ne recouvre que partiellement l'usage commun. En particulier on y pense généralement
comme un phénomène global, tandis que pour lui, elle ne touche souvent que des actions isolées : par
exemple un sujet sera « fatigué » de lire mais « en forme » pour peindre, ou fatigué par Martine, mais en
forme avec Jacques, ce dont l'explication dépasse hélas les cadres de ce texte. Or, l'un des premiers
symptômes de la fatigue était d’après ces approches de se sentir impuissant à agir, soumis à des contraintes
difficiles à surmonter, oppressé, victime. Il en ressort que chez beaucoup d'individus, être oppressé serait
une expérience quotidienne ou fréquente et la contrainte oppressante bien plus souvent perçue que réelle.
Parvenu à ce point, ne pourrait-on pas alors établir un parallèle assez inspirateur – espérons – entre ces
anciens résultats, et l'interprétation actuelle de l'expérience de Milgram, censée illustrer l'effet d'une
soumission à l'autorité sur une incohérence parole – actions ? Si la soumission à l'autorité était bien plus
souvent un sentiment qu'une réalité, alors Milgram aurait en fait réalisé la simulation d'un contexte
ordinaire de cognition normale, où d'après la psychologie dynamique, le sujet éprouve une autorité perçue,
une impression d’autorité, fréquente et souvent quotidienne dans sa vie, causée par un certain degré de
fatigue, rendant compte également de son langage inconsistant quotidien. D'après ces hypothèses
anciennes, la contrainte d'autorité et la dissonance cognitive ne seraient donc nullement dans un rapport de
cause à effet, mais constitueraient deux effets simultanés d'une cause que la psychologie actuelle n'a pas
encore assez explorée sous l'angle des conduites : la fatigue et les degrés de la psychasthénie.
Une autre – extraordinaire – expérience, celle de Zuckerman (1975) rappelée par Tostain p. 267, donnera
une nouvelle occasion d'illustrer quelques principes de psychologie dynamique propres, peut-être, à venir
enrichir la réflexion contemporaine. On évalue le degré de croyance en « un monde juste » d'étudiants
bénévoles au sein d'une association caritative. Ils sont ensuite sollicités par leur association, soit dans
l’année soit en pleine période d’examens. Les résultats sont « très contrastés », dit l’auteur, et surtout,
surprenants : ceux qui croient peu en « un monde juste » répondent dans l’année, les autres pendant les
examens. « Comment interpréter ces résultats ? » demande Tostain. La réponse est embarrassante, parce
qu'il semblerait qu'aucune interprétation en termes de « conduites » n'ait encore été donnée à ce jour.
Quoiqu'étayée semble-t-il par plusieurs études indépendantes, l'interprétation retenue ne devrait pas donner
entière satisfaction aux plus curieux. Des hypothèses attribuent aux sujets des motifs relativement
simplistes : les étudiants qui croient peu en un monde juste seraient (tautologiquement ?) « pragmatiques »,
puisqu'il semble rationnel de participer à la vie associative en dehors des examens. Les autres seraient
superstitieux : « si je ne fais pas cette bonne action, peut-être que ça me retombera dessus aux examens »
(p. 268). On reste, il faut le dire, assez sur sa faim, d’autant – et ça n’est pas le moins gênant – que ces
interprétations impliquent toutes un rôle causal des croyances morales sur les actes… dans un chapitre
méritoirement consacré à combattre cette idée. Essayons quelques idées alternatives.
En note préliminaire, remarquons que ces études s'inscrivent dans le programme BJW (Belief in a Just
World) qui a donné lieu à de très riches recherches de par le monde, tout comme la « dissonance ».
Justement il serait intéressant de savoir si – et comment – les deux théories ont déjà été rapprochées (?). Il
semble en effet que l'expérience de Zuckerman décrive en psychologie cognitive un superbe cas de

5
« dissonance » à la Festinger. Or, c'est cette dissonance (ce langage inconsistant), qui donne les indices
d'une possible interprétation dynamique, en termes de conduites. En effet, l'activité caritative des deux
populations consiste à aider des aveugles. Mais être aveugle n'est-il pas une criante injustice ? Il est donc
possible de considérer que l'activité caritative des sujets de Zuckerman – qu'ils croient ou non en « un
monde juste » – consiste bel et bien à réduire une injustice. La célèbre expérience se voit alors reformulée :
1) pendant l'année, certains étudiants déclarent croire « en un monde juste », et effectivement ne s'occupent
guère d'injustices (ils ne répondent pas à la demande). D'autres, eux, déclarent ne pas croire « en un monde
juste », et effectivement s'occupent bénévolement de réduire des injustices (ils répondent à la demande).
Leurs paroles sont donc cohérentes avec leurs actes. 2) Les examens arrivent : voilà maintenant que ceux
qui croient en « un monde juste » se mettent à réduire des injustices [!] (ils répondent à la demande). Quant
à ceux qui ne croient pas « en un monde juste », ils cessent de s'occuper d'injustices (ils ne répondent plus à
la demande). On observe donc que pendant les examens, les deux populations rendent momentanément
leurs paroles incohérentes avec leurs actes : la période d'examens provoque la dissonance cognitive des
sujets de Zuckerman.
Admettons l'hypothèse de travail. Mais pourquoi la période d'examens provoquerait-elle la dissonance ? Il
n'est pourtant plus question, ici, de soumission à l'autorité, comme chez Milgram, ou d'inquiétude horaire,
comme chez Darley. C'est là – à notre sens – qu'une approche en termes de « conduites », que recommande
judicieusement Tostain, donnerait sa pleine mesure. Les anciens modèles de psychologie dynamique
satisfont à ce critère, et voici comment ils pourraient être appliqués à la question. Appelons « pessimistes »
les sujets qui selon l'enquête préalable, ne croient pas (ou peu) en « un monde juste », et « optimistes » les
sujets qui selon l'enquête, croient assez en « un monde juste ». Il faudrait connaître leur tableau clinique
détaillé (leur « analyse psychologique » comme Janet en a proposé le terme). Toutefois, la simple
comparaison des deux permet tout de même de progresser : en attendant – bien impatiemment – de
nouvelles mesures et expérimentations, il suffit de dire ici que les deux populations d'étudiants diffèrent
probablement par le nombre et la qualité de leurs actions, surtout sociales, et par le contenu plus ou moins
gai de leurs idées générales. Que se passe-t-il donc quand ils reçoivent la demande de leur association
caritative ? 1) En dehors des examens, les optimistes, assez actifs, cultivent déjà des occupations, y compris
sociales, quand ils reçoivent la demande. Occupés, peu enclins à ce moment aux idées noires et à se
pencher sur le malheur d'autrui ni le leur, « profitant de la vie », la demande les laisse indifférents ou les
dérange, ils l'oublient ou la remettent à plus tard. Les pessimistes, eux, sont émus par la demande, qui entre
en résonance avec leurs idées noires, et ne leur quitte plus l'esprit. Ils y répondent immédiatement : ceux
qui croient peu en « un monde juste » répondent dans l’année, pas les autres. 2) Les examens arrivent.
Qu'ont-ils pour effet ? Bien simplement selon Janet, de fatiguer les deux populations d'étudiants, c'est à dire
– en termes dynamiques – de rabaisser d’un degré leur niveau mental (leur « tension »). De ce fait, les
anciens optimistes acquièrent le tableau clinique défini « pessimiste », tandis que les anciens pessimistes,
descendant encore d’un degré, se rapprochent d'un état dépressif (psychasthénie franche). Les anciens
optimistes répondent alors à la demande immédiatement, pour les mêmes raisons que les pessimistes
naturels précédents, tandis que les anciens pessimistes, frôlant maintenant la dépression, n'ont
temporairement plus assez de force (d'action, de volonté) pour se dévouer aux malheurs d'autrui : ceux qui
croient en « un monde juste » répondent en pleine période d'examens, pas les autres. Ces modèles anciens,
déjà publiés, ne semblent-ils pas présenter quelque potentiel à compléter les interprétations modernes ?
Finalement, la psychologie dynamique pourrait suggérer une synthèse, en un unique modèle, de faits
jusqu'alors peu unifiés : des fatigues ordinaires, plus ou moins étendues et durables, médicales ou
contextuelles (Zuckerman), entravent certaines conduites, et entretiennent les phénomènes d'inquiétude
(Darley), les sentiments de soumission, de mêmes effets qu'une soumission réelle (Milgram).
L'empêchement des actions éloigne le discours d'actes possibles ou effectués (Festinger) : sans prise de
conscience, souffrance, ni réajustement (Steele), l'incohérence « des jugements aux actions » (Tostain) est
probablement un phénomène des plus répandus. Pourquoi la recherche ne soumettrait-elle pas derechef
quelques-unes de ces idées à l’épreuve de la critique, dans un temps où l’excellence de ses
expérimentations invite à ne négliger aucune piste théorique d’interprétation ?
En conclusion, Tostain recommande que la psychologie morale ne perde plus de vue, dorénavant, « le rôle
des émotions » (p. 314), malheureusement guère développé dans ce livre (on attend ça dans le suivant...).
Depuis une quinzaine d'années, en effet, les « neurosciences affectives » ont efficacement réhabilité
 6
6
1
/
6
100%