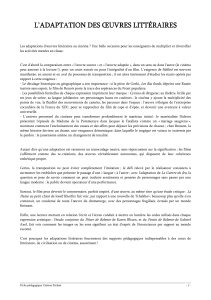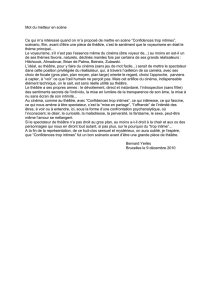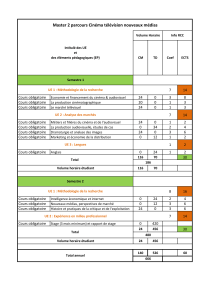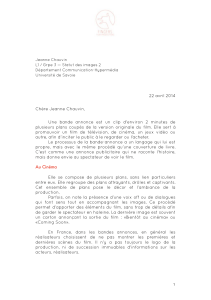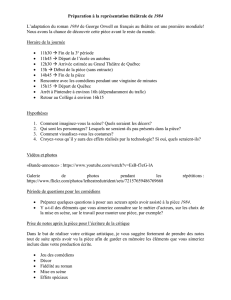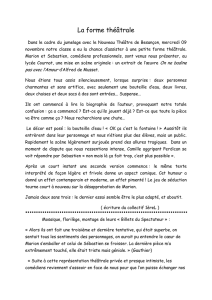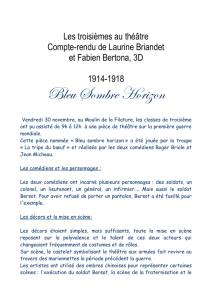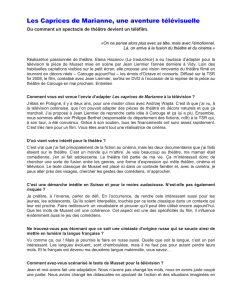On n`est pas à Dallas» d`Émile Breton

LA CHRONIQUE CINEMA D’ÉMILE BRETON
On n’est pas à Dallas
Ne pas oublier que ce film s’appelle Léo, en jouant dans La Compagnie des
hommes, qu’il est l’adaptation au cinéma par Arnaud Desplechin de la pièce du
dramaturge anglais Edward Bond. On est vite prévenu : les comédiens qu’on vient de
voir, jouant «comme pour de vrai» une scène en costumes, confortablement
installés dans les profonds fauteuils d’un salon richement meublé, on les retrouve à
la table de travail, pull-overs et vestes de velours, discutant de leur texte, de la
conception de leurs personnages. La première scène a manifestement été tournée
avec tout le lourd appareillage du cinéma, la seconde en vidéo légère : les acteurs,
tendus dans la première, plaisantent ici, reprennent leur texte, se le "mettent en
bouche". Coquetterie ? Évidemment pas pour qui connaît un peu l’ouvre du cinéaste
et qui sait comment, avec son précédent film, Esther Kahn, il avait su dire la
métamorphose sur scène et par la scène d’une jeune femme, loin de la vie
d’apparence larvaire qu’elle avait jusque-là menée. Film d’amour pour l’art du
comédien, Esther Kahn était aussi une réflexion sur cette mystérieuse alchimie des
corps qui, dès le lever d’un rideau, transforme un humain, terne peut-être, en
personnage flamboyant.
Cette réflexion, il la poursuit ici, mais cette fois dans la complicité avec les
comédiens, puisqu’on le voit fugacement, dans la première séance de travail,
partager leurs doutes à la table de travail, et il la redouble si l’on peut dire d’une
interrogation sur le cinéma dans ses rapports aux arts auxquels il a succédé. Car si
le metteur en scène de théâtre dont il s’est octroyé le rôle dans l’apparition qu’il fait à
la séance de travail est aussitôt escamoté que vu, on sent bien, à tout instant du jeu
au bord de l’hystérie des comédiens dans le côté " film de cinéma " de cette histoire
sanglante, que quelqu’un, derrière la caméra, est là pour les pousser à aller vers la
démesure. Ainsi ces gens qu’on a vus souriants, potaches à l’étude de leurs rôles,
vont s’affronter dans une lutte à mort dans la " vraie vie ", la caméra, dès lors qu’elle
tourne, étant censée enregistrer cette vie, le théâtre relevant du pur arbitraire.
Si cette inversion passablement diabolique peut déstabiliser le spectateur
naturellement porté à croire ce qu’il voit à l’écran, et à s’identifier à l’un des
personnages, elle devrait aussi l’amener à regarder d’un oil plus distant ce qui lui est
montré. Bref à ne pas se laisser faire le coup de l’émotion, ce que souhaitait Brecht,
on le sait, pour qui, si la passion, le désir étaient à l’origine de l’ouvre, tout devait être
mis en ouvre dans son déroulement pour éviter d’en obscurcir la " leçon ". Et c’est
bien ce à quoi tend le travail de Desplechin sur la pièce de Bond, qu’on lira avec
profit, aux Éditions de l’Arche, avant d’aller voir le film. C’est une féroce leçon de
choses sur le capitalisme. Autour d’un marchand d’armes et de son héritier se
trament des coups tordus, se nouent dans la politesse exquise des échanges de
conseil d’administration des complots et des projets d’assassinat. L’un voudra joindre
à son empire le trafic d’armes pour mieux implanter dans les pays en voie de
développement son commerce alimentaire, un autre trahira tous ceux qu’il sert, le fils
tuera le père, au moins en intention, le serviteur fidèle se prêtera à toutes les
manœuvres, et pour son maître " diriger une entreprise, c’est comme marcher sur
une corde raide avec des chaussures en feu ". Ainsi va la machine à broyer, d’autant

plus efficace qu’elle se sert entre autres de l’amour que se portent un père et un fils
pour assurer son emprise.
Desplechin respecte cette trame (à quelques modifications près, pas forcément
heureuses, ainsi l’adjonction d’un personnage féminin) mais les quelques échappées
qu’il se permet vers la mise en chantier de la pièce par les comédiens qu’on va
retrouver " dans la peau de leurs personnages " introduisent le juste recul qui permet
de mieux faire la part des hommes et la part du système dans ce sinistre " commerce
". Paradoxalement, peut-être parce qu’on les a vus se préparer à leur rôle, et parce
que, lorsqu’ils le jouent, ils le font avec une sorte de furie imprécatoire, les
comédiens apparaissent d’abord comme victimes du système. Ces va-et-vient du
théâtre au cinéma disent haut que l’on n’est pas ici devant Dallas, célèbre feuilleton
avec ses bons et ses méchants par rapport à qui le spectateur prendra parti, mais
devant une mise en représentation - et en cause - d’un système. Et que l’important,
c’est de comprendre ses mécanismes. Non pas d’être, par exemple, pour le fils
contre le père ou l’inverse, mais d’être capable de voir clair dans les forces qui les
agissent.
Un film qui ouvre une réflexion sur le monde capitaliste tout autant que sur les
diverses façons de représenter le réel, théâtre ou cinéma, et invite à ne pas se
laisser prendre aux apparences, mérite un spectateur attentif.
1
/
2
100%