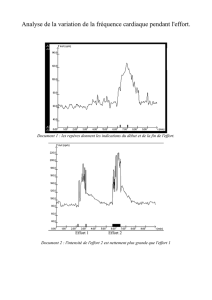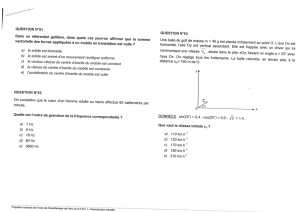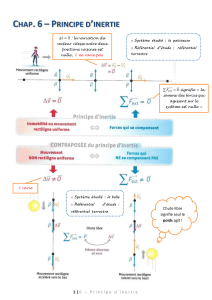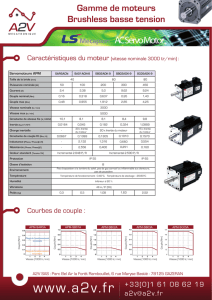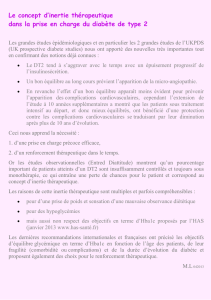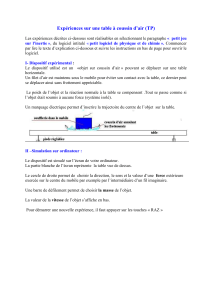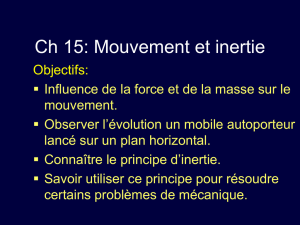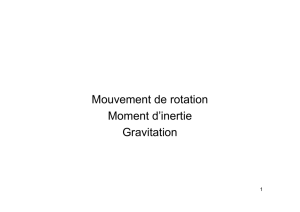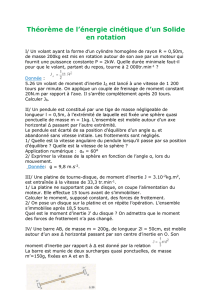Télécharger

1
Table des matières
Introduction............................................................2
Chapitre 1: L'histoire du concept de masse..............3
1.1 Approche historique du concept de masse................................3
1.2 Obstacles épistémologiques.....................................................8
Chapitre 2: Analyse des programmes et des
manuels: étude de la transposition didactique..........12
2.1 Bilan du savoir savant.............................................................12
2.2 Étude de la transposition didactique,
par l'analyse des programmes et des manuels scolaires.................17
Chapitre 3: Formulation des hypothèses
de recherche.............................................................25
3.1 La définition de la masse et sa conservation............................25
3.2 La masse inerte......................................................................26
3.3 La distinction entre la masse inerte et la masse pesante.........27
3.4 Les hypothèses de recherche..................................................27
Chapitre 4: Cadre théorique et mise en place du
dispositif expérimental.............................................29
4.1 Cadre théorique......................................................................29
4.2 Justification du dispositif expérimental...................................30
4.3 Le questionnaire.....................................................................31
Chapitre 5: Questionnaire........................................34
5.1 Élaboration des questions .......................................................34
5.2 Ordre des questions................................................................43
5.3 Possibilités d'analyse en fonction des personnes interrogées...45
Chapitre 6: Expérimentation
et analyse des résultats ............................................47
6.1 Expérimentation.....................................................................47
6.2 Analyse des résultats..............................................................48
6.2.1 Questionnaire des Troisièmes........................................................................49
6.2.2 Questionnaire des Terminales.......................................................................54
6.2.3 Questionnaire des Deug (deuxième année)..................................................59
6.2.4 Questionnaire des enseignants......................................................................65
6.3 Analyse de l'évolution des raisonnements...............................71
Conclusion...............................................................74
Bibliographie................................................................................76

2
Remerciements............................................................................78

3
Le concept de masse en physique
Introduction
Avant de commencer cette recherche il nous faut bien cerner le concept de masse. Dans
ce but nous allons commencer par faire une approche historique de ce concept. Nous
verrons les grands courants de pensée qui lui sont rattachés, ainsi que les polémiques qu'il
a soulevées. A partir des faits marquants de son histoire, nous tâcherons de faire
apparaître les obstacles épistémologiques qui lui sont reliés. Ensuite nous observerons la
transposition didactique de ce concept dans les programmes et dans les manuels. Cette
analyse est susceptible de nous montrer les "problèmes" qui vont s'opposer à
l'apprentissage du concept de masse.
En nous basant sur l'approche épistémologique de ce concept, ainsi que sur sa
transposition didactique, nous allons formuler un certain nombre d'hypothèses de
recherches. Le but de cette étude est de les tester, mais il faut auparavant définir un cadre
théorique dans lequel nous placer. Nous avons choisi celui de la didactique de la Physique
et plus précisément celui concernant les conceptions et les obstacles. La théorie étant
définie, nous allons pouvoir tester nos hypothèses par un dispositif expérimental. Parmi
les différents dispositifs possibles nous avons choisi le questionnaire pour des raisons de
temps et de commodité. Nous allons maintenant analyser le questionnaire. C'est-à-dire
qu'après avoir élaboré les questions, nous ferons une analyse des réponses possibles, qui
nous servira de référence lors de l'analyse des questionnaires. Après avoir justifié l'ordre
des questions, dans le but de limiter au maximum les effets de contrat didactique dans le
questionnaire, Nous évaluerons les possibilités d'analyses en fonction de la population
interrogée. Le questionnaire étant prêt sur le plan théorique, nous allons passer à la phase
d'expérimentation. Nous avons décidé de distribuer le questionnaire à: Une classe de
Troisième, une classe de Terminale, une classe de Deug et un groupe d'enseignants de
lycée. Après avoir récupéré les questionnaires, nous avons procédé à l'analyse des
résultats de chaque groupe interrogé. Nous avons ensuite comparé les résultats de chaque
groupe, afin d'analyser l'évolution des raisonnements en fonction des stades
d'apprentissages.

4
Chapitre 1: L'histoire du concept de masse
1.1 Approche historique du concept de masse
Introduction
Le concept physique de la masse a été défini par Newton, il est le pilier de la mécanique
classique. La masse est une grandeur invariable propre à tous corps, elle se différencie du
poids par la gravité (qui représente l'attraction de la terre sur l'objet). De cette définition
découle: la loi de la gravitation universelle, le principe de l'inertie, ainsi que la loi
fondamentale de la dynamique. A partir de ce nouveau concept, la physique et la chimie
ont connu un essor considérable. Néanmoins vers la fin du XIXe siècle, des critiques sont
apparues, on reprochait à la définition d'être imprécise. Puis de nouvelles expériences
vinrent remettre en cause la conservation de la masse. La théorie de la relativité restreinte
qui devait conduire à relier la masse à l'énergie, a complètement bouleversé la mécanique
classique. Depuis de nouveaux domaines se sont développés, mais le concept de masse
"relativisé" reste la clef de voûte de toute la physique moderne.
GALILÉE, la loi de chute des corps conquit contre l'opinion.
Newton fut le premier a définir la masse par le terme "quantité de matière". Il aura fallu
un changement conceptuel considérable pour arriver à ce résultat. En effet, au Moyen-
Age, l'enseignement de la philosophie et plus particulièrement des sciences se faisait dans
des écoles scolastiques. Ces écoles (inspirées de la philosophie d'Aristote) considéraient
le poids (pondus) comme une propriété des objets lourds.
C'est Galilée (1564-1642), qui en établissant la loi sur la chute des corps, a supprimé la
distinction entre les objets lourds, qui avaient un poids et les objets légers, qui n'en
avaient pas. Pour établir cette loi, Galilée va se heurter à des pseudo-théories admises par
les grands courants de pensée de l'époque. Il y a deux types d'explications qui font
barrage: "l'explication qualitative et cosmologique du mouvement de chute comme retour
des graves (comprenez les corps lourds) à leur lieu naturel." Ainsi qu'une "hypothèse
empirique et quasi-mathématique, qui ne manque pas d'une certaine vraisemblance bien
qu'elle soit fausse, suivant laquelle la vitesse de la chute est déterminée par le poids du
corps et la résistance du milieu" (J.Merleau-Ponty, 1974, p.22). C'est en lâchant des objets
du haut de la tour de Pise, que Galilée établit par l'expérience que tous les corps qui
tombent de la même hauteur acquièrent la même accélération. Il précise notamment que
"la chute ne dépend pas du poids" et que "l'action de la résistance du milieu (le
frottement) est relativement plus grande dans la chute des petits corps", c'est à dire que les
frottements dépendent de la taille des objets. Cependant, malgré cette loi bâtie contre
l'opinion générale, Galilée ne concevait pas la gravité comme extérieure au corps.

5
Il concevait néanmoins "l'idée d'une résistance interne au changement de mouvement",
qu'il exprima à l'aide du principe de l'inertie pour le mouvement dans le plan horizontal.
En effet, ce principe bien que général (valable dans toutes les directions, sur la terre
comme dans l'espace), ne fut envisagé qu'horizontalement par Galilée, car c'est selon lui
"le seul réalisable expérimentalement à la surface de la terre". De plus ce principe n'était
pas envisageable dans le cosmos, car pour lui "la ligne cosmique la plus naturelle" était"
le cercle et non la droite" et "par conséquent le mouvement rectiligne et uniforme "n'était
"qu'une abstraction, valable comme approximation locale".
Descartes (1596-1650), en s'appuyant sur ce principe définit, dans son livre: Méditation
métaphysique (1641), la quantité de mouvement comme étant le produit de la vitesse par
la quantité de matière ( p = m.v ).
Le terme "quantité de matière" était utilisé dès le XIVe siècle, avec l'idée de sa
conservation dans tous les changements, de plus Richard Swineshead envisageait la
possibilité de sa mesure mathématique par le produit de la densité et du volume.
NEWTON, la gravité est extérieure au corps.
Mais c'est Newton qui établit le premier une distinction nette entre la masse et le poids,
en concevant la gravité comme une sollicitation extérieure. C'est sur la base de ce
changement conceptuel révolutionnaire que repose la Mécanique Classique. Dans ses
Principia Mathématica (Principes mathématiques de la philosophie naturelle, 1687), il
définit la masse comme la "quantité de matière" donnée par la "réunion de la densité et du
volume"(sous-entendu le produit des deux).
Il établit, en faisant des expériences sur des pendules, la proportionnalité entre le poids
(p) et la masse (m) à une hauteur donnée, ce qui se traduit par l'équation:
p = m g
g étant l'accélération due à la gravité, "indépendante de la forme, de la nature et du poids
du corps". En voyant la gravité comme extérieure au corps et la masse comme une
quantité invariable, il apparaît que le poids varie en fonction de la distance au centre de la
terre. Newton définit la gravité comme "la force qui incite un corps à descendre".
C'est à partir de l'observation des étoiles que Newton décide d'étendre la gravitation à tous
les corps, il érige le principe de la gravitation universelle:
"Tous les corps ont en propre un pouvoir de gravité, proportionnel aux quantités de
matière que chacun d'eux contient."
C'est-à-dire que la force de gravitation de chaque objet est proportionnelle à sa masse.
A partir de ce principe et en utilisant les lois de Kepler (1571-1630) sur le mouvement
des planètes et la loi de Galilée de la chute des corps sur terre, qui utilisent toutes les deux
que les espaces parcourus sont en raison des carrés des temps, Newton établit que "la
force d'attraction de gravitation universelle entre deux corps de masse m et m' séparés par
une distance d est:
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
1
/
87
100%