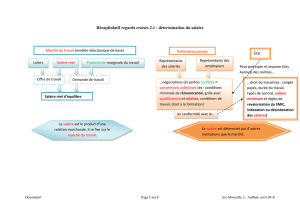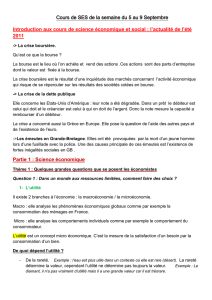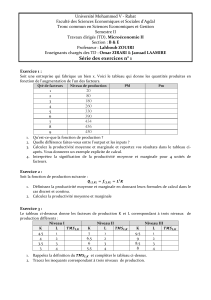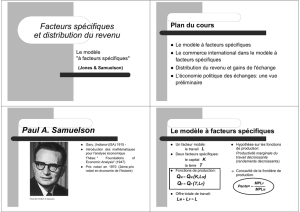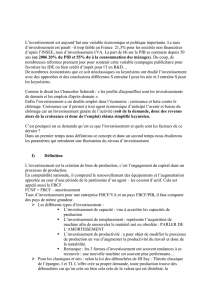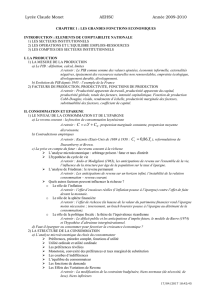pkilfautpartagerlesrevenusjosephine - prepa-bl

Pourquoi il faut partager les revenus ? Le seul antidote à l’appauvrissement collectif de
Patrick Artus et Marie-Paule Virard (La découverte, 2010).
Introduction : crise 2007 = pas une crise isolée mais une crise qui en préfigure d’autres Plan de relance : soutien aux PME
innovantes, aide à la recherche en entreprise mais plan de relance qui va mettre du temps à produire de la croissance (10-
15 ans). Il est donc dur de penser que la France pourra échapper au marasme qui a touché le Japon même si elle a relancé
plus tôt car rapidement on a observé un retour à l’austérité + réduction des exportations en direction ses pays émergents +
fin des possibilités de financement par l’épargne drainée par les pays émergents (puisque ceux-ci gardent de plus en plus
leur épargne pour financer des ov intérieur)
Thèse défendue : il faut que la France soutienne sa demande intérieure sans compter sur les exportations et sur l’aide
extérieure. Comment ? 1) modifier le partage des revenus entre salaires et profits car le salaire est consommé alors que les
profits sont surtout épargnés, 2) réforme fiscale : pas assez d’emploi, faible nécessité d’inv car on surproduit déjà =>
pourquoi taxer si fortement le travail et faiblement le capital ? et 3) renforcer la solidarité européenne
I-La « déglobalisation » et ses effets
Les pays émergents substituent rapidement de la demande intérieure aux importations et ont moins besoin de nous.
Pourquoi ?:
- Baisse de la demande intérieure des pays de l’OCDE dûe à la crise, ce qui a pour corollaire une baisse des
importations + baisse des investissements et une baisse du pouv d’achat ( car conséquences sur l’emploi et les salaires)
- Substitution de le production intérieure aux importations dans les pays émergents maintenant de plus en plus
capables de répondre à la demande intérieure du fait qu’ils réalisent désormais d’importants transferts technologiques
- Montée en gamme qui rend très compétitifs les nouveaux pays , tout cela est lié au transfert de compétences ( les
firmes des pays riches qui se sont installées dans les nouveaux pays ont permis des transferts de technologie et de
compétences) et rôle de l’Etat dans ces pays qui soutient de manière intense les entreprises high-tech ainsi que la
formation et l’enseignement technique/spécialisé. Ex : bas de gamme représentait 36% de leurs exportations en 1998 et
21% en 2007.
Dans les pays émergents le retour à la croissance a été plus rapide, ce qui joue est surtout la force de la demande. Le pays
qui incarne le plus ce nouveau modèle est celui de la Chine dans lequel l’évolution de la demande intérieure est
particulièrement forte => nécessité de sécuriser son approvisionnement en matière première et contourner ou éviter les
obstacles à sa croissance ( législation sociale et environnementale) et nécessité d’assurer la substitution de la prod nation
aux importations ( poursuivre les transferts technologiques).
Tout ceci n’est que mauvaise nouvelle pour les pays de l’OCDE qui devront maintenant compter sur leur seuls efforts
pour faire tourner leur machine éco puisque leur exportations vont baisser. Bien sûr, les grands groupes s’en sortiront mai
c’est en allant à l’étranger => dégradation de la situation de l’emploi national . De plus , il y a de fortes raisons de penser
qu’il y aura une augmentation du prix des matières premières du fait du redressement de l’activité industrielle dans les
pays émergents et de l’excès de liquidité mondiale qui alimente la spéculation sur les matières premières.
II- Le risque de « déglobalisation » financière
Fin 2009 : capitaux et IDE des pays riches reprennent le chemin des pays émergents. Pk ?
- augmentation du nombre de délocalisations car baisse des perspectives de demande intérieure des pays riches,
par contre, potentialité de croissance élevée dans les autres régions du monde. C’est d’autant plus grave que c’est
irréversible.
- les écarts de croissance => écarts de tx i ( plus élevés dans les pays émergents) et i inflation qui est plus forte là-
bas donc les investissements s’avèrent plus rentables…
- si les investissements se font massivement là-bas, cela crée des incitations pour les locaux à investir dans leur
pays.
Pour le moment, ce mouvement est un peu mis en pause parce que la Chine ne peut avoir de vrai politique monétaire, et
doit aligner son taux de change de sa monnaie sur celui du $ => BC chinoise crée de la monnaie et achète des actifs en $
càd accumule de fortes réserves de change pour maintenir sa monnaie basse et gagner des parts de marché. Or personne
ne sait ce qui se passerait si ce contrôle était levé. Or la contraction du marché mondial réduit les perspectives de ces pays
et les avantages d’assurer la stabilité des tx de change s’amenuisent à mesure que les pays émergents ressentent le besoin
de mettre en place un dev interne, ce qui implique que ces pays pourraient rapidement abandonner cette politique de
stabilisation et laisser flotter leur monnaie. Si cela arrive, ce serait terrible pour les USA et l’Europe car la dépréciation
importante de leur devise par rapport aux monnaies émergentes => hausse du prix des importations et hausse forte des tx i
de long terme ( car les BC de ces pays achèteraient moins d’obligations au BC des pays riches)
III- Le spectre de la « maladie japonaise »
Le risque d’entrer dans une crise semblable à celle qu’a connu le Japon et contre laquelle deux plans de relance n’ont
servi à rien est maintenant fort. Or même si la situation du Japon est structurellement (population vieillissante et
résistance culturelle forte aux changements) et conjoncturellement ( le Japon a tardé à réagir) de celle de l’Europe, il
existe des similitudes : surendettement public et privé important, récession sévère avec chômage. Ce qui explique la
réaction rapide de l’OCDE qui a peur de cette crise à la japonaise.

Fin 80’s : le Japon connait la prospérité : croissance, spéculation à tout va, augmentation forte du prix de l’immobilier
puis… retour à l’inflation car l’augmentation des couts salariaux ( gonflés par la surchauffe et les créations d’emplois)
entraine une augmentation des prix. Les autorités réagissent en montant les tx i ce qui provoque l’éclatement de la bulle
financière et immobilière, les ménages et les entreprises se rendent comptent de ce qui se passe et tentent de se
désendetter => lente glissade déflationniste. Du coup, la trop forte chute des prix a conduit la BC à baisser très fortement
les tx i, tellement bas que trappe à liquidité, dès lors, la politique monétaire n’est plus contracyclique mais procyclique
puisque quand l’inflation devient négatives, la baisse des tx i nominaux par la BC conduit à la hausse des tx i réels, ce qui
asphyxie les consommateurs, contracte la demande et réduit l’investissement => aggravation de la crise...Point de départ :
problème de baisse des salaires. En effet, les salaires nominaux ont chutés et le yen s’est apprécié or si les salaires
n’avaient pas baissé, la baisse des prix aurait permis de stimuler la demande intérieure. Pk les salaires ont baissé ? à cause
de l’exigence des actionnaires mais aussi à cause de la difficultés des entreprises nippones à se financer sur les marchés
ou par le crédit ( l’épargne privée est en effet drainée par le déficit public), ce qui les conduit à tailler dans les salaires
pour conserver leur capacité d’autofinancement, or les entreprises, en anticipant une crise et en voulant la prévenir ont
surréagit
Or le Japon est un pays dans lequel le secteur de pointe est surdéveloppé ( électronique, machine-outil,…) => retard
énorme qui explique ses difficultés à émerger.
2008 : même prémices de cette dynamique apparaissent en Europe et aux USA
Ressemblances avec la crise japonaise ?
-chute des prix des actifs, une volonté des ménages de se désendetter et des banques de rester en retrait, ce qui a
provoqué une baisse de l’inv et un recul du crédit bancaire => recul de l’inflation
-drain de l’épargne des entreprises par le déficit public, on observe alors aujourd’hui comme au Japon avant, une
hausse forte dans les portefeuilles des zinzins et des banques, de la part des titres publics, qui du coup ne sert pas à
financer du capital productif=>réduction de l’investissement réduisant leurs inv soit financement de celui-ci par
autofinancement donc baisse des salaires nominaux ( pas directement mais par exemple en associant cette baisse à une
baisse du temps de travail, en recourant à une embauche plus fréquente par temps partiel, etc). Cette baisse des salaires
nourrit donc la tendance déflationniste, ce qui est d’autant plus grave qu’en plus, on assiste à une contraction des
exportations alors que c’est justement la bonne situation exportatrice du Japon qui lui a permis de limiter la casse.
IV-Les politiques monétaires s’usent si l’on s’en sert
Tout va aller de plus en plus mal pour les pays riches ( vieillissement de la pop, perte de Pé, migration des K vers des
pays où les couts sont moins élevés, désindustrialisation forte… ) et tout va s’améliorer pour les pays émergents pour des
raisons symétriques. On s’attendait à une baisse de la croissance des pays de l’OCDE bien avant mais ça n’a pas été le
cas. Pk ? ils ont préféré faire une fuite vers l’avant en encourageant et favorisant le recours au crédit grâce à une politique
monétaire adaptée, qui a décidé de ne pas voir la hausse irraisonnée de ce crédit et du prix des actifs tant que l’inflation
restait sous contrôle Mais dès que l’endettement des entreprises et des ménages a été perçu comme excessif, la demande
fiancée à crédit a brusquement disparu et il a fallu que le financement public prenne le relais du financement privé pour
soutenir l’activité économique. Or, pour qu’il y ait croissance, il faut espérer que l’augmentation des salaires viendra
prendre le relais du creusement du déficit public ; or c’est le contraire qu’on observe puisque les salaires ne font que
baisser…
Autre danger qui est apparu : la monétisation du déficit public :comme les besoins de financement du déficit public sont
supérieurs à ce que les investisseurs privés étaient prêts à financer en achetant des titres publics, les BC des pays de
l’OCDE ont monétisé la dette publique càd qu’elles ont achetées des titres publics en masse, avec en contrepartie une
création monétaire ex nihilo. Donc quand la crise a tué la confiance en dissuadant les investisseurs d’acheter des titres
publics, le choix de la monétisation de la dette publique et l’accumulation de réserves qui lui est associé a été fait, ce qui a
entrainé une forte hausse de la liquidité mondiale (+ 30% en 2009) associée à des tx i bas, ce qui implique le retour à des
comportements spéculatifs et de nouvelles bulles se forment un peu partout.
Le problème est que les perspectives de réduction du déficit public sont quasi nulles puisque : croissance faible +
perspectives de vieillissement + précarité => creusement accru du déficit
Ensuite, si les BC augmentent les tx i à CT, les zinzins et les banques qui se sont gavés de titres publics vont le payer très
cher puisqu’ils profitent de l’écart de tx i pour acheter à court terme des obligations à tx bas pour financer l’achat de titre
sur le plus long terme, donc si la BC augmente ses tx i ( cf. effet balançoire),cela va pousser les banques à stopper leurs
achats de titres publics .Il y a alors le risque que les instances de régulation mettent fin à cette pratique parce que si les
banques financent des emplois donc du long terme avec des ressources de court terme, elles courent le risque énorme de
se trouver en illiquidité, or pour le moment, les institutions de régulation laisse faire pour que les banques reconstituent
leur profit mais que se passera-t-il quand elles sanctionneront ces pratiques frauduleuses ?D’autant plus que si le Japon
s’en est un peu sorti en monétisant sa dette càd en rendant sa monnaie plus faible donc en stimulant les exportations,
tandis que mtn, tous les pays riches le font ce qui est de fait néfaste puisque toutes les monnaies se lancent dans une
course effrénée vers le bas qui débouche le plus souvent et uniquement sur un excès de liquidité mondial. Un pays qui
veille particulièrement à ça c’est les USA puisque le $ peut être emprunté à des txi faibles attire les emprunteurs et les
spécialistes du carry trade garantit sa position de monnaie faible, ce qui permet aux USA de reporter le risque
déflationniste sur les pays que ne peuvent mener cette guerre, ce qui est le cas de la zone euro qui n’a pas de politique
monétaire qui lui permet de déprécier leur monnaie a! Mais les pays émergents aussi se livrent à cette guerre ( Chine
comme on l’a vu mais aussi Russie).

V-A long terme, nous serons tous morts sauf si…
Plusieurs mouvements se sont accélérés en Europe et grèvent les possibilités de reprise :
- le mouvement de désindustrialisation s’accélère du fait que les entrepreneurs anticipent la faible croissance des
pays de l’OCDE par rapport à celle des pays émergents qui va exploser, du coup, les usines trop vieilles et trop chères à
retaper ferment et on en ouvre mais le pire n’est pas la fermeture mais le manque d’ouverture d’autres usine. En France ,
c’est le pays où la désindustrialisation est la plus marquée mais la France va pâtir de cette désindustrialisation non
seulement au niveau des emplois dans l’industrie mais aussi au niveau de tous les autres emplois ( nombreux) dans les
services qui sont liés à l’industrie ( on peut penser à l’emploi qualifié dans la recherche et le développement
-la montée en gamme qu’on aurait pu espérer avec l’entrée dans le marché mondial des pays émergents qui
devaient logiquement occuper les emplois et effectivement les taches dites de bas de gamme. Or, on n’a pas observé ça,
puisque seuls certains emplois de milieu de gamme sont montés et les autres emplois peu qualifiés voire moyennement
qualifiés sont restés stables voire se sont dégradés. Deux stratégies ont été adoptées : celle de la France : se spécialiser
dans quelques niches très particulières et celle de l’Allemagne : faire supporter le poids de la concurrence à tous les
secteurs de l’industrie. Or ces deux stratégies ont e toutes les deux des conséquences néfastes sur l’emploi.
- sous-investissement dans le domaine du R&D et de l’enseignement supérieur, la France plus qu’ailleurs souffre
d’un déficit d’innovation parce que même si elle arrive à faire des progrès dans les quelques secteurs qu’elle prend en
charge (pharmacie, automobile, transport), c’est pas suffisant en terme de quantité et de Ex : dépenses en R&D de Sanofi-
Aventis : 4.5 milliards et celles de l’américain Pfizer : 6 milliards.
D’où situation d’entre deux en Europe : les Etats sont suffisamment unis pour avoir une monnaie commune et pour
pouvoir utiliser les avantages comparatifs des différents pays et changer plus facilement la localisation des usines en
fonction de ça mais pas assez de coopération pour permettre à chacun de dev une stratégie industrielle viable pour tous.
- faiblesse dans les emplois et les secteurs dits « verts »
- financement à long terme dur à faire car les crises éco qui se sont rapprochées n’incitent pas les ménages et les
entreprises à en acheter, enfin, les nouvelles lois de régulation de la finance mondiale imposent désormais aux zinzins et
aux banques d’accroitre leurs fonds propres et leur imposent une certaine prudence, ce qui les conduit encore à se
détourner des actions pour préférer acheter des obligations et des titres publics et surtout, pour les banques , à restreindre
leur offre de crédit
Que faudrait-il faire ? 1) abaisser l’exigence de rentabilité du capital ; 2) adopter une fiscalité qui décourage les plus-value
à court terme pour ne pas que l’épargne soit drainée par la spéculation ; 3 )mieux prendre en compte les effets macro-
économiques de plans de régulation pour ne pas que les institutions fi soient dissuadées d’investir en long terme
VI-Un nouveau partage, l’antidote à l’appauvrissement collectif
Début 2009, on voit apparaitre une situation tout à fait paradoxale : les grandes entreprises qui étaient tant en difficultés il
y a quelques mois distribuent une énorme quantité de dividendes aux actionnaires tandis que les plans sociaux se
multiplient. Sortir de la crise c’est rompre avec la logique qui veut que les salaires soit la « variable d’ajustement » des
entreprises, et qu’en cas de difficultés, les salariés les moins qualifiés et les plus vulnérables soient mis au chômage et
sombrent dans la précarité car le cocktail baisse des salaires et hausse des dividendes n’est pas vraiment efficace pour
soutenir la demande et l’emploi et donc la croissance. Certes de nombreux secteurs ont souffert ( ArcelorMittal a vu son
chiffre d’affaire divisé par deux) mais du côté des actionnaires, l’exigence n’a pas été revu à la baisse. Ce mouvement ne
fait donc que s’amplifier et, comme les perspectives de croissance sont de plus en plus faibles à mesure que les salaires
sont tirés vers le bas et ne peuvent plus garantir l’émergence d’une demande intérieure forte, le mouvement de
désindustrialisation et de délocalisation s’accroit. En France comme dans les autres pays riches, à la place de ces emplois
industriels, on voit naitre des emplois dans les services ( distribution, transport, loisir et tourisme, ) beaucoup moins bien
rémunérés que les précédents ( ex : en France l’ écart de rémunération entre un salarié du secteur des services aux
particuliers et un salarié de l’industrie est de 45 %). Ce qui est spécifique à la France et qui ne va pas pour conjurer la
crise : le pouvoir d’achat augmente faiblement et les taux d’épargne est parmi les plus élevé de tous les pays développés (
les Français préfèrent donc épargner pour survivre à un avenir incertain (réforme des retraites, montée du chômage et
donc anticipation de l’aggravation des difficultés ou encore…« neutralité ricardienne »).
La première solution serait de modifier le partage des revenus en faveur des revenus consommés càd des salaires et non
dividendes. Le poids des charges sociales qui alourdit le cout du travail ( 17% du PIB en France) est inadpaté à la
situation puisqu’en parallèle, le chômage est massif, le besoin d’inv est faible, le taux d’épargne est élevé, mieux vaut
alors alléger les prélèvements sur les salaires et le faire peser sur l’épargne et donc sur le revenu du capital. Pourquoi ne
pas soutenir les salaires moyens et bas grâce à des prélèvements effectués sur les profits investis et les revenus du K on
dépensés, sur les plus-value tirées des bulles spéculatives puisque celle-ci sont stériles pour la collectivité ? Mais il faut
que cette réforme dépasse le cadre national et soit par exemple appliquée par l’ensemble du G20.
Le deuxième solution serait réduire les objectifs de rentabilité du capital car il est incohérent d’exiger la même chose
avant et après la crise, quand le contexte a entièrement changé et s’est fragilisé. L’Etat pourrait ainsi investir dans les
entreprises françaises en exigeant d’elles des projets à long terme.
La troisième solution est de favoriser le baisse des prix sur le marché des biens te des services en cassant les situations de
monopole et d’oligopole comme dans le secteur de la téléphonie mais aussi sur le marché du travail en favorisant la
flexibilité de ce marché et ainsi permettre la disparition de certaines rentes que touchent les salariés et favoriser la rotation
de l’emploi.

La quatrième solution est de créer des politiques d’emplois favorables aux catégories de personnes les plus vulnérables
comme les jeunes en instaurant par exemple des quotas dans les entreprises.
VII-Le temps du tango ou l’impératif de la solidarité européenne
Le problème qui existe en Europe c’est que comme il n’y pas de risque de taux de change entre les pays puisque tous ont
la même monnaie, chacun peut pleinement profiter de l’hétérogénéité et de avantages comparatifs qu’offrent certains
pays. Or, tout pourrait bien se dérouler s’il y ait coopération ce qui n’est pas la cas, l’exemple le plus flagrant est celui de
l’Allemagne qui est la locomotive de l’Europe au niveau de la création de richesse, c’est elle qui innove le plus et garantit
une bonne part de la compétitivité de l’Europe au niveau mondial mais elle tient sa réussite sur sa faible coopération,
parce qu’elle pratique depuis des années une politique de désinflation compétitive avec contraction des couts salariaux, et
que cette stratégie dessert tous les autres pays qui sont obligés eux aussi de se lancer dans une guerre des couts qu’ils
n’auraient normalement pas à suivre.
La politique monétaire commune joue alors un rôle contrasté donc les pays à croissance forte « bénéficient » d’une
politique mon »taire trop restrictive pour eux tandis que les pays à croissance faible souffre d’une politique trop restrictive
( les tx i sont trop hauts pour eux).Il faut garantir la libre circulation du capital et du travail pour que le travail aille des
zones de faible croissance vers celles où la croissance est forte et que l’excès d’épargne suive le chemin inverse. Or on
voit que ça n’existe pas comme en témoignent les écarts de taux de chômage et, en temps de crise, les écarts de taux
d’intérêt. Il n’y a pas de fédéralité ( comme en Allemagne, entre les Länder) qui garantirait cela, même pas de politique
budgétaire qui y tendrait ( ça se comprend quand on voit la faiblesse du budget européen), il faut créer ces mécanismes
pour parvenir à une Europe uni économiquement qu’homogène socialement ( on ne peut abandonner un état avec un tx de
chômage de 20 %). ***
L’approche d’Artus et Virard est à la fois clair et plutôt synthétique, les données chiffrées ne sont pas trop
écrasantes mais correctement insérées et souvent tout à fait pertinentes (par contre, on ne donne que trop rarement leur
source, ce qui est plutôt grave !). En ce qui concerne le contenu strict, il est tout à fait important de replacer la France dans
le cadre des échanges économiques européens mais aussi mondiaux étant donné le niveau d’imbrication des différentes
économies. Cette manière de traiter le sujet (par zooms progressifs à travers lesquels la France n’apparait qu’à la moitié
du livre) est tout à fait intéressante, pertinente et rarement aussi clairement menée.
Par contre, il est également possible d’adresser plusieurs critiques à ce livre. En premier lieu, certains
phénomènes simples sont parfois expliqués de façon très détaillée (parfois trop) tandis que d’autres, plus complexes
auraient mérité plus d’éclaircissements, au moins en note (qui sont peu nombreuses) et du coup, restent obscurs. Pour ne
citer qu’un exemple, les auteurs parlent de taux de change et de cours obligataire sans préciser quel type de relation les
liait (sans nécessairement citer l’effet balançoire par exemple, on aurait au moins souhaité quelques explications
succinctes) tandis qu’à d’autres moments, ils s’attachent à décrire les conséquences sur leurs investissements de la
restriction de l’accès au crédit et aux marchés financiers pour les entreprises, ce qui n’était pas franchement nécessaire…
Les auteurs ne semblent donc souvent avoir que peu conscience de ce qui pourrait pour leurs lecteurs (pas tous
économistes) poser problème. En deuxième lieu, ce livre n’apporte finalement pas grand-chose par rapport aux autres
livres que ces deux auteurs ont écrit (ensemble ou séparément) il n’est qu’une synthèse des ouvrages précédents et
n’apporte pas réellement de pistes en plus… En troisième lieu, ce qui contribue parfois à rendre le livre peu clair est le
mélange « des genres » càd de l’analyse néoclassique mêlée à des solutions plutôt keynésiennes. En effet, dans la partie
plus analytiques, les auteurs font référence aux notions de marché du travail, de salaire comme variable d’ajustement et
même d’équivalence ricardienne. Ce qui ne n’aboutit pas toujours à une analyse cohérente : les ménages épargneraient
alors pendant les périodes de relance budgétaire car, selon les auteurs, ils anticiperaient une probable hausse de l’inflation
mais quelques pages plus loin, les auteurs expliquent que cette phase d’épargne a été observée pour la première fois au
cours d’un des plans de relance lors de la crise japonaise, cela voudrait donc dire que les agents ne sont pas toujours
ricardiens ? Ou ne le sont que quelques mois dans l’année ? Et lorsque le principe de l’équivalence ricardienne est à
nouveau appelé à la rescousse pour expliquer pourquoi le taux d’épargne des Français a été l’un des plus élevé au monde,
cela voudrait-il dire que nous sommes plus rationnels que les autres ? La confusion s’accroit encore lorsque à ce type
d’explications, les auteurs donnent des solutions d’inspiration keynésienne (sans jamais se référer à ce dernier !) comme
par exemple lorsqu’ils évoquent (seulement par allusion) la « socialisation de l’investissement », l’ « effet
multiplicateur » qui s’appuie sur la « propension marginale à consommer » plus forte chez les pauvres, tous les termes
entre guillemets n’apparaissant jamais dans le texte mais faisant l’objet de paraphrases.
En quatrième lieu, et ce qui est sans doute plus grave que les remarques précédentes est l’incohérence du titre
avec le reste du livre. Si en ouvrant le livre, on attend un ouvrage qui va certes constater mais surtout apporter des
solutions et défendre une réforme fiscale, il n’en est question que dans un (petit) chapitre à la fin ! Et encore, sans
vraiment d’explications approfondies, les auteurs se contentent de donner des pistes de réformes sur fond de « pourquoi
ne pas… ». Avec un titre pareil et surtout, des constats aussi solidement construits, on attendait que le livre aille plus loin
que le simple constat d’une situation et nous dise « pourquoi il faut partager les revenus ». Et c’est là tout le problème: le
titre annonce quelque chose, une thèse détaillée suivi de propositions or l’analyse n’est que très peu liée à l’ambition du
titre et même si l’analyse est souvent pertinente, on n’atteint jamais la dimension critique et normative que se proposait de
réaliser les auteurs puisque les solutions proposées sont insuffisamment développées voire frôlent le ridicule ou la naïveté.
On peut citer comme exemple celui de le réindustrialisation, proposition lancée comme ça, sans plus d’explication sur sa
mise en œuvre, que les auteurs doivent bien sentir impossible compte tenu de l’ampleur du mouvement de délocalisation

mais surtout du retard en matière de R&D dont souffre l’Europe. Un autre exemple : les auteurs déplorent un système qui
est arrivé au bout de ses forces, mais un système qui a quand même eu le temps de changer notre rapport au profit, la
place de salariat dans la production, la représentation de l’entreprise, bref un système qui a induit des modifications
jusqu’à l’intérieur de nos valeurs. Que faire face à cela ? L’une des trois propositions des auteurs (avec la socialisation de
l’investissement et la taxation des bénéfices boursiers reversé aux plus pauvres, ce qui n’est pas d’une grande originalité)
consiste à « convaincre les investisseurs de modérer leurs exigences de rendement du capital, afin d’éviter la baisse de la
part des salaires dans le partage des revenus »… On a presque envie de rire de la naïveté d’une telle proposition. Et
quand, à la suite de ces trois solutions plutôt keynésiennes, on trouve cette petite dernière « il ne s’agit pas de re-
réglementer le marché du travail » mais de lui donner plus de flexibilité en rompant avec une certaine idée de la
protection de l’emploi, on retrouve la conception libérale de l’économie avec un « marché » capable mieux que quiconque
de décider de l’allocation optimale des ressources.
Je ne reviendrais donc pas sur les analyses qui ont été faites et qui sont dans l’ensemble cohérents mais plutôt sur
la thèse que défendent les auteurs et qui est inusuffisamment soutenue « il faut partager les revenus ». En effet, on
s’attendait sans doute à ce que les auteurs s’appliquent davantage à analyser historiquement et à critiquer cette
déformation du partage des revenus au détriment des travailleurs, aujourd’hui premières victimes de la globalisation du
capitalisme, et des crises économiques qui marquent son évolution. On trouve ce type d’analyse dans le livre de Liêm
Hoang-Ngoc qui est quant à lui très clair et serait à la hauteur d’un titre comme « Pourquoi il faut partager les revenus ? ».
Ce livre est composé de trois parties, toutes les trois dotées d’une cohérence et d’une dynamique différente. Dans la
première, Hoang-Ngoc revient sur l’historique de la répartition des revenus et explique comment, après plusieurs
décennies de réduction des inégalités, celles-ci ont recommencé à se creuser et que même si le salaire médian et moyen
continuent de progresser, cela est surtout lié à la très forte progression de la situation des très hauts revenus tandis que
pour les ménages modestes et moyens, la situation stagne voire se détériore. L’auteur explique que cela vient de
l’augmentation forte qu’ont connus les revenus du patrimoine, notamment des dividendes or ces revenus sont très
inégalement répartis parmi les classes sociales. Parallèlement, les ménages modestes ( dont les prestations sociales
constituent 30 % des revenus) et les ménages moyens ( dont les revenus salariaux représentent 75 % des revenus)
connaissent une dégradation de leur situation sur ces deux fronts : outre la hausse des dépenses contraintes dont ces deux
types de ménages sont particulièrement tributaires, les allocations diverses et autres minima sociaux ont sans cesse connu
une érosion ( faible mais régulière), de même, les salaires ( moyens et bas ) ont eux-aussi connu une régression à mesure
que la part des salaires dans la VA était grignotée par celle du profit, utilisé non pas en investissements mais reversé sous
forme de dividendes… L’auteur veut ainsi tordre le cou aux thèses qui avanceraient que la perte de pouvoir d’achat dont
se plaignent les ménages ne serait que ressentie mais non réelle. Pour cela, il revient sur les indicateurs utilisés pour
mesurer les inégalités vis-à-vis du pouvoir d’achat, des revenus, etc. En détaillant la façon dont ceux-ci sont construits, ce
qu’ils mesurent, quels sont les biais qu’ils comportent et les inégalités qu’ils cachent, l’auteur montre quels sont les
indicateurs qu’il vaut mieux utiliser pour mieux prendre la mesure des inégalités. Dans la deuxième partie, l’auteur
revient sur les différents modèles macroéconomiques dans lesquels le revenu et sa répartition sont pris en ligne de
compte, il réfute alors le modèle néoclassique qui explique le phénomène de croissance par l’épargne (cf. théorème de
Schmidt) et qui insiste sur le fait que pour eux, l’économie est contrainte par l’offre qu’il est donc nécessaire de soutenir.
Pour ce faire, l’auteur explicite le paradoxe des couts et de l’épargne qui est observable aujourd’hui puisque l’épargne est
excédentaire mais l’investissement, la croissance et l’emploi n’en sont pas plus stimulés. Hoang-Ngoc développe alors le
modèle de croissance post-keynésiens qui lui, pose la consommation comme élément moteur de la croissance. On voit
alors, en utilisant le différentiels de propension marginale à consommer entre les différents ménages à quel point le
partage des revenus peut être bénéfique pour la croissance et permettrait, dans le cas présent de relancer l’économie.
Enfin, l’auteur, dans une troisième partie, revient sur la crise économique et financière récente. Il en détaille alors le
déroulement, les tout cela en comparant la crise de 29 et celle de 2008 et en dégageant ainsi les point communs mais aussi
les différences qui existent entre ces deux crises. D’une part, on voit alors, à quel point la crise récente comme celle de 29
sont liées au partage des revenus et plus particulièrement au décrochage que l’on observe avant chacune d’elle entre
l’évolution des gains de Pé dans les entreprises et l’évolution des salaires. D’autre part, lorsque Hoang-Ngoc explique
quels ont été les différents plans de relance, leur composition, leur but, leur ampleur, on perçoit à quel point les plans bien
que conséquents ne proposent que très rarement une réforme du système de répartition et de production, réformes pour le
moins nécessaires. En conclusion, l’auteur propose quelques solutions, développées de manière plus conséquente que
dans le livre d’Artus et Virard. Il prône par exemple, une extension des prérogatives du FMI qui pourrait devenir une
véritable instance de contrôle du système financier. En ce qui concerne la stricte répartition des revenus, il y a dans ce
livre de nombreuses pistes qui sont poursuivies et développées dans e livre du même auteur Vive l’impôt ! et qui
décortique le système fiscal français tel qu’il est depuis des siècles, tel qu’il a évolué, et tel qu’il devrait être pour être
vraiment équitable. Mais d’autre économistes ont également fait des propositions dans ce sens (sans forcément aller
chercher dans les thèses d’ATTAC Pour un big-bang fiscal) on peut citer certaines propositions originales ( mais tout à
fait réalisables) comme celle de Lordon et ses SLAM : Shareholder Limited Authorized Margin (marge actionnariale
limite autorisée) qui fixe une limite à la rentabilité des actions en utilisant le taux d’intérêt de l’actif sans risque plus une
prime de risque, non comme un seuil plancher tel qu’il était défini mais plutôt comme un seuil plafond au-delà duquel le
supplément de profit dégagé de l’action serait versé à l’Etat (voir texte complet dans les archives du Monde Diplomatique
de février 2007 ou en annexe 1)
Pour finir, il est également possible de trouver des auteurs qui ne voient pas pourquoi il faudrait partager les
revenus voire même qui voient dans l’impôt progressif une hérésie. Je vous ai donc reproduit le texte (en découpant
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%