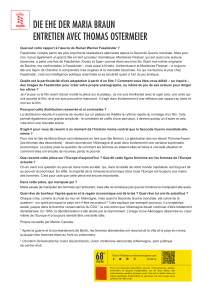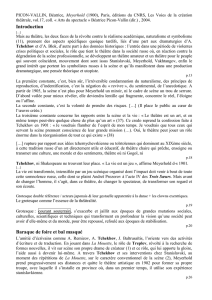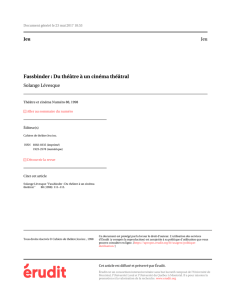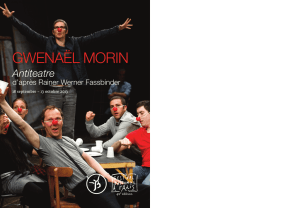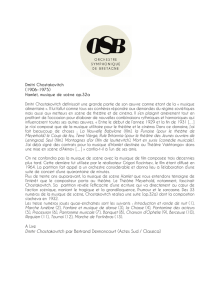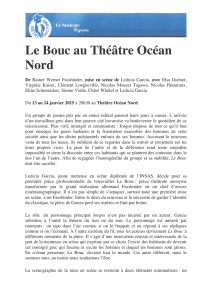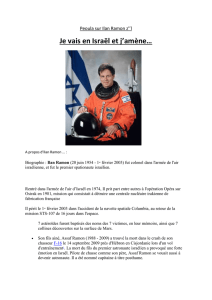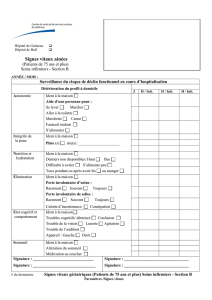trois theatres d`avant-garde

1
TROIS THEATRES D’AVANT-GARDE : MEYERHOLD, FASSBINDER, GRIFFERO
Mémoire de Master 2 de littérature comparée écrit par M. Jérôme Stéphan et dirigé par Mme
Clotilde Thouret

2
A Ramon Griffero, mi gratitud eterna. Quedan los recuerdos, y la esperanza de la victoria.
A Clotilde Thouret, pour m’avoir dirigé avec tant de sympathie. J’ai aimé votre esprit, votre
personnalité. Vos conseils justes. – La liberté approche !
A François Lecercle, pour m’avoir appuyé sans hésitation, sans relâche dans mon projet et
avoir fait que ce voyage au Chili soit possible.
A Joanne Delachair – pour les films que tu feras.

3
« Je ne jette pas de bombes, je fais des films », Fassbinder.

4
INTRODUCTION GENERALE
« Ce que l’élève doit apprendre est ce que le maître lui apprend. Ce que le spectateur
doit voir est ce que le metteur en scène lui fait voir. Ce qu’il doit ressentir est l’énergie qu’il
lui communique. A cette identité de la cause et de l’effet qui est au cœur de la logique
abrutissante, l’émancipation oppose leur dissociation. C’est le sens du paradoxe du maître
ignorant : l’élève apprend du maître quelque chose que le maître ne sait pas lui-même
1
» :
c’est ainsi que, par cette longue citation, Jacques Rancière entend évoquer « l’émancipation
du spectateur ». Comme l’élève apprend du maître un savoir que ce dernier ignore, le
spectateur a à dégager d’une mise en scène quelque chose d’immatériel, d’invisible qui se
libère et qui est peut-être une simple projection fantasmatique. Néanmoins, la mise en scène
construit, démolit, reconstruit l’univers mental du spectateur, contribue à déplacer ses
conceptions arrêtées et à l’exiler vers ce que Henri Michaux appelait un « lointain intérieur
2
».
C’est sans doute le sens du théâtre tel que Meyerhold l’a transformé au début du siècle, en
s’inspirant des pratiques orientales du Kabuki, en le déracinant, en l’arrachant à la tutelle
aristotélicienne pour le lancer dans l’aventure moderne. Le théâtre d’avant-garde est d’abord
un théâtre qui a donné les pleins pouvoirs au spectateur, qui lui a accordé une pleine liberté :
un théâtre sans cesse en recherche d’un indéterminé.
Meyerhold (1874-1940), Fassbinder (1945-1982) et Ramon Griffero (1954-…) portent
cette liberté du spectateur dans leurs propositions avant-gardistes respectives, tout en faisant
évoluer le sens de l’avant-garde théâtrale elle-même. Dans quelle direction ? Par rapport à
quoi ? Comment ? C’est ce que nous essaierons de déterminer par ce travail.
Si nous avons opté pour le présent sujet c’est pour traduire un double amour. L’amour
pour un pays et l’amour pour un art. Le Chili est un pays merveilleux, un pays du bout du
1
Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique, 2008, p. 20.
2
Titre d’un de ses recueils publié en 1938 chez Gallimard.

5
monde qui a connu son indépendance au XIXe siècle, un pays usurpateur
3
qui s’est étendu sur
les territoires d’autres nations, vite industrialisé, « sur-exploité » (Allende), libéralisé selon la
rigoureuse méthode imposée par la CIA après le coup d’Etat du général Pinochet. Ce qui nous
intéresse ce ne sont pas les guerres de la politique, les impérialismes et la constitution des
grandes coalitions : mais au contraire, nous accordons plus d’importance à la vie des gens et
le Chili est un pays de résistance. Son histoire est contestataire. Sa culture est de gauche. Du
Sud au Nord, les résistances se sont constituées : résistance des Selk’Nam, dans l’Extrême
Sud, Selk’Nam à qui les colonisateurs anglais coupaient les oreilles pour les revendre à la
sauvette une poignée de livres-sterlings
4
, résistance des Mapuches dans la région du Bio-Bio,
Mapuches combattant aujourd’hui encore les grandes multinationales qui ravagent leurs
paysages et empiètent sur leurs terres. Enfin, de La Serena à Arica, le Nord du Chili a connu
des mouvements syndicaux et anarchistes d’une telle envergure que le massacre de l’école de
Santa Maria
5
a transporté ses échos jusqu’à nous, est devenu un symbole de lutte, et d’espoir
dans la lutte.
Aller au Chili, rencontrer Ramon Griffero, réfléchir sur le théâtre d’avant-garde, est le
signe d’un amour profond pour le théâtre : le théâtre qui agite les consciences, qui bouscule
les individus, qui remet en cause le présent sans oublier le passé. Il se trouve que Ramon
Griffero est lié à ces deux auteurs déjà évoqués : Meyerhold et Fassbinder. Dès sa deuxième
pièce, Altazor Equinoxe (1981)
6
, le dramaturge et metteur en scène chilien s’est placé sous
l’égide de Meyerhold et a fait vœu de relancer le grotesque dans son théâtre, de s’inscrire en
tout cas dans une ligne claire : celle des « bouffons
7
», du jeu pur, du théâtre total (c’est-à-dire
organisant la synthèse des arts). En effet, une des citations placées en exergue de sa pièce est
3
Voir le recueil du jeune poète Vicente José Cociña publié en 2009 aux éditions Luciernaga : A partir de y no
también (A partir de plutôt qu’aussi), p. 38 : “Chile que robó a Perú, Chile que robó a Bolivia, Chile que negó a
Argentina, Chile que usurpó Isla de Pascua. De noche sólo quedarán los ladridos de tus perros callejeros”.
« Chili qui a volé le Pérou, Chili qui a volé la Bolivie, Chili qui n’a pas reconnu l’Argentine, Chili qui a usurpé
l’île de Pâques. De nuit ne resteront que les aboiements de tes chiens errants ».
4
Voir pour cela l’excellent roman du musicien et écrivain Patricio Manns intitulé El corazon a contraluz (1996)
et traduit en français sous le titre Cavalier seul, Phébus, 1999.
5
Massacre qui eut lieu à Iquique en 1907 (un an avant la naissance d’Allende) quand l’armée écrasa dans le sang
un conflit social étendu à toute la région du Tarapaca.
6
Texte écrit en français : http://www.griffero.cl/obra2.htm
7
Voir le livre de Florence Dupont : Aristote ou le vampire du théâtre occidental, Aubier, 2007. Livre dans lequel
est revendiqué un « retour des bouffons ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
1
/
141
100%