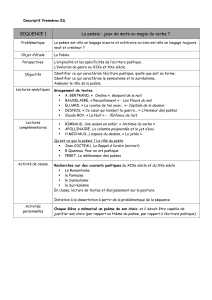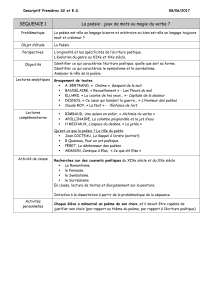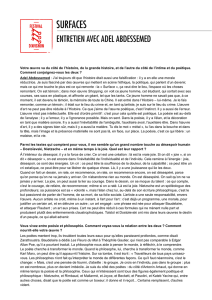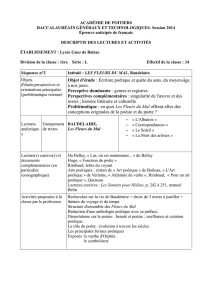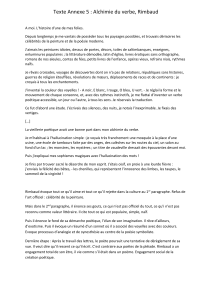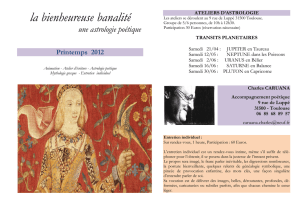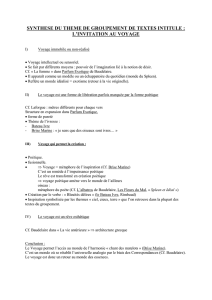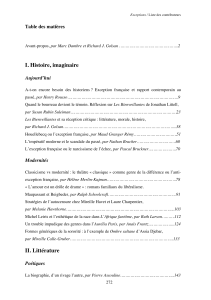EDITORIAL – Cahiers de géopolitique On parle beaucoup de

EDITORIAL – Cahiers de géopolitique
On parle beaucoup de culture. Dans les civilisations avancées, cela est en passe de
devenir la préoccupation principale. Mais l’accumulation culturelle en soi ne mène à rien.
Ce qui nous manque –au-delà de toutes les «déstructurations», au-delà de tous les
«post-modernismes»– c’est un nouveau contexte global: l’horizon d’un monde. C’est
dans cette aire de recherche-là (très ouverte, non encore définie) que se place la
géopoétique.
Les premiers pas de la grande piste géopoétique, du moins les premiers reconnus et
proclamés comme tels, remontent à 1979. Cette année-là, dans un petit texte, paru dans
une petite collection, Qui Vive, j’écrivais : «Automne 1979. Je voyage à travers les
Laurentides, le long de la côte Nord du Saint-Laurent, en route pour le grand espace
blanc du Labrador. Une nouvelle notion en tête: celle de géopoétique. L’idée qu’il faut
sortir du texte historique et littéraire pour retrouver une poésie de plein vent où
l’intelligence (intelligence incarnée) coule comme une rivière. Qui vive ? Oui, c’est la
question. Ou peut-être est-ce plutôt un appel. Un appel qui vous attire au-dehors.
Toujours plus loin au-dehors. Jusqu’à n’être plus cette personne trop connue, mais une
voix, une grande voix anonyme venant du large, disant les dix mille choses d’un monde
nouveau. Il faut bien que cela commence quelque part. Peut-être ici, et maintenant...»
Il s’agissait donc bien, dans un premier temps (et il faut toujours revenir aux «premiers
temps»), de voyage. Mais d’un voyage bien particulier, avec des exigences bien
particulières: pas seulement compte rendu de déplacement, mais aussi itinéraire
intellectuel, fondé sur une conception nouvelle de la nature des choses. Il fallait du blanc,
du vide (un vide plein de vagues!), il fallait un langage qui sorte des ornières, un esprit
qui sorte des manèges, un style saltatoire. Quand Doughty, un des plus grands
«écrivains voyageurs» que je connaisse, auteur d’Arabia Deserta (qu’il faut lire en entier,
non pas, ou non pas seulement, dans les versions abrégées qui circulent), jette, vers la
fin de sa vie, un regard sur les multiples chemins parcourus, il déclare sans ambiguïté
qu’il a toujours voyagé en vue d’une poétique.
Entendons-nous, et insistons là-dessus, pour que la situation soit claire. Il ne s’agit pas
ici d’une défense de la poésie. Telle qu ‘elle se pratique la plupart du temps, ce n’est pas
dans la poésie que l’on trouve la poétique dont il est question. J’en ai, pour ma part,
trouvé beaucoup plus d’éléments là où l’on s’y attend le moins: dans des études de
géologie, de physique, de botanique, mais plus encore dans des textes qui sortent de
toutes les catégories, de toutes les disciplines, et qui portent difficilement un nom –je
pense, par exemple, au Protogaia de Leibniz.
Je me rappelle encore ce que je lisais, au début des années 60, dans le Grand Recueil de
Francis Ponge: «L’espoir est donc dans une poésie par laquelle le monde envahisse à ce
point l’esprit de l’homme qu’il en perde à peu près la parole, puis réinvente un jargon...
Les poètes n’ont aucunement à s’occuper de leurs relations humaines, mais à s’enfoncer
dans le trente-sixième dessous... Ils sont les ambassadeurs du monde muet. Comme
tels... ils balbutient, ils murmurent, ils s’enfoncent dans la nuit du logos –jusqu’à ce
qu’enfin ils se retrouvent au niveau des RACINES, où se confondent les choses et les
formulations. Voilà pourquoi, malgré qu’on en ait, la poésie a beaucoup plus d’importance
qu’aucun autre art, qu’aucune autre science. Voilà aussi pourquoi la véritable poésie n’a
rien à voir avec ce qu’on trouve actuellement dans les collections poétiques. Elle est ce
qui ne se donne pas pour poésie. Elle est dans les brouillons acharnés de quelques
maniaques de la nouvelle étreinte.»
Je pouvais, et je peux, ne pas être totalement d’accord avec certaines de ces formules.
Je pouvais, et je peux, penser que la poétique de Ponge elle-même laisse encore
beaucoup à désirer. Mais le sens général de ses remarques me convenait, me convient
toujours, parfaitement. La géopoétique y reconnaît une de ses sources, une de ses

confirmations. Et elle en a trouvé d’autres chez Roger Caillois («ce serait l’amoindrir que
de faire de la poésie uniquement un luxe ou une fantaisie de la seule espèce humaine»),
chez Saint-John Perse («la grande écriture des choses»), chez beaucoup d’autres esprits
éparpillés dans l’espace et dans le temps. Il est bien évident qu’un concept de ce genre
ne s’invente pas ex nihilo. Il est fondé sur une re-connaissance, il révèle des éléments
non encore reconnus, il en fait la synthèse, ou plutôt il en dégage une cohérence
ouverte, en vue d’un monde.
Un monde, c’est ce qui émerge du rapport entre l’homme et la terre. Quand ce rapport
est sensible, intelligent, complexe, le monde est monde au sens profond du mot: un bel
espace où vivre pleinement. Quand ce rapport est simpliste et sot, le monde est inepte,
voire immonde, et tout discours «culturel» est superfétatoire. À regarder autour de soi
aujourd’hui, c’est bien l’impression que l’on peut avoir. À tel point que l’on peut se
demander parfois si cela vaut vraiment la peine de faire, publiquement, quoi que ce soit.
«Un sommeil bien ivre sur la grève», disait, déjà, Rimbaud. Et Hölderlin: «Pourquoi être
poète en un temps de manque?» En mettant les choses au pire, disons qu’avec les
Cahiers de Géopoétique, avec l’Institut de Géopoétique, qui regroupe des individus de
tous bords, de tous pays, qui pensent à peu près selon les lignes que je viens d’indiquer,
il s’agit, au minimum, d’un baroud d’honneur.
Mais, au maximum, il pourrait s’agir vraiment d’un «nouveau monde». Car autant la
scène socioculturelle générale est de plus en plus frappée d’indigence, autant, dans des
domaines retirés, à partir de silences prolongés, se sont élaborés des travaux et des
compositions qui bouleversent complètement les idées reçues, brisent totalement les
comportements convenus, ouvrent des perspectives inouïes. Le but des Cahiers, et de
l’Institut, tout en présentant des analogies ou des préfigurations surgies ici et là, est de
rassembler ces travaux et, grâce à eux, d’ouvrir un nouvel espace culturel, à côté duquel
t’autre apparaîtra de plus en plus comme une triste et sinistre caricature : la lie de
l’histoire.
Essayons autre chose.
Pour ces Cahiers, j’ai fait appel à des gens, artistes, écrivains ou scientifiques, parfois
artistes, écrivains et scientifiques, dont les travaux me semblaient tourner, d’une
manière ou d’une autre, autour de l’idée que je me fais de la géopoétique. Certains
textes me semblent plus près du vif du propos que d’autres. L’essentiel, pour le moment,
c’est que l’on sente une émergence, et la possibilité d’une convergence.
Il nous manque encore la poétique d’une nouvelle politique (j’entends, organisation
générale). A la sortie de 1989, souvenir de la Révolution oblige, on a tenté quelques
formulations. Edgar Morin parlait d’un «patriotisme terrestre», Michel Serres d’un
«contrat naturel». Ces deux formules sont bien trouvées, mais sont encore trop liées à
des systèmes périmés. Il ne peut s’agir ni de «patriotisme», ni de «contrat». Pensons
plutôt, pour commencer vraiment, en termes de cartographie (coordonnées de l’espace,
relevé des lieux, écriture des territoires). Après tout, la première formulation des droits
de l’homme (qu’il s’agit maintenant, non pas d’encenser ni d’écraser, mais de resituer)
ne date pas de 1789, mais de 1215. Je pense à la fameuse Magna Carta.
L’ambition des Cahiers de Géopoétique est de dresser, d’un point de vue qui ne soit pas
seulement celui de l’Homme, une magna mundi carta : une grande carte, une grande
charte du monde.
On verra.
Kenneth White

Considérations premières
A propos de culture
La culture est certainement la question primordiale de nos sociétés. On en parle beaucoup, mais la
plupart des discours sonnent creux et l’action socioculturelle manque de profondeur et de cohérence.
Pour introduire ce sujet et essayer de déblayer le terrain, je proposerai une définition plus aiguë, plus
essentielle de la notion de culture, et je ferai un tour d’horizon des grandes cultures connues de
l’histoire afin de voir ce qui a constitué leur dynamique.
Dans un deuxième temps, j’esquisserai une analyse, étape par étape, de la civilisation occidentale,
depuis ses débuts avec la philosophie grecque jusqu’à la crise actuelle. Aujourd’hui, nous nous situons
en fait au bout de ce que j’aime appeler «l’autoroute de l’Occident», qui fonce vers les catastrophes et
s’enfonce dans la platitude, avec son charroi de désarroi et de confusion. Mais, dès le XIXe siècle,
certains esprits commençaient à quitter cette «autoroute». On peut voir se dessiner dans leur travail
un autre champ. Là se situent les prémices de ce que j’appelle la géopoétique.
Dans un troisième temps, j’évoquerai ce champ à l’aide d’une triple approche – scientifique,
philosophique, poétique – afin de mieux percevoir la pluralité de la démarche géopoétique, afin de
mieux ressentir ce que ce projet a d’essentiel et de fécondant, et qui retient mon attention depuis
plusieurs années. Pour mieux y arriver, commençons donc par faire un peu de nettoyage sémantique.
Le mot «culture» manque souvent de précision et d’énergie. Pour y voir plus clair, je propose d’établir
une distinction entre trois termes: la culture, une culture, de la culture.
La culture (au sens général), c’est la manière dont l’être humain se conçoit, se travaille et se dirige.
Ces trois aspects forment un ensemble indissociable car, si la culture offre une vision de l’homme, une
conception de ce qu’est un être humain, elle insiste également sur ce que l’homme pourrait être en
fonction d’une direction, d’un idéal à atteindre. Selon moi, la culture devrait favoriser le travail sur soi
et aider l’être humain à exprimer ce qu’il peut avoir de meilleur.
Une culture, par contre, offre un ensemble de motifs et de motivations, une vue et une vie d’ensemble,
telles que les connaissaient, par exemple, le Moyen Âge, la cité grecque, une tribu paléolithique. Je
reviendrai sur ces exemples et sur cette définition d’une culture, qui sera notre point de départ.
Mais j’aimerais d’abord insister sur une évidence. Aujourd’hui, nous ne pouvons guère prétendre à une
culture dans le sens que je viens d’indiquer. Ce que nous avons, c’est de la culture, et même beaucoup
–certains diront beaucoup trop!– où l’on trouve le meilleur –à condition d’avoir de bons yeux!– et le
pire, mais surtout un étalage massif de médiocrité. Face à cette accumulation, il est bien dif€cile de se
frayer un chemin. Pour peu que nous soyons naïfs, la production actuelle est telle que nous pouvons
facilement en arriver à gober tout et n’importe quoi! Hier, on faisait encore quelques distinctions, par
exemple entre culture d’élite et culture de masse, même si on n’avait de choix, en fait, qu’entre une
sophistication creuse et une vulgarité crasse. Par les temps qui courent, on ne fait plus du tout de
distinctions. Tous les critères se sont dissous. Tout vaut tout et le jugement de valeur est tabou. Tout
au plus, ce que nous pouvons trouver, c’est du «goût» –souvent peu développé, au niveau des
sucettes– et des engouements successifs, à la petite semaine, selon l’excitation du moment, d’une
mode ou d’un concours. Et la roue tourne sur un axe bien huilé par l’industrie pseudo-culturelle.
Je comprends le dégoût de certains et leur désintérêt total pour cette foire. La crise du livre que nous
connaissons aujourd’hui est sans aucun doute une réaction de rejet qu’éprouvent les gens face à cette
machine économique qui produit beaucoup trop de non-livres. Cette attitude me paraît un bon terrain.
Un certain nihilisme me semble profitable parce que c’est peut-être à partir de cette base-là qu’on peut
recommencer à penser, à parler sérieusement et gaiement de culture. Les temps sont peut-être mûrs à
la fois pour une analyse culturelle en profondeur, pour une «culturanalyse» –plus troublante qu’une
psychanalyse– et pour une revivification, en vue d’une nouvelle inspiration. Je dis cela non pas avec

optimisme– toute une machine pseudo-culturelle continuera à tourner bruyamment avec n’importe
quoi–, mais dans un esprit possibiliste et pour des esprits à la fois lucides, ouverts et aventureux.
Revenons à notre concept: «une culture».
Pour qu’il y ait une culture au sens plein du mot, il faut que soit présent, dans les esprits d’un groupe,
un ensemble cohérent de motifs et de motivations. Il faut qu’il y ait des lignes de force, des traits
marquants, des «formes maîtresses» comme disait Montaigne. Et ce, à un niveau élevé, afin d’inviter la
personne sociale à se travailler, à déployer ses potentialités dans un espace exigeant. Là est la source
d’une véritable jouissance intellectuelle et existentielle.
Prenons quelques exemples de cultures puisés dans l’histoire de l’humanité.
En Grèce, avec la culture athénienne, tout tourne autour de l’agora, là où se discutent les affaires de la
cité. Qu’est-ce qu’une cité? Qu’est-ce que devenir un citoyen? Comment vivre ensemble dans une cité?
Voilà les questions que posent les Grecs et dont ils débattent dans cet espace qui est l’ancêtre de nos
hémicycles actuels.
Au Moyen Âge européen, tout s’organise autour d’un motif central, l’image du Christ et de la Vierge
Marie. Paysan, clerc, noble, tout le monde pense en fonction de cette image première qui rassemble les
esprits en une seule communauté, malgré les disparités et les inégalités sociales que connaissait cette
civilisation.
Dans une tribu paléolithique, la figure centrale, c’est le chaman qui, lui, assure le contact entre le
groupe humain et les forces cosmiques qui entourent l’espace social. Il préserve l’harmonie du groupe
et favorise les activités centrées autour de la subsistance : la chasse et la cueillette. Si la mythologie
d’un groupe peut varier et le singulariser par rapport à d’autres groupes, ces tribus primitives ont
toutes en commun une même relation au monde où coexistent deux espaces distincts : l’espace social
et l’espace cosmique. Dans ces sociétés, chacun est amené à un moment ou à un autre de son
existence à sortir du petit monde social pour s’aventurer dans le grand monde et s’initier aux mystères
de la vie. Pensons, par exemple, aux rites d’initiation qui consacrent le passage de l’enfance à l’état
adulte. Ceux-ci se déroulent toujours en dehors de l’espace social, dans un lieu tenu secret des
profanes, dans un ailleurs qui peut être une forêt, une montagne ou un désert. Chacun est donc invité
à chamaniser en quelque sorte, à se régénérer au contact du dehors, puis à revenir dans le groupe,
transformé et porteur de sources vives, bénéfiques à la destinée de tous.
L’ Occident, par contre, a davantage insisté sur la vie en communauté, sur l’espace social. Or, à mon
avis, pour qu’il y ait une culture, il faut également un espace autre que l’espace social. Durant le Moyen
Âge européen, cet espace autre était transcendantal, d’ordre religieux. Un rapport vertical unissait
l’esprit humain au divin, tel que nous pouvons le voir symbolisé en architecture par le clocher ou la
flèche gothique.
Personnellement, je préférerais parler d’espace horizontal. N’est-il pas plus essentiel de vivifier notre
existence par un va-et-vient constant entre nous et le dehors, en essayant d’éveiller notre présence au
monde de manière concentrique, en cercles de plus en plus larges?
Quoi qu’il en soit, puisqu’au centre de chaque culture il y a un motif, en ce qui nous concerne, la
question que je pose est celle-ci: quel peut être le motif central aujourd’hui? Je proposerais que, pour
nous tous, dans le monde entier, ce motif soit la terre même sur laquelle nous vivons. En effet, dans
mon vocabulaire, un monde, c’est ce qui émerge du rapport entre l’être humain et la terre. Si ce
rapport est riche, sensible, intelligent, fertile, nous avons un monde au sens plein du terme, un espace
agréable à vivre; si, par contre, ce rapport est inepte, insensible, pour ne pas dire brutal et exploiteur,
nous n’avons plus qu’un monde stérile et vide, un monde immonde.
Nous pouvons maintenant mieux comprendre le sens de géo dans «géopoétique». Il ne s’agit pas d’un
rapport de force entre les États (comme dans «géopolitique»), mais d’un rapport fécond à la terre et du
surgissement éventuel, possible, d’un monde. Le travail géopoétique viserait ainsi à explorer les
chemins de ce rapport sensible et intelligent à la terre, menant à la longue –peut-être?– à une vraie
culture.

La culture est certainement la question primordiale de nos sociétés. On en parle beaucoup, mais la
plupart des discours sonnent creux et l’action socioculturelle manque de profondeur et de cohérence.
Pour introduire ce sujet et essayer de déblayer le terrain, je proposerai une définition plus aiguë, plus
essentielle de la notion de culture, et je ferai un tour d’horizon des grandes cultures connues de
l’histoire afin de voir ce qui a constitué leur dynamique.
Dans un deuxième temps, j’esquisserai une analyse, étape par étape, de la civilisation occidentale,
depuis ses débuts avec la philosophie grecque jusqu’à la crise actuelle. Aujourd’hui, nous nous situons
en fait au bout de ce que j’aime appeler «l’autoroute de l’Occident», qui fonce vers les catastrophes et
s’enfonce dans la platitude, avec son charroi de désarroi et de confusion. Mais, dès le XIXe siècle,
certains esprits commençaient à quitter cette «autoroute». On peut voir se dessiner dans leur travail
un autre champ. Là se situent les prémices de ce que j’appelle la géopoétique.
Dans un troisième temps, j’évoquerai ce champ à l’aide d’une triple approche – scientifique,
philosophique, poétique – afin de mieux percevoir la pluralité de la démarche géopoétique, afin de
mieux ressentir ce que ce projet a d’essentiel et de fécondant, et qui retient mon attention depuis
plusieurs années. Pour mieux y arriver, commençons donc par faire un peu de nettoyage sémantique.
Le mot «culture» manque souvent de précision et d’énergie. Pour y voir plus clair, je propose d’établir
une distinction entre trois termes: la culture, une culture, de la culture.
La culture (au sens général), c’est la manière dont l’être humain se conçoit, se travaille et se dirige.
Ces trois aspects forment un ensemble indissociable car, si la culture offre une vision de l’homme,
une conception de ce qu’est un être humain, elle insiste également sur ce que l’homme pourrait être
en fonction d’une direction, d’un idéal à atteindre. Selon moi, la culture devrait favoriser le travail sur
soi et aider l’être humain à exprimer ce qu’il peut avoir de meilleur.
Une culture, par contre, offre un ensemble de motifs et de motivations, une vue et une vie
d’ensemble, telles que les connaissaient, par exemple, le Moyen Âge, la cité grecque, une tribu
paléolithique. Je reviendrai sur ces exemples et sur cette définition d’une culture, qui sera notre point
de départ.
Mais j’aimerais d’abord insister sur une évidence. Aujourd’hui, nous ne pouvons guère prétendre à
une culture dans le sens que je viens d’indiquer. Ce que nous avons, c’est de la culture, et même
beaucoup –certains diront beaucoup trop!– où l’on trouve le meilleur –à condition d’avoir de bons
yeux!– et le pire, mais surtout un étalage massif de médiocrité. Face à cette accumulation, il est bien
dif€cile de se frayer un chemin. Pour peu que nous soyons naïfs, la production actuelle est telle que
nous pouvons facilement en arriver à gober tout et n’importe quoi! Hier, on faisait encore quelques
distinctions, par exemple entre culture d’élite et culture de masse, même si on n’avait de choix, en
fait, qu’entre une sophistication creuse et une vulgarité crasse. Par les temps qui courent, on ne fait
plus du tout de distinctions. Tous les critères se sont dissous. Tout vaut tout et le jugement de valeur
est tabou. Tout au plus, ce que nous pouvons trouver, c’est du «goût» –souvent peu développé, au
niveau des sucettes– et des engouements successifs, à la petite semaine, selon l’excitation du
moment, d’une mode ou d’un concours. Et la roue tourne sur un axe bien huilé par l’industrie pseudo-
culturelle.
Je comprends le dégoût de certains et leur désintérêt total pour cette foire. La crise du livre que nous
connaissons aujourd’hui est sans aucun doute une réaction de rejet qu’éprouvent les gens face à cette
machine économique qui produit beaucoup trop de non-livres. Cette attitude me paraît un bon terrain.
Un certain nihilisme me semble profitable parce que c’est peut-être à partir de cette base-là qu’on
peut recommencer à penser, à parler sérieusement et gaiement de culture. Les temps sont peut-être
mûrs à la fois pour une analyse culturelle en profondeur, pour une «culturanalyse» –plus troublante
qu’une psychanalyse– et pour une revivification, en vue d’une nouvelle inspiration. Je dis cela non pas
avec optimisme– toute une machine pseudo-culturelle continuera à tourner bruyamment avec
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%