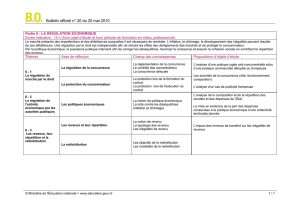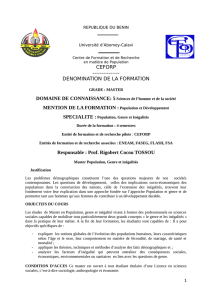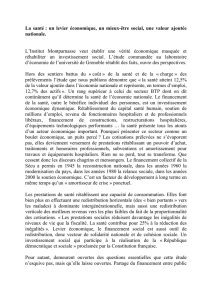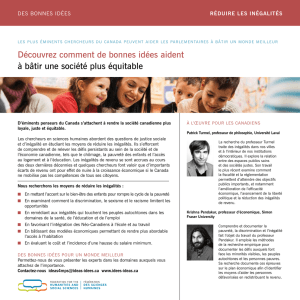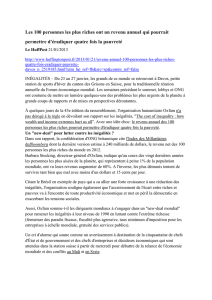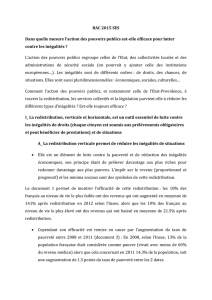Document

Démocratie, politique redistributive,
et inégalité sociale
Essaid Tarbalouti
1
Résumé :
Les approches théoriques sur la démocratie et la politique redistributive ont toujours établit un
lien positif entre les inégalités de revenus et les politiques redistributives. Aujourd’hui, ces
approches font l’objet d’un débat. La littérature empirique relative aux pays en
développement conteste les résultats de cette approche et montre que la demande politique de
redistribution n’est pas élevée lorsque les inégalités de revenus sont importantes. Dans cet
article, on dégage les conditions sous lesquelles la substitution des biens productifs par des
biens improductifs dont la valeur est faible peut réduire la valeur de la demande redistributive
et affecter le développement économique.
Mots clés : politique redistributive, Consommation productive, Consommation
improductive , développement économique
Summary :
The theoretical approaches on the democracy and the redistributive politics always have
establishes a positive link between the disparities of income and the redistributive politics.
Today, these approaches are the object of a debate. The empirical literature relative to
developing countries disputes the results of this approach and shows that the political demand
of redistribution is not raised when the disparities of income are important. In this article, we
release the conditions under which the substitution of the productive goods by the
unproductive goods can reduce the redistributive demands and affect the economic
development.
Keywords: Redistributive politics, Productive consumption, Unproductive consumption and
Economic Development
1
GREER, FSJESM, Université Cadi Ayyad Marrakech Maroc

I/ Introduction
La littérature économique de la politique de redistribution et la croissance
distingue deux approches distinctes : d’une part la relation entre politique
redistributive et croissance économique et, d’autre part, la relation entre les
inégalités de revenu et le niveau de la politique redistributive
Les études théoriques sur la relation entre politique redistributive et
croissance mettent en avant un lien négatif en raison des effets désincitatifs que
jouent les politiques redistributives sur l’investissement. Cette approche tourne
autour de l’argument célèbre de Kuznet selon lequel les inégalités de revenus sont
favorables à la croissance. Toute politique de redistribution tendant à réduire cette
inégalité ne peut qu’affecter négativement la croissance économique. Plus tard,
plusieurs auteurs se sont inscrits dans cette thèse. Ils confirment ce lien négatif
entre les politiques redistributives et croissance (voir Alésina et Rodrick (1994) et
Persson et Tabellini (1994)).
Toutefois, cette analyse n’est pas observée dans les pays en développent
où un accroissement des politiques redistributives peut déboucher sur un
investissement et donc sur la création de la richesse. Plusieurs auteurs ont
développé des modèles expliquant ce paradoxe par la prise en compte
d’imperfections sur le marché de crédit ou les externalités non pécuniaires (voir
Perotti (1993), Saint-Paul et Verdier (1993))
Quant à la relation entre le degré d’inégalité et l’importance de la politique
redistributive, la littérature considère qu’un niveau d’inégalité plus important est
susceptible d’accroître la demande politique redistributive. Cet argument est
avancé dans le cadre classique de l’électeur médian où, lorsque la position de ce
dernier se détériore par rapport à l’individu moyen, la pression politique en faveur
d’un accroissement de dépenses redistributives se fait sentir. Il en résulte que
malgré la cohérence de cette analyse, ces prédictions sont en opposition avec les
études empiriques menées dans les pays en développement. En effet, ce n’est
généralement pas là où les inégalités sont les plus élevées que les transferts
redistributifs sont les plus importants. Plusieurs idées sont alors avancées pour
invalider l’argument conventionnel (Voir Saint-Paul et Verdier (1993))
Cet article part de l’idée que la redistribution est favorable à la croissance
dans les pays en développement. On assimile la redistribution à la production d’un
bien public de long terme générateur de croissance, par exemple l’éducation
publique. Chaque agent consomme le bien en quantité identique mais son
financement s’effectue au prorata de la richesse des individus. Nous proposons
alors la substitution du bien de l’éducation par un bien de court terme dont le prix
est faible et dont l’impact sur la réduction des inégalités est faible comme une
explication alternative au paradoxe de la relation redistribution-inégalité. L’idée
est que la substitution du l’éducation par des biens de survie de court terme dans
les pays pauvres peut altérer le choix démocratique en faveur des membres les
plus riches. La raison est que les pauvres ont une propension de consommation
pour le court terme plus élevée que les riches.
Cet argument est développé dans une économie à deux agents dont
laquelle on compare deux solutions : une solution démocratique ou la pression de
famine est inexistence et la solution avec une pression de famine. En distinguant
deux types d’agents (pauvres et riches), nous verrons comment le choix
démocratique évolue lorsque le degré d’inégalité varie. Nous examinons ensuite

les conditions sous lesquelles le recours aux biens de court terme peut prendre
place et comment ce choix modifie la solution politique. Dans un tel cadre, il
apparaît qu’une élévation des inégalités accroît la pression pour les biens de court
terme et réduit donc la demande de politique redistributive.
La suite de cet article est organisée comme suit : la section II présente
quelques faits stylisés, la section III décrit le modèle de base et compare les
solutions évoquées. Enfin la section IV conclut.
II/ Les faits stylisés
Deux éléments empiriques établissent la pertinence de notre approche.
D’une part, c’est bien dans les pays en développement, là où les inégalités sont
élevées, que l’éducation publique est la plus faible. On n’observe pas de
corrélation positive entre inégalité et redistribution. D’autre part, c’est dans les
pays pauvres où les pressions de famine sont élevées que la consommation de
court terme est élevée.
Le tableau 1 présente d’une part, la part des dépenses d’enseignement
publique en pourcentage du produit national brut (assimilée à une politique
redistributive). D’autre part, il représente l’indice de Gini qui représente le niveau
des inégalités dans les pays en développement.
TABLEAU 1. – Redistribution, Inégalité et dépense en biens durables
Pays en développement
Indice de
Gini (2011)
Dépense d’éducation
publique en % du PNB
Brunéi
Colombie
Équateur
Guatemala
Erythrée
46,3
54
40,2
46,2
52,4
3,8
4,8
4,4
2,8
2,4
Pays développés
Finlande
Irlande
Islande
Pays-Bas
Royaume-Uni
27,7
32,3
27
28,2
33,7
6,8
6,5
7,8
5,9
5,6
Source : Word Bank (2011), «World Development Indicators».
On constate que la majorité des pays pauvres est marquée par de faibles
dépenses publiques d’enseignement et d’un indice de Gini élevé alors que, dans
les pays développés, la relation est inverse. En effet, pour ces derniers, la
moyenne de ratio dépenses en éducation/PNB dépasse les 5% alors que l’indice de
Gini est inférieur à 30.
Concernant la consommation des biens de court terme, le taux de
renonciation à la scolarité et le niveau élevé du travail des enfants dans le secteur
informel illustrent la réalité de nos propos.
Il en résulte que la pression de famine et la préférence pour les biens de
court terme pourrait renforcer le poids politique d’une classe de population et
donc induire des choix politiques favorisant une redistribution sous-optimale ou
un niveau insuffisant de dépenses publiques.

III / Démocratie, inégalité et politique redistributive
Nous supposons une économie en développement dans laquelle elle
coexiste deux types d’agents (1 et 2) différenciés par leurs revenus. On normalise
la population totale à l’unité et on note respectivement
n
et
(1 )n
les proportions
d’individus de type 1 et 2. Selon que
n
est supérieur ou inférieur à 1/2, la majorité
la population sera pauvre ou riche, ce qui affecte, dans un régime démocratique,
les choix politiques endogènes.
Les revenus avant impôt des agents sont notés
1
w
et
2
w
(avec
1
w
<
2
w
).
Le taux de salaire moyen dans l’économie peut s’écrire
(1)
12
(1 )w nw n w
Le gouvernement prélève une taxe proportionnelle sur les revenus bruts
(au taux identique
) en fonction de la production d’un des deux produits publics
proposés: un produit productif assimilé ici à la production de service éducatif noté
1
G
et un produit improductif assimilé à la production des biens de consommation
de court terme noté
2
G
. Selon le choix du produit, par les agents,
1
G
ou
2
G
, le
gouvernement prélève une taxe
1
ou
2
(avec
1
>
2
).
Ainsi, les contraintes publiques du gouvernement peuvent s’écrire comme
suit :
(2)
11
Gw
(3)
22
Gw
Dans ce qui suit, on suppose que les agents ont des préférences hétérogènes : leur
utilité dépend du niveau de leur consommation privée (noté
i
x
pour l’agent
i
) et
de la quantité d’un des deux biens publics. On peut écrire donc :
(4)
1ii
U x G
(5)
2ii
U x G
où
est un paramètre positif qui mesure la préférence pour les biens publiques.
La préférence pour l’un des deux biens est liée au niveau des inégalités.
L’indicateur d’inégalité est représenté par le paramètre
. Plus ce degré est élevé,
plus la préférence pour les biens de consommation de court terme est élevée. Le
salaire de population pauvre est supposé être une fraction
(1 )
du salaire de la
population riche.
Le niveau de taux de prélèvement dépend du choix du bien public. En
fonction de ce choix, chaque agent effectue sont choix de consommation en
maximisant son utilité sous sa propre contrainte budgétaire et celle de l’Etat. La
maximisation de l’agent
i
peut s’écrire selon deux options :
Lorsque l’agent
i
choisit le bien durable dont le taux d’imposition est élevé, la
maximisation de l’agent est de :
10 1 1
(1 ) ( )
i
Max w w

En revanche, lorsqu’il choisit le bien improductif de court terme dont le taux
d’imposition est faible, la maximisation de l’agent
i
est de :
20 2 2
(1 ) ( )
i
Max w w
De ces deux programmes de maximisation, on déduit deux taux de prélèvement
optimaux pour l’agent
i
qui sont donnés par les équations suivantes :
Pour le choix du produit productif durable, le taux de prélèvement optimal
pour l’agent
i
est donné par :
(6)
1* ( ) ;0
i
Max w w
Pour le choix du produit improductif de court terme, le taux de prélèvement
optimal pour l’agent
i
est donné par
(7)
2* ( ) ;0
i
Max w w
Comme les salaires des agents pauvres sont faibles et comme leurs
préférences pour les produits de court terme sont élevées, il s’ensuit qu’une
pression pour la demande du produit de court terme augmente. Par conséquence et
étant donné la nature redistributive des deux produits publics qui réside dans le
financement de l’un des produits publics au prorata des revenus mais dans le coût
de financement n’est pas le même (l’impôt pour financer le produit de l’éducation
est plus élevé que celui des produits de consommation de court terme,
12
()
, la
population riche vote pour un niveau de taxe plus faible
2
()
et la population
pauvre vote pour un niveau de taxe plus élevé
1
()
.
Ainsi, avec un régime démocratique et en présence d’un revenu minimum
permettant la consommation des biens de nécessité de court terme, le taux de
prélèvement effectif est celui qui maximise l’utilité de la majorité. Il en résulte
donc que lorsque la population pauvre
n
est majoritaire
( 1/ 2)n
, le taux de taxe
effectif est
1* ( ) ;0
i
Max w w
. Au contraire, lorsque la population riche est
majoritaire
((1 1/ 2)n
ou
( 1/ 2)n
, le taux de taxation que le gouvernement
impose est de
2* ( ) ;0
i
Max w w
Toutefois, lorsque les salaires de la population pauvre sont faibles de telle
sorte qu’ils sont en dessous du revenu minimum et comme leurs préférences pour
les produits de court terme sont corrélées positivement avec le degré d’inégalité, il
s’ensuit qu’une augmentation des inégalités accentue les pressions pour la
demande du produit de court terme. Ainsi, en introduisant l’indicateur d’inégalité,
on réécrit
1*
et
2*
comme suit :
8)
1* 1 (1 );0Max n
9)
2* 1 );0Max n
On peut dégager donc le résultat suivant :
Proposition 1: Lorsque
( 1/ 2)n
, le taux de prélèvement effectif est fonction
décroissante de l’indicateur d’inégalité.
 6
6
1
/
6
100%