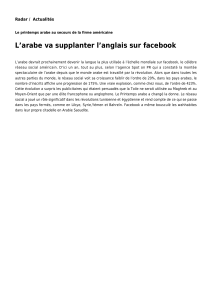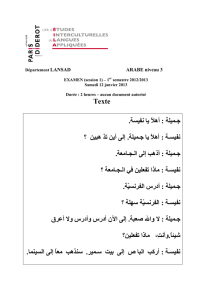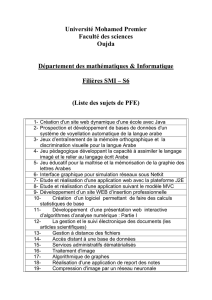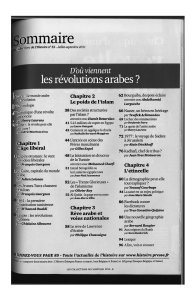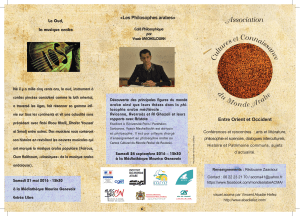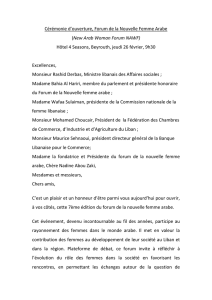analyse des erreurs - Faculté des Sciences Humaines et

1
Vous venez de télécharger ce document de www.modulesfrancais.c.la
Portail étudiants langue française
Faculté des Sciences Humaines et Sociales Tiaret
LINGUISTIQUE CONTRASTIVE
ANALYSE DES ERREURS
Langue arabe Langue française
Source cible
Sémiotique latine
1)Les interférences : en psychologie appliquée, l’interférence est un effet négatif d’un apprentissage sur un
autre.
En didactique, difficulté rencontrée par l’élève et les fautes qu’il commet en langues étrangères étudiées
antérieurement.
Les interférences peuvent effectuer les différents niveaux d’organisation du langage, elles peuvent retarder ou
au contraire, avancer l’acquisition d’un système phonologique, d’un schéma méthodique d’habitude accentué
(interférence phonologique), elles peuvent également affecter les marques grammaticales (la conjugaison, la
structure de l’énoncé, l’ordre des mots) il s’agit là d’interférences morpho-syntaxiques. Elles peuvent entraîner
aussi l’altération des mots ou mauvaise analogie sémantique (mauvaise ressemblance de sens) interférences
lexicales. On peut enfin tenter de déceler les interférences de civilisation culturelle, ex : je vais acheter la tête
du magasin.
Les fautes d’analogie.
EX : je dis, vous disez (dites)
Le cahier de papa
Le cahier de Ali
Le modèle utilisé par l’enfant appartient à sa langue maternelle (le Français, l’Arabe…), on appelle ces fautes :
fautes d’analogie internes).
Lorsque ce modèle responsable de la faute à une langue étrangère, on se trouve devant une faute analogique
externe.
Un élève étranger apprenant le Français se trouve exposé à commettre les deux types de fautes.
LES DIFFERENTS TYPES D’INTERFERENCES : il y a deux cas :
1- Interférence phonétique : elle est responsable de ce qu’on appelle : l’accent étranger. EX :accent
italien : je voudrais une couvée (cuvée)
accent arabe : je voudrais un coufi
accent français : je voudrais une cuvée (vin)
2- Interférence lexicale : elle se produit lorsque la langue cible et la langue source ont des origines
communes sur le plan lexical ; ces fautes sont plus nombreuses chez les élèves arabophones.
EXERCICE : soient les phrases suivantes transmises par un locuteur arabophone.
- je l’aime comme la pupille de mes yeux (faute lexicale culturelle), la pupille a un sens propre en langue
arabe.
- Mon père, il est fatigué (emphase)
- La voiture qu’elle est dans le garage, a son moteur sont cassé (faute morpho-syntaxique)
- Vous avez l’huile, j’ai (arabe)
- Vous avez de l’huile, j’en ai (français)
- J’ai pas le temps de revoir ton visage.
- Il va acheter le pain (morpho-syntaxique)
On dit faute lexicale, interférence lexicale.
La pupille a un sens propre en arabe.
Interférence, confrontation de deux systèmes différents :

2
Morphologie des genres, le genre est une caractéristique qui fait problème aux apprenants. On trouve des
facteurs morphologiques :
EX : Une brise-glace (un)
Une ouvre-boîte (un)
Les mots composés à base verbale sont masculin même si « boîte » et glace sont au féminin. On dit ; un brise-
glace, un ouvre-boîte
LINGUISTIQUE CONTRASTIVE : c’est une étude comparative de deux systèmes de langue. Elle met
en parallèle deux systèmes de langue par des outils qui nous permettent d’analyser et de comprendre.
La linguistique contrastive est étroitement liée aux hypothèses psycholinguistiques sur la nature et le rôle des
« fautes » de l’apprentissage. Son objectif est de prévoir, décrire, et d’expliquer les erreurs et les difficultés
dues à l’influence de la langue maternelle L1.
La linguistique contrastive semble concerner davantage l’enseignement que l’apprentissage, soit qu’elle
ambitionne d’établir une programmation d’une langue étrangère L2, soit qu’elle se limite à des exercices de
correction. Dans ce cas la linguistique contrastive liée à une pédagogie de la réussite qui considère la « faute »
comme une mauvaise herbe à extirper. Le meilleur parcours pédagogique à proposer à l’élève est en ce cas
établi par une progression sans faille, fortement contraignante où l’on cherche à éviter le contact avec l’erreur.
L’INTERFERENCE : on dit qu’il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une langue A
un trait phonétique, phonologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la langue B.
L’interférence reste individuelle : EX : un allemand parlant Français pourra donner au mot français « la mort »
genre féminin ; en Allemand, il lui donnera le genre masculin « tod ». masculin en arabe, la porte est une
interférence morphologique ; une avion : féminin devient en français « un avion » : penser en arabe et
écrire en français.
L’interférence peut être définie de trois manières :
- d’un point de vue psychologique : Piaget « l’interférence, elle a pu être considérée comme une
contamination de comportement, l’enfant peut avoir un comportement langagier »
- elle peut être aussi considérée comme l’effet négatif que peut avoir une habitude sur l’apprentissage
d’une autre habitude.
& Le livre que je me sers pour travailler bien dans l’examen appartient à mon ami.
Le corpus que nous avons sous les yeux provient d’un locuteur arabophone. En effet, nous constatons tout
d’abord une interférence syntaxique : le mauvais usage du pronom relatif que. Pourquoi ? Nous pouvons noter
d’abord que le pronom relatif dont est inexistant dans le système grammatical de la langue arabe ; l’élève va
substituer le P.R. que au profit du P.R. dont.
Il convient de noter également que notre apprenant ignore les fonctions du P.R. que , qui remplace un C.O.D.
un sujet ou un attribut. Dans cette phrase il s’agit d’un C.O.I. le livre appartient à mon frère. Je me sers de ce
livre. Cette fonction est propre au pronom relatif dont et on dira donc :le livre dont je me sers appartient à mon
ami.
LA TYPOLOGIE DES ERREURS :
Le type d’erreurs : la pauvreté linguistique, c’est l’utilisation des termes génériques. EX : le verbe « faire »,
« prendre », « truc ».
La structuration : elle se fait avec les moyens de bord, on utilise des mots vagues, « passe partout »
Les erreurs lexicales : on utilise le mot propre «clou» au lieu de «vis».
Utilisation des néologismes : mot inventé par le besoin pour combler le vide. EX : dégoutage, souffrage.
Confusion entre : il faut mieux et il vaut mieux.
Les erreurs syntaxiques : «c’est l’homme que je te parle»
Interférence lexicale : sens, ordre sémantique. EX : mon frère lit au lycée.
Interférence d’ordre morphologique. Elle a étendu le tapis dans le sol. Mauvais emploi de la préposition.
Cette arbre est gigantesque. «cet»féminin en Arabe, les journals, tout les matin : erreurs morphologiques
Interférences phonétiques : B P F V U I. Les voyelles nasales n’existent pas en arabe.
D’autres interférences :
-le collectif :toute la maison sont partis à le mariage (socioculturelle).
-le comparatif d’égalité : il était habile comme son père ; il était habile au-dessus de son père ; il était habile de
tout les hommes. L’absence de PLUS : il était grand que moi.

3
-l’adjectif indéfini : tout les hommes ; tout la ville.
-l’aphérèse : suppression de la 1ère syllabe. Ex : (telligent)
-la métathèse : interversion de phonèmes (diquse)
-l’amuïssement : suppression d’un phonème à l’intérieur d’un mot. Ex : mdame
-la syncope : suppression de la voyelle du milieu.
-l’apocope : suppression de la dernière syllabe. Ex : Abedeka.
EXERCICE : typologie des erreurs : dans le corpus suivant, relevez et analysez les différentes interférences.
a) – Ah ! c’est le dégoutage, j’arrive pas à me sortir du pétrin.
b) – J’eni marre tout les jor je vais achète le pin, et tout.
c) – Il faut moi meurir que ça ce souffrage.
a) dans ce corpus, nous pouvons relever les différentes interférences :
Le lecteur arabophone emploie un néologisme «dégoûtage» par besoin linguistique : c’est une erreur lexicale, le
locuteur arabophone n’a pas su employer le mot précis.
Le locuteur arabophone ignore la négation(interférence morphologique), emploi inexact du verbe «sortir».
Analyse des erreurs :
-interférence phonétique : nous constatons une altération de l’expression française «j’en ai» en effet, la nasale
a n’existe pas en arabe, elle est réduite en é et le (E) régresse en i.
Jor : confusion entre le u et le o
Pin : interférence orthographique
Meurir : confusion entre le o et le u
-interférence morphologique : tout les jor : absence de s dans tous et les jours.
-Interférence syntaxique : je vais achète, l’infinitif n’existe pas en langue arabe. En langue arabe, le locuteur a
tendance à faire remplacer l’infinitif par un verbe conjugué :
-interférence socioculturelle. Que ça : traduction intégrale de la langue arabe.
-néologisme, le locuteur arabophone ignore le substantif du verbe souffrir et il invente le néologisme
« souffrage » par besoin
EXERCICE : Chaque venderdi tout la maison elle vont marche à la cimitère.
Venderdi : métathèse : inversion de : dr en rd
Tout la maison elle vont marché : collectif, socioculturelle
Cimitère : morphologique phonétique
On constate une assimilation progressive ; le i de ci influe sur le e de me et le réduit en i ; absence de (j).
PROBLEMATIQUE :
Toute expression orale ou écrite dans la langue de l’autre provoque inéluctablement les interférences. Celles-ci
relèvent-elles de la pensée et des représentations intrinsèques de celui qui s’exprime, ou sont-elles dues à de
simples confusions de structures syntaxiques ?
4- L’ARTICLE DEFINI :
Le pantalon le neuf :
En Arabe, l’article est redoublé sur l’adjectif épithète qui accompagne le nom déterminé, c’est pourquoi il y a
répétition (la redondance) de l’article le en Français et qu’il n’est pas nécessaire pour le sens.
EX : l’enfant le petit même analyse.
5- L’ARTICLE INDEFINI :
fils du voisin chante
En arabe, le complément du nom va définir le nom ; l’élève n’emploiera pas par analogie la structure
syntaxique de la phrase, il évitera l’emploi du déterminant le.
6- L’ARTICLE PARTITIF :
EX : L’épicier a l’huile. L’élève a oublié «de» qui est un article partitif, en arabe, il n’existe pas d’article
partitif, c’est pour cela que le locuteur arabophone n’a pas utilisé de.
EX : j’ai pas la chance.
7- L’ARTICLE CONTRACTE :
EX : le fils de le voisin

4
L’article contracté n’existe pas en langue arabe, l’élève par conséquent n’a pas su utiliser l’article contracté du
8- L’ADJECTIF QUALIFICATIF :
EX : une maison petite
La place de l’adjectif pose un problème : en arabe l’adjectif est après le nom et en français l’adjectif se place
avant le nom «une petite maison». Cette interférence montre que l’enfant (le natif) passe directement de la
structure arabe sans même réfléchir en français.
Ex : aujourd’hui la mer belle
La phrase nominale existe en arabe, n’ayant pas besoin de verbe pour que le sens soit complet, l’élève a cru ne
pas utiliser le verbe puisque l’adjectif prend le statut d’attribut. Celui-ci étant implicite en arabe.
EXERCICE : la ville la neuve
En arabe, l’article est redoublé sur l’adjectif épithète qui accompagne le nom déterminé, c’est pourquoi il y a
répétition de l’article «la» en français et qu’il n’est pas nécessaire pour le sens.
Je vais à la marché
L’article contracté n’existe pas en arabe, l’élève par conséquent n’a pas su utiliser l’article contracté «au»
Fils du fermier travaille
En arabe, le complément du nom va définir le nom, l’élève n »emploiera pas par analogie la structure
syntaxique de la phrase, il évitera l’emploi du déterminant «le».
Il faut avoir la chance pour avoir le pain ici.
L’élève a oublié «de» qui est un article partitif ; en arabe, il n’existe pas d’article partitif, c’est pour cela que le
locuteur arabophone n’a pas utilisé «de». L’élève (le natif) passe directement de la structure arabe sans même
réfléchir en français. En langue arabe, le partitif n’existe pas, le locuteur arabophone passe directement de la
structure arabe à la structure française. (transposition) (le calque).
La foire de la village.
L’article contracté n’existe pas en langue arabe, l’élève par conséquent n’a pas su utiliser l’article contracté du
LE GENRE :
EX : la soldat ; la commissariat
Souvent chez le locuteur arabophone un substantif qui se termine par la voyelle «a» est au féminin, d’où les
interférences suivantes :
La soldat et la commissariat. Cette interférence n’a pas besoin d’être traduite en arabe car l’interférence est
visible au niveau du (a) qui est employé en général comme marque du féminin en arabe, c’est pourquoi l’élève
a fait allusion en disant la soldat et l’emploi du féminin.
LE NOMBRE :
EX : il se lave les deux mains.
Dans la traduction, on remarque que la phrase est correcte sachant que le duel existe en arabe mais pas en
français. Dans notre corpus, le locuteur arabophone a souligné l’emploi du duel en rajoutant «deux».
LE COMPARATIF :
EX : il est grand au dessus de moi. L’élève n’a pas employé le comparatif de supériorité «plus», car le
comparatif de supériorité n’existe pas en arabe, par contre il est préfixé à l’adjectif
LES PRONOMS PERSONNELS :
EX : moi grand.
Le locuteur arabophone pense dans sa langue maternelle, une structure de dialecte algérien (ana kbir). (ana)
englobe le verbe et le sujet en arabe. L’élève a négligé le verbe car il s’agit là d’une phrase nominale.
EX : Monsieur pars tu ? Le vouvoiement n’existe pas en arabe, il ne s’emploie que dans des situations
hiérarchiques politiques.
LES PRONOMS PERSONNELS COMPLEMENTS :
EX : elle appelle nous.
Le locuteur arabophone utilise le pronom personnel après le verbe car en arabe le pronom personnel est suffixé
au verbe et il vient après.

5
L’ACCORD DU VERBE AVEC LE SUJET :
EX : les chèvres broute l’herbe.
Pour l’élève, les chèvres sont des animaux, non des êtres humains, d’où le verbe en arabe ne s’accorde pas avec
le nom et il est conjugué au féminin singulier. Il y a ici une traduction intégrale de l’arabe au français.
EXERCIE :
1- la poupée la jolie est dans son lit petit
2- il se lave les deux jambes
3- va chez le boulanger achète le pain
4- donne moi l’eau de le robinet
5- les vaches connaît le chemin qui conduit à la ferme
En arabe, l’article est redoublé sur l’adjectif épithète qui accompagne le nom déterminé, c’est pourquoi il y a
répétition, la redondance de l’article «la» en français et qui n’est pas nécessaire pour le sens.
Le petit : cette interférence montre bien que l’enfant (le natif) passe directement de la structure arabe sans
même réfléchir en français.
LES MAUVAIS USAGES DES SYNTAGMES PREPOSITIONNELS.
EX : Elle laissait tourner sa bague qui était dans sa main.
EX : Ses longs cheveux et ses beaux yeux brillaient dans le soleil.
EX : Jean fouille dans Marie.
EX : Elle déjeune au un restaurant.
EX : Nous sortons en bonne heure.
EXERCICE : relever et expliquer les interférences dans les syntagmes prépositionnels suivants :
- ma mère a étendu le tapis dans la parterre.
- Ici c’est le coiffeur des dames et face le coiffeur des hommes.
- Je suis venu accompagné avec ma mère.
- Je jure de Dieu que je me vengerai.
1-dans le parterre : cette interférence est due à une contrainte morphosyntaxique par analogie à la structure de la
langue arabe Le locuteur arabophone parle ou écrit le français (langue cible) tout en pensant avec
sa langue natale(langue source), et par ses insuffisances de la langue française le locuteur arabophone tombe
dans des écarts ou interférences. Dans ce cas, il a ignoré les contraintes morphosyntaxiques qui l’ont conduit à
produire une phrase incorrecte ; il serait plus juste de dire : ma mère a étendu le tapis sur le parterre.
2-le coiffeur des dames et face…
Le locuteur arabophone a pensé directement dans sa langue à la structure syntaxique le déterminant et le
déterminé. En outre, il ignore le sens de la préposition «pour» dans la signification «et» spécialement destiné à
d’où l’amusement de cette préposition «pour».
On constate également la traduction intégrale de l’arabe au français concernant le mot «face» d’où l’effacement
de la préposition «en».
EX : la maison ils sont partir tous.
Dans ce corpus, on peut relever les interférences sur le plan morphologique ; le locuteur arabophone reprend
l’emphase avec le masculin il au lieu de elle. Partir : le locuteur ignore l’emploi du participe passé partis. Tous :
absence de l’accord du pronom indéfini toute.
REMARQUE : nous relevons dans le texte une interférence socioculturelle «la maison», le locuteur pense dans
sa langue maternelle où existe le collectif.
EX : les chèvres broute l’herbe. Erreur syntaxique (bRout)
En effet, dans la syntaxe arabe, le verbe ne s’accorde pas avec le nom pluriel mais il se met au féminin
singulier.
EX : j’ai pas la chance de mon frère à moi qu’il est grand de moi deux.
Notre corpus comporte de nombreuses interférences :
1- interférence morphosyntaxique : absence de la forme négative
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%