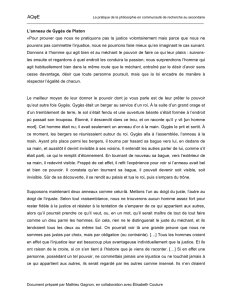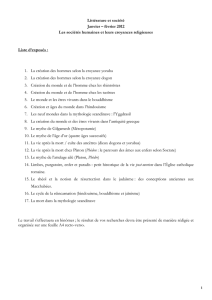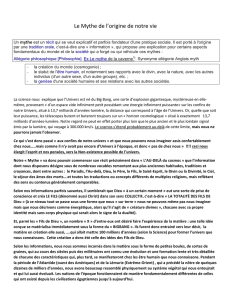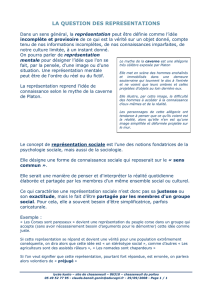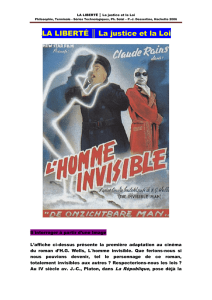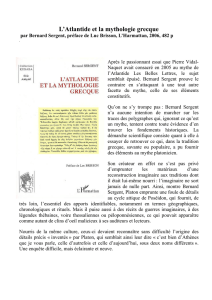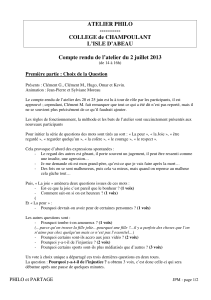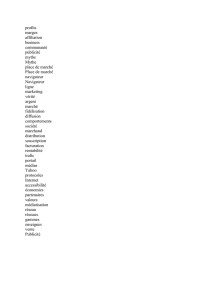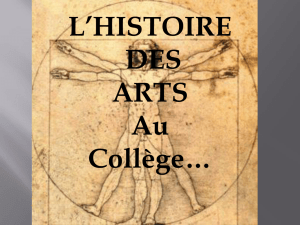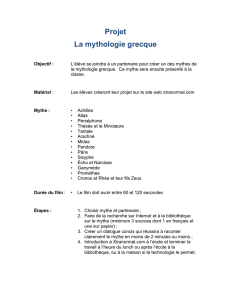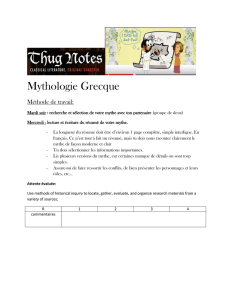Or, que ceux-là même qui pratiquent la justice par impuissance de

1 / 5
L’ANNEAU de GYGÈS PLATON
« Or, que ceux-là même qui pratiquent la justice par impuissance de commettre l'injustice la pratiquent
contre leur gré, c'est ce que nous comprendrions au mieux si nous imaginions le cas suivant : ayant
donné également au juste et à l'injuste la liberté pour chacun des deux de faire ce qui pourrait leur
plaire, nous les suivrions ensuite en observant où le désir mènerait chacun d'eux. Nous prendrions
alors sur le fait le juste marchant vers le même but que l'injuste, poussé par la cupidité insatiable à
laquelle toute nature est portée à s'attacher comme à un bien, mais qui est ramenée par la contrainte
au respect de l'égalité. Cette liberté dont je parle se manifesterait au mieux si un pouvoir venait à leur
échoir tel que celui qui échut à Gygès le Lydien. Eh bien, c'était un berger aux gages du roi qui
régnait alors sur la Lydie. A la suite d'une pluie abondante et d'un tremblement de terre, une fente
s'était produite dans le sol et un gouffre s'était ouvert à l'endroit où il faisait paître. Stupéfait à cette
vue, il y descendit et, entre autres merveilles que l'on raconte, il y aperçut un cheval de bronze, creux,
muni de petites portes à travers lesquelles en se penchant il vit à l'intérieur un homme qui selon toute
apparence était mort, d'une taille plus qu'humaine et qui n'avait sur lui rien d'autre qu'à la main un
anneau d'or qu'il lui enleva avant de sortir. Et lors de la réunion habituelle des bergers en vue de faire
au roi leur rapport de chaque mois sur les troupeaux, il s'y rendit portant au doigt cet anneau. S'étant
donc assis au milieu des autres, il vint par hasard à tourner le chaton de la bague vers soi en dedans
de sa main. Or sitôt ce geste fait, il devint invisible à son entourage et on parla de lui comme s'il était
parti. Il en fut tout étonné et en maniant à nouveau la bague, il se trouva à tourner le chaton en dehors
et sitôt l'anneau retourné, il redevint visible. Puis, ayant réfléchi, il mit l'anneau à l'épreuve pour voir s'il
avait bien ce pouvoir et il constata qu'en tournant le chaton à l'intérieur, il devenait invisible ; à
l'extérieur, visible. Ayant ainsi vérifié que l'effet était assuré, il s'introduisit dans la délégation qui se
rendait auprès du roi ; et une fois là, il séduisit son épouse, avec son aide attaqua et tua le roi, puis
s'empara du pouvoir.
Eh bien, supposons qu'il existe deux anneaux de ce genre, que le juste se passe l'un au doigt et
l'injuste l'autre, il ne se trouvera personne, ce semble, d'une assez forte trempe pour demeurer dans
la justice et pour avoir le courage de s'abstenir du bien d'autrui sans y porter atteinte, alors qu'il aurait
la faculté d'emporter du marché en toute sûreté ce qui lui plairait ; en pénétrant dans les maisons de
s'accoupler à qui lui plairait ; de mettre à mort ou de délivrer des fers qui il voudrait ; bref, de tout faire
comme l'égal des dieux parmi les hommes. En agissant de la sorte, le juste ne ferait rien de différent
de l'autre et ils marcheraient tous les deux vers le même but. En vérité, on pourrait y voir une grande
preuve de ce que personne n'est juste volontairement mais par contrainte, vu que ce n'est pas là en
soi-même un bien, puisque partout où quelqu'un croira être en mesure de commettre l'injustice, il la
commettra. Tout homme en effet croit que l'injustice lui est en elle-même plus avantageuse que la
justice, et il aura raison de le croire, à ce que dira celui qui soutient une telle doctrine. Si en effet

2 / 5
quelqu'un qui se serait arrogé pareille liberté ne consentait jamais à commettre une injustice ni à
porter atteinte au bien d'autrui, il serait regardé par ceux qui seraient au courant comme l'homme le
plus malheureux et le plus insensé. Mais ils feraient son éloge en vue de se tromper mutuellement par
crainte de subir l'injustice. Voilà donc ce qui en est de ce point. »
PLATON, République, livre II, 359b-360d ; trad. L.-M. MORFAUX.
Le mythe de Gygès, pour être bien compris, doit être situé dans le contexte du Livre II de la
République de Platon. On pourrait dire, en des termes modernes mais parfaitement fidèles, nous
semble-t-il au texte platonicien, que pour Socrate la vertu de justice est une valeur, qu'elle « doit être
aimée comme un bien en soi ». Thrasymaque - dont les propos immoralistes ont retenti tout au long
du Premier Livre - nie cette valeur de la justice. Pour lui, les chefs d'Etats en imposant des lois au
peuple ne cherchent qu'à assurer leur domination ; quant aux hommes prétendus « justes » ce sont
des moutons peureux et dociles qui n'obéissent aux lois que parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de s'y
soustraire, Glaucon (c'est le propre frère de Platon) qui apparaît en scène dans le Livre Il ne partage
pas le point de vue de Thrasymaque ; mais pour provoquer de la part de Socrate une réfutation
décisive il se fait l'avocat du diable et commence par proposer une réduction psychologique de la
valeur de justice. La justice dit-il « tient le milieu entre le plus grand bien - commettre impunément
l'injustice - et le plus grand mal - la subir quand on est incapable de se venger ». La justice est aimée
non comme un bien en soi mais comme un moindre mal : obéir aux lois pour être en retour protégé
contre l'agression des plus puissants ; par peur du loup, le mouton obéit à la loi du berger. La vertu de
justice est appréciée non pour elle-même, mais à cause des avantages que sa pratique confère
(bonne réputation, protection des lois, etc.). La soi-disant valeur de la vertu de justice est ainsi réduite
à des motivations psychologiques, à des calculs d'intérêts. C'est déjà une réduction psychologique
dans le style de La Rochefoucauld : « Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la
mer.» D'où l'idée que le mythe de Gygès va illustrer : l'homme invisible qui pourrait impunément
accomplir les plus délicieux forfaits ne pratiquerait jamais la justice.
Gygès s'empare de l'anneau. L'aventure de Gygès nous est contée sous la forme d'un mythe avec
tous les accessoires habituels des contes : climat d'épouvante, un violent orage, la terre se fend,
Gygès descend dans le gouffre ; succession de prodiges : Gygès trouve un cheval de bronze, percé
de fenêtres ; à l'intérieur le cadavre d'un être plus grand qu'un homme qui porte à un doigt une bague
dont Gygès s'empare. Nous sommes plongés dans le merveilleux et préparés à accepter le dernier
prodige : cette bague a le pouvoir de rendre invisible celui qui la porte. Notez ici le clin d’œil de
Platon : « entre autres merveilles que les mythes racontent ». Platon s'amuse à multiplier les détails
fabuleux ; l'imagination se fait ici précise et féconde. Mais la beauté, la poésie étrange du mythe sont

3 / 5
au service du vrai ; le mythe est un message métaphysique - l'art mythique est toujours chez Platon
second par rapport à la philosophie. Le mythe est un procédé pédagogique dont le caractère
paradoxal ne doit pas nous échapper. Car enfin la philosophie de Platon est pour l'essentiel un
dualisme qui nous invite à rejeter le monde des images, illusions fugitives, au profit de la vérité
éternelle des idées pures. Et voici que Platon veut traduire dans une sorte de récit poétique
légendaire, c'est-à-dire dans un langage d'images, une vérité philosophique étrangère au monde
sensible. Le « monde » des idées éternelles, étranger aux images, est suggéré par un monde
d'images !
L'aventure de Gygès est ici, notons-le, plus ou moins annoncée comme une fable. Ce n'est pas
toujours le cas dans les mythes platoniciens. Dans les mythes eschatologiques, ceux qui parlent de la
vie future et de l'enfer, Platon semble parfois convaincu par le récit. Il faudrait appliquer aux mythes
platoniciens la méthode des genres littéraires qui s'est révélée si féconde dans l'exégèse biblique.
Tantôt le mythe platonicien est proche de la croyance, la philosophie se ressource dans la tradition
religieuse, tantôt le mythe n'est que procédé pédagogique. C'est ici le cas, le mythe a pour mission
d'illustrer une hypothèse éthique celle du problème moral posé par l'homme invisible.
« ... Surpris, il recommença de manier la bague avec précaution, tourna le chaton en dehors et l'ayant
fait redevint visible. Ayant pris conscience de ce prodige, il répéta l'expérience pour vérifier si la bague
avait bien ce pouvoir... Dès qu'il fut assuré que l'effet était infaillible, il s'arrangea pour faire partie de la
délégation ... »
Il faut ici remarquer que toutes les précautions, toutes les hésitations de Gygès concernent
exclusivement la technique du maniement de l'anneau. Tournez le chaton en dedans, on devient
invisible, en dehors, on redevient visible. Gygès ne s'en tient pas à l'expérience fortuite qu'il fait au
début de l'assemblée des bergers. Il répète l'expérience « pour vérifier si la bague avait bien ce
pouvoir. » Gygès est prudent et avisé. Il fait plusieurs essais afin de s'assurer de son nouveau
pouvoir... Mais dès qu'il est assuré, il fonce au palais, séduit la reine et tue le roi ; ici pas d'hésitations,
pas de scrupules. Quel contraste entre sa patience, ses multiples essais pour vérifier son pouvoir, et
sa détermination subite - sans aucune délibération - pour se livrer aux actions injustes ! Il ne délibère
que sur les moyens, mais il se convertit en un instant aux fins de l'injustice ! « Gygès, commente
Alain, n'était point méchant homme. Il faisait son métier de berger comme on le fait, mais c'est qu'il ne
pouvait pas faire autrement, c'est qu'il ne voyait pas le moyen de faire autrement. » Dès que le moyen
de faire autrement s'offre à lui, avec l'assurance de l'impunité totale, cet « honnête homme » se jette
dans le crime.
« ... Si donc il existait deux bagues de ce genre, que le juste se passe l'une au doigt, l'injuste l'autre,
personne n'aurait une âme de diamant assez pur pour persévérer dans la justice... »

4 / 5
Voilà donc la conclusion apparente du mythe. Le juste ne serait plus juste si devenant invisible il
pouvait impunément se livrer à l'injustice... En fait ce n'est pas tout à fait une conclusion car Glaucon
nous l'a dit, il ne se range pas au parti de Thrasymaque. C'est plutôt une question que Glaucon pose
à Socrate, c'est une invitation à radicaliser le problème de la vertu de justice, une invitation à poser ce
problème au niveau de l'essence de la justice. Dans la vie concrète des hommes, en effet, tout est
ambigu. Le juste, dans une société policée gagne souvent quelques honneurs et bénéficie de la
protection des lois, l'injuste est quelquefois sévèrement puni. Ce qu'il faut pour juger de ce problème
en philosophe, c'est connaître en leur pure essence la justice et l'injustice, « leur nature et quel est le
pouvoir propre de chacune, prise en elle-même, dans l'âme où elle réside, sans tenir compte des
récompenses qu'elles procurent et de leurs conséquences. » Supposons, dit Glaucon, un homme
injuste qui soit parfait en son genre, aussi hypocrite que méchant et qui, tel Gygès, puisse dissimuler
les oeuvres de son injustice donc jouir malgré son injustice de tous les avantages d'une bonne
réputation. Et maintenant imaginons un homme juste qui sans rien faire de mal ait une réputation
d'injustice (ce qui est royal, disait Empédocle, c'est de bien agir et d'avoir mauvaise réputation,
Basilikon eu prattein Kakôs d'akouein), qui pour le prix de ses vertus parfaites ne récolte que
l'ingratitude et soit puni de mort par ses concitoyens. Voilà l'injustice et la justice toutes pures, réduites
à leur propre essence et offertes à notre choix. « Oh, cher Glaucon, dit Socrate, avec quelle force tu
nettoies comme des statues ces deux hommes pour les soumettre à notre jugement ! » Il ne s'agit
plus ici d'opérer une réduction psychologique de la valeur de justice, en cherchant toutes les
motivations intéressées qu'on peut avoir d'être juste, comme les moralistes anglais du XIXe siècle qui
tenteront de fonder la morale sur l'intérêt. Il s'agit au contraire d'entreprendre pour employer un terme
actuel, husserlien, une réduction eidétique de la valeur de justice c'est-à-dire de la réduire à sa propre
essence, de la purifier de tous les éléments empiriques, extérieurs à son essence qui dans la pratique
concrète l'accompagnent. Ce que Glaucon demande à Socrate c'est de justifier la vertu de justice en
elle-même et par elle-même, dans la pureté de son essence. La justice n'est une valeur que si elle
vaut absolument, quelles que soient ses conséquences, et même si l'on doit comme fera Socrate
accepter de mourir pour elle. C'est donc le problème des valeurs qui est ici posé et soigneusement
dépouillé de tous les accessoires empiriques qui ne peuvent que le fausser.
L'intérêt de ce texte est donc double. Il pose le problème du mythe platonicien. Il montre d'autre part
comment Platon pose le problème de la justice et par là discrédite fort bien par avance toutes les
approches empiriques du problème moral (comme l'approche anglaise du XIX° siècle qui prétend
fonder la morale sur ce qui n'est pas moral).
L'appel au mythe a ici un rôle très évident. C'est le mythe qui permet à Platon de radicaliser le
problème de la valeur éthique. Le mythe de Gygès, l'homme invisible (qui peut faire tout ce qui lui plaît

5 / 5
sans aucun risque), est très exactement l'équivalent de ce que nous appelons une « réduction
eidétique». En effet l'essence (eidos) authentique de la justice et de l'injustice se révélerait pleinement
dans le cas de l'homme qui pourrait agir sans aucune peur des conséquences. Le juste ne serait juste
que par amour de la justice (et non par intérêt), l'injuste oserait enfin être lui-même : Gygès l'honnête
berger qui n'avait jamais trompé personne et qui soignait bien ses moutons n'a que l'apparence de la
probité puisque l'anneau magique fait voler en éclats sa justice prétendue.
- C'est une fiction analogue qu'imaginera Chateaubriand, connue sous la forme de la fameuse
question : Tuerai-je le mandarin ? «Je m'interroge, écrit-il, je me fais cette question : si tu pouvais, par
un seul désir, tuer un homme à la Chine, et hériter de sa fortune en Europe, avec la conviction
surnaturelle qu'on n'en saurait jamais rien, consentirais-tu à former ce désir ? »1
Balzac, qui, dans Le Père Goriot, l'attribue par erreur à Rousseau, lui prête la formule suivante : « S'il
suffisait pour devenir le riche héritier d'un homme qu'on n'aurait jamais vu, dont on n'aurait jamais
entendu parler, et qui habiterait le fin fond de la Chine, de pousser un bouton pour le faire mourir, qui
de nous ne pousserait ce bouton et ne tuerait le mandarin ? »2
1 Le Génie du christianisme, 1802, 1ère partie, I, VI, chap. II.
2 Le Père Goriot, 1834, in La Comédie humaine, édition Marcel Bouteron, Pléiade, p. 960. La phrase
citée est extraite d'un article signé par Balzac avec Protat dans le Courrier de Vaugelas.
1
/
5
100%