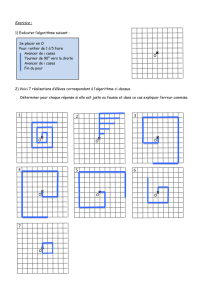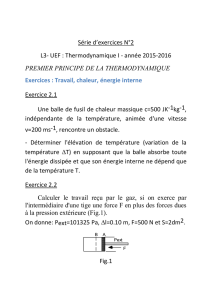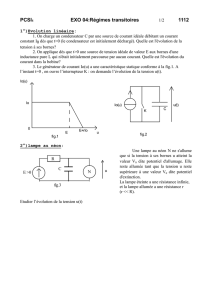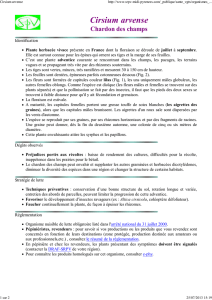Principales techniques et méthodes utilisées en Neurosciences

1
Plan du cours
Introduction
I-TECHNIQUES D’EXPLORATION ANATOMIQUE ET STRUCTURELLE
A) Techniques de microscopie, histologie et cytologie
1- Principes généraux en microscopie optique
a-fixation
b-inclusion et coupe
2- Principales applications
a- colorations
b- histo- et cytochimie
-histochimie classique-autoradiographie-immunohistochimie
-hybridation in situ
3-La microscopie confocale
4- Principes généraux en microscopie électronique
a- microscopie électronique à transmission
b- microscopie électronique à balayage
B) Techniques d’exploration anatomique sur l’animal ou le sujet vivant
1- radiographie classique et angiogrammes
2- tomographie aux rayons X
3- Imagerie par résonance magnétique nucléaire IRM
La RMN-L’IRM anatomique –l’IRM de diffusion
TECHNIQUES ET METHODES EN NEUROSCIENCES
Sous le terme général de Neurosciences il faut en fait regrouper tout un éventail de
disciplines scientifiques très diverses qui s’appliquent toutes à essayer de comprendre comment
se construit, comment fonctionne le système nerveux (SN) et comment il gère les différents
comportements individuels et collectifs. C’est ainsi que les diverses Sociétés scientifiques
internationales consacrées aux Neurosciences reconnaissent :
-la Neuroanatomie qui caractérise la structure et l’organisation (morphologie,
connectivité...) du SN,
-la Neurophysiologie qui étudie le fonctionnement physiologique des neurones,
-la Neurochimie qui étudie les molécules vectrices d’informations dans le SN,
-les Neurosciences moléculaires qui étudient et manipulent le matériel génétique des
cellules nerveuses
-la Neurologie qui est la branche de la médecine s'intéressant aux conséquences
cliniques des pathologies du SN et à leurs traitements,

2
-la Neuropsychologie qui s'intéresse aux conséquences cliniques des affections du SN
sur les processus mentaux,
-la Neuroendocrinologie étudie les liens entre le SN et le système hormonal,
-les Neurosciences comportementales qui s’intéressent aux bases biologiques des
comportements
-les Neurosciences cognitives qui cherchent à établir les liens entre le SN et la
cognition,
-les Neurosciences computationnelles qui cherchent à modéliser le fonctionnement du
système nerveux au moyen de simulations informatiques.
Enfin sont apparues de nouvelles disciplines telles que la Neuroéconomie et la
Neurofinance qui s'intéressent aux processus de décision des agents économiques, et
notamment l'étude des rôles respectifs des émotions et de la cognition dans ceux-ci.
Ces disciplines, relevant des différentes branches de la Biologie, de la Physiologie, de la
Physique, de la Chimie, de la Psychologie ou encore des Mathématiques ou de l’Informatique,
ont apporté diverses techniques et méthodes d’investigation et d’analyse qui contribuent toutes
à une meilleure connaissance du SN. Ces techniques ont été développées à tous les niveaux
d’organisation des êtres vivants : du niveau moléculaire jusqu’au niveau du groupe d’individus,
en passant par les niveaux cellulaires, tissulaires et organiques.
Lorsqu’on s’engage dans l’étude des bases biologiques des comportements, il est
nécessaire de savoir comment les connaissances actuelles ont pu être acquises, de comprendre
quelles sont les démarches qui les feront progresser et de comprendre comment certaines
applications issues de la recherche fondamentale sont utilisées à des fin thérapeutiques. A cet
effet, je vous propose donc de découvrir un certain nombre de techniques et méthodes de base
en Neurosciences en décrivant les méthodes d’exploration anatomique et structurale, puis les
méthodes dédiées à l’étude du fonctionnement du SN. Dans chacune de ces parties nous
distinguerons les techniques « in vitro » qui s’appliquent après le sacrifice ou la mort naturelle
de l’organisme étudié et les techniques « in vivo »développées sur des organismes vivants.
I- TECHNIQUES D’EXPLORATION ANATOMIQUE ET STRUCTURELLE
Pendant plusieurs millénaires, les savants égyptiens puis grecs ont pensé que le cœur
était le siège de la conscience, de l’âme, de la pensée et des souvenirs. Aristote a écrit que le
cerveau, composé de tissus mous apparemment indifférenciés, avait pour principale fonction
refroidir le cœur. Les premières observations et dissections pratiquées sur des gladiateurs par

3
les médecins romains les ont conduit à postuler que la tête était l’organe des sensations et le
siège de l’intelligence. Certains médecins, dont Gallien, ont découvert que le cerveau était
creux et que des fluides circulaient dans des cavités (ventricules). Les premières théories
fonctionnelles disaient que les fonctions du corps dépendaient de l’équilibre de 4 liquides
vitaux, ou humeurs. On pensait alors que les sensations étaient enregistrées et les mouvements
initiés par le déplacement de ces humeurs vers ou à partir de ces ventricules du cerveau. Les
nerfs étaient considérés comme des canaux!
Cette théorie a persisté jusqu'à la Renaissance. Les premiers appareils d’optique ont
alors autorisées des observations précises du cerveau et du tissu nerveux qui ont conduit les
savants a construire d’autres théories plus ou moins fantaisistes (l’erreur de Descartes!). A la
fin du 18ème siècle le cerveau est toutefois considéré comme un organe complexe dont le
fonctionnement est intimement lié à sa structure et les nerfs sont reconnus pour assurer la
communication entre le corps et le cerveau en transportant de l’électricité (Galvani, Benjamin
Franklin). Le véritable essor des Neurosciences se situe à la fin du 19ème siècle avec les
possibilités nouvelles offertes par les technologies de l’époque : microscopie, chimie,
enregistrement et stimulations électriques qui ont permis de découvrir les neurones, les
synapses...
Ce petit historique vous démontre à quel point la connaissance est liée à l’évolution de
la technologie, dans le domaine des Neurosciences, comme dans bien d’autres.
A) Techniques de microscopie, histologie et cytologie
Historiquement, ce sont les techniques qui ont le plus fait progresser les Neurosciences.
Ces méthodes se sont développées grâce aux avancées réalisées en Physique optique puis en
Physique électronique. Lorsque les chercheurs s’intéressent à la structure et l’organisation des
tissus, ils pratiquent de l’histologie. S’ils se penchent plus particulièrement sur les structures
cellulaires, ils pratiquent la cytologie. En fait, dans le langage courant ces deux approches sont
décrites sous le terme « histologie », car elles utilisent une méthodologie commune.
Il est rare qu’un laboratoire de Neurosciences ne soit pas équipé de matériel d’histologie
et de microscopie. En effet, ces techniques sont les plus couramment utilisées par les
neurobiologistes de tous bords, que se soit pour l’exploration purement anatomique et
structurale, explorer les modes de communication entre les cellules nerveuses ou pour contrôler
les expériences faisant appel à des lésions ou des stimulations du SN, (vérification de la
position des lésions ou électrodes) comme nous le verrons plus loin. Cela explique la nécessité
de décrire quelque peu les principales méthodes utilisées en microscopie classique (optique) et
en microscopie électronique.

4
1- Principes généraux en microscopie optique.
C’est grâce à ces techniques que l’on a pu décrire, dès le 19ème siècle, la structure fine du
tissu nerveux. On a ainsi pu découvrir la microarchitecture des structures du cerveau déjà
décrites grossièrement par l’observation anatomique classique. Par exemple l’existence de
groupes cellulaires ou encore noyaux, formés par le rassemblement plus ou moins important de
neurones (découverte de la microanatomie des noyaux gris centraux et des noyaux du tronc
cérébral) ou encore l’existence de faisceaux de fibres nerveuses constituant les voies de
communication entre les différents noyaux.
Ces techniques ont également permis de caractériser les différents types de cellules
nerveuses et ainsi de distinguer les neurones des diverses cellules gliales (astrocytes,
oligodendrocytes, cellules de la microglie, Fig. A-1 et A-3).
Fig. A-1 : coupe de moelle épinière humaine. Coloration Nissl.
Les plus grosses cellules sont des neurones moteurs, les plus
petites avec des noyaux très foncés sont des cellules gliales
a- Fixation
Pour étudier le tissu nerveux dans un état le plus proche possible de l’état vivant, il est
nécessaire d’éviter l’auto-dégradation de la matière biologique ; il faut donc traiter les tissus
pour éviter qu’ils ne « pourrissent ». Le traitement s’appelle la fixation.
En effet, les cellules et les tissus contiennent diverses enzymes de dégradation qui,
lorsque l’équilibre vital est rompu, vont attaquer les composants cellulaires, les membranes, les
mitochondries …etc et provoquer la décomposition des échantillons. Cette auto-dégradation est
accélérée par l’action de la flore microbienne omniprésente, qui peut se développer

5
extrêmement rapidement en se nourrissant des tissus morts (dépourvus de défenses
immunitaires).
Donc pour garder les tissus dans l’état proche de l’état vivant, il est nécessaire de fixer,
de figer les structures cellulaires en bloquant les molécules biologiques, pour les protéger ou
pour les empêcher d’agir (dans le cas des enzymes et des bactéries).
Il existe plusieurs méthodes de fixation, physique et chimiques ; les plus utilisées sont la
fixation par congélation rapide ou cryofixation et la fixation chimique.
La cryofixation est surtout utilisée lorsqu’on veut étudier les caractéristiques
biochimiques des tissus, car elle n’altère pratiquement pas les molécules biologiques. Par
exemple, on utilise la cryofixation pour étudier la localisation des enzymes de synthèse ou de
dégradation des neurotransmetteurs, ou encore le métabolisme de diverses protéines
neuronales. La cryofixation est souvent réalisée en immergeant un petit échantillon de tissu
frais dans un liquide organique neutre refroidi à -40 °C.
La fixation chimique est réalisée par des aldéhydes, qui présentent la particularité
d’établir de nombreux « ponts » entre les différentes molécules biologiques.
La fixation au formol est considérée comme universelle car elle autorise à la fois les
observations neuroanatomiques les plus fines et certaines manipulations biochimiques.
La meilleure fixation chimique est obtenue par perfusion du système cardiovasculaire de
l’animal étudié: le formol peut ainsi agir directement au sein des différents tissus et figer très
rapidement les structures cellulaires. La perfusion présente aussi l’avantage d’éliminer les
hématies qui peuvent contrarier certaines réactions biochimiques. Lorsqu’on ne peut perfuser,
c’est le cas chez l’homme, on se contente de disséquer rapidement les structures en petits
morceaux et de les immerger dans des volumes importants de solution de fixateur.
b-Inclusion et coupe
Après la fixation, les échantillons doivent être préparés pour qu’on puisse les sectionner
en tranches assez fines pour les rendre observables par transparence au microscope. Les coupes
sont réalisées à l’aide d’un microtome (Fig. A-2), appareil de précision qui ressemble en gros à
une machine à trancher la charcuterie, et qui permet d’obtenir des fines tranches d’une
épaisseur de 1 à 100 microns. Toutefois, bien que la fixation durcisse les tissus, ceux-ci sont
encore trop mous pour être coupés en tranches très fines. Il faut alors traiter les échantillons
fixés afin de les durcir pour rendre la coupe possible.
Deux méthodes peuvent être employées selon le type de fixation utilisé. La première,
rapide, mais aussi délicate si l’on veut conserver les tissus en très bon état, consiste à couper
directement les échantillons qui ont été traités par cryofixation. On peut également congeler des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%




![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)