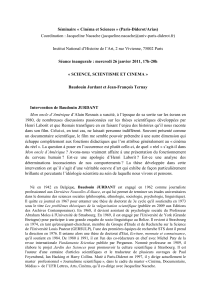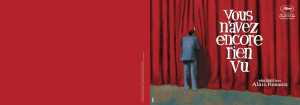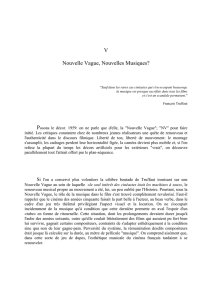Aimer, rire et filmer

Aimer, rire et filmer
Retour sur l‘œuvre et la vie du grand réalisateur.
On l’a souvent classé comme l’un des pères de la Nouvelle Vague, pour des raisons plus
amicales, plus historiques, que réelles. Disons qu’il faisait partie, avec Chris Marker, Jacques
Demy, Agnès Varda (à laquelle il apprit le montage), de ce que par convention on appelle sa
frange “Rive gauche” (par opposition à la “bande des Cahiers” – du cinéma – dont les bureaux
se situaient à l’époque sur les Champs-Elysées). Cette “Rive gauche” l’était aussi à l’origine
pour des raisons politiques (Les statues meurent aussi, admirable pamphlet anticolonialiste
réalisé avec Chris Marker, mais aussi, Alain Resnais (1922-2014) évidemment Nuit et
Brouillard, premier film, inoubliable, sur les camps d’extermination nazis), la “Rive droite” ne le
devenant, parfois de manière radicale, qu’à la fin des années 60.
Hiroshima mon amour et L’Année dernière à Marienbad, déflagrations dans l’histoire du récit
cinématographique, avaient été accueillis avec enthousiasme par Les Cahiers et notamment
par François Truffaut. Mais Resnais sortait de l’Idhec, pas les gens des Cahiers, qui se
voulaient auteurs, écrivains. Il n’écrivit jamais un seul scénario de sa vie, mais il sut faire écrire
les plus grand écrivains ou scénaristes pour lui : Jean Cayrol, Marguerite Duras, Jean-Pierre
Bacri et Agnès Jaoui, Jean Gruault… Il se considéra toujours comme un réalisateur (c’est ce
qu’on lit aux génériques de tous ses films), comme un alchimiste.
“Ô temps, suspens ton bol !” Ainsi commence Le Chant du styrène, court métrage en couleur
qui synthétise déjà tout l’art d’Alain Resnais et son œuvre à venir. De quoi y est-il question ? De
la fabrication du plastique, matière qui symbolise le mieux la société de consommation née
après la Seconde Guerre mondiale. Sur des images purement documentaires d’une usine de
production de plastique, dont les couleurs primaires sont rehaussées par la photo de Sacha
Vierny (qui restera comme le grand chef opérateur de Resnais), une voix off nous décrit le
processus chimique à l’œuvre.

Le texte, en alexandrins, est écrit par Raymond Queneau et dit en voix off par Pierre Dux. En
soixante-dix-huit vers totalement fidèles à la science, accompagnés par la musique très
contemporaine de Pierre Barbaud, Queneau/Resnais réalisent un film à nul autre pareil,
absolument de son temps, d’une intelligence aiguë, se jouant des conventions du docucu
traditionnel. Tout est déjà réuni dans Le Chant du styrène : la rigueur du filmage et du montage,
le goût pour la langue impertinente de la poésie moderne, pour l’humour pince-sans-rire, la
coïncidence de la réalité et de la beauté, la curiosité pour les choses les plus simples en
apparence, les plus banales.
De Rimbaud, Resnais a le goût pour “les peintures idiotes, (…) les contes de fées, petits livres
de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, rhythmes (sic) naïfs”. Comme Baudelaire, il veut
transformer la boue en or, le réel en une projection de lanterne magique.
Point de départ : il n’y a pas de petit ou de grand art. Le cinéma, la sociologie ou la bande
dessinée ne sont pas plus petits que la littérature, l’histoire ou la science et la technologie. Il y a
aussi, chez lui, le goût de Renoir pour les artifices de la représentation, qui l’ont fait considérer,
à juste titre d’ailleurs, comme un formaliste. Mais peut-être serait-il bon d’y ajouter l’idée de
spectaculaire : le formalisme chez Resnais est tout entier tourné vers le spectacle, au sens d’art
vivant, de spectacle de marionnettes et d’entrées de clowns.
Ce n’est donc pas un hasard si Resnais a de toute évidence été un metteur en scène qui aimait
les acteurs (souvent venus du théâtre, d’ailleurs), possédant une sorte d’hystérie fondatrice. On
s’est souvent moqué de lui – il le faisait d’ailleurs lui-même dans ses bandes annonces –, de sa
fidélité aux mêmes acteurs depuis environ trente ans : André Dussollier, Pierre Arditi, à une
époque Fanny Ardant, et bien sûr celle qui était devenue son épouse, Sabine Azéma
Auparavant, il y avait eu évidemment la grande Delphine Seyrig (Marienbad, Muriel…). Comme
Guitry et Renoir, oui, comme d’une manière plus discrète Truffaut, Chabrol et Rohmer, Resnais
aimait les acteurs expressifs, avec leurs excès, leur théâtralité naturelle, cet état qui fait que
tout ce que vous dites ou faites dans la vie semble déjà faire partie d’un spectacle. De cela,
Resnais ne s’est jamais lassé. Il est toujours resté fidèle au petit garçon de Vannes, fasciné par
ces monstres aussi drôles qu’inquiétants que sont les saltimbanques.
Vinrent ensuite rejoindre la troupe Michel Vuillermoz, Mathieu Amalric, Anne Consigny et pour
son dernier film Sandrine Kiberlain. Alors Resnais, curieux de tout, arpenta de nombreux
sentiers : le roman de son temps (Robbe-Grillet pour L’Année dernière à Marienbad, Duras
pour Hiroshima mon amour, Jorge Semprún pour La guerre est finie et Stavisky, puis Christian
Gailly pour Les Herbes folles), la chanson populaire (On connaît la chanson), l’opérette (Pas
sur la bouche), le psychodrame bourgeois de boulevard (Mélo), la comédie (plusieurs fois
l’auteur britannique Alan Ayckbourn – Smoking/No Smoking, Cœurs, Aimer, boire et chanter –,
Jean Anouilh (Vous n’avez encore rien vu), la politique toujours (Nuit et Brouillard, Muriel…, La
guerre est finie, Stavisky), la bande dessinée (I Want to Go Home), et l’amour toujours, parfois
revisité au regard de la science (Je t’aime, je t’aime, Hiroshima…, Mon oncle d’Amérique,
Coeurs, etc.).
De tout, il voulait produire une œuvre supérieure à la matière d’origine. Il y parvint avec plus ou
moins de bonheur, mais toujours avec la même ferveur, la même croyance dans les pouvoirs
magiques du cinéma. Dans ses origines bretonnes, dans sa fascination évidente pour une
Angleterre surfantasmée, Resnais avait aussi puisé un attrait pour les fantômes, pour
l’irrationnel (évident dans L’Amour à mort ou La vie est un roman), qui passa aussi pour lui par
le surréalisme, un certain ésotérisme, des images saisissantes et inattendues qui manifestaient
une véritable interrogation sur les mondes parallèles (goût qu’il partageait évidemment avec
son ami Chris Marker), l’infini de l’imaginaire, et la fascination apeurée pour la mort
(Providence).
Dans tous ses films de fiction, on trouve trace de dépressivité (pas seulement dans On connaît
la chanson) et même de morbidité : il y a quelque chose de malade et de fondamentalement
mou dans l’esprit humain, et cette maladie lénifiante mettait mal à l’aise l’artiste Resnais, ou le
plongeait tout du moins dans un état de perplexité qui passait par des images insolites,
incongrues, oniriques (comme ces personnages qui s’évaporaient littéralement de l’écran dans
Pas sur la bouche, ou l’image récurrente de la neige tombant dans la nuit).
Quand le “bonheur” était prononcé dans Stavisky, aussitôt ce monteur de formation le
contrebalançait par l’image d’une tombe pyramidale. Comme si de rien n’était. Comme si le
spectateur n’allait pas s’en apercevoir. Mais si vous lui posiez la question, Resnais souriait et

esquivait l’idée d’une pirouette, avec élégance, diplomatie, mais affirmation. Ça n’était pas à lui
de commenter son cinéma, et il n’y voyait rien de triste ! Avec tout le respect que je lui dois,
Alain Resnais était resté un petit chenapan. Son dernier film, Aimer, boire et chanter (quel beau
titre pour conclure une oeuvre et une vie), sort le 26 mars. Jean-Baptiste Morrain
© Les Inrocks
4 mars 2014
1
/
3
100%