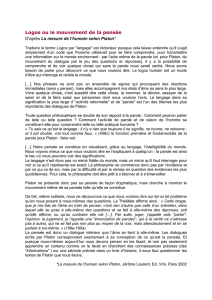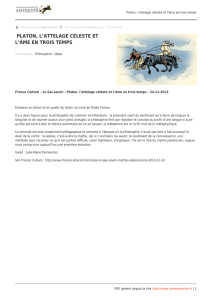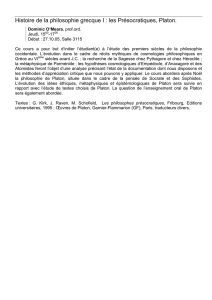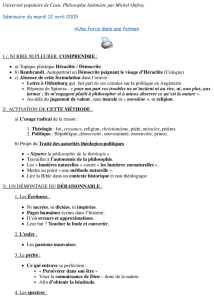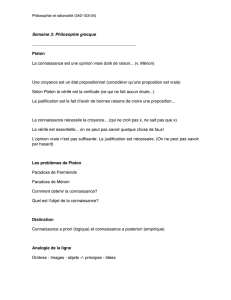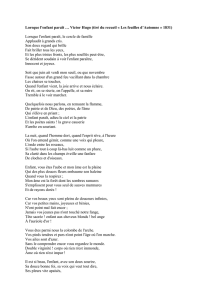Platon Spinoza et l`éthique

La République de Platon,
l'Ethique de Spinoza
par Saverio Ansaldi
Avec la publication des textes de Julia Annas (Introduction à la République de Platon) [1] et de Pierre
Macherey (Introduction à l'Éthique de Spinoza. La cinquième partie) [2], les Presses Universitaires de
France inaugurent une nouvelle collection (Les grandes livres de la philosophie) dont l'objectif est de
fournir des outils de travail et de réflexion capables de nous permettre une approche critique et
argumentée des classiques de la pensée philosophique (ce sont en préparation aussi les
« Introductions » au Leviathan de Hobbes, à la Métaphysique d'Aristote, au Capital de Marx, aux
Méditations cartésiennes de Husserl).
En effet, les livres de Annas et de Macherey ne sont pas des simples commentaires ou des guides
de lecture à la République de Platon et à l'Éthique de Spinoza ; au contraire, ils se présentent
comme des parcours de réflexion larges et approfondis, traversant les oeuvres en question dans
tous les aspects et mettant en lumière leurs contenus les plus significatifs et importants pour
l'histoire de la philosophie.
Le livre de Julia Annas est désormais considéré de plein droit comme un classique des études
critiques platoniciennes [3] ; son principal mérite consiste à nous livrer une interprétation de la
République de Platon qui se concentre tout d'abord sur les questions philosophiques majeures
réellement en jeu dans le texte, en évitant, dans les limites du possible, toutes les querelles
philologiques qui rendent si souvent difficile, pour le non-spécialiste, la lecture d'essais consacrés
à la pensée ancienne. La démarche interprétative de J. Annas nous permet en effet de saisir, avec
une clarté remarquable, tous les enjeux théoriques soulevés par Platon dans son oeuvre, qui vont
de l'origine et des fondements de l'État à la définition des principes éthiques, des différentes
formes de connaissance à l'éducation et à l'art.
En suivant fidèlement le développement du texte, J. Annas nous montre comment la pensée de
Platon, dans la République, se déploie autour d'un concept bien précis : la justice (dikaiosynê). C'est
à partir de la question posée par Glaucon à Socrate « qu'est-ce qu'une vie juste ? », que Platon
entreprend l'examen du concept de justice, en commençant d'abord à analyser ce qu'est la justice
dans la cité, pour passer après à la définition de la justice individuelle. Cette formulation du
problème amène Platon à s'interroger directement sur l'origine de la cité et de la société ; or, selon
J. Annas, pour Platon « le fondement d'une société est une association de personnes qui repose
sur le besoin. Les gens ne peuvent se suffire à eux-mêmes, et ont des besoins variés. On a une
société lorsqu'il se trouve un groupe de personnes dont l'intérêt personnel laisse suffisamment de
place à la prévoyance pour qu'elles se spécialisent, et se partagent les tâches. Ainsi est introduit ce
que j'appellerai le « Principe de Spécialisation », à savoir l'idée qu'à une seule personne, il faut
une seule tâche » [4]. Les interprètes ont souvent considéré ce principe comme un des éléments
les plus critiquables de la pensée de Platon ; or, J. Annas montre que « l'idée fondamentale de
Platon, c'est que les différences naturelles des gens entre eux révèlent les rôles complémentaires
et différents que ceux-ci jouent dans et pour la communauté considérée comme un tout...
L'individu trouve selon Platon sa place naturelle dans une association coopérative : il lui paraît
tout simplement évident que nul ne peut suffire à soi-même, et que chaque individu a donc besoin
d'une place dans la société pour mener une vie qui réalise son potentiel » [5].
La pensée politique de Platon se fonde sur l'idée qu'il faut toujours sauvegarder l'unité et
l'harmonie de la cité - seule garantie de justice -, et cela à partir du « principe de spécialisation »,
selon lequel chacun ne doit pas suivre d'une manière égoïste ses inclinations personnelles mais
exercer plutôt l'activité sociale pour laquelle il est le mieux adapté. C'est sur ces présupposés que
Platon esquisse sa théorie de l'État idéal : « Une véritable cité forme une unité indivise. Une cité

est un groupe où règne une unité d'intérêts : c'est pourquoi seul l'État est une cité, parce que c'est
le seul endroit où les citoyens sont unis comme un seul homme en trouvant l'harmonie entre les
intérêts de la cité considérée comme un tout, et leurs intérêts propres, en tant qu'ils sont
membres d'un groupe particulier » [6]. L'idée de l'unité politique de la cité conduit Platon à
formuler ses thèses célèbres sur la collectivité de la propriété et sur la suppression des familles
nucléaires, qui, comme le montre J. Annas, relèvent du projet radical à la base de La République,
dans le sens où Platon n'entend pas fournir dans son oeuvre des conseils pratiques pour
administrer la cité, mais définir plutôt un modèle idéal à partir duquel penser une transformation
profonde de la société civile. La tentative de Platon s'inscrit dans une démarche philosophique
plutôt que dans une démarche strictement politique : ce qu'il faut avant tout changer sont les
concepts avec lesquels on pense la politique, et ce changement doit être le plus radical possible.
Cela n'empêche toutefois pas de poser la question de savoir si l'État idéal, tel qu'il décrit dans la
République, peut être enfin réalisé ; or, selon J. Annas, « Platon veut que nous lisions la République,
non comme une fiction divertissante, mais comme quelque chose qui doit affecter notre manière
de vivre ; à cette fin, il lui faut montrer que la cité juste, la société des hommes bons, n'est pas
impossible en principe ; en réalité, il juge cette éventualité peu probable à courte échéance,
puisque l'homme vraiment juste et intelligent est celui qui sera le plus probablement corrompu
par la société. Tout ce que peut montrer Platon, c'est qu'il est en principe possible, quoique peu
probable dans la pratique, de rompre le cercle. L'État juste demeure plus efficace comme idéal
destiné à inciter les individus à la vertu, que comme modèle d'une société réelle » [7]. Et c'est en
effet sur ce double registre, à la fois philosophique et politique, qui est construite toute la
République, dans laquelle la démarche idéale de la pensée (théorie de la connaissance, formes de la
vertu) sert toujours à définir un cadre de réflexion ayant comme objet principal la constitution de
l'État juste. Cela devient tout à fait évident dans les livres centraux de la République (VI-VII), dans
lesquels Platon illustre les principes les plus importants et les plus connus de sa pensée, c'est-à-
dire la « théorie des Formes », la notion du « Bien », le mythe de la « Caverne » et la
« dialectique ». C'est à travers ces concepts que Platon fonde et justifie la méthode philosophique
en tant que connaissance absolue de toutes les formes idéales de l'être, dont la première par
hiérarchie ontologique est représentée par le Bien. En utilisant le mythe de la caverne, Platon
nous montre comment la connaissance philosophique est un processus progressif de libération
vers de formes de compréhension de plus en plus éclairées ; l'homme qui, grâce à la dialectique,
parvient à se libérer des contraintes de l'expérience ordinaire, atteint, au terme de son chemin (la
sortie de la caverne), une condition existentielle fondée sur une connaissance impersonnelle et
contemplative du Bien suprême. Or, J. Annas nous fait justement remarquer comment cela
représente une contradiction au sein du système platonicien de la République ; en effet, l'objectif
de l'ouvrage est de définir, dans un cadre bien précis - l'État -, ce qu'est l'homme juste, tandis que,
dans les livres VI-VI, Platon nous indique une démarche contemplative et idéale de connaissance,
qui sert à son tour à fonder la compréhension de l'homme juste. Nous avons ainsi affaire à deux
conceptions de la justice : celle qui relève d'une pratique à l'intérieur d'une cité juste, et celle qui
relève d'une connaissance juste des formes idéales de l'être. De l'avis de J. Annas, cette
contradiction ne remet pas en cause la suite de l'argumentation (livres VIII, IX) concernant le
sens et la valeur de la justice dans la cité, car elle témoigne plutôt d'un glissement dans le procédé
théorique de Platon, dû en particulier à sa prédilection pour des formes de connaissance et
d'éducation abstraites et contemplatives (les mathématiques et la dialectique).
En effet, dans les derniers livres de la République, Platon reprend le développement du thème de la
justice dans le cadre de la discussion sur l'État juste, afin de montrer que « la raison d'être d'un
État est d'intégrer ses membres à une unité politique et culturelle qui fasse ressortir le meilleur de
chacun, parce que chacun sera assuré d'avoir la place qui convient le mieux à ses talents » [8]. De
cette manière, la justice se révèle comme « un agencement de l'âme qui voit le jour quand toutes
les parties de l'âme d'une personne font ce qui est approprié dans des conditions
convenables » [9]. L'homme juste est celui dont l'action obéit à certains principes d'harmonie et
de raison entre ses différentes parties de l'âme, principes qui ont comme conséquence
d'engendrer en lui le plaisir et le bonheur. Et en même temps, l'État juste est le contexte qui
permet le déploiement complet des facultés rationnelles de l'homme, de manière que « Platon

finit par dire qu'il importe peu que l'État idéal juste ne soit qu'un modèle "dressé dans le ciel" ; ce
qui compte, c'est le rôle qu'il joue pour faire advenir la justice dans l'individu » [10].
Pour J. Annas, la réflexion philosophico-politique de Platon nous entraîne vers une conception
radicale de la justice et de l'éthique, dans laquelle il est question non pas d'une adhésion aveugle
et irréfléchie à des règles et à des normes morales abstraites et vides, mais, bien plus
profondément, d'une forme de pratique enracinée dans le réel et capable d'agir directement sur
l'individu. La justice nous fait comprendre qu'il vaut mieux agir en suivant les lois de la raison et
de l'intelligence (la meilleure partie de nous-mêmes), en évitant tous les actes qui peuvent nuire
ou dérégler notre individualité ; comme le dit J. Annas, l'objectif de Platon dans la République
« est de montrer que la justice est une exigence intelligible faite à la nature humaine, qu'elle est
conforme aux potentialités dont nous disposons pour mener une vie créative et épanouissante, au
lieu de celle que nous aurions probablement si nous consacrions nos potentialités à suivre un
ensemble arbitraire d'exigences extérieures. La justice m'apportera une vie satisfaisante - si je
fonctionne bien comme le devrait faire tout être humain » [11].
L'interprétation de J. Annas nous permet de comprendre comment la République de Platon, si
souvent considéré comme un texte purement philosophique et très éloigné des problématiques
réelles de son temps, est en réalité un véritable dispositif conceptuel placé au cœur de la vie
politique et culturelle de la cité d'Athènes, dans lequel Platon s'interroge sur des questions qui
mettent directement en jeu l'individu et son rapport à la communauté : le sens et la valeur des
décisions collectives vis-à-vis des pratiques singulières, l'apport de chacun à la constitution d'un
bien commun, la relation entre les formes des savoirs partagées (l'éducation) et les formes de
connaissance spécialisées (les mathématiques, la philosophie). L'ouvrage de Platon peut donc être
considéré non seulement comme un système théorique qui fonde et justifie une démarche
particulière de connaissance (la philosophie), mais aussi comme un « dialogue » ouvert aux
contributions et aux problématiques les plus riches et les plus fécondes de l'Athènes du lVème
siècle.
En poursuivant sa réflexion consacrée à l'étude de la philosophie de Spinoza (Spinoza contra Hegel,
Avec Spinoza), Pierre Macherey, avec son dernier texte, donne le coup d'envoi pour une relecture
complète des cinq parties de l'Éthique, en commençant par la cinquième partie (De Libertate), dans
laquelle Spinoza achève formellement le système, en ouvrant, en même temps, la démarche
spéculative en direction d'une ontologie de la praxis et de la libération de notre puissance d'agir.
Le De libertate se présente donc comme un système dans un système, puisque Spinoza y reprend
tous les thèmes développés dans les parties précédentes, mais en le considérant dans une
perspective radicalement pratique, fondée sur la notion de puissance, c'est-à-dire de la capacité
dont dispose l'homme pour s'affranchir des limites imposées par la force des affects. « Toutes les
analyses de la cinquième partie de l'Éthique, écrit P. Macherey, sont donc rattachées aux
implications de la notion cruciale de puissance (potentia) qui est inscrite au point crucial de son
intitulé : il s'agit avant tout de savoir ce que peut l'homme, en tant qu'il est naturellement porteur
d'une certaine puissance de connaître et de comprendre, et, en le sachant, d'identifier les
conditions dans lesquelles il est en mesure de faire tout ce qu'il « peut » en vue de sa libération, et
rien au-delà » [12].
Le déploiement de la puissance se réalise toujours à partir de conditions bien déterminées, les
affects ; ce qui signifie que le fondement de De libertate est constitué par le De Servitute (IVème
partie) et que la définition de la liberté en tant que puissance ne peut jamais faire abstraction de
l'expérience réelle dans laquelle l'homme vit et agit. C'est pour cette raison que Spinoza, dans la
préface de la Vème partie, adresse un certain nombre de critiques aux philosophies morales des
stoïciens et de Descartes, car elles représentent un des exemples parmi les plus célèbres d'une
éthique fondée sur la volonté et sur la tentative d'assujettir les affects à une force externe et
indépendante. Ce qu'entend par contre montrer Spinoza est la possibilité de définir une éthique
qui soit « la réalisation naturelle d'une puissance qui se libère en libérant tout ce qu'il est en elle
de faire, en tant que cause déterminée à produire des effets qui soient naturellement ses propres
effets » [13].

L'éthique, telle que Spinoza la conçoit, comme expression de la puissance, n'est pas le résultat
d'une négation ou d'un contrôle des affects à travers la volonté, mais elle est plutôt la
compréhension et l'affirmation des causes réelles qui nous font agir. La liberté est la réalisation
pratique d'une « dynamique tendancielle » ayant comme sujet la puissance : cela veut dire que la
liberté éthique se construit par degrés, à travers le jeu complexe des affects et la stratégie
différenciée des passions. La liberté définie par la puissance n'est pas un état entièrement
nouveau, un saut par rapport à la servitude décrite dans la quatrième partie, mais elle est une
construction graduelle et patiente d'une attitude dans laquelle s'intègrent les composantes les plus
diverses. La réalisation complète de la puissance - la vertu -, est le résultat d'une composition
pratique dans laquelle les élans positifs de l'âme sont constamment modérées par les limites et les
obstacles des passions.
La lecture de P. Macherey traverse point par point toute la cinquième partie, en considérant
toutes les articulations et tous les passages décisifs qui, de la condition de servitude de la
quatrième partie, nous amènent jusqu'au déploiement maximal de la puissance comme béatitude
et exercice de la vertu. En analysant d'une manière détaillée toutes les propositions, P. Macherey
nous montre comment, au fur et au mesure qu'il avance, le procédé systématique de Spinoza crée
un réseau conceptuel capable de donner un sens et une direction rationnelle à l'expérience
affective, en permettant ainsi la libération de la puissance pratique sous les formes éthiques de la
vertu et de la béatitude.
Dans les premières vingt propositions de la cinquième partie, Spinoza illustre le processus qui
conduit l'âme à maîtriser l'affectivité à travers une méthode rationnelle capable de produire des
affects nouveaux, plus puissants que les précédents, et grâce auxquels il est possible d'augmenter
notre puissance d'agir. « En ramenant le projet libératoire sur le terrain du possible, Spinoza fait
du même coup comprendre que l'affectivité, qui est une dimension parfaitement naturelle, et
même plus naturelle de toutes, de notre fonctionnement psychique, n'a rien en soi qui doive nous
inquiéter sur le fond : elle n'est nocive que par ses excès incontrôlés ; et c'est là précisément
qu'intervient la connaissance rationnelle » [14].
Et c'est justement dans ce rapport entre affectivité et rationalité que la fonction de l'imagination
se révèle essentielle. En effet, Spinoza nous montre comment le processus de régulation de la vie
affective ne peut pas se réaliser qu'en s'appuyant sur le fonctionnement constructif et positif de
l'imagination. Contrôler les affects ne signifie pas, pour Spinoza, les limiter ou les réprimer, mais
se servir de l'imagination afin d'augmenter notre puissance mentale ; « Il s'agit non pas
d'imaginer moins, écrit P. Macherey, mais au contraire d'insuffler à cette activité une plus grande
énergie, c'est-à-dire d'y appliquer davantage notre puissance mentale, en la pratiquant de
manière moins distraite et inattentive, c'est-à-dire moins mécanique » [15]. Il s'agit en effet de
faire en sorte que l'imagination cesse de se représenter les choses comme libres, donc en tant que
sources de doute, et les considère par contre comme nécessaires, autrement dit comme parties du
réseau conceptuel construit par l'âme dans son effort de connaissance. Or, « par cette stratégie
concertée, l'âme est mise sur la voie d'une complète réorganisation de son fonctionnement, allant
dans le sens d'un renforcement de son activité, puisque sont progressivement écartés les obstacles
qui freinent son activité. Sont ainsi installées les procédures d'une libération mentale conduisant
l'âme vers des formes d'expression maximale de sa puissance propre, qui est la puissance de
penser » [16].
Cela ne veut pas pour autant dire que le processus de « libération » concerne seulement les idées
de l'âme : même le corps doit être compris dans la stratégie progressive de rationalisation de la
puissance d'agir. C'est pour cette raison que Spinoza affirme qu'il est nécessaire de donner au
corps des règles de vie capables de seconder et de soutenir les activités de l'âme. La fin de cette
« éducation » consiste à parvenir à une conduite active de l'âme et du corps, fondée sur la joie qui
découle de la connaissance rationnelle de nos affects. En d'autres termes, il faut, selon Spinoza,
que nos actions et nos activités prennent le dessus sur nos expériences négatives du passé,
toujours dans le perspective d'un élargissement maximal de notre capacité d'agir. Le résultat est
que l'âme, « au terme de ce processus dynamique, considère à la fois un maximum de choses, en

associant entre elles toutes les images de choses possibles : alors elle est en mesure de rapporter
tout ce qui lui arrive, en tant qu'elle est idée d'un corps, à l'idée de Dieu, c'est-à-dire à l'idée de
tout ce qui existe par la seule nécessité de sa nature » [17].
Spinoza n'entend pas démontrer, avec son argumentation, l'existence de Dieu, mais plutôt
illustrer le processus qui conduit l'âme et le corps à une compréhension de la nécessité de la
substance, et cela à travers une connaissance de plus en plus rationnelle et approfondie de la vie
affective. C'est pour cela que Spinoza affirme, dans la proposition XV, que ce mouvement conjoint
de l'âme et du corps nous conduit à un amour envers Dieu, parce que Dieu n'est pas représenté à
partir d'une démarche abstraite et idéale, mais « atteint aux prix d'une procédure extensive,
d'allure non pas déductive mais inductive, qui, sans quitter le terrain de l'imagination et de
l'expérience, finit par intégrer la représentation de toutes les cause extérieures dans celle d'une
cause unique, vers laquelle l'âme oriente progressivement toutes ses préoccupations affectives,
dans une perspective qui, jusqu'au bout, reste celle de l'amour envers une chose » [18].
Cette première partie du De Libertate (Prop. XX.) s'achève avec la définition d'une ontologie
collective, c'est-à-dire d'une ontologie dans laquelle la pratique individuelle est associée à la
pratique générale des autres individus, dans l'effort commun de comprendre rationnellement les
affects. Cela veut dire que, en joignant l'exercice de l'affectivité à l'amour de Dieu, il possible de
construire une expérience large et partagée, dans laquelle le perfectionnement individuel de la
puissance d'agir se lie d'une manière intense et profonde au perfectionnement collectif et
commun, afin de créer un contexte interindividuel fondé sur l'affirmation singulière de la liberté
et de la joie.
Dans la deuxième partie du De Libertate, Spinoza laisse apparemment de côté la tractation de la
vie affective pour se concentrer directement sur la puissance de l'âme. Et cette considération de la
puissance de l'âme se dépolie autour de deux notions fondamentales : l'éternité et la connaissance
de troisième genre [19]. Comme le montre clairement P. Macherey, ces deux notions
correspondent à l'extension maximale de la puissance cognitive de l'âme, sans pour autant
compromettre sa dimension affective. En analysant les propositions 21-23, dans lesquelles il est
question de la vie éternelle de l'âme, P. Macherey affirme que « il y a une véritable expérience de
l'éternité, et celle-ci est quelque chose de l'âme elle-même, qui touche à son essence... L'éternité à
laquelle l'âme accède par cette expérience est une éternité présente, éprouvée, non sous la forme
d'une réminiscence ou d'une espérance, au passé ou au futur, mais directement, à travers la saisie
adéquate de son objet » [20]. L'éternité dont parle ici Spinoza n'est pas une notion temporelle, elle
est plutôt l'appréhension parfaite et adéquate d'une nécessité (Dieu), l'identification avec un objet
qui n'est ni possible ni contingent.
Cette appréhension est justement le troisième genre de connaissance, lequel, selon P. Macherey,
se présente comme une pratique cognitive qui nous permet de comprendre que Dieu et les choses
singulières sont une seule et même chose ; « comprendre Dieu, ce n'est précisément rien d'autre
que cela : c'est pousser notre effort de compréhension des choses singulières jusqu'au point où
cette compréhension s'identifie complètement à celle de la nature divine dont toutes ces choses
dépendent et dont elles sont les expressions nécessaires » [21]. La connaissance de troisième
genre est la réalisation complète de la puissance de l'âme, elle correspond pleinement à la
dynamique progressive et tendancielle du conatus ; elle appartient donc à la nature même des
choses, et elle n'est pas une d'expérience mystique, située au-delà de nos capacités et de nos
possibilités. Le troisième genre de connaissance permet ainsi à l'âme de parvenir à l'amour
intellectuel de Dieu, grâce auquel elle participe directement à l'éternité et à l'infinité de Dieu,
« c'est-à-dire qu'elle se comprend et s'affirme comme la figure concrète, limitée et déterminée, de
cette infinité. Ainsi est réalisée une synthèse complète du fini et de l'infini » [22].
L'extension maximale de la puissance de connaître conduit l'âme à une unité profonde avec la
puissance infinie de Dieu : en connaissant les choses singulières dans leur nécessité, nous aimons
en même temps Dieu, parce que nous comprenons qu'il est la cause effective de tout ce qui se
 6
6
 7
7
1
/
7
100%