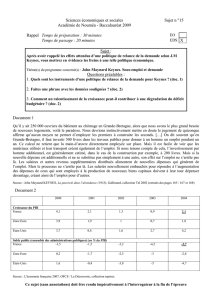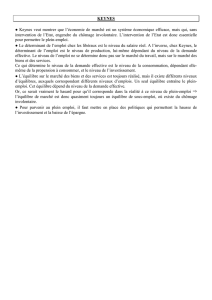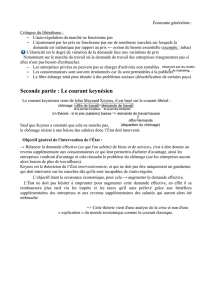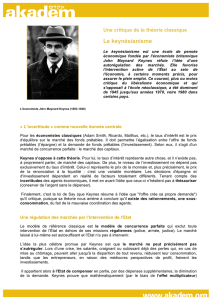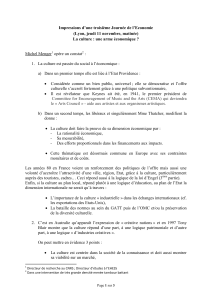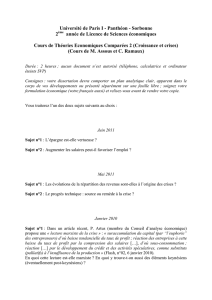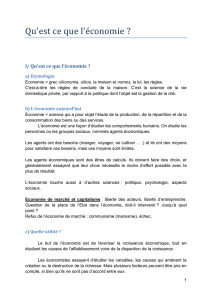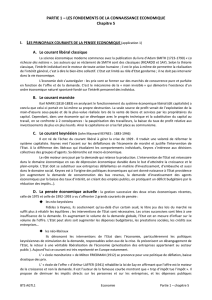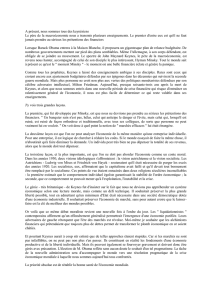Controverse Keynes/Rueff sur les causes de l`abandon de l`étalon

1
La controverse entre Keynes et Rueff sur les causes de l’abandon de l’étalon-or
en Grande-Bretagne en septembre 1931
Antoine Autier
1
Université Paris 8 Saint-Denis – LED
Septembre 2008
INTRODUCTION
Pour reprendre le propos de Barry Eichengreen (1997, p. 102), « la toile de fond pour
comprendre la chute de l’étalon-or » dans les années 1930 est connue. Elle a pour point de
départ la crise du Crédit Ansalt en Autriche. La rumeur de pertes plus importantes que celles
annoncées par la plus grande banque de dépôts du pays conjuguée aux difficultés d’une
coordination internationale efficace pour enrayer la crise entraîne une liquidation massive des
dépôts en Autriche et des transferts de fonds hors du pays. L’Autriche choisit de défendre son
système bancaire et doit se résoudre à abandonner l’étalon-or. Afin de prévenir le retour de
l’hyperinflation
2
qui avait touché le pays au début des années 1920, elle met en place un
contrôle des changes. La crise du système bancaire autrichien se propage à celui de
l’Allemagne en raison de fondamentaux économiques relativement proches entre les deux
pays bien que les interactions entre les deux systèmes bancaires soient faibles
3
. L’Allemagne
voit également les capitaux investis sur son territoire le quitter. A son tour, elle ne peut
1
Doctorant, LED – Université Paris 8 Saint-Denis. Email : antoine.autier@univ-paris8.fr
2
Pour Eichengreen, notamment, on parle d’hyperinflation quand l’augmentation générale des prix est supérieure
à 50 % par mois.
3
Eichengreen (1997, p. 104) sur ce point précis : « Bien que les investissements du Crédit Ansalt en Allemagne
fussent insignifiants et que les dépôts allemands à Vienne fussent limités, les systèmes bancaires allemands et
autrichiens se ressemblaient sur plusieurs points importants. Les banques allemandes, comme leurs homologues
autrichiennes étaient largement engagées dans l’industrie et subissaient des pertes importantes à cause de la
récession. La crise du Crédit Ansalt signala donc aux observateurs la vulnérabilité respective des systèmes
bancaires. […] A partir du moment où la crise autrichienne se déclara, aussi bien les détenteurs de dépôts
nationaux que de dépôts étrangers retirèrent leurs liquidités déposées dans des banques allemandes. »

2
compter sur une coopération internationale visant à l’aider à défendre ses réserves, en
particulier en raison du refus français de reconsidérer les modalités des paiements allemands
au titre des réparations de guerre. Le 13 juillet 1931, l’Allemagne abandonne l’étalon-or.
Au cœur du système économique international, la Grande-Bretagne est plus
particulièrement touchée par les difficultés de l’économie mondiale. La chute du commerce
international, amplifiée par la mise en place progressive de tarifs douaniers, et l’impossibilité
de transférer à partir de 1931 les intérêts provenant de l’Allemagne, de l’Autriche et de la
Hongrie, engendrent une détérioration de la balance commerciale britannique ainsi que de sa
balance des invisibles. Ayant un système bancaire solide, la Grande-Bretagne augmente
fortement son taux d’escompte afin de défendre ses réserves
4
. Seulement, en raison de crises
sociales profondes liées au niveau élevé du chômage et aux autres conséquences de la
déflation, et de la dégradation du solde budgétaire, le maintien d’un taux d’escompte élevé est
jugé peu crédible par les acteurs financiers. Les ventes de livres sterling se mettent à croître.
Etouffée, la Grande-Bretagne suspend l’étalon-or le 19 septembre 1931 pour définitivement
quitter le régime monétaire deux jours plus tard
5
.
Si cet enchaînement des faits est reconnu par tous, il ne permet pas de mettre en exergue
les événements antérieurs en Grande-Bretagne ayant conduit son économie à une situation de
fragilité. La séquence brièvement évoquée n’est que la cause immédiate de la fin de l’étalon-
or en Grande-Bretagne et non la cause profonde dont l’analyse doit pourtant être
recherchée du fait de son importance. Il convient en effet pour les dirigeants des pays encore
membres du « club » de l’étalon-or de s’intéresser à cette cause profonde afin de mesurer les
conséquences du maintien du régime monétaire sur leur territoire. Doit-on attribuer la fin de
l’étalon-or en Grande-Bretagne à un défaut intrinsèque du régime monétaire tel qu’il fut
rétabli en 1925 ? Dans ce cas, ce défaut entraînerait mécaniquement, à terme, la fin de
l’étalon-or dans les pays le pratiquant encore. Doit-on l’attribuer à une incapacité propre à la
Grande-Bretagne à ne pas avoir su permettre les conditions du maintien du système ? Dans ce
cas, les pays devraient éviter de pratiquer des politiques se rapprochant de celles qui furent
pratiquées par les autorités britanniques depuis son retour à l’étalon-or.
4
Déjà à un niveau de 2,5 % le 16 juillet 1931, le taux d’escompte monte à 3,5 % le 23 juillet puis à 4,5 % le 30
juillet alors que l’Angleterre connait un chômage de 20 %.
5
Cf. Eichengreen (1997, p. 102-120) pour plus de précisions sur les causes de la crise du Crédit Ansalt et sur le
processus de la chute de l’étalon-or.

3
Deux conceptions totalement différentes s’opposent alors concernant la nature de la
cause profonde ayant conduit à la fin du régime monétaire en Grande-Bretagne. La première
met en évidence le défaut du système et a très longtemps été minoritaire et marginalisée au
sein de la sphère économique. Pourtant, alors que dès la fin de la Première Guerre mondiale,
comme le réaffirmera le rapport Cunliffe en 1923, le retour à l’étalon-or est programmé,
Keynes critique ardemment l’intention du gouvernement britannique de le faire sur la base de
la parité d’avant-guerre – à savoir 3 livres 17 shillings 10,5 pence l’once d’or. Il tente de
montrer quelles contraintes, dans un monde profondément bouleversé, seraient engendrées par
pareil fait et quelles menaces nouvelles pèseraient sur la société britannique. En septembre
1931, bien que réjoui par l’abandon des « chaînes d’or » et la fin de « la période romantique »,
Keynes ne peut que regretter de ne pas avoir été entendu. Alors que les autorités françaises
s’enquièrent d’avis sur le changement brutal et les conséquences de la nouvelle structure
monétaire internationale, Jacques Rueff, économiste réputé, en particulier dans le monde
politique, défend la seconde conception proposée, celle qui souligne que les erreurs dans la
gestion de l’économie britannique ont causé des désagréments rendant inévitable l’abandon de
l’étalon-or suite au choc de la crise du Crédit Ansalt.
Il paraît intéressant de confronter les conceptions défendues par Keynes et Rueff. Au
cours de notre développement nous mettrons en évidence plusieurs éléments indiquant cet
intérêt. Dans la première partie nous mettrons en avant l’argumentation proposée par Rueff
pour expliquer les raisons pour lesquelles l’étalon-or ne pouvait subsister en Grande-
Bretagne. La seconde exposera la position de Keynes. Les bases seront ainsi posées pour que
nous puissions, dans la troisième partie, évoquer les différences fondamentales entre les
positions exprimées et nous tâcherons, en évoquant un débat plus ancien entre les deux
auteurs, de donner une perspective nouvelle à celui concernant la fin de l’étalon-or en Grande-
Bretagne.
1) Les causes de la chute de l’étalon-or en Grande-Bretagne selon Rueff
Rueff pressent au moment de la chute de l’étalon-or en Grande-Bretagne que le principe
même de ce régime monétaire va être remis en cause sur le plan international et que lui seront
attribués en grande partie les maux constatés. Or il considère qu’il ne faut pas imputer à
l’étalon-or la responsabilité des troubles économiques et sociaux qu’elle a rencontrés depuis

4
le rétablissement du régime monétaire en 1925. Pour lui, l’abandon de l’étalon-or n’est pas le
fait d’une « fatalité contraire » mais « le résultat de quelques erreurs, peu nombreuses, mais
fondamentales, commises dans la gestion de l’économie anglaise » (Rueff, 1931b, p. 299).
Avant de s’interroger sur les conséquences de la nouvelle configuration du système monétaire
international, il s’attache à mettre en évidence plusieurs erreurs ayant causé la décision de la
Grande-Bretagne dont deux nous semblent fondamentales et particulièrement importantes
dans la perspective de la confrontation de ses idées avec celles de Keynes. La première erreur
est liée à l’application d’une mesure sociale, la seconde à la politique menée par la Banque
d’Angleterre.
La « dole » et ses conséquences sur le chômage anglais
La question du chômage en Grande-Bretagne a fait l’objet de deux articles majeurs de
Rueff et font partie de ceux ayant eu les échos les plus retentissants. Le premier, Les
variations du chômage en Angleterre
6
, parait en 1925. Se basant sur des séries statistiques
allant de 1919 à 1925, Rueff montre que les variations du chômage s’expliquent sur la base du
salaire réel. Le second, L’assurance chômage : cause du chômage permanent
7
, paraît en
1931, prolonge les séries statistiques du premier jusqu’en 1930, et pointe la responsabilité de
l’assurance-chômage dans la persistance d’un chômage de masse en Angleterre. Tout part
donc d’une « étonnante corrélation entre les variations du chômage en Angleterre et celles du
salaire » (Rueff, 1931, p. 212). Sur la période considérée, « il a existé en Angleterre, entre le
nombre des chômeurs et le rapport du niveau des salaires au niveau général des prix, une
relation permanente, toute variation de la valeur de ce rapport entrainant sans délai une
variation concomitante de l’indice du chômage. On est, par là, fondé à penser que la cause
immédiate du chômage généralisé […] consiste dans le défaut d’adaptation des salaires au
niveau général des prix » (ibid., p. 213)
8
.
6
« Les variations du chômage en Angleterre », Revue Politique et Parlementaire, 32, décembre 1925, pp. 425-
437.
7
« L’assurance-Chômage : cause du chômage permanent », Revue d’Economie Politique, 45, mars-avril 1931,
pp. 211-251. Notons que cet article n’est pas signé « Jacques Rueff ». En effet, Jacques Rueff étant au moment
où est publié cet article Attaché financier à l’ambassade de France à Londres, il lui était interdit de publier un
article en relation avec l’Angleterre. Pour Fitoussi (1987, p. 854), « [Cet article] constitue l’exposé le plus
complet, le plus systématique, le plus pédagogique aussi de ce que Keynes appellera la « théorie classique »,
l’archétype de la théorie qu’il s’attachera à réfuter dans la Théorie Générale. »
8
Rueff précise que le coefficient de corrélation des deux valeurs est de 0,95 ; coefficient calculé par
l’économiste anglais Sir Josiah Stamp sur la période 1919-1925.

5
La période des années 1920 est marquée par une forte baisse du niveau général des prix.
Cette baisse a été accentuée en Grande-Bretagne par le processus de restauration de l’étalon-
or sur la parité d’avant-guerre. Or à partir de 1921 on constate qu’en Angleterre la variation
de l’indice des salaires devient supérieure à celle de l’indice des prix et que le chômage croît
brusquement. Alors qu’à partir de ce moment là l’indice des prix, qui a fortement chuté depuis
le second trimestre de 1920, continue une lente et faible chute (une très légère hausse est tout
de même constatée en 1924), l’indice des salaires, toujours supérieur à celui des prix, décroît
également. Mais à partir de la fin de l’année 1922, se produit en Angleterre, selon Rueff
(ibid., p. 217) « un fait d’une immense importance : l’indice des salaires cesse de varier ». Il
semble en effet que l’indice se heurte à une valeur plancher. Il convient donc de faire en sorte
que le salaire réel diminue pour que le chômage fasse de même. Agir sur le niveau des prix
pour qu’ils remontent paraît impossible dans la mesure où à l’échelle internationale les prix-or
tendent à baisser et que la Grande-Bretagne se doit de respecter la parité-or de la livre. Une
baisse du salaire monétaire est donc indispensable pour faire baisser le chômage. Or Rueff
considère que les autorités politiques anglaises ont mis en place une mesure qui empêche la
réalisation du mécanisme qui permettrait une baisse du salaire réel.
« Depuis 1911 […] il existe en Angleterre un système d’assurance-chômage, qui donne
aux ouvriers sans travail une indemnité connue sous le nom de « dole ». […]
La conséquence d’un pareil régime a été d’établir un certain niveau minimum de salaire, à
partir duquel l’ouvrier préfère toucher la « dole » plutôt que de travailler pour un salaire qui ne
lui vaudrait qu’un excédent assez faible sur la somme qu’il reçoit comme chômeur. Il semble
bien qu’au début de l’année 1923 les salaires qui suivaient en Angleterre la baisse des prix soient
venus buter contre ce niveau d’équilibre. Ils se sont brusquement arrêtés dans leur chute et
depuis ce moment ils ont pratiquement cessé de varier.
En fait, d’ailleurs, le niveau des salaires est pratiquement celui qui résulte des contrats
collectifs de travail; mais il est évident que la stricte obédience à des contrats laissant subsister
un nombre important de chômeurs n’aurait pu être maintenue sans subvention aux ouvriers sans
travail.
Ainsi, la « dole » a surtout pour effet d’assurer indéfiniment le maintien de la discipline
syndicale. C’est elle qui est l’instrument essentiel de la stabilisation des salaires à un niveau
entièrement indépendant du niveau des prix, c’est elle qui est, par là, la cause du chômage
permanent. »
9
9
Rueff (1931a, p. 222).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%