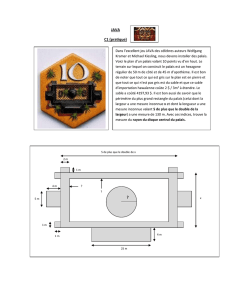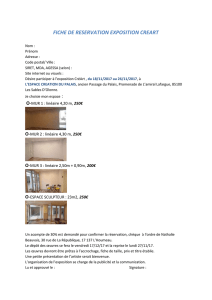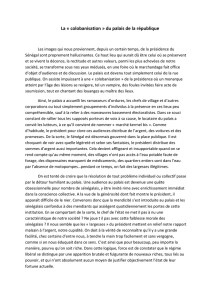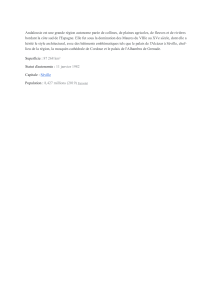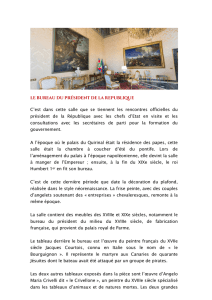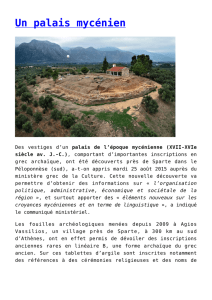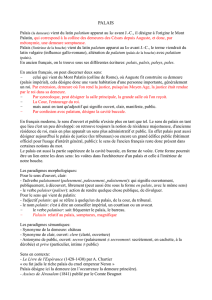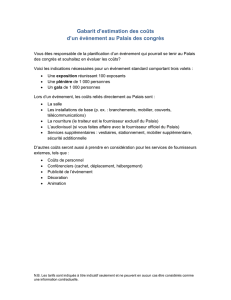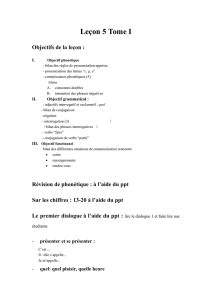Resume_1

1
Résumé
Notre recherche de doctorant aborde l’architecture royale en Mésopotamie à la fin du
bronze ancien et au bronze moyen (de l’époque de la IIIème dynastie d’Ur : 2112- 2004 av. J.-
C. à l’époque paléo-babylonienne : 2004-1595 av. J.-C.). C’est durant cette partie de l’âge du
Bronze que les activités de construction de grands bâtiments publics ont été les plus
importantes et qu’elles sont les mieux documentées par les fouilles archéologiques
La thèse comporte deux volumes dont le premier donne le texte et le second est
destiné aux figures. Le volume du texte se compose de trois parties : la première concerne
l’analyse architecturale des palais de la Mésopotamie du Sud et comporte cinq chapitres
consacrés respectivement aux palais d’Ur, aux différentes phases des palais des dynasties
amorrites de Tell Asmar, au palais et bâtiment 50 de Larsa et au palais de Sinkashid d’Uruk.
Avant de faire l’analyse architecturale de chaque bâtiment, on a fait une présentation générale
du site pour mettre en évidence l’histoire, la situation géographique, la fouille et l’urbanisme
de la ville comportant le monument royal. On a adopté la même manière de procéder dans la
partie suivante. On a insisté plus particulièrement, dans la première partie, sur le palais de Tell
Asmar qui a connu une longue durée d’utilisation (2070-1850 av. J.-C.) durant laquelle il a
fait l’objet de modifications, que l’on peut analyse à travers six phases architecturales. Ces
phases peuvent être regroupées en deux étapes principales. La même méthode d’analyse peut
être appliquée dans tous les chapitres de cette partie (histoire de la fouille, secteurs et
fonctions des palais) avec de petites différences : les nouvelles recherches du palais de Tell
Asmar s’appuient sur les sceaux et les scellements, nous permettant de révéler la fonction
économique et administrative de diverses phases de cet édifice.
La seconde partie est identique à la précédente quant à la méthode (analyse
architecturale) mais, cette fois, on traitera les palais du nord de la Mésopotamie. Le nombre
de chapitres de cette partie est plus important que celui de la première partie et comporte sept
chapitres : grand et petit palais royal de Mari, palais A de Tuttul, palais d’Assur, palais de
Samsi-Addu et de Qarni-Lim de Tell Leilan, et palais de Tell al-Rimah. D’un point de vue
scientifique, le grand palais de Mari est plus important que les autres palais de cette partie, du
fait de sa conservation, meilleure que celle des autres palais, et parce qu’il comportait des
aménagements permettant de mettre en évidence ses fonctions, ce qui nous aidera à mettre en
lumière une image de l’architecture royale de la fin du troisième millénaire et du début du
second.

2
Dans la dernière partie, on a proposé une étude comparative entre les palais
mésopotamiens construits de la période d’Ur III à l’époque paléo-babylonienne. Des
comparaison sont aussi faites entre ces derniers palais et ceux appartenant à la même région
(Mésopotamie) mais datant d’autres périodes de l’âge du bronze (dynasties archaïques et
deuxième moitié du second millénaire). On a aussi proposé d’autres études comparatives entre
les palais mésopotamiens constuits durant cette période et ceux relevant des civilisations
voisines, ainsi qu’entre ces palais mésopotamiens et les grandes maisons de la même région et
de la même époque. Cette dernière partie est donc organisée en cinq chapitres : techniques de
constructions, relation entre le monde du palais et le monde de l’extérieur, fonctions
principales des palais mésopotamiens de l’âge du bronze, étude comparative des palais
mésopotamiens datant d’Ur III à l’époque paléo-babylonienne et des autres palais orientaux
de l’âge du bronze et étude comparative des palais mésopotamiens et des maisons privées. Le
chapitre qui parle des techniques de construction traite les questions importantes (les
matériaux de construction, les différents éléments constitutifs des palais mésopotamiens,
l’éclairage et l’étage) qu’on n’a pu aborder que rapidement dans les deux premières parties :
on les a donc repris ici en détail, de façon synthétique. Dans les trois derniers chapitres, on a
parfois utilisé des titres similaires à ceux employés dans les deux premières parties mais ces
études, dans la troisième partie, sont liées à la méthode comparative et prennent en compte de
nouveaux bâtiments (palais et maisons) qui n’ont pas été étudiés dans la première et la
deuxième partie.
Mots-clefs : Mésopotamie, architecture publique, architecture domestique, palais, maison,
ville, roi, cour, appartement, étage,
1
/
2
100%