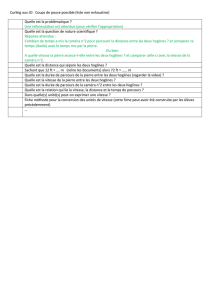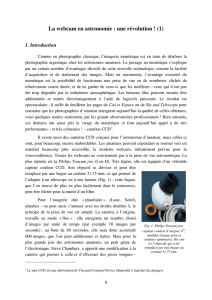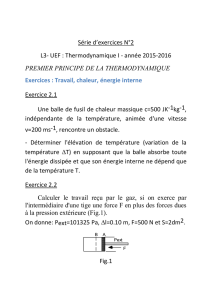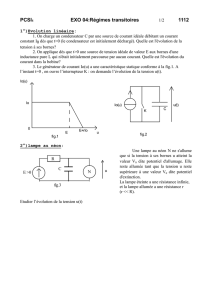Mesures d`étoiles doubles : un point de vue pratique

Speckle Interferometry with mid-sized amateur telescope: why not?
Florent LOSSE
S.A.F. Commission des Etoiles Doubles
This talk shows how using interferometry methods provide routinely accurate measurements
with a mid-sized amateur telescope. It is illustrated by the implementation of a homemade
410mm telescope dedicated to double stars measurements and highlights the most important
practical tips. The results of a 1000 measurements campaign are briefly discussed.
As a part of the solutions used during this campaign, a focus is made on the new version of
Reduc software including now interferometry reduction routines. This version will be released
to the public after the meeting.
Interferometría con un telescopio amateur: ¿por qué no?
Florent LOSSE
S.A.F. Commission des Etoiles Doubles
Esta comunicación muestra cómo los métodos de interferometría permiten la obtención
rutinaria de medidas de calidad con un telescopio amateur. Este hecho se ilustra mediante el
uso de un instrumento de 410 mm de diámetro dedicado a la medición de estrellas dobles y se
resaltan los aspectos prácticos más importantes. Los resultados de una campaña de 1000
medidas son brevemente discutidos.
Como parte de las soluciones utilizadas en el curso de esta campaña, es remarcable la nueva
versión del programa Reduc que ahora incluye técnicas de reducción de medidas
interferométricas. Esta versión estará disponible públicamente después del meeting.
L'interférométrie des tavelures avec un télescope d'amateur: pourquoi pas ?
Florent LOSSE
S.A.F. Commission des Etoiles Doubles
Cette communication montre comment les méthodes de l'interférométrie permettent
l'obtention routinière de mesures de qualité avec un télescope d'amateur. Elle est illustrée par
la mise en oeuvre d'un instrument de 410 mm de diamètre dédié à la mesure d'étoiles doubles
et met en évidence les aspects pratiques les plus importants. Les résultats d'une campagne de
1000 mesures sont brièvement discutés.
Dans le cadre des solutions utilisées au cours de cette campagne, l'accent est mis sur la
nouvelle version du logiciel Reduc qui inclut maintenant les techniques de réduction des
mesures interférométriques. Cette version sera disponible publiquement après le meeting.

Introduction
L'interférométrie des tavelures est depuis longtemps l'un des outils préférés des professionnels
pour mesurer les étoiles doubles. De très rares amateurs utilisent cette technique lors de
missions dans des observatoires (fig.1) mais aucun ne semble s'en servir de façon routinière
avec une instrumentation 'classique' d'amateur.
On peut distinguer deux grandes classes parmi les instruments mis en oeuvre quotidiennement
par les amateurs:
- ceux dont la limite de résolution est la plupart du temps fixée par le diamètre
- ceux dont la limite de résolution est quasi-systématiquement affectée par l'atmosphère
La frontière entre les deux catégories dépend évidemment des conditions d'observation, elle
se situe généralement aux environs de 20 à 30 cm de diamètre.
Lorsque la turbulence limite la résolution, l'imagerie classique échoue à fournir des images
mesurables. L'interférométrie des tavelures apporte t'elle alors une solution aux amateurs
comme elle le fait sur les grands instruments ? La réponse est oui. Le but de cette discussion
est de vous faire partager d'un point de vue résolument pratique le cheminement qui justifie
cette réponse.
L'observatoire et le télescope
Lorsque j'ai construit mon télescope de 400mm (fig. 2) en 2008 en remplacement de l'ancien
T200, mon but était d'obtenir des mesures sur des étoiles doubles relativement faibles (mv ~
11,12) et dans une tranche de séparation de l'ordre de 1" à 3". Compte tenu des conditions
habituelles sur le site, je ne pensais pas à l'époque pouvoir obtenir régulièrement des mesures
de qualité sur des séparations plus faibles. L'observatoire est en effet situé à proximité d'un
fleuve important et à une altitude de 20 mètres, des conditions loin d'être idéales pour la haute
résolution.
L'instrument est un télescope de Newton, le miroir principal possède un diamètre optique de
408mm pour une distance focale de 2052.5mm. Le miroir secondaire présente un petit axe de
72.5mm. Les premières lumières profitent d'un ciel exceptionnellement calme et le télescope
montre que le pouvoir de résolution angulaire peut être atteint (fig.3).
Evidemment c'est très différent dès que les conditions normales sont rétablies et que
scintillation, agitation et étalement reprennent leur symphonie.
2009 : mesures avec une caméra Audine
La première caméra utilisée sur le T400 est une caméra Audine (fig. 4) équipée d'un capteur
KAF400 (matrice 768x512 pixels carrés de 9m de côté). Elle est installée derrière un
amplificateur optique Televue 5x, la distance focale résultante est de 11.96 mètres.
En utilisant l'imagerie classique (sélection manuelle des meilleures images et shift-and-add)
les mesures de couples au-delà de 1"3 sont généralement assez faciles. Avec des couples plus
serrés il faut procéder à des tris sévères pour trouver des images mesurables. Utiliser la
technique du lucky-imaging nécessite d'enregistrer un millier d'images pour avoir quelques
chances de trouver suffisamment d'images correctes. C'est un problème avec l'Audine dont la
cadence de lecture est lente. Obtenir 1000 images exige 40 minutes ! Il y a de quoi décourager
le plus entêté des observateurs.
Le temps d'exposition minimal fixé par l'obturateur de la caméra est de 60ms. C'est trop long
pour figer les mouvements rapides de l'atmosphère et cela réduit encore plus les chances de
trouver des images exploitables en lucky-imaging. On peut parler ici de miracle imaging!

Cependant 60 ms reste suffisamment court pour que l'on perçoive une structure tavelée
brouillée par les mouvements les plus rapides de l’atmosphère. Ces nodules sont formés par
l'assemblage de plusieurs tavelures du au temps d'exposition trop long ainsi à l'absence de
filtrage. Ces "super tavelures" (le terme est emprunté à Christian Buil) portent cependant les
informations essentielles sur la position relative des composantes (fig. 5).
C'est lors de la réduction qu'interviennent les méthodes de l'interférométrie des tavelures avec
plusieurs avantages clés par rapport à l'imagerie classique :
Le traitement par autocorrélation autorise la mesure sur ces images inexploitables avec
un traitement classique
Quelques centaines d'images sont suffisantes, typiquement de 200 à 400 pour obtenir
un autocorrélogramme mesurable. On peut visiter environ 4 couples par heure, de quoi
redonner courage à l'observateur!
Le tri des images s'avère inutile ce qui fait gagner beaucoup de temps pendant la
réduction et ôte également toute part de subjectivité dans le choix des images
Les mesures sont possibles jusqu'aux environs de 0"6 soit deux fois le pouvoir séparateur du
télescope. Travailler en confiance en deçà de cette limite exige par contre d'excellentes
conditions atmosphériques.
2010 : mesures avec une Atik314
En 2010, le télescope est équipé d'une caméra Atik 314L+. Comme l'Audine, elle est très
répandue chez les amateurs. Le capteur possède une matrice de 1392x1040 pixels carrés de
6.45m de côté. Placée derrière l'amplificateur Televue, le système présente une distance
focale résultante est de 11.40 mètres (fig. 6). Cette caméra se montre beaucoup mieux adaptée
au travail sur les étoiles doubles :
Grâce aux pixels plus petits, l'échantillonnage est fin et la distance focale reste
raisonnable
La vitesse de lecture est confortable : 3 à 4 images/seconde en définissant une fenêtre
de 128x128 pixels au centre du capteur.
L’atout majeur est la vitesse d’obturation. Les temps d'exposition sont typiquement de
20 ms pour des étoiles de magnitude 10
Avec ces caractéristiques, on travaille plus près des conditions habituelles de l'interférométrie
des tavelures. Les images sont mieux structurées et les tavelures sont fines. Les performances
s'en ressentent et 70% des mesures s’effectuent entre 0"3 et 1"5.
Les réductions
Toutes les réductions sont réalisées avec une version de Reduc dédiée à l'interférométrie des
tavelures. Elle implémente les fonctions d'autocorrélation, d'intercorrélation et DVA. Les
mesures sont systématiquement effectuées sur l'image d'autocorrélation. L’ambiguïté de 180°
sur l’orientation est levée en créant soit une image d’intercorrélation soit une image composite
lorsque c'est possible (fig.7).
Après le traitement d'une série d'images Reduc fournit l’autocorrélogramme ainsi qu’une série
d’images où ce dernier est traité par la soustraction d'un masque médian afin de mettre les
pics en évidence. Le masque doit être adapté en fonction de la configuration optique. Avec le
T400 à F/D=30, les meilleurs résultats sont obtenus avec des masques de noyau 3x3 et 5x5
(fig.8).
Les principales fonctionnalités de la version publique de Reduc sont présentées dans un autre
partie.

L'étalonnage
L'étalonnage reste la pierre angulaire de toute mesure et c'est sûrement le plus problème le
plus important pour les installations d'amateurs. Le T400 est sur une monture stable et la
caméra reste en place plusieurs mois pendant les campagnes d'observation d'étoiles doubles. Il
m'a paru plus solide de procéder à un étalonnage indépendant plutôt que d'utiliser la méthode
classique des étoiles étalons.
Echantillonnage:
Il est déterminé en trois étapes. Dans la première étape la caméra est placée au foyer primaire
du télescope et on enregistre des séries d'images de champs stellaires comportant des couples
quelconques d'étoiles de magnitudes voisines, séparées de quelques secondes d'arc et
d'orientations variées.
La deuxième étape consiste à refaire des images de ces mêmes couples en configuration de
mesure.
Enfin, tous les couples présents sur les deux séries d'images sont réduits en utilisant une
valeur d'échantillonnage quelconque (différente de zéro!). Chaque couple présente une
séparation df sur les images au foyer et dm en configuration de mesure (càd avec
l'amplificateur de focale). Le rapport dm/df fournit le facteur d'échelle entre les deux
configurations.
En appliquant ce facteur d'échelle on déduit la distance focale de la configuration de mesure.
La taille des pixels et la distance focale du miroir sont parfaitement connues.
L'échantillonnage est calculé avec la formule habituelle et ne dépend que de ces deux
grandeurs physiques connues avec précision. Les données numériques essentielles sont
résumées dans le tableau I.
Tableau I : Données numériques au foyer et en configuration de mesure
Au foyer
Avec amplificateur Televue 5x
Caméra
Focale
Echantillonnage
Focale
Résultante
Echantillonnage
Champ
Audine
2052.5 mm
0"904/px
11.96m
0"1552/px
2'x1.3'
Atik 314L
2052.5 mm
0"648/px
11.40m
0"1167/px
2.7'x2'
Orientation des images:
L'axe est/ouest est déterminé par la méthode des traînées sidérales. La caméra et le train
optique sont installées de façon que le seul mouvement possible soit la translation rectiligne
nécessaire à la mise au point. L'installation restant à poste fixe, l'étalonnage est effectué sur
plusieurs nuits. L'incertitude sur l'orientation de la caméra est de l'ordre de 0°2.
Les résultats
La campagne d'observation s'est déroulée en deux phases. Les résultats sont résumés dans le
tableau suivant II et les mesures détaillées sont publiées dans le n° 75 d'Observations et
Travaux.
Tableau II: Résultats de la campagne d'observation
Période
Caméra
Nuits
Nb de couples
Nb d'orbitales
Phase I
mai/décembre 2009
Audine
75
429
41
Phase II
février/juillet 2010
Atik
63
579
125

138
1008
166
Les histogrammes (fig.9) montrent l'évolution du programme d'observation. En 2009, les
mesures sont d'abord effectuées sur une gamme étendue de séparations afin de valider les
procédures. La réduction par autocorrélation permet de s'affranchir partiellement de la
turbulence. C'est l'époque des "super tavelures". Avec les limitations du matériel les mesures
en dessous de 0"6 restent pratiquement impossibles.
En 2010, le matériel est mieux adapté au travail en interférométrie des tavelures. Le
programme d'observation est spectaculairement décalé vers les plus faibles séparations.
La figure 10 montre la répartition spatiale des o-c obtenus sur les 43 couples orbitaux dont les
orbites sont de grade 1 ou 2.
Conclusion et projets
Après 140 nuits à pratiquer avec ces méthodes, je n'ai trouvé que des arguments favorables à
leur l'utilisation :
La possibilité d'observer chaque nuit claire sans s'inquiéter de la turbulence
L'exploitation optimale de l'instrument
La précision des mesures
Avec un logiciel adapté les procédures de réduction sont rapides et objectives
Au titre des difficultés mais qui ne sont pas des arguments défavorables:
Trouver la bonne distance focale qui permet à la fois de séparer les tavelures et de
conserver assez de lumière
La diffraction atmosphérique: sans filtrage les tavelures s'allongent significativement
lorsqu'on observe au-delà de 25° de distance zénithale
L'étalonnage qui pourrait être délicat pour une installation mobile
Projets :
Travailler avec une distance focale plus importante. Utiliser un échantillonnage tel que le
disque d'Airy couvre 4 ou 5 pixels afin de diminuer les incertitudes aux très faibles
séparations.
Utiliser un filtre avec une bande passante de 100nm centré sur le maximum de sensibilité de
la caméra devrait également permettre de travailler efficacement à de grandes distances
zénithales.
Ce qui est remarquable c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des caméras haut de gamme
ou de dernière technologie pour travailler de façon routinière au pouvoir de résolution. C'est
sûrement la leçon la plus importante que je retiens de cette expérience. Les amateurs qui
possèdent un télescope de 30 à 50 cm de diamètre éprouvent parfois une certaine frustration
de se voir limités par l'atmosphère. L'application des méthodes tirées de l'interférométrie des
tavelures leur offrira les plus grandes satisfactions !
Références:
- Bagnuolo, W.G., 1992, Absolute Quadrant Determinations from Speckle Observations of
Binary Stars, AJ Vol. 103
- Buil, C., 1989, Astronomie CCD. Société d'Astronomie Populaire, Toulouse
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%





![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)