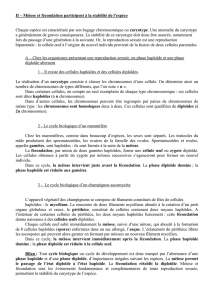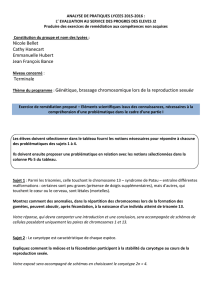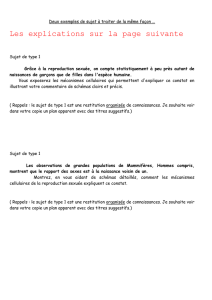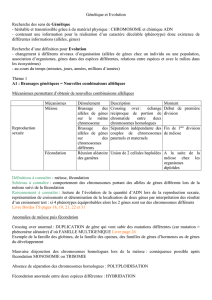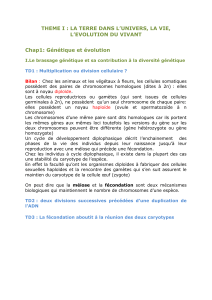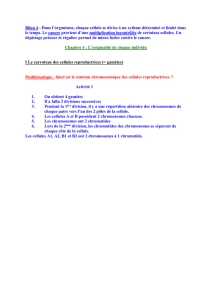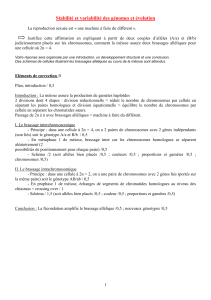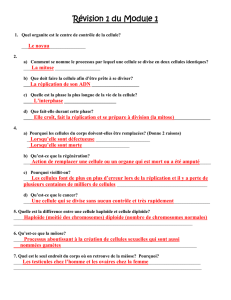dossier génétique ( DOC

PARTIE 2
3ème partie (I - 3 du programme officiel )
STABILITE ET VARIABILITE DES GENOMES
ET EVOLUTION
chapitre I : Les innovations génétiques
Les individus d’une même espèce ont en commun les mêmes gènes. Ils
commandent l’expression de leurs protéines, à l’origine de leur
phénotype. Il existe pourtant un polymorphisme phénotypique au sein
d’une même espèce. Nous verrons comment peuvent apparaître
plusieurs versions d’un gène ( ou allèles )
Au cours du temps, on assiste à une complexification du génome des
êtres vivants . On expliquera comment les gènes ont pu se multiplier au
cours du temps en entraînant l’apparition de fonctions nouvelles .
I LE GENOME D’UNE ESPECE PRESENTE UN POLYMORPHISME .
Le génome de chaque être vivant est constitué d’une molécule d’ADN
portant un certain nombre de gènes. Au sein d’une population, de
nombreux gènes existent sous plusieurs versions, ses allèles qui
différent par leur séquence de nucléotides.
L’existence de ces différents allèles constituent le polyallélisme*. Les
allèles d’un même gène occupent toujours le même emplacement,
appelé locus, sur un chromosome .
II LES MUTATIONS GENIQUES CREENT DE NOUVEAUX ALLELES .
Les différentes mutations
Un allèle provient d’une modification de la séquence nucléotidique du
gène, appelée mutation*.
Les mutations peuvent être ponctuelles* (n’affectant qu’un seul
nucléotide) ou plus étendues.

Les mutations ponctuelles sont de trois types :
- substitution* : changement d’un nucléotide par un autre (présentant
une base différente),
- addition* : insertion d’un nucléotide supplémentaire,
- délétion* : perte d’un nucléotide.
Conséquences des mutations
Les modifications subies par l’ADN peuvent ou non affecter les
polypeptides synthétisés.
Une substitution n’entraînant pas de modification de la séquence
peptidique, du fait de la redondance du code génétique, est une
mutation silencieuse*.
Une substitution entraînant le changement d’un codon sens par un autre
codon sens, qui conduit au remplacement d’un acide aminé par un autre
est :
- une mutation neutre* si elle ne modifie pas la fonction de la protéine
synthétisée,
- une mutation faux-sens* si la fonction de la protéine est modifiée ou
altérée.
Une mutation entraînant le changement d’un codon sens en un codon
non-sens est une mutation non-sens*. Elle introduit un arrêt prématuré
de la traduction et donne une chaîne polypeptidique incomplète.
Enfin, des additions ou délétions d’un nombre de nucléotides non
multiple de 3 constituent des mutations décalantes* qui modifient le
cadre de lecture et donc l’ensemble de la séquence polypeptidique à
partir de la mutation.
III LES DUPLICATIONS GENIQUES CREENT DE NOUVEAUX GENES
Les familles multigéniques

L’évolution s’est traduite par une augmentation de la taille des
génomes, en particulier du nombre de gènes. Un des mécanismes
créateurs de gènes nouveaux a été révélé par l’étude des familles
multigéniques*. Il s’agit d’un ensemble de gènes homologues,
présents dans le génome d’une même espèce et présentant de grandes
similitudes. Ces gènes multiples, qui ne sont pas des allèles (ils
n’occupent pas le même locus), sont interprétés comme le résultat de
duplications* de gènes ancestraux.
Les copies du gène issu de duplications peuvent être transposées en un
autre point du génôme.
L’innovation génétique liée aux duplications
L’évolution ultérieure des copies de gènes est autonome., chaque copie
subissant des mutations ponctuelles indépendamment des autres . Il se
formera alors des gènes différents codant pour des protéines différentes
dont les fonctions pourront donc être également différentes. Il y a ainsi
un enrichissement du génome avec apparition de nouvelles
caractéristiques phénotypiques .
IV LES INNOVATIONS GENETIQUES SONT RARES ET
ALEATOIRES.
Les mutations sont des accidents qui se produisent spontanément au
cours de la réplication de l’ADN qui précède la division cellulaire. Il
s’agit cependant d’évènements relativement rares puisque leur
fréquence au niveau d’un gène est de l’ordre de moins d’une erreur pour
un million de copies.
Toute mutation est automatiquement transmise aux cellules-filles
descendant de la cellule mutée.
Chez les organismes se reproduisant par reproduction sexuée, seules
les mutations affectant les cellules de la lignée germinale* (aboutissant
à la formation des gamètes) peuvent être transmises à la descendance.
En revanche, les mutations affectant les cellules somatiques* (toutes

les autres cellules du corps) ne sont pas transmissibles à la
descendance.
La fréquence des mutations est considérablement augmentée par
certains facteurs de l’environnement (agents mutagènes*) : rayons
ultraviolets, rayons X, radiations nucléaires, produits chimiques...
Lexique
addition : insertion d’un ou plusieurs nucléotides dans la séquence de
l’ADN.
agent mutagène : facteur de l’environnement (rayonnement, produit
chimique...) augmentant la fréquence des mutations.
allèles : différentes formes d’un même gène, occupant le même site ou
locus sur le chromosome, présentant entre eux des variations dans la
séquence nucléotidique.
cellule somatique : cellule de l’organisme autre que les cellules
reproductrices.
délétion : perte d’une partie du matériel génétique pouvant aller d’un
nucléotide à plusieurs gènes.
duplication de gènes : phénomène conduisant, au niveau d’un
chromosome, à la présence en double exemplaire d’un fragment
chromosomique englobant un gène.
espèce : unité de base de la classification, regroupant les individus
présentant certains caractères de ressemblance et interféconds (les
produits de cette fécondation étant eux-mêmes fertiles).
famille multigénique : ensemble de gènes homologues, présents dans
le génome d’une même espèce et présentant de grandes similitudes. Ils
dérivent d’un gène ancestral unique par des mécanismes de duplication.
gène : segment d’ADN codant pour un polypeptide précis, représentant
une unité d’information génétique.
génome : ensemble des gènes d’une cellule, d’un individu ou d’une
espèce.

génotype : combinaison des allèles que possède un organisme pour un
ou plusieurs gènes donnés.
lignée germinale : ensemble des cellules à l’origine des gamètes.
mutation : modification rare, brutale et imprévisible de la séquence
nucléotidique de l’ADN, au cours de la réplication, aboutissant à la
création de nouveaux allèles.
mutation décalante : mutation provoquée par une délétion ou une
addition d’un nombre de nucléotides non multiple de trois, ce qui change
le cadre de lecture à partir de la mutation.
mutation faux-sens : substitution d’un nucléotide par un autre dans la
séquence nucléotidique d’un gène conduisant au changement d’un acide
aminé par un autre dans la séquence peptidique, ce qui modifie la
fonction de la protéine synthétisée.
mutation neutre : substitution d’un nucléotide par un autre dans la
séquence nucléotidique d’un gène conduisant au changement d’un acide
aminé par un autre dans la séquence peptidique, sans que la fonction de
la protéine synthétisée soit modifiée.
mutation non-sens : mutation entraînant le changement d’un codon
sens en un codon non-sens, introduisant un arrêt prématuré de la
traduction et aboutissant à une chaîne peptidique incomplète.
mutation ponctuelle : mutation portant sur un seul nucléotide
mutation silencieuse : mutation qui ne provoque aucune modification
apparente du produit du gène.
phénotype : expression du génotype au niveau moléculaire (protéine
synthétisée) ou au niveau de l’organisme (caractère observable).
polyallélie : existence de plusieurs allèles d’un gène donné.
polymorphisme génique: multiplicité des différentes formes (allèles)
des gènes constituant le génome d'une espèce. Un gène est dit
polymorphe quand il présente au moins 2 allèles dont le plus rare est
présent dans plus de 1% de la population.
polymorphisme génotypique : diversité des combinaisons d’allèles
constituant les divers génotypes des individus d’une espèce donnée.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%