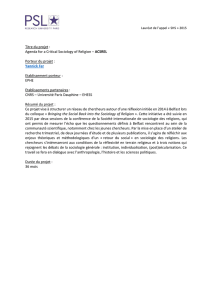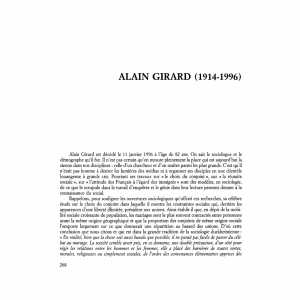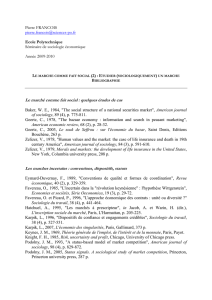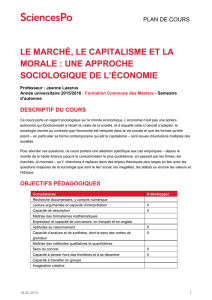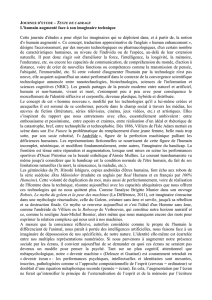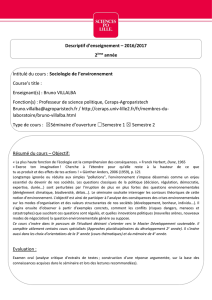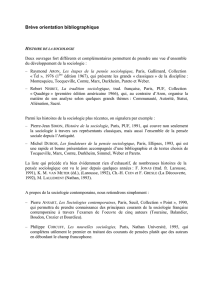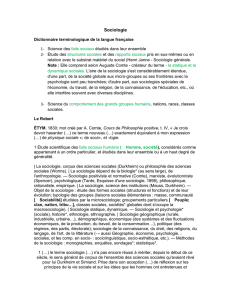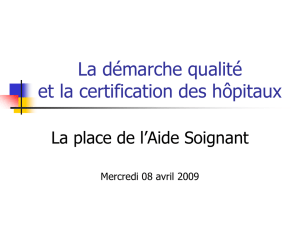Author: Alain Girard Co-Author: Bernard Schéou Department

Author: Alain Girard
Co-Author: Bernard Schéou
Department: Sociology
Institution: University of Perpgnan
E-mail: [email protected]
Abstract:
Tout pratique sociale est structurée par des formes symboliques qui médiatisent le
rapport au monde des acteurs et constituent le monde de leur expérience. Quand
(ou en tant que) ces formes symboliques ont une force de structuration du monde
perçu telle qu’elles constituent des matrices de sélection et d’agencement des
éléments du réel qui restent inchangées au contact de ces éléments, on peut parler
d’imaginaire. Les pratiques touristiques seraient incompréhensibles sans la prise en
compte des imaginaires qui constituent des cadres collectifs pour les expériences
touristiques des sujets et instaurent des schèmes de désidérabilité des lieux, des
cartes touristiques qui permettent le déplacement des sujets. On posera que les
imaginaires du tourisme occidental sont principalement structurés par un code de
l’authenticité qui définit les marques de la désirabilité des lieux pertinentes
notamment pour ces parenthèses temporelles que constituent les « vacances » qui
trouvent leur accomplissement le plus socialement « naturel » dans le départ de
chez soi.
Nous nous proposerons d’analyser l’imaginaire qui anime les touristes solidaires
français, usagers d’associations de voyages proposant des circuits et séjours «
équitables » dans des destinations du Sud. Alors qu’il est coutume d’opposer cette
forme de tourisme au tourisme de masse, un peu comme un tourisme de vraie
rencontre des autres cultures à un tourisme sans véritable rencontre de l’autre,
nous montrerons qu’un même imaginaire touristique, le code de l’authenticité et
plus précisément de la « typicité », structure l’expérience et le rapport à l’autre.
Toutefois si l’imaginaire fonctionne comme une institution collective du sens, il ne
détermine pas mécaniquement et uniformément les pratiques. Les personnes
structurent leur expérience par des appropriations différenciées des institutions,
dans des variantes qui vont de l’accomplissement rituel de ce qui est requis pour
réaliser l’Institution à la prise de distance sélective voire jusqu’à la subversion. Si on
nomme « expérience de l’étrangeté » les moments de subversion du code de
l’authenticité et de transformations des schèmes du regard, notre hypothèse est que
les expériences de tourisme solidaire s’accomplissent également principalement
sous le mode rituel et ne sont pas ainsi beaucoup plus propices à l’expérience de
l’étrangeté que les tourismes dit de « masse ». Cela ne constitue pas un argument qui
disqualifie les expériences de tourisme solidaire mais remet en question la barrière
idéologique instituant d’un côté des pratiques authentiques et de l’autre des
pratiques qui ne le seraient pas. Cela conduit aussi à reposer le statut de la
compétence critique dans l’expérience touristique sur de nouvelles bases.
Author Bio (French):

Alain Girard est sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Perpignan,
membre de l'Equipe d'Accueil (Voyage Echange Confrontation Transformation)
depuis 1997 après avoir soutenu une thèse de doctorat en sociologie sur le tourisme
(1996) à l'Université de Provence (Aix-Marseille). Ses travaux sur l'expérience
touristique s'inscrivent dans une approche qui raccorde sociologie critique et
sociologie pragmatique des régimes d'action.
Author Bio (English):
Alain Girard is a sociologist, lecturer at the University of Perpignan, member since
1997 of the VECT (Voyage Echange Confrontation Transformation) after having
defended a phd thesis in sociology about Tourism (1996) at the University of
Provence (Aix-Marseille). His works on the tourist experience are part of an
approach that try to connect critical sociology and pragmatic sociology.
1
/
2
100%