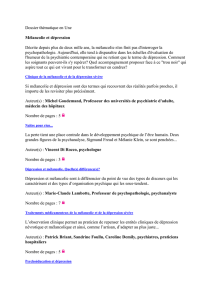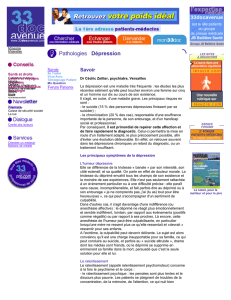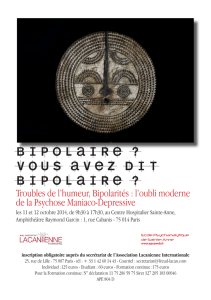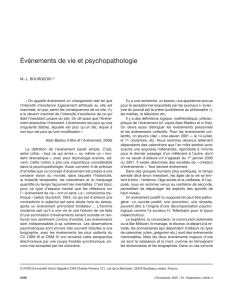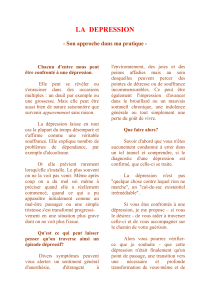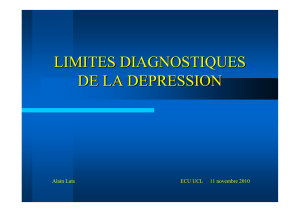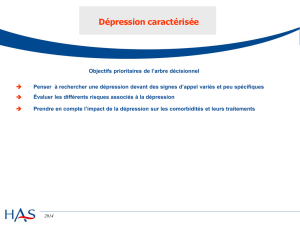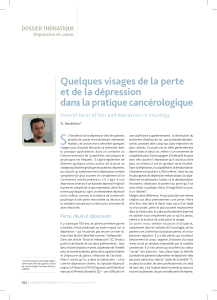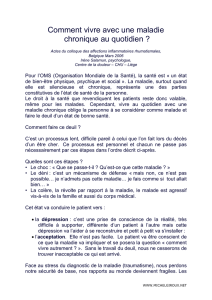I - Free

1
- Conclusions -
I / Psychopathologie descriptive et psychopathologie dynamique :
Nous avons vu les principales entités nosographiques en nous basant sur une psychopathologie
descriptive (signes observables). A côté de cette psychopathologie, il en existe aussi une autre dite
psychodynamique qui est plus basée sur les signes fonctionnels du patient.
Dans ce contexte, le diagnostic portera plus sur les modes de fonctionnement du patient que sur son
état clinique.
On cherchera à identifier la dynamique du sujet, ses investissements, ses modes de résolution de
conflit, et son histoire. Ce travail peut se faire à 2 niveaux :
L’étude de la dynamique des processus :
Analyse du symptôme et de la demande,
Etude des mécanismes de défense,
Etude du type de relation d’objet,
Etude des formes et du type d’angoisse,
Etude des modes d’investissements libidinaux,
Etude de la nature du conflit.
L’étude de l’histoire du sujet : Elle s’appuie sur le récit de la vie du sujet tel qu’il la raconte (anamnèse).
Pour pouvoir faire ce type de diagnostic, cela suppose des connaissances théoriques sur les modes
de fonctionnement du sujet. Ces connaissances peuvent faire référence à différentes approches
(psychanalyse, humanisme, cognitivo-comportemental…). C’est pour cette raison que ce type de
diagnostic est en général utilisé secondairement au diagnostic descriptif et dans le cadre d’une prise en
charge ou d’un travail de recherche.
II / la diversité des modèles explicatifs pour un même trouble :
Une fois le diagnostic posé, la question de la cause possible des troubles peut être avancée (c'est à
dire l’étiologie). Il existe de nombreux modèles explicatifs qui tentent de répondre à cette question
souvent pour un même trouble donné.
Pour illustrer cela, nous allons prendre l’exemple de la dépression. Beaucoup de travaux dans des
champs variés ont été produits pour essayer de rendre compte de ce trouble mental très contemporain. A
titre d’exemple, nous avons les modèles psychanalytiques et cognitivo-comportemental de la
dépression.
1) Le modèle psychanalytique de la dépression :
C’est en 1916, dans son ouvrage Deuil et mélancolie que FREUD a présenté sa théorie de la
dépression qu’il nomme alors, la mélancolie.
Pour FREUD, l’état mélancolique correspond à un état profondément douloureux qui se traduit par
une suspension de l’intérêt pour le monde extérieur, une perte de la capacité d’aimer, une inhibition de
toute activité, une diminution de l’estime de soi et des auto reproches.
Pour FREUD, tous ces éléments sont communs au deuil et à la mélancolie.
FREUD disait « L’affect qui correspond à la mélancolie et celui du deuil, c'est à dire le regret amer de
l’objet disparu » ou encore « La mélancolie est un deuil provoqué par une perte de libido ».
Dans le cas de la mélancolie, il s’agit bine du deuil d’un objet perdu même si ce dernier n’est pas
consciemment repérable.
Tous les psychanalystes qui se sont intéressés à la mélancolie après FREUD (ABRAHAM, KLEIN,
NACHT), s’accordent pour dire que la perte d’objet est capitale dans la mélancolie.
Le deuil normal se résout par un déplacement de la libido vers de nouveaux objets alors qu’elle se
replie dans le Moi du mélancolique. Dans le deuil, la perte de l’objet rend le monde pauvre et vide alors
que dans la mélancolie, c’est le Moi du sujet qui est devenu pauvre et vide.
FREUD décrit ainsi l’état mélancolique « Il existe initialement un objet d’amour extérieur avec lequel la
relation est rompue mais au lieu de la déplacer vers un autre objet, la libido du sujet se replie vers le
Moi ». une partie du Moi est donc identifiée à l’objet perdu et l’autre devient la critique du Moi.
Pour FREUD, 3 conditions doivent être remplies pour déterminer ultérieurement un état
mélancolique :
Une ambivalence initiale pour l’objet d’amour (si la relation se rompt si facilement).
Suivie d’une perte de cet objet.
Puis d’une régression de la libido sur le Moi.

2
Enfin, on peut dire qu’historiquement, il s’agit du premier modèle explicatif de la dépression.
2) Modèles cognitivo-comportemental de la dépression :
Les théories cognitivo-comportementales ont acquis une importance capitale pour expliquer et
prendre en charge la survenue d’un épisode dépressif.
L’approche comportementale s’est intéressée à la dépression en tant qu’état constitué et se montre
très attentive à l’aspect auto-entretenu du trouble dépressif. C'est à dire qu’une fois le trouble dépressif
est instauré chez un patient, il a une forte tendance à s’auto renforcer.
Le modèle tridimensionnel de LANG modélise bien ce phénomène. Ce dernier postule que la
dépression repose sur 3 types de symptômes : Comportementaux, Affectifs, Cognitifs.
Ils sont en interaction constante et se renforcent mutuellement.
Chaque type de symptôme peut être une cible de l’intervention thérapeutique :
Au plan comportemental, la dépression résulte d’une diminution des expériences gratifiantes. Le
sujet est déprimé car il n’a plus accès à tout ce qui habituellement renforce et gratifie son ego : soit parce
que son environnement est réellement appauvri (deuil, séparation, échec professionnel…), soit parce que
le déprimé est incapable de rechercher activement les renforçateurs sociaux (il se replie sur lui-même et
s’isole).
Au plan affectif, les patients sont anhédoniques et sont persuadés qu’ils ne sont plus capables
d’éprouver du plaisir. Le travail du thérapeute sera de leur montrer qu’ils éprouvent moins de plaisir mais
qu’ils sont encore capables d’en éprouver.
Au plan cognitif, le déprimé fait une lecture pessimiste du monde qui selon lui est en grande partie
responsable de ses souffrances. L’intervention clinique porte ici sur les modes de pensée des déprimés.
Le modèle cognitif princeps des troubles dépressifs. Demeure celui construit par BECK. Cet auteur a
identifié l’existence d’une triade cognitive négative et qui se regroupe de la façon suivante chez les
patients déprimés :
Une vision négative de soi (« Je ne vaux rien »), du monde extérieur (« Les autres ne me
comprennent pas »), du futur (« Je ne m’en sortirais jamais »).
Ces prémices vont déterminer les interprétations des situations réalisées par le patient déprimé, et
tout événement même positif sera perçu négativement. Cette vision de la réalité entraîne de véritables
distorsions cognitives dans le traitement de l’information. C’est l’activation des schémas dépressogènes
(structures profondes stockées en mémoire à long terme) qui provoqueraient ces distorsions.
La théorie cognitive la plus élaborée de la dépression est fondée sur les modèles d’attribution
cognitive (auteurs : BECK, RUSH, EMERY). Pour ces auteurs, la dépression résulte d’une interprétation
systématiquement négative des perceptions du fait de la rigidité des structures cognitives du déprimé.
Suite à une perte d’objet, les structures cognitives négatives du patient l’orientent vers l’attribution
interne de la cause de la perte (culpabilité). C'est à dire que le déprimé s’attribue la responsabilité des
événements considérés comme négatifs.
Le patient en exagère l’importance (focalisation) et devient, avec le temps, convaincu que
l’amélioration de son état est impossible (stabilité des troubles).
III / Conclusion :
En conclusion, la démarche psychopathologique peut se résumer de la façon suivante :
A un 1er niveau, la question que l’on se pose, est de savoir qu’est ce que le sujet a ? c’est le
diagnostic descriptif qui va permettre de répondre à cette question à partir de l’observation des signes et
du regroupement en syndromes.
A un 2ème niveau, la question que l’on se pose, est de savoir quel est le mode de fonctionnement
du sujet ; c’est le diagnostic psychodynamique qui va permettre d’apporter les éléments de réponse à
partir de l’analyse des modes de fonctionnement du sujet.
A un 3ème niveau, la question que l’on se pose est de savoir comment on peut expliquer l’origine
du trouble mental chez le patient. Ce sont les modèles explicatifs ou psychopathologiques explicatifs qui
vont tenter de répondre à cette question en proposant des théories psychologiques à l’origine des
troubles.
On voit donc bien dans cette démarche que le point de départ fondamental reste le diagnostic
descriptif puisque les modes de fonctionnement et les modèles explicatifs sont souvent à la fois très
différents d’un trouble mental à un autre et à la fois d’un sujet à un autre.

3
Signes
Diagnostic descriptif
Indices de fonctionnement
Diagnostic psychanalytique
Théorie psychologique
Modèles explicatifs
Niveaux
1
/
3
100%