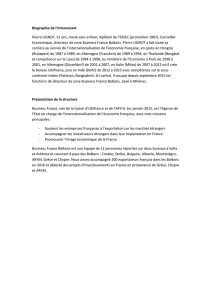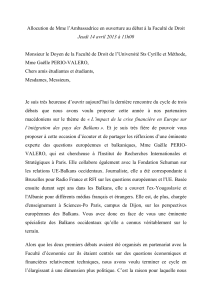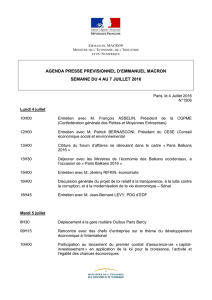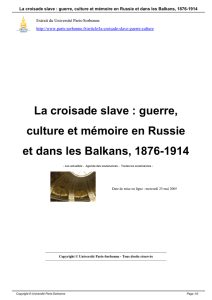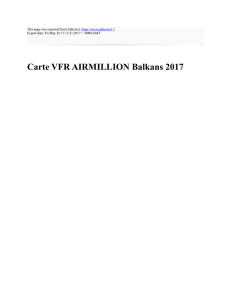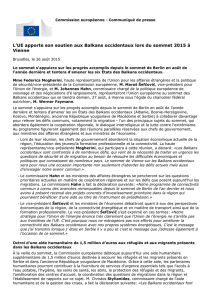Cadmos-serpent chez les Illyriens : diffusion et réception d`un mythe

R
RE
EG
GA
AR
RD
DS
S
S
SU
UR
R
L
LE
ES
S
B
BA
AL
LK
KA
AN
NS
S
:
:
U
UN
NE
E
H
HI
IS
ST
TO
OI
IR
RE
E
E
EN
N
P
PA
AL
LI
IM
MP
PS
SE
ES
ST
TE
E
Cadmos-serpent chez les Illyriens : diffusion et réception d’un mythe grec
Maria Paola CASTIGLIONI
Dans le cadre d’une étude visant à approfondir les relations culturelles entre les Grecs
et les populations illyriennes installées dans la péninsule balkanique à l’époque pré-romaine,
l’exposé analysera d’abord, à partir des sources littéraires appropriées, le récit mythique de
l’exil de Cadmos et Harmonie en Illyrie ainsi que leur métamorphose en serpents.
Un examen de quelques témoignages iconographiques et épigraphiques permettra
ensuite de s’interroger sur le contexte historique de la diffusion et de la réception de ce mythe
par les indigènes illyriens et de mieux comprendre les raisons de son large succès.
Les Balkans, la papauté et les missions des frères Mendiants (XIIIe -XIVes.)
Thomas TANASE
L’objet « Balkans », comme tout objet géographique, et plus encore dans le cas d’un
nom tellement connoté, n’est pas un objet neutre, évident, défini par sa géographie physique
(la montagne), ou sociale (la spécificité de ses habitants, leur culture), même si tous ces
éléments sont évidement essentiels. Les Balkans sont créés par un point de vue, par une
manière de regarder et de comprendre un ensemble réuni et constitué sous le nom de
« Balkans ». Or les discours de la papauté et des frères Mendiants sur la péninsule du sud-est
européen me semblent marquer une étape décisive pour dans la création des « Balkans » et
par certains aspects (mais cela peut se débattre) leur véritable naissance. Car la décomposition
de l’ensemble byzantin place la région dans une situation de marge de la chrétienté latine que
la papauté et les Mendiants se proposent d’arrimer et d’intégrer. Derrière le discours d’une
chrétienté romaine et universelle qu’il faut étendre, les politiques suivies sont complexes. Mais
les divers intérêts politiques doivent tous se justifier vis-à-vis de ce discours. À cet égard, les
peuples de la région ne semblent aux yeux des Latins qui les décrivent ni suffisamment
éloignés et exotiques ni suffisamment développés pour incarner une véritable altérité à
combattre sur le même plan que le « Sarrasin », le « Tartare », le « Grec » de Constantinople.
Nous voyons ainsi apparaître à travers nos sources un certain nombre de biais (mise en
exergue d’une situation religieuse parfois irrégulière, nomadisme pastoral, montagne) qui
finissent par caractériser la région comme trop mélangée, informe, hérétique. L’ensemble finit
par faire système et devenir stéréotype à partir du moment où il est incapable de voir les
transformations à l’oeuvre parmi ces peuples, avec l’émergence de cultures et d’états plus
résistants qu’il n’y paraît : les frères Mendiants ne cessent de parler de succès spectaculaires,
mais n’arrivent jamais vraiment à faire avancer leur cause, malgré un effort continu jusqu’à la
conquête turque. C’est en fait une vision comparable à l’imaginaire contemporain sur les
Balkans qui se dessine (une région mélangée, informe, trop fragmentée politiquement), même
s’il manque encore la conquête turque pour individualiser la région, séparer son destin du
reste de l’espace est-européen et léguer le nom de « Balkans » au XIXe siècle européen.
Charles Ier d’Anjou, roi d’Albanie : l’aventure balkanique des Angevins de Naples au XIIIes.
Aude RAPATOUT
En 1272, Charles Ier d’Anjou, frère de Saint Louis prend le titre de reges Albanie. Cette
action est dans la droite ligne de sa politique orientale, mais c’est également sa pierre
d’achoppement. En battant Manfred de Hohenstaufen en 1266, Charles Ier devient à la fois
l’héritier de ses terres albanaises et du rêve qui les accompagnait : parvenir jusqu’à
Constantinople et reconstituer à son compte l’Empire Latin de Constantinople. L’intérêt

majeur que représente l’Albanie est directement lié à sa position stratégique, puisque c’est de
Durazzo, le grand port albanais, que part la Via Egnatia qui mène à la ville impériale. Les
Angevins donc déploient sur place un grand nombre de militaires et d’administrateurs, et
accordent la nomination d’un capitaine des Albanais d’origine albanaise, mais cette
concession n’empêche pas la rétention d’otages albanais dans le royaume de Sicile. À partir de
1278, Charles d’Anjou se lance dans une entreprise d’envergure, afin de battre Michel VIII
Paléologue. Après une période d’intense activité diplomatique au cours de laquelle il a noué
des alliances avec les ennemis de Michel VIII, on assiste à toute une période d’envoi en grand
nombre d’hommes, d’argent, de chevaux, de matériel divers outre-Adriatique. Le roi nomme
Hugues de Sully capitaine général et de vicaire extraordinaire en Romanie. La campagne
commence au printemps 1280 par le siège de la forteresse albanaise de Bérat. Le siège devait
être court : il se termine un an plus tard, par la capture d’Hugues de Sully et la déroute de
l’armée angevine, en avril 1281. Il s’agit de l’une des trois grandes victoires de Michel VIII sur
les Latins, à égalité avec la victoire de Pélagonia (au printemps 1259) et la reprise de
Constantinople (en juillet 1261). Elle fut estimée ainsi par Michel VIII, qui aurait ordonné
que l’on illustre cette victoire par une fresque dans le palais des Blachernes, au coté de ses
autres victoires. L’ironie de l’histoire veut que l’armée de Charles Ier et son capitaine général
soient bien allés jusqu’à Constantinople, mais en tant que prisonniers de l’empereur que leur
roi voulait renverser et remplacer. Le siège de Bérat, ou plutôt son échec, est un moment
capital du règne de Charles d’Anjou, car il marque la fin de sa politique orientale, quelques
mois avant que les Vêpres siciliennes ne sonnent le glas de son autorité sur l’Italie
méridionale.
Les racines idéologiques de l’impérialisme italien dans les Balkans, 1861-1915
Fabrice JESNÉ
L’Italie, jeune puissance et jeune nation, s’est unifiée au nom du principe des
nationalités, contre l’Europe du Congrès de Vienne. L’épopée du Risorgimento constitue le
mythe fondateur de la nation italienne. La jeune Italie se sent investie d’une mission en faveur
des peuples opprimés par les empires multinationaux d’Ancien Régime qui dominent
l’Europe centrale et orientale. Toutefois, elle se veut également une grande puissance, un
membre du cartel des grands qui tente de gérer la « Question d’Orient », c’est-à-dire le
progressif démantèlement de l’Empire ottoman sous l’effet de la révolte des diverses
nationalités qui le composent, mais aussi des appétits contradictoires des puissances. Le
mythe romantique d’une l’Italie guidant les nationalités opprimées s’efface donc au profit de
la réalité d’une puissance défendant ses intérêts propres. Il s’agit de maintenir l’Italie parmi les
grands, soit par des conquêtes territoriales outre-mer, soit par une politique d’influence, en
particulier dans les Balkans. Pour garantir son statut de grande puissance, l’Italie s’allie à
l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie. Or, cette dernière domine toujours des territoires de
langue ou de culture italienne. Parmi ces terres d’ « italianité », Trieste, l’Istrie et les villes
dalmates se situent au carrefour de l’Europe centrale, de la Méditerranée et des Balkans. Les
relations italo-balkaniques ont été, jusqu’à présent, surtout étudiées du point de vue
diplomatique ou économique. Un travail d’histoire des représentations reste à faire pour
comprendre comment l’Italie unifiée s’est lancée dans une politique d’expansion dans les
Balkans. Hésitant entre messianisme libérateur, Realpolitik de la faiblesse et nationalisme de
frustration, les Italiens ont, de l’Unité à la Première Guerre mondiale, interprété de différentes
manières l’héritage du Risorgimento, et forgé un regard occidental spécifique sur les Balkans.
L’Albanie dans la politique étrangère de la France (1916-juin 1940)
Stefan POPESCU
L’étude des relations bilatérales constitue un instrument fondamental dans la recherche
des relations internationales. Malgré l’intégration des forces profondes, qui ont beaucoup
changé ce genre de la recherche historique, la théorisation est restée très lacunaire. Si les

études de cas abondent, elles ne sont pas reliées entre elles. Une relation bilatérale délimite
premièrement un espace d’action pour deux acteurs à partir des leurs intérêts qui peuvent être
distincts mais parfois convergents. Cet espace n’est pas entièrement institutionnalisé. Il y a
donc un « officiel » et un « non officiel » dans les rapports des deux pays. L’espace officiel,
conceptualisé, s’organise autour des dirigeants et des appareils diplomatiques qui sont des
partenaires privilégiés. L’autre, non conceptualisé, compte les contacts non étatiques, entre les
sociétés civiles. Il y a bien évidemment des points de rencontre entre ces deux niveaux. Mais
lorsqu’on parle des liens entre deux pays, il est impossible de ne pas réaliser que les relations
bilatérales – qui ouvrent aussi la perspective d’une étude comparative – sont encadrées dans
des espaces géopolitiques plus larges. C’est pour quoi une telle étude doit partir de l’idée que
rien n’est local, mais régional et continental. Cette étude vise à mettre en évidence le côté
évolutif d’une relation bilatérale à partir du cas franco-albanais. Il s’agit d’une période
comprise entre la Première Guerre mondiale, suivie par l’établissement d’un nouvel ordre,
celui de Versailles et sa destruction en 1939-40. Nous avons donc une période d’évolutions
majeures de l’équilibre des puissances, de l’architecture du sud-est européenne, de l’évolution
de l’Albanie. À l’intérieur de ces limites on rencontre d’autres repères, la période de 1916-
1920 avec la présence militaire française à Kortcha, de 1921-1925 , la Conférence des
Ambassadeurs, représente une nouvelle lecture du traité de Londres pour les dix années
suivantes. Ensuite, de 1926 à 1928, nous avons un autre repère : le traité de Tirana, et l’année
1934, avec la création de l’Entente balkanique, dernier essai d’attirer l’Albanie dans la
politique de sécurité collective. La période se clôt par la chute de la France, en juin 1940.
La rivalité après l’alliance : à la source de la friction gréco-turque dans l’après-guerre (1947-
1955)
Sofia PAPASTAMKOU
En février 1952, la Turquie et la Grèce assistent pour la première fois en tant que
membres de l’Alliance Atlantique à la conférence de Lisbonne. Leur accession simultanée
n’est pourtant pas le fruit d’un effort diplomatique concerté, même si le danger communiste
est le principal problème de sécurité aux yeux des Turcs comme aux yeux des Grecs. La
Grèce n’a pas systématiquement cherché son insertion dans l’OTAN, alors que la Turquie
voit là l’aboutissement d’une politique réfléchie qui vise à obtenir des garanties d’un allié fort.
C’est n’est qu’après que le principe d’admission des deux pays à l’OTAN ait été accepté que
les gouvernements turc et grec ont fait d’efforts pour resserrer leurs liens. Le rapprochement
gréco-turc reflète une volonté politique sincère, mais limitée, et n’a jamais été profond, même
avec l’extension de leurs liens dans une entente balkanique triangulaire avec la Yougoslavie.
L’intérêt de la Grèce pour l’île de Chypre, colonie britannique, a attiré la vive attention du
gouvernement turc et le gouvernement britannique a trouvé en lui un soutien fort pour
contrecarrer les revendications grecques. L’internationalisation de l’affaire de Chypre a
gravement miné les relations gréco-turques et la brève « amitié » entre les deux pays a perdu
tout sens au moment des incidents graves contre les minoritaires Grecs de la Turquie en
septembre 1955. Les problèmes qui apparaissent dans les relations gréco-tuques de cette
période relèvent d’une importance particulière parce qu’ils se trouvent à la base des difficultés
bilatérales entre les deux pays qui continuent à être présentes aujourd’hui et qui ont rendu
problématique le fonctionnement du flanc sud-est de l’Alliance Atlantique.
B
BI
IB
BL
LI
IO
OG
GR
RA
AP
PH
HI
IE
E
D
DE
E
S
SY
YN
NT
TH
HÈ
ÈS
SE
E
Dimitri T. ANALIS, Les Balkans, 1945-1960, la prise du pouvoir, Paris, P.U.F., 1978.
Jacques ANCEL, Peuples et nations des Balkans, Géographie politique, Paris, A. Colin, 1930 (reproduction
anastatique en 1995, avec une préface de Pierre George).
Nicoară BELDICEANU, Le monde ottoman des Balkans (1402-1566), Institutions, société, économie, Londres,
Variorum Reprints, 1976.
André BLANC, Géographie des Balkans, coll. « Que sais-je ? », Paris, P.U.F, 1965.
Pierre CABANES (dir.), Histoire de l’Adriatique, coll. L’univers historique, Paris, Seuil, 2001.

Francis W. CARTER, An historical Geography of the Balkans, Londres, Academic Press Inc, 1997.
George CASTELLAN, Histoire des Balkans, XIVe-XXe siècle, Paris, Fayard, 1991
Alain DUCELLIER, « Structures politiques et mentales de longue durée dans les Balkans », in Historiens et
Géographes n° 337, sept 1992, pp. 89-105.
Paul GARDE, Les Balkans : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, Paris, Flammarion, 1999
(3e édition).
Paul GARDE, Le discours balkanique, Des mots et des hommes, Paris, Fayard, 2005.
Hérodote, n°63 : les Balkans, oct-déc 1991.
Bernard LORY, L’Europe balkanique, de 1945 à nos jours, Paris, Ellipses, 1996.
François MASPÉRO, Balkans-Transit, Paris, Seuil, 1997
Thierry MUDRY, Guerre de religion dans les Balkans, coll. Référence Géopolitique, Paris, Ellipses, 2005.
P.Y. PÉCHOUX et M. SIVIGNON, Les Balkans, Collection Magellan, Paris, P.U.F., 1971.
Georges PRÉVÉLAKIS, Les Balkans, culture et géopolitique, Paris, Nathan, 1994.
Violette REY, « Tristes richesses de l’Europe balkanique » in Historiens et Géographes n° 337, sept. 1992,
pp. 53-63.
Jacques RUPNIK (dir.), Les Balkans, paysage après la bataille, coll. L’espace international, Bruxelles, éd.
Complexe, 1996.
Maria TODOROVA, Imagining the Balkans, Oxford, Oxford University Press, 1997.
Stéphane YÉRASIMOS (dir.), Le retour des Balkans, 1991-2001, coll. Mémoires, Paris, éd. Autrement (n° 78),
2002.
Ernest WEIBEL, Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos jours, Paris, Ellipses, collection l’Orient
politique, Paris, 2002.
1
/
4
100%