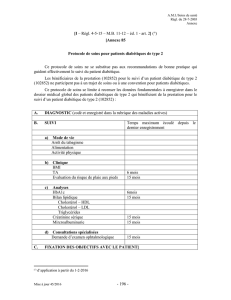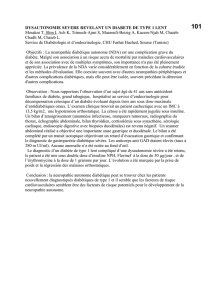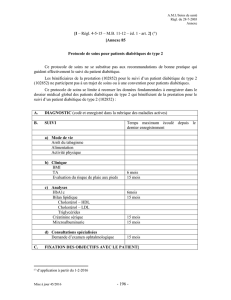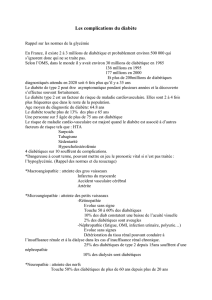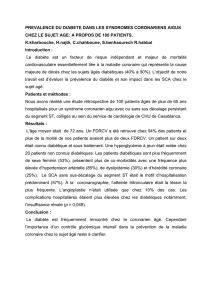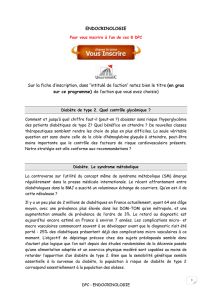Prise en charge hémodynamique du sepsis gave

PRISE EN CHARGE DU DIABÉTIQUE
NON INSULINODÉPENDANT (TYPE 2)
Michel Carles, Livu Dimache, Marc Raucoules-Aimé
Département d’Anesthésie-Réanimation du CHU de Nice, Hôpital l’Archet
2, 151 Route Saint Antoine Ginestière, 06202, Nice Cedex 3, France.
E-mail : carles.m@chu-nice.fr
INTRODUCTION
Le diabète de type 2 est une maladie lourde de conséquences par ses com-
plications. Il constitue un problème de santé publique dont le poids humain et
économique va croissant. Ses complications en font une maladie dont la morbidité
et mortalité sont fortement accrues par rapport à la population générale. Pour
les complications cardio-vasculaires, le risque est multiplié par un facteur de 2 à
3. Le diabète de type 2 est la première cause de mise en dialyse en France, et
le risque d’amputation de membre est multiplié par 10. Enfin, les complications
oculaires en font une des premières causes de cécité ou d’altération de l’acuité
visuelle. On estime à environ 7 ans le retard au diagnostic dans cette affection.
Aux Etats-Unis, des études longitudinales de suivi de sujets ayant été diagnosti-
qués comme diabétiques sur un test d’hyperglycémie provoquée orale (HGPO)
pathologique, ont montré que le délai moyen entre la découverte biologique et
le diagnostic clinique de diabète de type 2 est de 10 ans. Dans ces conditions,
les complications micro et macrovasculaires commencent à se développer avant
que le diagnostic de diabète de type 2 n’ait été porté, expliquant en grande
partie la morbidité importante de cette affection. Ainsi, au moment du diagnostic
clinique du diabète, la rétinopathie est présente chez 10 à 29 % des patients et
la protéinurie est détectée chez 10 à 37 % des sujets. Quant aux complications
macrovasculaires (coronaropathie, artériopathie périphérique), elles débutent
encore plus précocement dès le stade de l’intolérance au glucose.
Cette affection s’associe fréquemment à d’autres facteurs de risque cardio-
vasculaire : parmi les adultes porteurs d’un diabète de type 2 non diagnostiqué,
61 % déjà sont hypertendus, 50 % hypercholestérolémiques, 30 % hypertrigly-
céridémiques. Une fois le diabète diagnostiqué, 50 % à 74 % sont hypertendus
et 38 % à 60 % selon les pays sont porteurs d’une dyslipidémie [1].
Ces données expliquent pourquoi les critères diagnostiques de diabète
(Tableau I) ayant prévalu jusqu’alors (glycémie > 1,4 g.l-1) ont dû être révisés à
la baisse car ils ont contribué au retard de prise en charge de cette affection (cf.
chapitre suivant).

MAPAR 2006
384
TABLEAU I
Critères diagnostiques du diabète
Les anciens critères diagnostiques (OMS, Technical report 1980)
Était considéré comme diabétique, un sujet présentant à deux reprises :
• une glycémie à jeun supérieure à 7,8 mmol.l-1 (1,40 g.l-1)
• ou une glycémie deux heures après la prise orale (charge) de 75 g de glucose,
supérieure à 11 mmol.l-1
.
Les nouveaux critères proposés par l’American Diabetic
Association (ADA, 1997) et l’ANAES (1998)
Est considéré comme diabétique, un sujet présentant à deux reprises :
•
une glycémie à jeun (au moins 8 heures de jeûne) > 7 mmol.l-1 (> 1,26 g.l-1)
Est considéré comme normal :
• un sujet ayant une glycémie à jeun < 6,1 mmol.l-1 (< 1,10 g.l-1)
Sont considérés comme ayant une glycorégulation anormale :
•
les sujets ayant une hyperglycémie modérée à jeun : glycémie > 6,1 mmol.
l-1 e
t < 7 mmol.l-1 (>1,10 g.l-1 et < 1,26 g.l-1)
• les sujets ayant une intolérance au glucose: glycémie à jeun < 7 mmol.l-1
(< 1,26 g.l-1) et glycémie deux heures après la prise de 75 g de glucose
> 7,6 mmol.l-1 (> 1,40 g.l-1) et < 11,1 mmol.l-1 (< 2 g.l-1).
Cette modification des critères diagnostiques conduit aussi à une révision
de la classification des diabètes et à une réévaluation des données épidémiolo-
giques. La précocité du diagnostic et de la prise en charge ainsi que la globalité
des actions thérapeutiques conditionnent à l’avenir le pronostic de ces patients.
Quant au risque opératoire, il est essentiellement lié aux complications dégénéra-
tives du diabète en particulier cardio-vasculaires ou affectant le système nerveux
autonome. Dans ce contexte l’évaluation préopératoire est fondamentale. Par
ailleurs, la place de l’anesthésie locorégionale est aujourd’hui réhabilitée et les
niveaux du contrôle glycémique en per et postopératoire sont maintenant aussi
bien définis.
1. DIAGNOSTIC, CLASSIFICATION ET ÉPIDÉMIOLOGIE DU DIABÈTE
Le diabète est une affection métabolique caractérisée par la présence d’une
hyperglycémie chronique résultant d’une déficience de sécrétion d’insuline,
d’anomalies de l’action de l’insuline sur les tissus cibles, ou de l’association
des deux. Le diagnostic du diabète repose donc sur la mesure de la glycémie
réalisée soit à jeun, soit deux heures après ingestion de 75 grammes de glucose
(test d’hyperglycémie provoquée orale : HGPO). En l’absence de symptômes
cliniques, le diagnostic de diabète, avant d’être retenu, doit être confirmé par
une deuxième mesure montrant un nouveau résultat anormal.
La classification du diabète comporte schématiquement deux formes : le
diabète de type 1 anciennement appelé diabète insulinodépendant ou diabète
juvénile, qui représente environ 10 % des cas (150 000 personnes en France)
et débute habituellement avant 30 ans, et le diabète de type 2 anciennement
dénommé diabète non insulinodépendant ou diabète de la maturité qui repré-
sente environ 90 % des cas (1 300 000 personnes en France).

Questions pour un champion en anesthésie 385
La prévalence du diabète de type 2 diagnostiqué est proche de 3 % dans
la population française. La population à risque de diabète de type 2 correspond
essentiellement à la population des obèses. La prévalence de l’obésité (indice
de masse corporelle > 30 kg.m-²) dans la population adulte française est estimée
à plus de 10 %. Si le diabète de type 1 est habituellement reconnu devant des
symptômes (amaigrissement, polyurie, polydypsie) le diabète de type 2 est le
plus souvent asymptomatique et diagnostiqué fortuitement, à l’occasion d’une
prise de sang lors d’un bilan systématique en particulier avant un acte chirurgical.
Le nombre de diabétiques méconnus ne dépasse probablement pas 500 000.
2. LES LÉSIONS DÉGÉNÉRATIVES ET L’ÉVALUATION PRÉOPÉRATOIRE
2.1. L’ATTEINTE CARDIO-VASCULAIRE
L’atteinte cardio-vasculaire fait toute la gravité et la difficulté de prise en
charge péri-opératoire du patient diabétique.
2.1.1. L’ATTEINTE CORONARIENNE
L’étude Framingham a montré que le risque de maladie coronaire est multi-
plié par deux chez les diabétiques de sexe masculin, comparés à une population
non diabétique de même âge [2]. Le risque est multiplié par trois, chez les
femmes diabétiques après la ménopause. Cette étude a, pour la première fois,
souligné la fréquence des morts subites et le caractère volontiers atypique de
la sémiologie de l’ischémie myocardique chez les diabétiques. Au cours des
20 dernières années, d’innombrables études épidémiologiques ou d’interventions
thérapeutiques portant sur de grandes cohortes de diabétiques ont confirmé
le risque coronarien. En 1993, l’étude MRFIT a montré que sur une période de
suivi de 12 ans, l’incidence de la maladie coronaire était multipliée par 3,2 chez
des hommes diabétiques comparés à des hommes non diabétiques, strictement
appariés. Cette étude a également démontré que le diabète de type 2 était un
facteur de risque coronarien majeur et indépendant [3]. Plus récemment dans
l’étude épidémiologique UKPDS, chez des diabétiques de type 2 récemment
diagnostiqués et des deux sexes, la maladie coronaire a été identifiée comme
la cause principale de décès [4].
La fréquence et le mauvais pronostic de la maladie coronarienne sont donc
augmentés chez les patients diabétiques qui viennent à la chirurgie et ceci
d’autant plus qu’ils sont âgés. Trois points concernant leur prise en charge en péri-
opératoire sont à souligner. Le premier porte sur le dépistage en préopératoire de
l’ischémie myocardique silencieuse (IMS), le second sur la place de l’angioplastie
dans le traitement des lésions coronaires, le troisième concerne la place des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) après infarctus du myocarde.
Le diagnostic d’IMS doit être porté chez un malade ayant des lésions signifi-
catives, alors que le malade n’a aucun symptôme clinique thoracique, au repos,
à l’effort, ou au froid, qu’il n’a pas de cardiomyopathie ou de valvulopathie [5].
Son ECG de repos est soit normal, soit le siège d’anomalies évocatrices d’une
ischémie myocardique. Les malades diabétiques qui se plaignent à l’effort, au
froid, d’une dyspnée invalidante, de palpitations, d’une gêne thoracique, même
si celle-ci n’a pas les caractéristiques habituelles de la douleur angineuse, ne
rentrent pas dans le cadre du dépistage de l’IMS. Ils sont d’emblée suspects
d’une maladie coronaire à confirmer ou à infirmer par un enregistrement élec-
trocardiographique au cours d’une épreuve d’effort.

MAPAR 2006
386
Le dépistage de l’IMS, doit être effectué pour les hommes, chez les diabéti-
ques de type 2, âgés de plus de 60 ans, artéritiques, ou ayant fait un AVC ayant
laissé peu de séquelles. Chez ces patients, une maladie coronaire est diagnosti-
quée dans 50 % des cas ; les diabétiques micro albuminuriques ou protéinuriques
dont le risque coronarien est multiplié par 2 à 3 sur une période de 10 ans par
rapport à des diabétiques de type 2 normo-albuminuriques appariés ; enfin, les
sujets cumulant tabagisme, HTA et hyperlipidémie. Pour les femmes âgées de
plus de 65 ans, le dépistage de l’IMS doit être pratiqué chez les femmes ayant
eu une ménopause précoce, non substituée ; artéritiques, ou ayant fait un AVC ;
protéinuriques avec ou sans insuffisance rénale.
Pour dépister l’ischémie myocardique silencieuse, on dispose de quatre
méthodes d’investigation non invasives. Ces examens ne doivent être prescrits
que si le malade a préalablement accepté que soit réalisée une coronarographie
et éventuellement un geste de revascularisation, au décours d’un test indiscu-
tablement positif.
L’enregistrement Holter des 24 heures possède une bonne spécificité mais
une sensibilité très faible pour le diagnostic de maladie coronaire ; il est de peu
d’intérêt.
L’échocardiographie de stress est un examen séduisant, mais sa spécificité
et sa sensibilité n’ont pas été évaluées chez les patients diabétiques.
L’enregistrement électrocardiographique au cours d’une épreuve d’effort
est un examen facilement réalisable et d’un coût raisonnable. A la condition
qu’elle soit maximale et qu’elle soit réalisée après l’arrêt des anti-ischémiques,
en particulier les bêta-bloquants, depuis au moins 48 heures, elle possède une
excellente valeur prédictive négative de l’ordre de 85 %. Une épreuve d’effort
maximale négative dans les conditions précitées, permet en pratique d’éliminer
le diagnostic de maladie coronaire.
La scintigraphie myocardique n’est réalisable que dans les centres de
médecine nucléaire. Ses performances sont légèrement supérieures à celle
de l’épreuve d’effort. En pratique, elle doit être réservée aux diabétiques dont
l’épreuve d’effort sera impossible ou ininterprétable.
La coronarographie n’est pas un examen de dépistage de l’IMS, mais elle est
indispensable pour préciser le siège, le degré et l’étendue des sténoses coro-
naires lorsque l’épreuve d’effort et/ou la scintigraphie myocardique ont suggéré
une ischémie myocardique. Cet examen est nécessaire pour dépister les faux
positifs des scintigraphies myocardiques dont le pourcentage est directement
corrélé avec l’expérience de l’équipe ayant réalisé l’épreuve. La coronarographie
est également indispensable pour poser les indications d’une revascularisation
myocardique. La coronarographie justifie des précautions d’emploi, tant en ce
qui concerne la prévention des épisodes d’insuffisance rénale aiguë iatrogénique,
que l’utilisation des antidiabétiques oraux.
Concernant la place respective de l’angioplastie et du pontage aorto-coro-
narien, en termes de réduction de mortalité, il semble que globalement les
diabétiques tirent le même bénéfice que les non diabétiques des pontages
aorto-coronariens (en particulier les greffons artériels) et des dilatations endolu-
minales avec pose de stents (réduction de la mortalité de 44 % après pontage
aorto-coronarien) [6, 7]. Les résultats préliminaires obtenus avec les stents
actifs dans la population diabétique sont prometteurs. Cependant une étude a

Questions pour un champion en anesthésie 387
comparé l’angioplastie au pontage aorto-coronarien chez 2600 diabétiques qui
présentaient une atteinte pluritronculaire [8].
Cette étude confirme la mortalité élevée péri-opératoire après pontage
(5 %) mais montre aussi que, chez les diabétiques traités par insuline, la survie à
5 ans et 10 ans est meilleure après pontage qu’après dilatation. Cependant dans
la plupart des études sur le diabète et la chirurgie coronarienne, d’importants
facteurs additionnels n’ont pas été pris en compte. Par exemple l’incidence et
le degré d’hypertension artérielle, la présence d’une dysfonction ventriculaire,
ou encore la sévérité des lésions coronariennes. Il convient d’être prudent sur le
pronostic d’un pontage coronarien chez le diabétique ayant une mauvaise fonction
ventriculaire, puisque la mortalité, dans certaines études, atteint 10 à 15 %.
Les données de l’étude GISI-3 sur la capacité des IEC (lisinopril) de réduire
la mortalité dans le post infarctus du myocarde apparaissent transposables
au diabétique [9]. L’étude du sous-groupe des 2790 diabétiques dont 2294 de
type 2, montre une réduction de la mortalité à 6 mois de 3,2 % par rapport au
groupe placebo. Les résultats de l’étude EUROPA suggèrent aussi un bénéfice
de l’utilisation des IEC (périndopril) chez le patient diabétique coronarien stable
en termes de diminution des événements cardio-vasculaires majeurs [10].
2.1.2. L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
L’hypertension artérielle (définie par une pression artérielle ≥ 140/90 mmHg
à au moins trois consultations) est d’une grande fréquence au cours du diabète
de type 2 affectant 40 à 60 % des patients. A côté d’un lien génétique fort entre
diabète de type 2 et hypertension artérielle, un certain nombre de facteurs ou
de causes peuvent rendre compte de la survenue ou de l’aggravation d’une
hypertension artérielle chez un diabétique : obésité, hypersécrétion freinable
de catécholamines, néphropathies (notamment vasculaires), syndrome d’ap-
née du sommeil, tabagisme, alcoolisme [11]. Elles représentent un facteur de
risque majeur de survenue d’une atteinte coronaire et un facteur aggravant de la
néphropathie, de la rétinopathie et de la cardiopathie diabétiques. L’étude UKPDS
a montré que le niveau tensionnel optimal pour prévenir les complications micro
ou macroangiopathiques ou éviter leur progression était une pression artérielle
inférieure à 139/81 mmHg [12].
Nous pouvons raisonnablement nous fixer le respect de cet objectif en
péri-opératoire. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’un abaissement de
la pression artérielle systolique en dessous de 140 mmHg peut être difficile à
obtenir, notamment chez le sujet âgé. Quoi qu’il en soit le contrôle de cette
hypertension artérielle est indispensable en préopératoire pour éviter, en asso-
ciation avec une neuropathie dysautonomique, une instabilité hémodynamique
peropératoire et des complications coronariennes et rénales. Le traitement
en première intention de l’hypertension artérielle du diabète de type 2 repose
sur l’un des médicaments suivants : bêta-bloquant cardiosélectif, diurétique
thiazidique, IEC, inhibiteur calcique, antagoniste des récepteurs de l’angioten-
sine II. Une association d’antihypertenseurs est le plus souvent nécessaire et
tout médicament antihypertenseur efficace et bien toléré peut être utilisé chez
l’hypertendu diabétique. Il est recommandé d’inclure un diurétique thiazidique
dans les associations [1]. Il n’y a pas d’effet délétère des diurétiques thiazidi-
ques chez les diabétiques de type 2. L’administration de faibles doses d’aspirine
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%