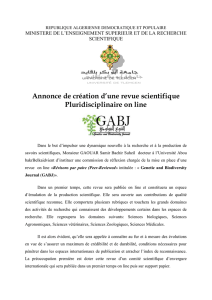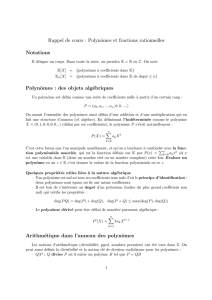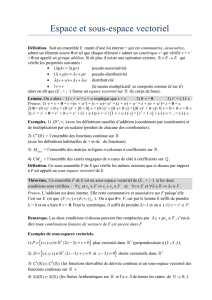Alg`ebre des polynômes

Maths PCSI Cours
Alg`ebre des polynˆomes
Table des mati`eres
1 Introduction `a l’alg`ebre lin´eaire 2
1.1 Espaces vectoriels ........................................... 2
1.2 Sous-espaces vectoriels ........................................ 2
1.3 Applications lin´eaires ......................................... 3
1.4 Familles libres, g´en´eratrices ; bases ................................. 4
2 L’alg`ebre K[X]5
2.1 “D´efinition” de K[X]......................................... 5
2.2 Division euclidienne ......................................... 6
2.3 Racines d’un polynˆome ........................................ 7
3 D´erivation 8
3.1 D´eriv´ees d’un polynˆome, formule de Leibnitz ........................... 8
3.2 Formule de Taylor .......................................... 9
3.3 Caract´erisation de l’ordre d’une racine ............................... 9
4 Factorisation 10
4.1 Un peu de vocabulaire ........................................ 10
4.2 Factorisation sur C.......................................... 11
4.3 Factorisation sur R.......................................... 11
4.4 Quelques exemples .......................................... 11
4.5 Relations entre coefficients et racines ................................ 12
1

Dans tout ce chapitre, Kd´esigne un corps : Rou C. On trouvera moins d’exercices de cours que d’ha-
bitude, mais les exemples non triviaux devront ˆetre d´evelopp´es, et la feuille d’exercice contient beaucoup
d’applications directes des d´efinitions et r´esultats de base.
1 Introduction `a l’alg`ebre lin´eaire
1.1 Espaces vectoriels
D´
efinition 1
Un K-espace vectoriel est un ensemble Emuni d’une loi de composition interne + et d’une loi de composition
externe ., c’est-`a-dire une application de K×Edans Enot´ee de fa¸con infixe, de sorte que (E, +) est un
groupe commutatif, et :
• ∀λ1, λ2∈K,∀v∈E, (λ1+λ2).v =λ1.v +λ2.v
• ∀λ∈K,∀v1, v2∈E, λ.(v1+v2) = λ.v1+λ.v2
• ∀λ1, λ2∈K,∀v∈E, λ1.(λ2.v)=(λ1λ2).v
• ∀v∈E, 1K.v =v
Les ´el´ements de Esont appel´es les vecteurs ; ceux de Kles scalaires. La loi .est aussi appel´ee multiplication
externe.
Exemples 1
•E=R3muni de la somme (a, b, c)+(a0, b0, c0)=(a+a0, b +b0, c +c0)et du produit externe λ.(a, b, c) =
(λa, λb, λc)est un R-espace vectoriel.
Bien entendu, on munit de la mˆeme fa¸con Knd’une structure de K-espace vectoriel
•E=RNmuni de la somme des suites et du produit externe “naturel” λ.u =λu (dont le n-i`eme terme
vaut λun).
•Mˆeme chose pour l’ensemble des fonctions de Xdans R, o`u Xest un ensemble quelconque donn´e.
•Kpeut ˆetre vu comme un K-espace vectoriel (on confond ici la multiplication externe et interne).
•Cpeut ˆetre vu comme un C-espace vectoriel, mais aussi comme un R-espace vectoriel. Mˆeme chose
pour Cnqui peut ˆetre vu comme espace vectoriel sur C, mais aussi sur R.
•E=C1([0,1]) muni de la somme et du produit externe naturels est un R-espace vectoriel.
Remarque 1 On montrera soigneusement les trois faits suivants :
•pour tout v∈E, 0K.v = 0E;
•pour tout λ∈K,λ.0E= 0E;
•λ.x = 0Esi et seulement si λ= 0Kou v= 0E(ce qui s’apparente `a de l’int´egrit´e, mais ici il s’agit
d’une loi de composition externe...).
1.2 Sous-espaces vectoriels
D´
efinition 2
•Un sous-espace de Eest une partie Fde Etelle que (F, +) est un sous-groupe de Eet Fest stable
par multiplication externe. (F, +, .) est alors un K-espace vectoriel.
•Les combinaisons lin´eaires de vecteurs v1,...,vnsont les vecteurs de la forme λ1v1+···+λnvn, o`u
les λisont dans K.
Remarques 2
•On montrera sans mal qu’une partie Fde Eest un sous-espace de Esi et seulement si elle est stable
par combinaison lin´eaire : dans un sens, c’est trivial, et dans l’autre, c’est une r´ecurrence facile sur le
nombre de vecteurs concern´es.
•Il est ais´e de v´erifier qu’un sous-espace vectoriel est lui-mˆeme un espace vectoriel, ce qui fournit un
outil pratique pour montrer qu’un ensemble muni de deux lois est un espace vectoriel : on montre qu’il
est en fait sous-espace d’un espace d´ej`a connu ; on n’a donc pas `a v´erifier les propri´et´es individuelles
et crois´ees des lois.
2

Exercice 1 Soient F1et F2deux sous-espaces de E. Montrer qu’il en est de mˆeme pour F1∩F2.
Exemples 2
•(x, y, 0)
x, y ∈Rest un sous-espace de R3. Mˆeme chose pour (x−y, y, x +y)
x, y ∈Ret
(x, y, z)∈R3
x+y−2z= 0.
•L’ensemble {f∈E|f(1515) = 0}est un sous-espace de RR, mais pas {f∈E|f(0) = 1515}.
•Eet {0E}sont des sous-espaces (dits triviaux) de E.
•Une intersection1de sous-espaces d’un mˆeme espace Eest un sous-espace de E.
• C1([0,1]) est un sous-espace de C([0,1]) qui est un sous-espace de R[0,1].
Remarque 3 IMPORTANT
Dans bien des cas, on peut d´ecrire un mˆeme espace d’un point de vue “´enum´eration” (l’ensemble des . . . pour
. . . d´ecrivant . . . ), ou bien d’un point de vue “v´erification” (l’ensemble des . . . tels que . . . ). Par exemple :
(x, y, 0)
x, y ∈R=(u, v, w)∈R3
w= 0.
1.3 Applications lin´eaires
D´
efinition 3
Soient Eet Fdeux K-espaces vectoriels.
•Une application u:E→Fest dite lin´eaire lorsque :
∀λ∈K,∀v1, v2∈E, u(λv1+v2) = λu(v1) + u(v2).
•On reprend au langage des groupes les termes d’endomorphisme, automorphisme, isomorphisme.
• L(E, F ) d´esigne l’ensemble des applications lin´eaires de Edans F. L’ensemble des endomorphismes de
Eest not´e L(E) plutˆot que L(E, E).
Remarque 4 Si uest lin´eaire, alors uest un morphisme entre les groupes additifs Eet F; en particulier
u(0E)=0F. Pour montrer que uest lin´eaire, on peut alors s´eparer les probl`emes, en montrant que u(λv) =
λu(v) et u(w1+w2) = u(w1) + u(w2).
Exemples 3
•L’application identit´e r´ealise un automorphisme de E.
•u:R3→R2,(a, b, c)7→ (a+b, c −b)est une application lin´eaire de R3dans R2non injective mais
surjective.
•La d´erivation est une application lin´eaire de C1([0,1]) dans C([0,1]) non injective (facile) mais surjec-
tive : pourquoi ?
•L’application de E=RRdans lui-mˆeme qui `a fassocie sa partie paire est un endomorphisme de Eni
injectif ni surjectif.
•ϕ:CN→C, u 7→ u1515 est une application lin´eaire surjective et non injective de CNsur C.
Exercice 2 Munir L(E, F )d’une structure d’espace vectoriel.
Solution : Que faut-il faire au juste ? Quelle est la seule fa¸con raisonnable de le faire ? Montrer qu’en
faisant ainsi, ¸ca marche effectivement !
Proposition 1 Soit ϕ∈ L(E, F ).
•Si E1(resp. F1) est un sous-espace de E(resp. F), alors ϕ(E1)(resp. ϕ−1(F1)) est un sous-espace
de F(resp. E).
Le noyau ker ϕ={x∈E|ϕ(x)=0}=ϕ−1({0F})est donc un sous-espace de Eet l’image Im ϕ=
ϕ(E)est un sous-espace de F.
1mˆeme d’une infinit´e
3

•ϕest injective si et seulement si ker ϕ={0E}.
Preuve : Le premier point se montre sans probl`eme en suivant les d´efinitions, et le second n’est qu’un
cas particulier de la caract´erisation des morphismes de groupe injectifs. Une application lin´eaire induisant
en effet un morphisme entre les groupes (E, +) et (F, +).
Bien que cons´equence d’un r´esultat ant´erieur, la preuve du dernier r´esultat doit ˆetre refaite dans ce cas
pr´ecis.
1.4 Familles libres, g´en´eratrices ; bases
INTERDICTION D’ABORDER LA SUITE AVANT DE LIRE ET COMPRENDRE CE PARAGRAPHE
Si v1,...,vn∈E, la combinaison lin´eaire 0.v1+ 0.v2+···+ 0.vnest appel´ee “combinaison lin´eaire triviale”,
et est clairement ´egale au vecteur nul.
Une combinaison lin´eaire triviale est donc nulle.
Maintenant, si on prend E=R2,u= (1,0), v= (0,1) et w= (−2,−3), alors 2.u + 3.v + 1.w = 0E.
Une combinaison lin´eaire nulle n’est donc pas n´ecessairement triviale.
D´
efinition 4
Soient v1,...,vndes vecteurs d’un K-espace vectoriel E. On dit que la famille (v1,...,vn) est :
•g´en´eratrice si tout vecteur de Epeut s’´ecrire comme combinaison lin´eaire de v1,...,vn;
•libre si la seule combinaison lin´eaire des viqui est nulle est la combinaison lin´eaire triviale ;
•une base de Esi elle est libre et g´en´eratrice.
Remarque 5 Lorsque la famille est une base, on montre facilement2que tout vecteur de Es’´ecrit de
fa¸con unique comme combinaison lin´eaire des vi.
Exemple 4 Dans E=R3, on pose e1= (1,0,0),e2= (0,1,0) et e3= (0,0,1). Alors :
•(2e1+e3, e2−e1)est libre et non g´en´eratrice ;
•(e1+e2, e1+e3, e2+e3, e1+e2+e3+e4)est g´en´eratrice mais n’est pas libre ;
•(e1, e2, e3)est une base de E(on parle de base canonique).
•A VOTRE AVIS (en vous fiant `a votre “exp´erience” : on ne demande pas de preuve), que peut-on dire
de psi (v1,...,vp)est libre (resp. g´en´eratrice) dans R3?
D´
efinition 5
Soient v1,...,vk∈E. Le “sous-espace engendr´e par les vi” est l’ensemble des combinaisons lin´eaires des
vi. On montre sans mal que c’est un sous-espace de E(ouf !), et mˆeme qu’il est inclus dans tout sous-
espace contenant les vi(c’est mˆeme parfois comme cela qu’on le d´efinit). Ce sous-espace engendr´e est not´e
Vect(v1,...,vk), et, par d´efinition, les vien constituent une famille g´en´eratrice.
Exemple 5 Avec les notations de l’exemple 4:
•Vect(e1, e2) = Vect(e1, e1+e2) = {(x, y, 0) |x, y ∈R};
•Vect(e2) = Vect(2e2) = {(0, t, 0) |t∈R};
•Vect(e3, e2−2e3, e1 + e2, e1+e3) = Vect(e3, e2−2e3, e1 + e2) = E.
Dans ce chapitre, on consid´erera parfois des familles infinies. On est donc amen´e `a ´etendre les d´efinitions
pr´ec´edentes :
D´
efinition 6
On consid`ere une famille de vecteurs F= (vi)i∈I. On dit que Fest :
•g´en´eratrice si tout vecteur de Epeut s’´ecrire comme combinaison lin´eaire d’´el´ements de F;
•libre si les seules combinaisons lin´eaires d’´el´ements de Fqui sont nulles sont les combinaisons triviales ;
2Le v´erifier !
4

•une base si elle est libre et g´en´eratrice.
Remarque 6 BIEN ENTENDU, on ne parlera JAMAIS de “combinaisons lin´eaires infinies” : quand on
parle d’une combinaison lin´eaire des (vi)i∈I, il s’agit d’un vecteur de la forme
n
X
k=1
λkvik, avec λk∈Ket
ik∈Ipour tout k∈[[1, n]].
Exercice 3 Dans E=CR, montrer que les applications fn:t7→ enit (n∈Z) forment une famille libre
non g´en´eratrice.
Solution : Pour la libert´e, on pourra partir d’une combinaison lin´eaire nulle, multiplier par e−kit et
int´egrer entre 0 et 2π. Pour montrer que la famille n’est pas g´en´eratrice, on pourra consid´erer une fonction
non born´ee.
2 L’alg`ebre K[X]
Alg`ebre ? C´ekoadonc ?
D´
efinition 7
Une K-alg`ebre est un ensemble Emuni de deux lois de composition interne + et ∗et d’une loi de composition
externe .de sorte que (E, +,∗), est un anneau3, (E, +, .) est un K-espace vectoriel, et “les lois .et ∗se
comportent bien entre elles” c’est-`a-dire plus pr´ecis´ement :
∀λ∈K,∀x, y ∈E, (λ.x)∗y=λ.(x∗y) = x∗(λ.y).
Remarque 7 En pratique, d`es qu’on a une structure naturelle d’anneau et d’espace vectoriel, la relation
de “compatibilit´e” des lois .et ∗est en g´en´eral ´evidente. A l’usage, on ne note ni .ni ∗!
Exemples 6
•L’ensemble des suites complexes, muni de la somme, des produits externe et interne naturels est une
K-alg`ebre commutative.
•Mˆeme chose avec l’ensemble des fonctions continues de Rdans lui-mˆeme, qui est une R-alg`ebre (pour
les lois d´efinissant f+g,f.g et λf ). Par contre, si on prend comme seconde loi de composition interne
la composition des applications, on n’obtient pas une alg`ebre car f◦(g+h)n’est pas en g´en´eral ´egal
`a (f◦g)+(f◦h), de sorte que (RR,+,◦)n’est pas un anneau.
•Par contre, si Eest un K-espace vectoriel, alors (L(E),+,◦, .)est une K-alg`ebre (le v´erifier).
•Kpeut ˆetre vu comme une K-alg`ebre. . .
2.1 “D´efinition” de K[X]
Dans la suite, Xva d´esigner ce qu’on appelle une “ind´etermin´ee” : il ne s’agit pas d’une variable, mais
d’un symbole nouveau4.
Proposition 2 On admet l’existence d’une alg`ebre commutative, not´ee K[X], appel´ee alg`ebre des po-
lynˆomes `a coefficients dans K, qui est une K-alg`ebre contenant un ´el´ement not´e X, et tel que la famille
(1, X, X2,...,Xn,...)est une base de K[X].
Remarques 8
•De mˆeme qu’on peut construire C`a partir de R2, on peut construire K[X] `a partir de K(N), c’est-`a-dire
les suites complexes “presque nulles”, c’est-`a-dire n’admettant qu’un nombre fini de termes non nuls.
3pas forc´ement commutatif
4Un peu comme pour construire C, on part de R, et on introduit un symbole nouveau not´e i. L’analogie s’arr`ete l`a, puisque
dans le cas qui nous int´eresse, Xne v´erifiera pas de relation alg´ebrique contrairement `a iqui v´erifie i2+ 1 = 0
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%