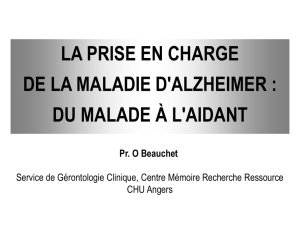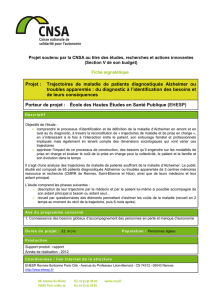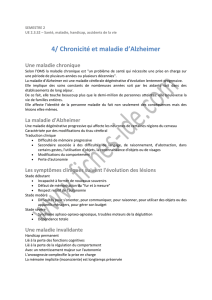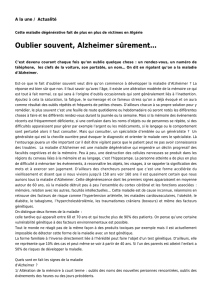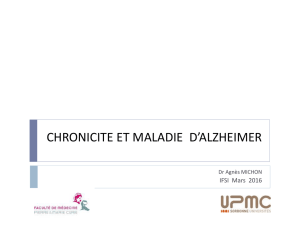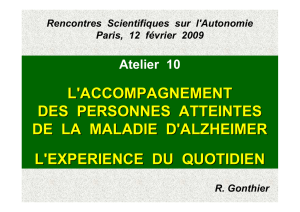Alzheimer, famille, institution Alzheimer, family, institution

Mémoire
Alzheimer, famille, institution
Alzheimer, family, institution
J. Monfort *, M. Neiss, P. Rabier, M.-P. Hervy
Service de Gérontologie, Centre Maurice-Deparis, CHU de Bicêtre, 12, rue Séverine, 94276 Kremlin-Bicêtre cedex, France
Reçu le 16 mai 2005 ; accepté le 25 mai 2005
Disponible sur internet le 28 novembre 2005
Résumé
La maladie d’Alzheimer est une démence qui se manifeste à la fois par une altération des fonctions cognitives et par des troubles psychocom-
portementaux. Une étude sur les réactions de la famille à la démence d’un parent doit envisager plusieurs points de vue : a) La charge familiale. Le
poids de la maladie d’Alzheimer sur la famille est très important. La prise en charge a des effets physiques et psychiques sur l’aidant qui peut
présenter un état anxieux, une dépression, un éthylisme et qui a un risque de mortalité élevé ; b) Les réactions aux symptômes de la maladie. La
famille doit supporter les symptômes de la maladie d’Alzheimer : les troubles cognitifs et surtout les troubles psychocomportementaux. Les réactions
de la famille peuvent être le déni, l’hyperprotection, le maternage, l’hyperinvestissement dans les soins ; c) Les relations avec l’institution gériatrique.
Elles ne sont pas toujours paisibles. Des conflits peuvent éclater entre le patient, la famille et l’institution, surtout quand la famille ressent de la
culpabilité et est ambivalente par rapport à l’institutionnalisation ; d) Les relations pathologiques famille–dément. Des relations pathologiques entre la
famille et le parent peuvent apparaître, dues à la pathologie psychique de l’aidant aggravée par la maladie d’Alzheimer du parent ; e) Le soutien
apporté à la famille. Avant l’institutionnalisation, l’aidant familial doit être soutenu dans le cadre du suivi gériatrique du patient. Des médicaments à
visée cognitive et des psychotropes peuvent réduire les troubles du comportement. Le plus important est d’organiser et d’adapter les aides à domicile,
avec si possible une prise en charge en centre de jour. Après l’institutionnalisation, l’aidant doit continuer à être soutenu. La fin de vie et la mort sont
particulièrement difficiles, parce que la compréhension des sentiments et des sensations de la personne démente reste toujours incertaine. Et il semble
que le deuil d’un patient institutionnalisé soit plus douloureux que le deuil après une période longue et stressante d’aide à domicile.
© 2005 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Alzheimer’s disease (AD) is a dementia in which symptoms include cognitive impairment and also behaviour and psychological disorders. A
study on the family’s responses to the AD of a relative, requires envisaging several points of view. a) The family’s burden. The caregiver who is
generally a spouse, a daughter or a daughter-in-law has to perform difficult tasks. Caring for a patient with AD the caregiver faces a loss of role and
reference. The patient’s child is often playing the role of parent of the parent. Dementia caregiving exposes to high levels of stress and has psy-
chiatric and physical effects on the caregiver, who is likely to suffer from anxiety, depression, alcoholism, and have an increased risk of mortality.
Institutionalisation is a step of critical importance in AD care; the decision has to be made by the family, at the right time; b) The family’s responses
to AD symptoms. The family has to bear the AD symptoms: cognitive symptoms and above all, behavioural and psychological symptoms. The
family senses the diagnosis when the first disorders appear in daily life. Then a large part of the family’s history is lost, as the patient becomes
unable to talk about the present and the past experience. In AD, the psychological disorders are: depression, anxiety, psychotic disorders and
delirium. And in several psychotic disorders, the family may be involved: hallucinations, delusions particularly with ideas of theft, abandonment,
jealousy or misidentification. But the most difficult problems are those of behavioural disorders; the family has to face agitation, aggressiveness,
apathy, eating disorders, sleeping disturbances, sphincter disorders. The family’s responses may be: denial, overprotection, mothering and hyper-
activity in caregiving; c) The relationships with the geriatric institution. They are not always peaceful. Conflicts among patient, family and institu-
tion may occur, when the family resents guilt and ambivalence about institutionalisation. A former family caregiver may compete with the institu-
tion, because he feels deprived of the caregiving role. So, professional caregivers and geriatricians have to propose a therapeutic plan in which
http://france.elsevier.com/direct/AMEPSY/
Annales Médico Psychologiques 164 (2006) 726–731
*
Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (J. Monfort).
0003-4487/$ - see front matter © 2005 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.amp.2005.05.011

family caregivers are implicated; d) The family-patient pathological relationships. The relationships between family and patient may be pathologi-
cal, due to the caregiver’s psychological pathology. The caregiver may suffer from psychiatric or personality disorders, worsened by the relative’s
AD. Sometimes, abuse by the family is a danger for the patient; e) The support to the family. Before institutionalisation, family caregiving must be
helped and supported by professional caregivers and geriatricians. Some treatments reduce behavioural disorders: cognitive enhancement medica-
tion or psychotropic medication. But the most important help is provided by professional care at home, re-education, psychotherapies and, if
possible, treatment in a day care centre. In practice, american medical associations have tried to design strategies (with guidelines) to support the
family caregiver. After institutionalisation, the family must also be supported, so as to keep a pleasant relationship with the relative. The end-of-life
and the death are especially difficult, because the feelings of a person with dementia remain partly misunderstood. And the bereavement of an
institutionalised patient seems to be more painful than the bereavement after a long and stressful period of family caregiving.
© 2005 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Aidant (familial) ; Institutionnalisation ; Maladie d’Alzheimer ; Soignant
Keywords: Alzheimer’s Disease; Family Caregiver; Institutionalisation; Professional (or formal) Caregiver
1. Introduction
La maladie d’Alzheimer est une démence qui se manifeste à
la fois par une altération des fonctions cognitives et par des
troubles psychocomportementaux ; elle retentit lourdement
sur la famille du patient et pose de difficiles problèmes de prise
en charge thérapeutique.
Si l’on étudie les réactions de la famille à la démence d’un
parent, il faut envisager plusieurs points de vue : la charge
familiale de la maladie, les réactions aux symptômes, les rela-
tions avec l’institution gériatrique, les relations pathologiques
famille–dément et le soutien qui peut être apporté à la famille.
2. La charge familiale
Le poids de la maladie d’Alzheimer sur la famille est très
important, surtout pour les 60 à 80 % de patients qui sont au
domicile, mais il ne faut pas le sous-estimer quand le patient
est institutionnalisé [22]. Il se mesure en termes de disponibi-
lité de temps, de disponibilité psychique, d’affectivité, de
soins, et aussi en termes financiers et juridiques.
Cette charge entraîne une souffrance qui n’est pas toujours
exprimée et qui peut même être niée, l’idée de démence et le
nom d’Alzheimer étant alors rejetés. Pour P. Charazac [4],la
démence est un véritable traumatisme familial, avec une me-
nace irreprésentable et le fantasme de l’anéantissement de la
famille entière. Même si toute la famille est concernée, il y a
un aidant principal qui est plus exposé que les autres ; il est le
plus souvent de sexe féminin ; c’est l’épouse, la fille ou la
belle-fille du patient.
L’aidant familial est confronté à une situation de perte de
rôle et de repères ; il doit assumer le paradoxe d’être comme
un parent du parent [5]. Ses idées et ses décisions concernant le
parent ne peuvent plus être considérées comme validées par
l’intéressé, même s’il est apparemment d’accord. Cette position
se retrouve, de façon très pragmatique, sur le plan juridique,
lorsqu’un enfant est le tuteur d’un parent dément. L’enfant doit
assumer, lui-même, cette responsabilité qui peut lui apparaître
très lourde, mais il n’acceptera pas forcément mieux la dési-
gnation d’un tuteur extérieur à la famille.
La question de la prise de décision par le patient dément est
un champ d’investigation qui se développe beaucoup, actuelle-
ment [8]. Des recherches neuropsychologiques sont menées
pour améliorer la prise de décision, notamment sur le plan mé-
dical, mais elles ne concernent que les démences peu évoluées.
Les répercussions familiales de la maladie d’Alzheimer d’un
parent ne sont pas uniformes. Souvent les conjoints sont plus
optimistes que les enfants mais en revanche, certains membres
de la famille vivent un deuil anticipé. En fait, la qualité de vie
du dément agit sur celle de l’aidant et vice-versa [19], mais des
différences d’appréciation s’accentuent avec l’évolution de la ma-
ladie d’Alzheimer ; c’est-à-dire que quand l’aide devient très dif-
ficile, l’appréciation de la qualité de vie du dément, par l’aidant,
devient plus négative que celle du dément lui-même [17].Par
ailleurs, les relations au sein de la famille peuvent se détériorer,
entraînant des troubles de la communication et des conflits.
Plusieurs études sur la santé des aidants familiaux [14,18,
19,21] montrent qu’ils constituent une population à risque sur
le plan physique et sur le plan psychique. Ils ont tendance à
négliger leur propre santé, au profit de celle du parent. Ils pré-
sentent souvent un état anxieux ou dépressif [10], un éthy-
lisme. Des liens ont été, aussi, mis en évidence chez les
conjoints, entre leur stress et des pathologies comme l’hyperac-
tivité du système nerveux sympathique et la baisse des défen-
ses immunitaires [12]. Le risque de mortalité est élevé chez les
aidants épuisés [18].
Selon des données récentes [1], en France, 17 à 35 % des
aidants présentent un état dépressif et quant au risque de mor-
talité du conjoint, il est majoré de 50 à 63 %, par rapport à un
sujet du même âge vivant avec une personne en bonne santé.
L’institutionnalisation est une étape très importante dans la
prise en charge de la maladie d’Alzheimer et, pour la famille,
la décision est difficile à prendre. Elle est retardée quand la
famille s’accroche, parfois de façon déraisonnable, au maintien
au domicile ; elle est précipitée quand un épisode somatique
survient ou quand les troubles du comportement s’aggravent.
3. Les réactions aux symptômes de la maladie
La famille doit supporter les troubles de la maladie d’Alz-
heimer : les troubles cognitifs et surtout psychocomportemen-
taux [13].
Pour ce qui est du déficit cognitif, la famille est souvent la
première à s’en rendre compte et à prendre la décision de pro-
J. Monfort et al. / Annales Médico Psychologiques 164 (2006) 726–731 727

poser au patient une consultation parce qu’il commence à avoir
des difficultés dans la vie quotidienne, des oublis, des condui-
tes aberrantes. Le diagnostic de maladie d’Alzheimer est pres-
senti dans la moitié des cas par l’aidant avant la consultation
médicale (Étude OPDAL, M.-C. Gely-Nargeot et al. [6]). Et,
alors que la famille entrevoit le diagnostic, le patient a ten-
dance à banaliser ses troubles. Au moment de l’annonce du
diagnostic, on retrouve, le plus souvent, une grande ambiva-
lence de la famille sur la nécessité de dire au patient lui-même
le diagnostic de maladie d’Alzheimer. Même dans les pays
anglo-saxons [2], le diagnostic n’est pas toujours révélé au pa-
tient. Selon M.-C. Gely-Nargeot et al., quand il n’est révélé
qu’àl’aidant, 56 % d’entre eux ne souhaitent pas que le diag-
nostic soit annoncé au patient, par crainte de réactions négati-
ves (40 %) ou d’incompréhension (31 %). Déjà, C.-P. Maguire
et al. [11] avaient montré que 83 % des aidants ne voulaient
pas que le diagnostic de maladie d’Alzheimer soit révélé au
patient mais que 71 % d’entre eux voudraient « savoir », si
un jour ils étaient eux-mêmes atteints par la maladie d’Alzhei-
mer. À l’inverse, on retrouve dans l’étude de M.-C. Gely-
Nargeot et al. que 36 % des aidants considèrent que l’annonce
du diagnostic au patient améliore sa prise en charge, en parti-
culier en permettant un dialogue au sein de la famille.
Au cours de l’évolution de la maladie d’Alzheimer, avec
l’aggravation progressive des troubles mnésiques, les enfants
assistent à l’effondrement de tout un pan de l’histoire familiale
car le parent ne peut plus évoquer son vécu personnel passé ou
présent. Le déficit cognitif va aussi imposer aux membres de la
famille la frustration de ne plus être reconnus par le parent.
Ainsi, le deuil anticipé de certains peut se comprendre comme
une réaction à une forme de « mort de l’esprit », précédant la
mort physique. D’ailleurs, R. Schultz, A.B. Mendelsohn et al.
[20] montrent, dans une étude portant sur des aidants fami-
liaux, que leur dépression est améliorée par la mort du parent
dément (non institutionnalisé), comme si le deuil était, en
grande partie, déjà fait.
Dans la maladie d’Alzheimer, les troubles psychiques sont
des troubles thymiques, anxieux, psychotiques ou confusion-
nels. La survenue d’un épisode d’anxiété, de dépression ou
de confusion est toujours impressionnante pour la famille. L’ai-
dant perçoit plus de symptômes dépressifs que le patient lui-
même, surtout si celui-ci n’est pas conscient de ses troubles
cognitifs [3]. Et la forme de la dépression peut créer, en plus,
des malentendus entre la famille et les soignants, quand les
plaintes hypocondriaques sont au premier plan ou quand la dé-
pression est masquée par des manifestations physiques, notam-
ment douloureuses.
Et en dehors de ces états aigus ou subaigus, les proches
continuent à subir les conséquences des éventuels troubles né-
vrotiques antérieurs, persistant au début de la démence : pho-
bies, obsessions, manifestations hystériques. D’un point de vue
psychopathologique, avec l’avancée de la démence, ces types
de mécanisme de défense perdent progressivement de leur effi-
cacité dans la lutte contre l’angoisse et finissent par être rem-
placés par des fonctionnements psychotiques ou régressifs.
Dans les troubles psychotiques, les états délirants et halluci-
natoires ont souvent pour thèmes les relations avec la famille :
vol, préjudice, abandon, jalousie, mésidentification. Les faus-
ses identifications mettent à rude épreuve la tolérance de la
famille ; elles se présentent sous plusieurs formes : soit le pa-
tient est convaincu de la présence auprès de lui d’un parent ou
d’un proche absent ou décédé (c’est le phénomène du compa-
gnon imaginaire ou « hallucinations mnésiques » [15]), soit le
patient reconnaît formellement un parent absent ou décédé
dans une personne de son entourage immédiat familial ou soi-
gnant, soit le patient proteste parce qu’un familier a été rem-
placé par un imposteur (syndrome de Capgras ou illusion des
sosies). Pour le dément, l’appel à ses images parentales est,
sans doute, une recherche de réassurance et de réparation nar-
cissique.
Mais le problème essentiel est celui des troubles du compor-
tement dans la maladie d’Alzheimer ; ils sont, quelquefois, le
motif de la première consultation et sont, très souvent, à l’ori-
gine des entrées en institution. En effet, la famille est particu-
lièrement atteinte par l’agitation, l’opposition, l’agressivité ver-
bale ou physique, l’apathie, les troubles du comportement
alimentaire, les troubles du sommeil et les troubles sphincté-
riens. L’agitation peut se manifester par des comportements
répétitifs, inadéquats, mais aussi par la déambulation ou la fu-
gue, et les troubles du comportement moteur aggravent le
risque de chute. L’apathie et la démotivation sont, sans doute,
moins conflictuelles que l’agressivité et l’opposition, mais
amènent au découragement de l’aidant. La réduction de l’appé-
tit et les troubles praxiques de l’alimentation nécessitent plus
d’attention et d’aide au moment des repas. À un stade avancé
de la maladie d’Alzheimer, quand les troubles alimentaires en-
traînent une dénutrition, les questions soulevées par la pose
d’une sonde nasogastrique ou par une gastrostomie sont évo-
quées avec la famille. Les troubles du sommeil, surtout l’inver-
sion du rythme veille–sommeil, perturbent beaucoup la vie
quotidienne de la famille mais ses plaintes les plus fréquentes
sont en rapport avec les problèmes posés par les troubles
sphinctériens, c’est-à-dire l’incontinence, urinaire d’abord, puis
fécale.
Face aux troubles manifestes de la maladie d’Alzheimer, la
famille peut garder une attitude de déni ou, comme le décrit
L. Ploton [16], avoir des réactions qui vont de la protection
au maternage ou même à la symbiose avec « hyperintimité ».
Il faut dire que dans la prise en charge de la maladie d’Alzhei-
mer, la limite entre aide et soin est floue ; par exemple, la
toilette relève, au début, de l’aide mais, avec l’évolution, elle
devient un soin fait par l’aidant puis par le soignant. Il y a
souvent, dans la famille, une hyperactivité et un hyperinvestis-
sement des soins, et les aidants surmenés sont parfois énervés,
agressifs et supportent mal les conditions de vie imposées par
la maladie d’Alzheimer. En fait, le patient par sa dépendance
provoque consciemment ou inconsciemment une culpabilisa-
tion de l’aidant qui se sent pris dans des conduites de répara-
tion, la culpabilité étant sous-tendue par l’agressivité [5].
Et l’on a vu que la prise en charge d’un parent atteint de
maladie d’Alzheimer expose les aidants familiaux à des trou-
bles psychiques et physiques et à un risque de mortalité élevé.
J. Monfort et al. / Annales Médico Psychologiques 164 (2006) 726–731728

4. Les relations avec l’institution gériatrique
En gériatrie, on entend par institution l’établissement ou le
service qui prend en charge le patient âgé de façon prolongée ;
il s’agit d’une maison de retraite ou d’un service hospitalier de
soins de longue durée (anciennement long séjour). Mais pour
ce qui est des problèmes de relations avec l’institution, ils se
posent, évidemment, aussi dans les services de soins de suite et
de réadaptation (anciennement moyen séjour) et dans les autres
services hospitaliers où le patient dément est soigné.
Lorsque le patient est dans l’institution, les relations entre
les différents intervenants ne sont pas toujours paisibles. Dans
notre expérience qui a pour cadre un service hospitalier de gé-
rontologie, recevant des patients en moyen et long séjour,
quand des tensions surviennent entre le patient, les soignants
et la famille, c’est souvent au début du séjour et les conflits
s’organisent autour des mêmes thèmes :
●le patient reproche à sa famille de l’avoir fait entrer sans son
accord et réclame son retour immédiat au domicile ; il ac-
cuse les soignants de le maltraiter ;
●les soignants trouvent que la famille est peu présente et
abandonne son parent, mais quand elle vient en visite, elle
est d’une exigence extrême et critique tout : les soins, l’ins-
titution, les autres patients ; par ailleurs, la famille trop pré-
sente peut être ressentie comme « envahissante » ;
●la famille critique l’institution parce qu’elle prend mal en
charge son parent, et que le coût financier est excessif (long
séjour) ; les critiques portent sur l’hébergement, les repas,
en plus des soins ; les soignants ne sont pas assez attentifs,
pas assez disponibles ; les médecins ne sont pas assez pré-
sents, pas accessibles. Les griefs sont renforcés par les éven-
tuels défauts d’organisation d’un hôpital : retards, rendez-
vous raté, dossier égaré…
Pour mieux comprendre ces conflits, il faut envisager les
différentes façons dont l’institutionnalisation est vécue par le
patient, par sa famille et par les soignants.
Le patient lui-même va devoir s’adapter à l’institution et
supporter les différentes pertes dues au changement de ses
conditions de vie ; ce travail de deuil se fait plus ou moins
complètement, selon les possibilités de compréhension et
d’élaboration psychique.
En ce qui concerne la famille, elle est souvent ambivalente
par rapport à l’institution et se trouve dans un état d’angoisse,
de culpabilité et de dévalorisation qui se manifeste par de l’a-
gressivité. Elle peut avoir un sentiment d’échec parce que le
traitement à domicile n’a pu être prolongé ; alors, la famille
risque de rechercher des soins idéaux, donc impossibles, ou
croire à l’effet magique d’une hospitalisation. Parfois un aidant
familial s’attribue une parfaite compétence, une expertise pour
tout ce qui concerne les soins à donner à son parent ; souvent il
s’agit d’un aidant principal qui était isolé avant l’admission.
Dans sa rivalité avec les soignants de l’institution, il espère
obtenir une satisfaction narcissique après avoir été dépossédé
de sa propre mission de soignant.
Àl’occasion de l’entrée en institution, il n’est pas rare qu’au
sein de la famille les relations se modifient ; de vieilles ran-
cœurs, de vieux conflits resurgissent ; des divisions s’accen-
tuent. Les médecins et les soignants en sont éventuellement
pris à témoin ou à parti.
Plus profondément, la famille ressent l’entrée en institution
comme une « répétition symbolique de la mort » [16] et elle est
confrontée à « un travail de séparation » [14], différent du tra-
vail de deuil car les changements internes à la famille restent
dépendants de la réalité externe de l’absent et de sa maladie.
Pour les soignants, la prise en charge du patient peut être
difficile et entraîner des sentiments d’impuissance, de dévalo-
risation et de culpabilité. En outre, le mécontentement et
l’agressivité des familles sont des facteurs de déstabilisation
qui viennent aggraver un dysfonctionnement institutionnel.
Un travail d’équipe permet de mieux évaluer la souffrance et
la pathologie éventuelle de la famille et donc de mieux com-
prendre l’impossibilité du maintien à domicile ou simplement
la nécessité d’un séjour dit « pour soulagement familial ».
L’équipe soignante et les médecins travaillent dans le cadre
d’un projet thérapeutique pour le patient, dans lequel la famille
doit être impliquée. Mais l’ambivalence de la famille peut ren-
dre cette implication incertaine, inconstante, voire hostile.
Dans les services de psychogériatrie où sont traités les trou-
bles psychocomportementaux sévères de la maladie d’Alzhei-
mer, les relations entre l’institution et la famille sont, en géné-
ral, tendues. Et dans les grosses institutions psychogériatriques,
tous les problèmes relationnels sont amplifiés. Des phénomè-
nes de masse renforcent l’agressivité des familles et la violence
institutionnelle [7] ; les médecins et les soignants deviennent
alors les boucs émissaires d’une situation due à l’ambivalence
de la famille et aux contraintes institutionnelles.
5. Les relations pathologiques famille–dément
On sait que les modalités d’annonce du diagnostic peuvent
influer sur les relations famille–patient. En effet, la révélation
du diagnostic et du pronostic peut provoquer des réactions ex-
cessives ou pathologiques. Souvent, la famille est entraînée
dans une hyperactivité combattante, peut-être dispersée, et elle
ne prend pas toujours suffisamment en compte les désirs du
parent, d’autant plus que celui-ci a du mal à les exprimer.
Mais des relations pathologiques entre l’aidant et son parent
peuvent apparaître. Dans certains cas, elles sont dues à la pa-
thologie psychique personnelle de l’aidant, pathologie anté-
rieure à l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Les troubles
psychiatriques ou troubles de la personnalité de l’aidant sont
aggravés ou décompensés par la maladie d’Alzheimer du pa-
rent ; ce sont des troubles anxieux, des troubles thymiques, un
éthylisme, une personnalité obsessionnelle, une personnalité
dépendante, une personnalité paranoïaque. Dans d’autres cas,
la pathologie relationnelle entre l’aidant et le parent est une
histoire ancienne ; la démence vient compliquer, plus encore,
leur relation.
La pathologie d’un enfant peut se manifester par une atti-
tude de captation du parent dément ; il prend alors une position
J. Monfort et al. / Annales Médico Psychologiques 164 (2006) 726–731 729

de toute-puissance, écartant des responsabilités et des décisions
tout le reste de la famille.
Des relations très perturbées entre l’aidant et le dément de-
viennent parfois complètement exclusives et fermées à toute
intervention extérieure. À ce stade d’« enfermement à deux »,
l’approche thérapeutique est impossible.
Les troubles du comportement de la maladie d’Alzheimer
ajoutés à des troubles psychiques de l’aidant risquent d’aboutir
à des situations de maltraitance. Des mesures de protection du
patient dément sont alors nécessaires : hospitalisation et mise
en place d’une protection juridique.
6. Le soutien apporté à la famille
Avant l’institutionnalisation, le suivi gériatrique du patient
atteint de maladie d’Alzheimer comporte le traitement médical
et surtout l’organisation et l’adaptation des aides à domicile,
car actuellement en France, une famille sur trois assume la si-
tuation sans aucune aide extérieure [1]. Les médicaments utili-
sés sont à visée cognitive (et comportementale) –anticholines-
térasique, glutamatergique –, ou sont des traitements
spécifiques des troubles psychocomportementaux –antidépres-
seur, thymorégulateur, antipsychotique. Les aides à domicile
comprennent les aides-ménagères, les soins, les rééducations,
parfois des aides psychothérapiques et, quand cela est possible,
une hospitalisation de jour. La prise en charge thérapeutique a
pour but de traiter les différents troubles de la maladie d’Alz-
heimer, notamment les troubles psychocomportementaux et,
par conséquent, de réduire la charge familiale.
Au cours du suivi ambulatoire, il faut aussi informer la fa-
mille, expliciter le sens des troubles psychocomportementaux,
notamment comme adaptation au déficit cognitif. Des conseils
sont nécessaires pour optimiser le moment de l’entrée en ins-
titution afin d’éviter de trop attendre si le maintien au domicile
devient difficile, ou de se précipiter alors que la famille et le
patient ne sont pas prêts.
De façon pratique, des associations médicales américaines
tentent d’élaborer des stratégies de soutien à l’aidant [19] du
patient atteint de maladie d’Alzheimer. Le but est d’améliorer
le fonctionnement de la dyade dément–aidant, en se référant,
principalement, au modèle théorique stress–santé et en recher-
chant la meilleure intervention dans plusieurs domaines : la
sécurité (actes du dément dangereux pour lui-même et pour
l’aidant), l’attention de l’aidant à sa propre santé, son soutien
familial et social, la dépression de l’aidant, les troubles psycho-
comportementaux du dément. Ainsi, par exemple, il est sûr que
le traitement de la dépression de l’aidant est non seulement un
bénéfice pour lui-même, mais aussi un des moyens d’améliorer
sa relation avec le dément.
Quand le patient dément est institutionnalisé, la famille doit
trouver la possibilité d’exprimer ses angoisses, sa culpabilité,
ses obligations vis-à-vis de son parent, son besoin de répara-
tion. La disponibilité des médecins et des soignants doit être
suffisante pour assurer cette écoute et permettre de conclure
une alliance thérapeutique et élaborer un projet de soin, bien
accepté par tous.
Un soutien psychothérapique est indiqué dans les situations
les plus douloureuses. P. Charazac [4] propose « une guidance
familiale » qui, par la création d’un espace et d’un temps de
symbolisation, aide à restaurer le narcissisme familial, et aide à
faire « le travail de séparation ». Cependant, il faut aussi que la
famille arrive à maintenir une relation avec le parent dément en
tant que sujet. Dans la mesure du possible, les discussions le
concernant doivent se faire en sa présence et il faut éviter de
garder des non-dits (à propos du long séjour, de la mort du
conjoint, de la vente du domicile…), car leur perception par
le patient peut entraîner un état confusionnel.
Même dans la démence sévère, le « savoir affectif » (tel que
le conçoit G. Le Gouès [9]), à défaut de savoir cognitif, permet
de maintenir un certain niveau d’échanges avec l’entourage ; le
dément et sa famille peuvent en tirer quelques satisfactions.
Mais face aux attitudes régressives, infantiles, la famille,
comme le soignant, doit accepter de réduire son intervention
à la réassurance, c’est-à-dire être comme un parent rassurant
l’enfant perdu.
La famille aura besoin d’être plus particulièrement soutenue
au moment de la fin de vie et de la mort dans l’institution.
L’attitude de la famille est compliquée par le fait que la com-
préhension des sentiments et des sensations du parent dément
reste toujours incertaine. Et il semble que le deuil soit plus
difficile quand le patient est institutionnalisé, si on compare
au cas où sa mort survient après une longue et stressante pé-
riode d’aide à domicile [20].
7. Conclusion
Les troubles de la maladie d’Alzheimer et plus particulière-
ment les troubles psychocomportementaux pèsent lourdement
sur la famille du patient. L’institutionnalisation pose différents
problèmes aux intervenants : patient, famille, institution ; les
relations entre ceux-ci peuvent être conflictuelles. La mise au
point du projet thérapeutique et le soutien apporté à la famille,
sous ses différentes formes, sont des moyens qui permettent
d’améliorer la prise en charge du patient.
Références
[1] Association France Alzheimer. Paris : Troisième congrès national; 14/09/
2004.
[2] Bamford C, Lamont S, Eccles M, Robinson L, May C, Bond J. Disclo-
sing a diagnosis of dementia: a systematic review. Int J Geriatr Psychia-
try 2004;19:151–69.
[3] Burke WJ, Roccaforte WH, Wengel SP, McArthur-Miller D, Folks DG,
Potter JF. Disagreement in the reporting of depressive symptoms bet-
ween patients with dementia of the Alzheimer type and their collateral
sources. Am J Geriatr Psychiatry 1998;6:308–19.
[4] Charazac P. Psychothérapie du sujet âgé et sa famille. Paris: Dunod;
1998.
[5] Gaucher J, Ploton L, Talpin JM, Israël L. Le vieillard et sa famille. In:
Léger JM, Clément JP, Wertheimer J, editors. Psychiatrie du sujet âgé.
Paris: Flammarion; 1999.
[6] Gely-Nargeot MC, Derouesné C, Selmès J. Enquête européenne sur l’éta-
blissement et la révélation du diagnostic de maladie d’Alzheimer. Étude
réalisée à partir du recueil de l’opinion des aidants familiaux. Psychol
NeuroPsychiatr Vieillissement 2003;1:45–55.
J. Monfort et al. / Annales Médico Psychologiques 164 (2006) 726–731730
 6
6
1
/
6
100%