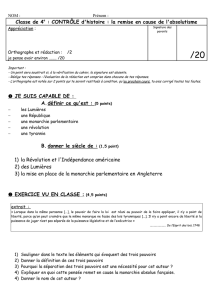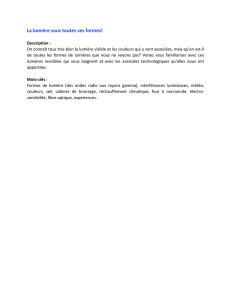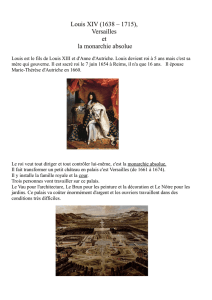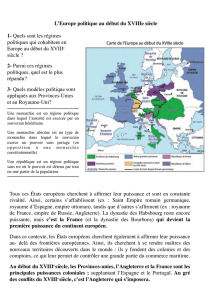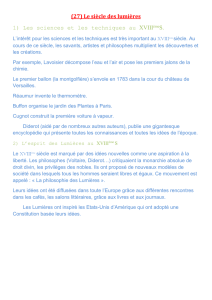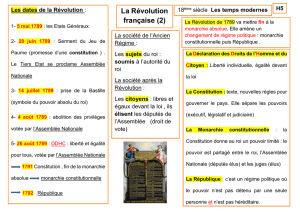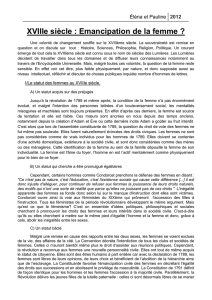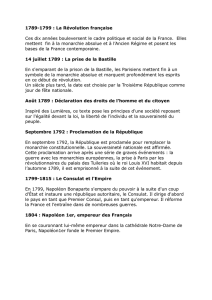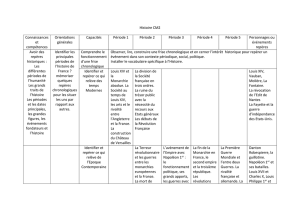1/1 - Ressources en histoire-géographie

1
Fiches réalisées par Arnaud LEONARD
(Lycée français de Varsovie, Pologne)
à partir de sources diverses, notamment des excellents « livres du professeur »
des éditions Nathan (dir. Guillaume LE QUINTREC)

2
HM – L'Europe et l'élargissement du monde XVe-XVIe s.
Approche scientifique Approche didactique
Définition du sujet (termes et concepts liés, temps court et temps long, amplitude
spatiale) :
Insertion dans les programmes (avant,
après) :
Sources et muséographie :
Ouvrages généraux :
Serge Gruzinski, Le Destin brisé de l’Empire aztèque, Gallimard, coll. «Découvertes », Paris, 1995. (Spécialiste de l'Amérique
latine, des colonisations de l'Amérique et de l'Asie, notamment des métissages et des espaces hybrides).
C. Bernard et S. Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde, Fayard, Paris, 1991.
Jean Meyer, L’Europe à la conquête du Monde, Armand Colin, coll. «U», Paris, 1990. (un des spécialistes de l'histoire maritime à
l'époque moderne).
Bartolomé et Lucile Bennassar, 1492 Un monde nouveau ?, Perrin, 1991, 273 pages
Michel Chandeigne (dir), Lisbonne hors les murs. 1415-1580. L'invention du monde par les navigateurs portugais, Autrement,
1992, 285 pages
Guy Martinière et Consuelo Varela (dir), L'État du monde en 1492, La Découverte, 1992, 638 pages
J. Favier, Les Grandes Découvertes, Fayard, Paris, 1991.
Pierre Chaunu, Conquête et exploitation des Nouveaux Mondes, PUF, Paris, (1969) 1991. (spécialiste de l'Amérique espagnole et
de l’histoire sociale et religieuse de la France des XVIe-XVIIIe siècles).
Michel Lequenne, Christophe Colomb amiral de la mer océane, Gallimard, coll. «Découvertes », Paris, 1991.
Marco Polo, Le devisement du monde, Textes choisis, Bibliothèque Gallimard, rééd., 1998.
Christophe Colomb, Journal de bord 1492-1493, Imprimerie nationale, 1992.
Stephen GREENBLATT, Ces merveilleuses possessions : découvertes et appropriation du Nouveau Monde au XVIe siècle, Les
Belles Lettres, Paris, trad. fr., 1996
Documentation Photographique et diapos :
Civilisations amérindiennes - n° 7022 (1994) / Claude Baudez, Danièle Lavallée
1492 : les royaumes ibériques - n° 7011 (1992) / Bernard Vincent, Jean-Frédéric Schaub
« Les grandes découvertes », n° 6075, février 1985.
Revues :
Histoire de l'Amérique latine , Dossier H&G, 371 juillet août 2000 et 374 mai 2001
2000 ans de mondialisation / Collectif, in LES COLLECTIONS DE L'HISTOIRE N° 38, Hors-Série, Janvier-Mars 2008 :
- « L'Europe à la conquête du monde » (Joël Cornette) : L'expansion géographique des Européens, à la fin du XVe siècle,
bouleverse l'histoire du monde. Désormais, tout communique, les frontières sont abolies, la Terre est unifiée. Et les monarques se
reprennent à rêver d'empire universel
- Un christ métis (Serge Gruzinski) : Les conquistadors voulaient christianiser l'Amérique pour mieux l'assimiler. Ils y parvinrent
au prix de massacres et d'un long travail sur les esprits. Mais aussi d'un certain nombre de malentendus : en adoptant le
catholicisme, les indigènes l'ont profondément transformé
- Ces plantes venues du Mexique (Martine Pedron) : L'arrivée des conquistadors en Amérique latine à la fin du XVe siècle est le
point de départ d'un authentique métissage culinaire. Les produits importés d'Amérique modifient en profondeur la gastronomie
européenne
Pierre Chaunu: "Colomb, ce fou..." dans L'Espagne / Collectif, in LES COLLECTIONS DE L'HISTOIRE N° 31, Avril-Juin 2006
L’Histoire, n° spécial 146 : «1492 : la découverte de l’Amérique », juillet-août 1991.
Carte murale :
Enjeux scientifiques (épistémologie, historiographie et renouvellement des
savoirs, concepts, problématique) :
L’objectif est de montrer comment et pourquoi la découverte de nouveaux
mondes a été rendue possible et comment la découverte a entraîné la colonisation
et l’exploitation, premier temps de la domination européenne sur le monde.
Une étude sur Marco Polo permet de faire le lien avec le Moyen Âge et de
montrer ce que les explorateurs des XVe et XVIe siècles doivent à leurs
prédécesseurs. Ce sujet s’articule autour d’un axe central : la conquête de
l’Amérique.
BO futur 5e : « Les découvertes européennes et la conquête des empires ouvrent
le monde aux Européens.
Ouverture au monde :
- un voyage de découverte et un épisode de la conquête ;
- une carte des découvertes européennes et des premiers empires.
Connaître et utiliser les repères suivants :
− Le premier voyage de Christophe Colomb (1492) ou le voyage de Magellan
(1519-1521) sur une carte du monde
Enjeux didactiques (repères, notions et
méthodes) :
BO 5
e
actuel : « L’Europe à la découverte du
monde (3 à 4 heures)
Les grands voyages de découverte terrestres
et maritimes sont analysés à partir d’une
carte. La destruction des civilisations
amérindiennes et la constitution des premiers
empires coloniaux font l’objet d’une étude
synthétique.
• Cartes : les grandes découvertes ; les
empires coloniaux.
• Repère chronologique : prise de Grenade,
Christophe Colomb en Amérique (1492).
• Documents : Marco Polo : le Livre des
Merveilles ; une caravelle. »
Socle. Ajout au commentaire
« Le Livre des Merveilles de Marco Polo sert

3
Raconter et expliquer un épisode des découvertes ou de la conquête de l’empire
espagnol d’Amérique »
BO 2nde : « Humanisme et Renaissance
– Une nouvelle vision de l'homme et du monde
Dans l'Europe du XVe et XVIe siècles se produit une modification profonde de la
vision de l'homme sur sa condition et sur le monde, ainsi que la naissance d'un
esprit scientifique. Ces bouleversements sont facilités par les mutations
importantes des moyens de communication et de diffusion des idées et des
savoirs : invention de l'imprimerie, multiplication des universités, collèges et
académies. L'utilisation de cartes permet de prendre conscience de l'élargissement
du monde (les grandes découvertes) et de localiser les exemples choisis. »
de support à une évocation du monde chinois.
On veille à l’articulation de la découverte du
continent américain par les Européens avec
celle de l’Amérique en géographie. »
Plan, entrées originales (événements, acteurs, lieux, œuvres d’art), supports
documentaires et productions graphiques :
La partie 1 met l’accent sur les raisons des grands voyages et les découvertes
territoriales qui s’en suivent. Elle est étroitement liée à l’étude de cas qui suit sur
les conditions matérielles des grandes découvertes ; à travers celle-ci on peut
envisager les progrès techniques qui ont permis aux Européens d’affronter la
haute mer.
La partie 2 constitue donc le point fort de l’étude de la conquête de l’Amérique.
L’étude des civilisations amérindiennes laisse place à la notion de «rencontre »
(premiers contacts, conquête et colonisation) des Européens avec les Indiens.
Il faut donc terminer logiquement cette étude par la présentation des premiers
empires coloniaux et l’idée de domination européenne (partie 3).
1. L’aventure des grandes découvertes
Mais où sont les isles fortunées...
Tandis que Constantinople tombe aux mains des Turcs, l’Europe s’ouvre aux
terres inconnues. Le Vénitien Marco Polo avait déjà connu la Chine au XIIIe
siècle, les voyageurs de la Renaissance firent plus : Sumatra en 1419, Le Caire,
Calicut, l’Abyssinie en 1494 ; Damas, Goa, Malacca... On part chercher les pays
merveilleux que les fables et les chroniques médiévales ont tant décrits : l’Inde où
les pygmées luttent contre les grues, où les hommes ont des têtes de chiens ; le
paradis terrestre que l’on croit en Asie, visité déjà par Alexandre, et où séjournent
les deux géants Gog et Magog, non loin du tombeau de l’apôtre Thomas et du
royaume légendaire du Prêtre Jean. Naviguant d’une île à l’autre des petites
Antilles, Colomb croit voir les cinq mille îles fortunées dont parlait Jean de
Mandeville au début du XIVe siècle. Le Rio d’Oro (Eldorado) que l’on croit
d’abord en Afrique est localisé et cherché sans relâche au Venezuela.
L’Europe part en quête de ses rêves, mais aussi de l’or, de l’argent, des épices et
des parfums, pour combler des besoins que le luxe de la Renaissance et les
expéditions guerrières nécessitent. Vers l’est d’abord avec les bateaux portugais,
puis vers l’ouest, ce sont les Espagnols qui foulent une terra incognita, sans que
l’on ait tout de suite compris que Colomb venait de découvrir un continent ; les
Français, les Anglais cherchent une route vers l’Extrême-Orient qui ne fût pas
contrôlée par les Ibériques : surgit la côte nord-américaine et les glaces de la baie
d’Hudson.
Avec les voyages commence la curiosité pour les « sauvages ». Dans la deuxième
moitié du XVIe siècle se multiplient les récits sur les mœurs, les coutumes
étranges. L’homme européen venait d’apercevoir un nouveau rêve : il existait des
peuples nus qui ignoraient la pudeur et la religion...
Quelles parties du monde sont découvertes par les Européens entre la fin du XVe
siècle et le XVIe siècle ?
Au cours des XVe et XVIe siècles, les Européens ont déplacé les limites du
monde connu. Vers 1400, les terres connues se limitent à l’Europe occidentale, à
une partie de l’Asie (notamment grâce aux routes de la soie, des épices, de la
porcelaine et aux voyages de Marco Polo), ainsi qu’à une partie des côtes de
l’Afrique et à la péninsule arabique. Vers 1500, les hommes, grâce à des
expéditions comme celles de B. Diaz (1487-1488) et de Vasco de Gama (1497-
1499), complètent leur connaissance du pourtour africain ainsi que d’une partie
de l’Inde. L’Extrême-Orient est lui aussi peu à peu mieux connu, tandis que la
nouveauté essentielle de la fi n du XVe siècle et du début du XVIe réside dans la
découverte et la conquête progressive du nouveau continent américain. Le 12
Activités, consignes et productions des élèves
:
Marco Polo raconte ses aventures dans Le
Livre des merveilles
On a pu recenser cent quarante trois
manuscrits du Livre des merveilles. Écrit au
départ en français, il en existe diverses
traductions. Henri le Navigateur et
Christophe Colomb en possédèrent chacun un
exemplaire illustré. La double page vise à
la fois à présenter les aventures de Marco
Polo et à montrer en quoi leur récit,
conjuguant le réel et le légendaire, ont fasciné
et inspiré les grands explorateurs des XVe et
XVIe siècles.
L’élargissement du monde connu
Lorsque Christophe Colomb arrive au terme
de son voyage, les Européens connaissent
déjà la Chine (le voyage de Marco Polo a lieu
entre 1275 et 1291), l’Inde et le Sud-
Est asiatique. En Afrique, seul le littoral est
connu ; le continent reste mystérieux : les
navires portugais ont découvert et colonisé
les îles du Cap-Vert, Madère et les
Açores. Au-delà, s’étend la « mer océane »
dont on ignore les limites.
Le Portugais Magellan franchit une étape
cruciale en contournant le continent
américain (1519) : il découvre l’océan
Pacifique. Son équipage rentre à San Lucar
en 1522 en ayant effectué le tour du monde
en 1483 jours (Magellan est mort aux
Philippines).
Vasco de Gama contourne l’Afrique (1497-
1498) en empruntant le cap de Bonne-
Espérance (découvert dix ans plus tôt par
Bartolomé Diaz) et longe les côtes orientales
du continent. Il explore ensuite l’océan Indien
et ouvre la route des épices jusqu’à Goa.
Les explorations des Français et des Anglais
sont mineures, comparées aux empires que se
taillent les Espagnols et les Portugais.
La découverte de Colomb n’est pas
immédiatement perçue comme un événement
important (le navigateur
pense lui-même avoir débarqué en Asie).
Les représentations géographiques évoluent
lentement, a fortiori quand elles remettent en
cause la Bible et les autorités antiques.
Amerigo Vespucci affirme en 1503
qu’il s’agit bien d’un nouveau continent et

4
octobre 1492, le Génois Christophe Colomb, persuadé d’avoir atteint l’Inde par
l’ouest, découvre les Antilles. La découverte des Amériques se poursuit ensuite
grâce à divers explorateurs comme Vespucci, Cabot, Magellan, Verrazzano,
Cartier. Les navigateurs, grâce à leur audace et aux progrès de la navigation,
s’éloignent des côtes et complètent la connaissance des mers et des océans. Ainsi,
entre 1519 et 1522, l’expédition menée par le navigateur portugais Magellan puis
par son second, Elcano, réalise le premier tour du monde par voie maritime, en
contournant l’Amérique par le sud. Cela amène les hommes à découvrir que le
globe est beaucoup plus vaste et complexe que tout ce que l’on avait pu imaginer.
L’espace géographique connu s’élargit donc et les Européens prennent
conscience de leur capacité à le maîtriser.
Le planisphère de Toscanelli au milieu du XVe siècle
L’Amérique, l’Océanie et l’Antarctique ne sont pas représentés car encore
inconnus. Les parties du monde les mieux connues et représentées sont l’Europe
et une partie de l’Asie. Le reste de ce dernier continent est cependant encore fi
guré de façon très imprécise et fautive de même que l’Afrique. En 1507, une carte
laisse percevoir des progrès dans la représentation de l’Afrique et du continent
asiatique même si ces derniers restent encore mal connus. L’Océanie et
l’Antarctique n’y apparaissent pas. Le phénomène le plus remarquable est la
représentation du continent américain nouvellement découvert. Ces améliorations
sont le fruit des Grandes Découvertes, favorisées par une meilleure connaissance
de la carte des vents et des courants, par les progrès dans le domaine de la
navigation et l’utilisation d’instruments de mesure comme la boussole ou
l’astrolabe. Ces Découvertes sont aussi le résultat des motivations politiques,
religieuses et économiques des souverains européens. Ainsi, les Portugais
contournent l’Afrique (Diaz, Vasco de Gama) ; les Espagnols traversent
l’Atlantique (Colomb) et découvrent l’Amérique. En 1503, Amerigo Vespucci
affi rme qu’il s’agit d’un nouveau continent et non d’une île. Cette idée est
reprise ici par Martin Waldseemüller qui donne sur sa carte le nom du navigateur
au continent.
Uun monde nouveau…
Gravure de Théodore de Bry, 1594. Paris, BN.
Le XVIe siècle s’ouvre au monde lors des Grandes Découvertes. La gravure de
Théodore de Bry représente l’instrument des voyages transocéaniques: les trois
caravelles de Christophe Colomb abordent Hispaniola. La gravure prévoit ce que
devint la colonisation espagnole du continent américain, puisqu’en arrière-plan
on voit les sauvages fuir devant le débarquement espagnol. Ce document
condense ainsi plusieurs aspects des Grandes Découvertes, la croix plantée sur la
plage évoquant le formidable élan missionnaire qui anima les colons. Au premier
plan, la représentation de Colomb et des Indiens témoigne de cette découverte de
« l’autre» d’où naîtra le mythe du bon sauvage en Europe.
La découverte du monde
Les Grandes Découvertes ont considérablement élargi le monde connu, puisqu’à
la fin du XVIe siècle, les Européens ont mis le pied sur la plupart des continents.
Les conquêtes coloniales n’ont cependant pas encore permis l’exploration de
l’intérieur de certains continents : c’est le cas de l’Amérique du Sud, notamment
le coeur amazonien du Brésil, ainsi qu’une partie de l’actuelle Bolivie. La logique
d’une colonisation de comptoirs, qui ponctuent les côtes africaines, a de la même
manière retardé la découverte de l’Afrique intérieure. Une partie de l’Amérique
du Nord est encore vierge, tout comme l’Australie. De même, les moyens de la
colonisation restent trop rudimentaires pour que les Européens s’aventurent dans
le Grand Nord canadien ou sibérien.
Les commerces méditerranéen et hanséatique développés pendant la période
médiévale sont désormais concurrencés en valeur par des flux transocéaniques :
en provenance d’Asie en contournant la corne de l’Afrique, mais aussi à partir de
l’Afrique de l’Ouest, axe qui servira plus tard au commerce triangulaire. Ce sont
surtout les flux transatlantiques qui se développent et qui permettent notamment
l’afflux des métaux précieux du Nouveau Monde dans la péninsule Ibérique.
2. La conquête de l’Amérique
non d’une île « car il s’étend sur une très
grande longueur de côtes ». Cette idée est
reprise en 1507 par un éditeur installé à
Saint-Dié, Martin Walseemüller qui propose
de baptiser le « quatrième continent » du nom
du navigateur « subtil » qui a vraiment pris la
mesure de l’immensité du territoire.
Les grandes découvertes
L’humanisme symbolise d’abord l’ouverture
de nouveaux horizons géographiques. Les
grands voyages sont favorisés par les
conditions techniques (invention de la
caravelle…), économiques (besoin de métaux
précieux et d’épices) et religieuses
(la fermeture de la route commerciale entre
l’Occident et l’Extrême-Orient par les
Ottomans relance l’esprit de reconquête). Ce
mouvement est impulsé par le Portugal : les
souverains patronnent des expéditions
maritimes vers l’Afrique dans le
but de ramener de l’or (Soudan), du sel, du
sucre… C’est aussi à ce moment que débute
la traite des Noirs (milieu du xve siècle).
En 1476, le Génois Christophe Colomb
développe le projet d’aller aux Indes en
naviguant vers l’ouest. Son objectif est
d’atteindre le Japon, dont Marco
Polo (marchand vénitien du xıııe siècle qui a
résidé en Chine) a vanté les richesses. La
reine Isabelle de Castille accepte de financer
l’expédition de Colomb. 1492 voit le départ
de trois caravelles qui découvrent les
Bahamas, Cuba, Haïti, et la côte de
l’Amérique Centrale au cours de quatre
voyages. Mais Christophe Colomb est
convaincu d’avoir trouvé la route des Indes.
C’est Amerigo Vespucci, reprenant le même
trajet, qui découvre, sur les côtes du
Venezuela, que cette terre est un nouveau
continent. Parallèlement, Vasco de Gama,
soutenu par le roi du Portugal Manuel Ier, se
rend en Inde. Le Portugal contrôle alors
l’océan Indien. Une expédition
menée par Alvarez Cabral vers l’Amérique
permet aussi la découverte du Brésil.
L’expédition de trois ans (1519-1522) du
Portugais Magellan accomplit le premier tour
du monde. La preuve est faite qu’il existe une
route occidentale vers les
Indes et que la Terre est une sphère.
Deux grandes découvertes sont effectuées par
les Européens :
– l’existence d’un quatrième continent. Celui-
ci prendra le nom du navigateur Amerigo
Vespucci qui est le premier à affirmer
l’existence de ce continent au début du XVIe
siècle ;
– la preuve que la Terre est une sphère, grâce
au voyage de Magellan, confirmant ainsi la
géographie de Ptolémée.
L’Occident découvre une nouvelle plante

5
La rencontre entre Christophe Colomb et les Indiens.
Cette épître, connue sous le nom de « lettre à Santangel », est sûrement assez
semblable à celle que Colomb adresse au même moment aux souverains
espagnols, Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille, mais qui n’est pas
parvenue jusqu’à nous. Elle rapporte le succès de son entreprise. Il y fait état de
ses bonnes relations avec les populations rencontrées (« sans rencontrer aucune
opposition »). Dans ses écrits, Colomb fait souvent mention de l’accueil que les
autochtones lui réservent et des cérémonies de don et de contre-don qui le
caractérise. Il se livre ici à une description de l’aspect physique (« tout nus », «
belle stature », « pas noirs ») et des traits de caractère de ces populations qu’il
présente comme dociles, naïves et inoffensives. Le Génois en fait une sorte de
peuple infantile. Leur innocence, décrite ici, commence alors à alimenter le
mythe du bon sauvage. !
Le texte de Colomb fait écho aux légendes entretenues autour de la cruauté
supposée des populations indiennes. En effet, les Européens ont assimilé le
nouveau monde tantôt à l’enfer, tantôt au paradis. Et l’indigène a pris la forme
soit du cannibale, soit du bon sauvage. Si Colomb insiste sur le caractère
vertueux et pacifi que des Indiens, contredisant l’image qu’on leur prête depuis
l’Europe (« je n’ai pas encore rencontré d’hommes monstrueux »), il écrit
néanmoins : « j’ai pourtant entendu dire qu’il y a une île peuplée de gens très
féroces qui mangent la chair humaine ». Ainsi, des récits du XVIe siècle nous
rapportent le culte sanguinaire des Aztèques, la cruauté de certains Indiens
Caraïbes (d’où vient le terme cannibale) qui apparaissent comme une résurgence
des récits antérieurs comme ceux de Marco Polo décrivant les cynocéphales, ces
hommes à tête de chien qui aboient au lieu de parler et se nourrissent de chair
humaine.
Si le portrait des Indiens tracé par Colomb est positif, il est aussi assez méprisant
dans la mesure où, le caractère pacifique et la bonté qu’il dépeint sont jugés
comme une faiblesse exploitable par les Européens. Son discours annonce les
dérapages de la colonisation future. Il propose en effet d’assujettir les Indiens et
d’exploiter les ressources nombreuses de leur territoire (or, épices, coton, mastic,
bois d’aloès…). On retrouve aussi dans ce texte la mission d’évangélisation que
se donne Colomb mandaté par les souverains espagnols : « je leur donnai mille
jolies choses pour qu’ils nous prennent en affection ; ils seront ainsi attirés à se
faire chrétiens ». En effet, la colonisation a d’abord un objectif religieux, dans le
prolongement de la Reconquista qui vient de se terminer avec la prise de Grenade
en 1492. On peut voir dans cette lettre les prémisses d’une domination fondée sur
des rapports de force, de mépris, d’exploitation et d’acculturation des
populations.
La conquête du Nouveau Monde
« Les Indiens sont propres à être commandés »
Dans cet extrait de son Journal de bord, Christophe Colomb rend compte de son
premier voyage, qui lui a permis de découvrir les « Indes occidentales ». Il
s’adresse à ses commanditaires, les Rois catholiques (« Vos Altesses »), Isabelle
de Castille et Ferdinand d’Aragon. Colomb justifie son premier voyage comme
une mission d’évangélisation : « convertir ces peuples à notre Sainte Foi ». La
colonisation a d’abord un objectif religieux, dans le prolongement de la
Reconquista (qui vient de se terminer, avec la prise de Grenade en 1492). Colomb
décrit les Indiens comme des êtres dociles et inoffensifs (« gens très pauvres en
tout », « nus », autrement dit à l’état sauvage, sans « aucun culte », « sans génie
pour le combat », « peureux », « propres à être commandés »). Vus par un
Européen, ils constituent une sorte de peuple infantile. Colomb fait miroiter des
richesses qui pourraient renforcer la position de l’Espagne. Les terres sont «
bonnes et fertiles » et il semble y avoir de l’or. Colomb se présente comme
l’envoyé du roi et de la reine d’Espagne. Il s’adresse à eux avec déférence, tout
en leur conseillant assez fermement la marche à suivre. Le 17 avril 1492, les «
capitulations » signées par les Rois catholiques confèrent à Colomb les titres
d’amiral, vice-roi et gouverneur « des îles et terre ferme » qu’il pourra découvrir.
Christophe Colomb débarque à Hispaniola (Haïti) en octobre 1492. Gravure de
Théodore de Bry, 1594. B.N.F., Paris.
Cette gravure est postérieure de presque un siècle à l’événement relaté et elle est
loin d’être une image neutre. Théodore de Bry, graveur et éditeur installé à
Francfort, est spécialisé dans la publication et l’illustration d’ouvrages dénonçant
Le voyageur français Jean de Léry livre en
1578 un véritable bréviaire d’ethnologie dans
le récit de son voyage au Brésil. Il y étudie la
peuplade des Indiens Toupinanbaou, et
s’intéresse notamment à leur langage.
Huguenot, il trouve dans les cannibales une
métaphore des catholiques, dévoreurs du
corps du Christ. Dans cet extrait, il fait la
description du tabac, qui commence à être
introduit en Europe et en Asie au XVIe
siècle. Jean de Léry décrit ainsi la pipe
rudimentaire qu’utilisent les indigènes pour
fumer la plante à laquelle la médecine
européenne prêtait des effets revigorants.
Mais l’approche de Léry se veut aussi
sociologique, puisque les dernières lignes
montrent la fonction sociale qu’occupe le
tabac, qui est un moyen d’échange entre
individus.
Les empires coloniaux
Les empires coloniaux de l’Espagne et du
Portugal sont de nature différente. Dans
l’océan Indien, les Portugais ont développé
un empire purement commercial qui repose
sur une chaîne de comptoirs fortifiés, sur les
côtes d’Afrique, d’Inde, jusqu’en Chine et au
Japon. Ils colonisent aussi le Brésil. Pour
prendre le contrôle de ce commerce, les
Portugais s’efforcent de briser les échanges
du monde musulman préexistants. Ils
s’attaquent donc aux clés de l’océan Indien :
Malacca (1511), Ormuz (1515). Pour payer
les produits asiatiques, les Portugais
exportent des produits européens comme le
cuivre, le mercure, l’alun… mais les
échanges sont déficitaires, ils doivent donc
payer en or et en argent, en particulier
d’Amérique.
Les Espagnols conquièrent un immense
territoire. Ils installent une administration et
exploitent les richesses des territoires conquis
(mines et plantations). Les produits expédiés
vers l’Europe sont : la soie de Chine, les
épices d’Inde, l’ivoire, les esclaves et l’or
d’Afrique, le sucre et le bois du Brésil, le
sucre des Antilles, l’argent du Mexique et des
mines du Potosi dans l’actuelle Bolivie, et
l’or de l’actuel Pérou.
Vue de Séville au XVIe siècle. Tableau de
Francisco Pacheco,musée des Amériques,
Madrid.
Ce tableau permet d’évoquer le
développement, à partir des grandes
découvertes, des ports de l’Atlantique, et en
particulier Séville. On fera observer l’activité
intense et fébrile qui semble y régner en
faisant relever le nombre de navires à quai et
les personnages qui s’activent pour
embarquer ou débarquer des marchandises.
Les bateaux arrivent du Nouveau Monde
chargés d’or et d’argent et repartent avec des
produits de la métropole : vin, huile, meubles,
chaussures, draps et soieries… Séville reste
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
1
/
148
100%