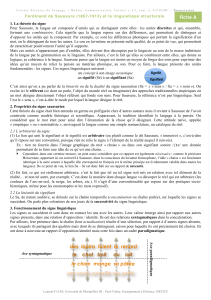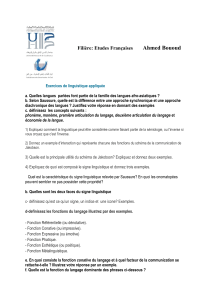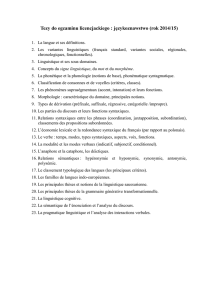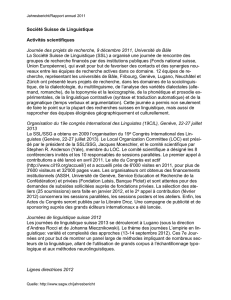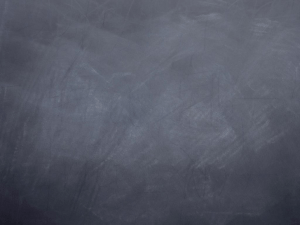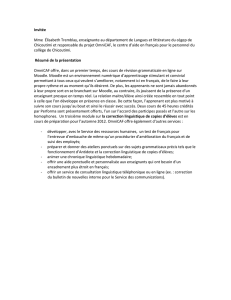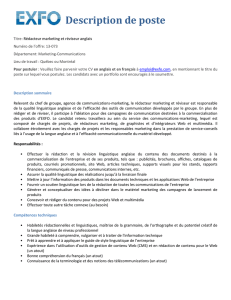Introduction à la Sociologie du langage I.

I – Les Sciences de la Langue et du Langage
Introduction à la Sociologie du langage I.
Plan : 1. Généralités
2. Le statut des langues
3. Quelques disciplines consacrées à la langue
a.) L’étude des grammaires
b.) La linguistique
c.) La sémiologie
d.) la pragmatique
1. Généralités
a) Les définitions
La sociologie est l’étude des liens sociaux. Même si on parle de langue, on est toujours dans la
perspective de liens sociaux.
La première discipline qui avait comme objet d’études la langue avec ses règles fut la Grammaire.
Cette dernière se définit comme l’étude systématique des éléments constitutifs d‘une langue :
sons, formes, procédés. L’étude de la grammaire existait déjà dans l’Antiquité. Pour pouvoir
communiquer avec les habitants des autres régions, il fallait étudier leur langue, comprendre leurs
mots, apprendre les règles de combinaison leur permettant de lier les mots, etc.
Après la découverte de l’Amérique au 16ème siècle, l’activité grammairienne était encore plus
intensive. Les missionnaires devenaient souvent des spécialistes de grammaire. Certains
grammairiens pensaient que les différentes langues, en dépit des contraintes et des règles
différentes, ont des points communs : elles obéissent à des principes qui viennent un fondement
commun appelé « langage ».
Les premiers grammairiens qui ont affirmé l’existence de ce fondement commun étaient
probablement Cl. Lancelot et A. Arnaud. Ils faisaient partie de la petite École de Port Royal-des-
Champs. C’est pour cela que leur grammaire est appelée la Grammaire de Port Royal.
Ferdinand de Saussure, linguiste suisse au début du 20éme siècle, faisait la distinction entre
langue et parole.
Pour lui, la langue est un système fermé, un ensemble de signes utilisés et de leur règles
d’usage.
La parole, c’est l’utilisation de la langue par des individus qui s’expriment.
Selon lui, la linguistique doit s’intéresser à la langue et non pas à la parole. Cette dernière peut
être étudiée par les représentants des diverses sciences sociales, par les psychologues sociaux ou
par les sociologues. Pour Saussure la langue et la parole, ensemble, représentent le langage.
Les sémiologues disent que la langue est un système de signes indépendamment du fait d’être des
mots, des images ou des objets.
b) La diversité des langues
Il existe environ 6700 langues sur la Terre. (Selon un numéro hors série du Courrier
International : A la découverte des 6700 langues de la planète, mars-avril-mai 2003. La précision
du titre est impressionnante mais on peut affirmer que probablement il existe entre 6000 et 7000
langues sur la terre.) Et on peut noter une inégalité au niveau de leur répartition puisque 96% des
langues existantes sont parlées par seulement 4% de la population. Cl. Hagège, professeur du
Collège de France, affirme que tous les 15 jours une langue disparaît. (Cl. Hagège : Halte à la
mort des langues, Odile Jacob, 2000). Il s’agit bien des langues qui sont parlées par des tribus très
peu nombreuses, par des populations qui disparaissent elles-mêmes…

Pour expliquer l’origine de cette diversité, les réponses sont nombreuses, souvent fantaisistes et
les preuves sont rares. Lors de sa fondation en 1966, la Société Linguistique de Paris déclare dans
ses statut qu’elle n’admet aucune communication concernant origine des langues.
Malgré un tel avertissement, on peut évoquer au moins l’une des théories, celle qui figure dans la
Bible. Dans l’histoire de Babylone, les gens voulaient construire une tour dont le sommet pourrait
atteindre le ciel. Mais Dieu voulait empêcher la construction, il brouillait la langue des hommes
pour rendre impossible la communication entre eux. Pourquoi a-t-il procédé ainsi ? Selon la
réponse habituelle, il était indigné par cet orgueil démesuré des gens. Mais on peut avancer aussi
une autre explication : Dieu a compris mieux que n’importe qui d’autres que la langue n’est pas
seulement un moyen d’expression, elle est également un moyen d’action. La tour était le symbole
de l’unité et de la puissance des hommes, à travers de l’usage d’une seule et même langue qui
permettait d’éviter les dissensions et des conflits. (Géza Révész : Origine et préhistoire du
langage, Payot, 1950)
Certaines théories qui disent que la langue serve à la communication. Mais on observe que la
langue est souvent un obstacle dans la communication.
Les langues les plus parlées aujourd’hui sont dans l’ordre suivant :
1) Le chinois
2) L’anglais
3) Le hindi et l’ourdou
4) L’espagnol
5) Le russe
6) L’arabe
2. Le statut des langues
On a popularisé deux termes : les langues véhiculaires et les langues vernaculaires.
Les langues véhiculaires qui sont les langues de substitution et de commerce, utilisées entre
des gens et des cultures différentes. Un exemple de langue véhiculaire est la lingua franca. A
la base le créole était aussi une langue véhiculaire mais il est devenu aujourd’hui une langue
vernaculaire.
Les langues vernaculaires sont utilisées en famille ou dans le réseau amical. Le basque en est
un exemple, le breton aussi. Labov considère que l’anglais parlé dans les ghettos noirs au
cours des années 50 aux États-Unis, est aussi une langue vernaculaire.
Les sociolinguistes analysent les rapports entre les différentes langues utilisées sur un même
territoire. Certains d’entre eux considèrent que l’alternance des langues dans une population
donnée se réalise plutôt de manière harmonieuse. Et ils n’abordent pas la question de l’existence
de conflits derrière la pluralité linguistique.
Dans la plupart des cas, les différentes langues parlées au sein de la même population et dans les
mêmes cadres étatiques ont des statuts différents. Regardons ce qui se passe en Europe. Dans
l’Europe occidentale, en particulier en France et en Angleterre, on assiste relativement tôt à la
formation des États nationaux. En France à partir de 1539 le français est la langue obligatoire dans
l’administration et dans la justice. Les langues provinciales et les patois survivent encore pendant
quelques siècles mais le statut privilégié de la langue française n’est pas remis en question. En
revanche, dans l’Europe de l’Est, on voit la formation des empires multinationaux comme
l’empire danubien des Habsbourg, l’empire russe des tzars et l’empire ottomane. Ces empires
étaient moins centralisés que les Etats-Nations et il arrivait que dans leur sein plusieurs langues
remplissent le rôle de langue « officielle ».
Prenons l’exemple de l’empire danubien qu’on appelle parfois aussi Autriche-Hongrie et où on
parlait 17 langues. En première vue, il y avait deux langues « officielles » dans cet Etat-
multinational, l’allemand dans la partie occidentale et le hongrois dans la partie orientale. Mais

dans chacun des parties, il existait des pays qui jouissaient une certaine autonomie avec des
parlements régionaux et avec des gouvernements locaux. Ainsi en Bohême, la langue dominante
était le tchèque, dans la Pologne autrichienne, le polonais et en Croatie, liée depuis plusieurs
siècles sur le plan politico-administratif au Royaume de Hongrie, le croate. Il y avait aussi des
populations, - comme par exemple les slovaques ou les roumaines, majoritaires sur un territoire
donné -, qui disposaient un mouvement politique (un mouvement national) revendiquant à leur
langue le même statut que celui des langues « officielles ».
La situation de la langue allemande dans les pays de l’Est mérite encore quelques mots.
L’Allemagne n’était pas un Etat-Nation, elle était composée d’une série d’Etats, environ 300
encore au XVIIIéme siècle, des Etats indépendants les uns des autres. (Napoléon a su les
organiser et a réduit leur nombre à 38.) Mais au cours des siècles, on assiste à l’installation
successive des colons allemands dans les pays de l’Est, dans les régions baltiques, dans les
confins slaves, en Transylvanie etc. Des minorités allemandes se sont émergées sur nombreuses
parties de l’Europe orientale, minorités qui ne coupaient pas tout leurs liens avec la mère patrie.
Elles servaient comme des repères ou des soutiens aux Allemands d’Allemagne qui affairaient en
Europe orientale. Dans ces conditions, la langue allemande était à la fois une langue véhiculaire et
une langue vernaculaire.
Dans certains pays on voit l’existence de langues qui n’ont qu’une réalité orale. Tel est le cas des
Ruthènes en Europe, les Nenets et les Vogouls en Sibérie.
3. Quelques disciplines consacrées à la langue
a.) L’étude des grammaires
On a déjà donné quelques éléments dessus. Les études grammairiennes visaient toujours
l’établissement d’un ensemble de règles (principes, contraintes) à suivre pour parler et écrire
correctement une langue. Les grammairiens avaient eu des divers arguments pour justifier des
règles mises en évidence : la tradition, l’étymologie, la logique, la soucie de clarté ou d’élégance,
etc.
b.) La linguistique
La linguistique est une science relativement récente. Pour certains, elle est née vers la fin du
18ème siècle ; c’est la linguistique dite historique qui étudie le langage par une lecture
diachronique (cd. en suivant l’évolution de la langue). Pour d’autres, la linguistique naît au début
du 20ème siècle avec sa lecture synchronique (qui s’intéresse à une langue à un moment précis de
son histoire).
La linguistique historique naît à la fin du 18ème siècle. La linguistique comparée (ou encore
linguistique historique ou grammaire comparée) est une discipline de la linguistique qui étudie
l'histoire et l'évolution des langues (prises individuellement) ou des familles de langues. C'est une
discipline éminemment diachronique. La linguistique comparée procède de la philologie, terme
qui, parfois, doit être compris comme un synonyme bien que les deux disciplines soient
différentes.
La principale méthode de travail repose sur la comparaison, entre les différents états d'une même
langue ou entre des langues différentes mais issues d'un même ancêtre. Elle permet, en relevant
des concordances régulières phonétiques, syntaxiques et, plus rarement, sémantiques, d'établir
des parentés entre les langues. Elle a donc comme premier objet d'étude les similarités formelles
révélées par ces comparaisons. C'est la linguistique comparée qui permet donc d'établir de
manière scientifique l'existence des familles de langues qu'on dit alors liées par des relations
génétiques.
Dans la naissance de la linguistique historique, la découverte de la parenté entre la plupart des
langues européennes d’une part et le sanscrit, langue sacrée de l’Inde d’autre part dans les années
80 du XVIIIème siècle par les colonisateurs britanniques a joué un rôle important. Certains
savants supposaient que les langues européennes (baptisées indo-germaniques ou indo-
européennes à l’époque) sont les descendants du sanscrit. Des travaux comparatistes ont été lancés

pour démontrer des régularités dans le changement. Certains comparatistes pensaient que le
changement des langues est un processus régulier et naturel, dû aux « empruntes inévitables » et
aux « héritages » mais il respect l’organisation interne des langues. (Ces sont les éléments qui
changent, les règles grammaticales et phonétiques sont conservées, la structure reste la même.) En
revanche, d’autres comparatistes constataient que les langues déclinent avec les temps. Pour eux,
le comportement de l’homme par rapport à la langue est un comportement d’utilisateur. Ce
dernier considère la langue comme un instrument qui doit être économique, commode et aussi
efficace que possible. Et l’homme est capable de sacrifier la clarté d’une organisation
grammaticale pour posséder des moyens de communication plus efficaces. Sous un autre angle,
on peut noter que les changements phonétiques (c.-à-d. les changements qui concernent
l’articulation des sons) détruisent progressivement, par une sorte d’érosion, l’organisation
grammaticale des langues qui leur est soumis.
Certains comparatistes, partisans de la thèse du déclin des langues, supposaient que l’époque pré-
historique fut particulièrement positive du point de vue du développement des langues. A cette
époque, l’homme cherchait de s’exprimer, de se représenter par la langue. La langue n’était pas un
moyen mais une fin. Ce fut une période de création ! Et par déduction, ils essayaient imaginer les
étapes de l’évolution des langues en les rangeant dans trois catégories :
- les langues isolantes : les mots sont des unités inanalysables, on ne peut pas faire la différence
entre les radicaux et les éléments grammaticaux. Exemple : le chinois.
- les langues agglutinantes : dans ces langues, on arrive à distinguer les radicaux et les éléments
grammaticaux ou, dire tout simplement, les différentes parties qui composent le mot (ex : toujours
= tout + jour) mais on ne peut pas identifier des règles précises qui déterminent les relations entre
les composantes. Exemple : le hongrois et le finnois en Europe, le vogoul, l’ostiak, le nenet en
Sibérie, nombreuses langues en Amérique du Sud.
- les langues flexionnelles : ce sont des langues où la construction du mot est très nette. Les règles
précises (de la morphologie) commandent l’organisation interne du mot dans la plupart des
langues européennes, donc dans le français.
La linguistique historique a hiérarchisé les langues. Les langues flexionnelles sont en haut de
l’échelle de l’évolution contre les langues isolantes. Mais aujourd’hui cette théorie de la hiérarchie
des langues au niveau de leur statut et de leur développement sera très critiquée.
La linguistique synchronique naît au début du 20ème siècle avec F. de Saussure.
Saussure (1857 – 1913) est issu d'une famille genevoise d'illustres savants. Après avoir achevé ses
études secondaires, il se rend en 1875 à Leipzig où se trouvait alors la plus célèbre université de
philologie de l'époque, puis à Berlin et à Paris. En 1877, Saussure communique à la Société de
linguistique de Paris son Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-
européennes. Il travailla ensuite quelques années en France, où il enseigna la linguistique indo-
européenne avant de retourner en Suisse.
Le Cours de linguistique générale (1916) constitue le document le plus important dont nous
disposons pour connaître la pensée de Saussure. Cependant ce texte ne fut pas rédigé par de
Saussure lui-même, mais par les deux linguistes Charles Bally et Albert Sechehaye : en se fondant
sur les notes de l'étudiant Albert Riedlinger, ils rédigèrent un texte censé rendre la pensée de
Saussure.
Ce n'est que dans les années cinquante que se développa une étude plus précise des sources du
Cours de linguistique générale qui tenta de cerner les idées appartenant authentiquement à
Saussure à partir des fragments qui nous restent aujourd'hui. (Certains spécialistes font la
différence entre Saussure et le saussurisme.)
Saussure fait la distinction entre langue et parole. Il définit la langue comme un ensemble de
signes utilisés et les règles de leur mise en œuvre. La parole est l’usage de la langue par un
individu qui s’exprime. La linguistique doit étudier seulement la langue, les sciences sociales
(psychologie, sociologie, psychologie sociale) peuvent étudier les paroles. (Mais le linguiste ne

peut pas ignorer complètement les paroles puisque il doit reconstruire les règles de mise en œuvre
à partir des mots prononcés par des interlocuteurs concrets.)
La langue est un système clos (une structure comme ses interprètes disaient plus tard), un
ensemble de signe en elle-même et pour elle-même, « un ensemble où tout se tient ». Les
éléments du système ne peut se définir que dans un rapport aux autres éléments : « les mots n’ont
pas de sens, ils n’ont que d’usage », un signe n’a pas de valeur absolue mais une valeur relative.
Les signes ont des valeurs parce qu’ils ont une position dans le système comme les pièces d’un
jeu d’échecs sur un échiquier.
Saussure propose aussi une théorie du signe.
Pour certains la langue est « une liste de termes correspondant à autant de choses ». Autrement
dit, pour beaucoup de gens, le mot signifie une chose. Donc pour eux, le signe est la relation entre
un mot est une chose. Mais d’après Saussure, cette conception est tout à fait critiquable :
« elle suppose des idées toutes faites préexistant aux mots »
« elle ne nous dit pas si le nom est de nature vocale ou psychique »
enfin «elle laisse supposer que le lien qui unit un nom à une chose est une
opération toute simple ce qui est bien loin d’être vrai »
Pour Saussure « le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image
acoustique. Cette dernière n’est pas le son matériel, chose purement physique mais l’empreinte
psychique de ce son, la représentation que nous en donne le témoignage de nos sens ; »
Nous pouvons nous parler à nous-mêmes ou nous réciter mentalement une pièce de vers. C’est
parce que les mots de la langue sont pour nous des images acoustiques. L’action vocale n’est donc
que « la réalisation de l’image intérieure dans le discours ». Le signe linguistique est donc une
entité psychique à deux faces, qui peut être représentée par la figure :
Nous appelons donc signe « la combinaison du concept et de l’image acoustique ».
Saussure propose de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer
« concept » et « image acoustique » respectivement par « signifié » et « signifiant ».
Le signifié désigne le concept, le contenu, c'est-à-dire la représentation mentale d'une
chose. Contrairement à une idée répandue, la langue n'est pas un répertoire de mots qui
refléteraient les choses ou des concepts préexistants en y apposant des étiquettes. Si c'était
le cas, les mots d'une langue, mais aussi ses catégories grammaticales auraient toujours
leur correspondant exact dans une autre.
Le signifiant désigne l'image acoustique d'un mot. Ce qui importe dans un mot, ce n'est
pas sa sonorité en elle-même, mais les différences phoniques qui le distinguent des autres.
Sa valeur découle de ces différenciations.
La théorie de Saussure s’inscrit donc dans une logique dichotomique. Les sociolinguistes vont
critiquer Saussure parce qu’il ignore complètement la parole.
Antoine Meillet (1866-1936) Il est de 9 ans de cadet de Saussure. On le considère comme le
disciple de Saussure mais sa conception se distingue du celle du maître genevois sur deux points.
(1) D’abord, Meillet n’est pas d’accord sur la séparation de l’approche diachronique et
synchronique. Pour Meillet, les deux sont nécessaires et indispensables.
(2) Ensuite, il est en désaccord avec la définition de la linguistique. Meillet a une vision beaucoup
plus sociologique car il est aussi disciple de Durkheim. Meillet insiste sur le lien entre
changement social et changement linguistique. Cette idée sera reprise plus tard par Labov, un des
premiers représentants de la sociolinguistique naissante.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%