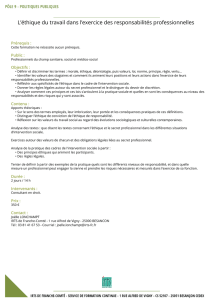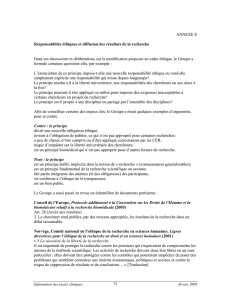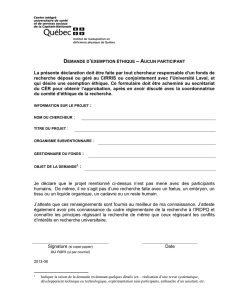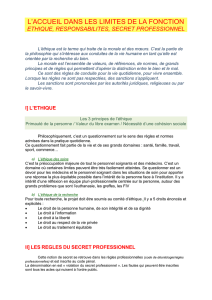Médecin et anthropologue, médecin contre anthropologue

Rev u e e n l i g ne d e scie n c e s h u mai ne s e t s o c iale s
© 2008 – http://www.ethnographiques.org – ISSN 1961-9162
ethnographiques.org
est une revue publiée uniquement en ligne. Les versions pdf ne sont pas toujours en
mesure d’intégrer l’ensemble des documents multimédias associés aux articles. Elles ne sauraient donc se
substituer aux articles en ligne qui, eux seuls, constituent les versions intégrales et authentiques des articles
publiés par la revue.
Aline Sarradon-Eck
Médecin et anthropologue, médecin contre anthropologue :
dilemmes éthiques pour ethnographes en situation clinique
Résumé
À partir de l’expérience de plusieurs terrains (observation participante et directe de
consultations médicales), le texte aborde les questions éthiques relatives à la position du
chercheur dès lors que l’enquête de terrain repose sur l’observation des lieux et des
pratiques de soins. Sont examinés en particulier quelques dilemmes soulevés par
l’application des principes éthiques de la recherche médicale à l’ethnographie dans le
champ de la santé (consentement éclairé, non malfaisance, confidentialité). Sont analysés
les significations et usages sociaux de l’interprétation des règles de l’éthique médicale par
les instances chargées d’autoriser l’enquête de terrain (ici le Conseil de l’Ordre des
médecins) : sacralisation de la parole des patients et du colloque singulier ; protection de
l’autonomie professionnelle ; incompatibilité épistémologique ; usages du secret médical.
Abstract
Drawing on fieldwork experiences (participant/direct-observation of medical consultations),
this article examines some ethical issues concerning researcher posture when fieldwork is
based on observation of places and practices of medical care. Particularly, I review some of
the dilemmas raised by the application to care ethnography of medical researchs’ ethical
principles (informed consent procedures, no harm, confidentiality, etc.). I analyze : the social
meanings and uses of the interpretation of medical ethics rules by authorities that authorize
the fieldwork (here the Conseil de l’Ordre des médecins) : the sacralization of patients’ speech
and the clinical encountersacred ; the protection of professional autonomy ; epistemological
incompatibility ; and the uses of medical secrecy.
Pour citer cet article :
Aline Sarradon-Eck. « Médecin et anthropologue, médecin contre anthropologue : dilemmes éthiques pour
ethnographes en situation clinique »,
ethnographiques.org
, [en ligne].
http://www.ethnographiques.org/2008/Sarradon-Eck.html (consulté le [date]).

2
ethnographiques.org
, numéro 1
7
,
novembre
2008 version pdf, page
Introduction
« Au cours de ma promenade matinale à travers le village, je pouvais observer les
détails intimes de l’existence familiale, de la toilette, de la cuisine, des repas [...]
Parce qu’ils me voyaient tout le temps parmi eux, les indigènes n’étaient plus
intrigués, inquiets ou gênés par ma présence ; dès lors, je cessais d’être un élément
perturbateur dans la vie tribale que j’étudiais, je ne faussais plus tout du fait de
mon approche, comme cela se produit toujours quand un nouveau venu se présente
dans une communauté de primitifs. En réalité, comme ils savaient que je fourrerais
mon nez partout, même là où un indigène bien éduqué ne songerait pas à
s’immiscer, ils finissaient par me regarder comme une part et un élément de leur
existence, un mal ou un ennui nécessaires, atténués par les distributions de tabac »
(Malinowski, 1989 (1922 ; 1963 traduction française) : 64-65)
Depuis que les vertus de l’observation directe ont imposé l’enquête de terrain
comme la méthode permettant « seule d’accéder à certaines dimensions du social »
(Fabre, 1992 : 43), les chercheurs réfléchissent aux conditions de l’enquête et aux
effets produits par la présence de l’ethnologue sur le terrain. L’identité du
chercheur (son genre, sa couleur de peau, son statut social) ou celle que lui
attribuent les acteurs sociaux étudiés, le dosage de son implication sur le terrain (la
nature et le degré de participation aux activités du groupe) sont précisés dans la
plupart des textes produits par les anthropologues comme des critères d’évaluation
de la validité des matériaux ethnologiques et de la valeur des analyses. Ces
éléments témoignent de la réflexion du chercheur sur sa posture d’observateur, et
de l’intégration des effets de leur interaction avec le terrain dans son interprétation
et dans la signification qu’il donne aux informations recueillies, jusqu’à
« l’exploitation des perturbations créées par l’observation » (Devereux, 1980 : 363).
La démarche réflexive sur le mode de production des connaissances
anthropologiques est, selon Bernard Hours et Monique Selim (2000), la principale
exigence éthique de la recherche en anthropologie, corrélative d’une obligation de
transparence sur les conditions de l’enquête. À un autre niveau, le principe
déontologique de la confidentialité est consensuel au sein de la discipline avec la
règle de respect de l’anonymat des personnes enquêtées dans la description
ethnographique (par la modification des noms, prénoms, initiales et le masquage
du lieu de l’enquête). De même, les effets de l’enquête sur les sujets (risques et
bénéfices) sont souvent discutés. En anthropologie de la santé, d’autres
préoccupations d’ordre éthique apparaissent. Par exemple, Didier Fassin (1992 :
32-33) n’a pas caché sa qualité de médecin à ses interlocuteurs dans un double
souci éthique — médical (ne pas refuser de donner des soins) et sociologique (les
soins ou conseils donnés sont des contre-dons) — tout en analysant « l’obstacle
épistémologique » de sa formation médicale et les enjeux de pouvoir autour de son
double statut mobilisés par l’enquête. Sylvie Fainzang (2006) s’est astreinte à
conserver une « parfaite neutralité » vis-à-vis des soignants en refusant l’identité
de membre des équipes médicales que les professionnels et les malades voulaient
lui assigner. Si cette attitude a une justification méthodologique, elle est aussi
éthique : S. Fainzang (2006) a rapidement saisi que ses non-réponses aux
questions d’ordre médical ou sa gestuelle pouvaient être interprétées par les
malades en espoir de guérison comme une information sur leur pronostic, dès lors
qu’elle était assimilée à l’équipe soignante.

3
ethnographiques.org
, numéro 1
7
,
novembre
2008 version pdf, page
Le respect de la confidentialité des données et l’évaluation des risques éventuels de
la recherche pour les sujets annoncés par ces auteurs correspondent au principe de
bienveillance (et de non-malveillance) inscrit dans les codes d’éthique de la
recherche impliquant des sujets humains. L’application de ce principe — ainsi que
ceux de respect de l’autonomie des personnes, de justice et d’équité, — rencontre
l’adhésion a priori des anthropologues de la santé (voir Bonnet, 2003 ; Hardon et
al, 2001). Néanmoins, la soumission à l’un des principes, ou leur interprétation,
peuvent conduire à des pratiques de terrain antagonistes dans certaines situations
telles que l’observation directe des soins, des pratiques médicales, des interactions
soignants-soignés, ou lorsque l’ethnographe est aussi soignant. Le chercheur
rencontre alors des dilemmes dont la résolution peut exiger des choix et une
hiérarchisation symbolique des règles de l’éthique biomédicale que ce texte propose
d’examiner à partir de l’expérience de deux enquêtes ethnographiques. Il s’agira de
pointer les paradoxes que soulève une formalisation de l’éthique de la pratique du
terrain en anthropologie de la santé qui respecterait les normes de l’éthique
biomédicale. Il s’agira aussi, au travers de ces expériences, de se demander si
l’ethnographie, que l’on pourrait qualifier « d’art de l’intrusion systématique dans
la vie des autres » selon la formule empruntée à Andréas Zempléni (1996 : 35), est
compatible avec les valeurs qui fixent les règles de l’éthique de la recherche.
Les deux enquêtes portent sur la pratique de la médecine générale dans le secteur
libéral des soins. Néanmoins, l’objet d’étude et les conditions de l’enquête sont très
différents d’une recherche à l’autre. Dans la première, effectuée dans le cadre de ma
thèse (Eck-Sarradon, 2002), il s’agissait d’analyser la parole des patients destinée
au médecin dans un contexte d’énonciation spécifique (la rencontre clinique). Étant
médecin généraliste en exercice au moment de l’enquête, je n’ai bénéficié d’aucun
soutien financier pour ce travail, et mon principal terrain d’investigation était mon
propre cabinet et le discours des personnes me consultant. La seconde recherche
avait pour objet d’étude les interrelations professionnelles que le généraliste
développe avec les autres acteurs de la santé. Réalisée dans le cadre d’un appel à
projet de l’ANAES [1], elle a été conduite par une équipe de cinq chercheurs [2]
avec un double soutien financier [3] et une technique d’enquête basée sur
l’observation de la pratique de dix médecins généralistes dans leur activité
professionnelle quotidienne dans un premier temps [4] (Sarradon-Eck et al, 2004).
Cette brève description de la configuration des deux enquêtes laisse entrevoir une
différence radicale de posture du chercheur par rapport à son terrain. L’objectif de
ce texte n’étant pas de présenter les matériaux ethnographiques recueillis, ces
postures seront analysées uniquement dans leurs implications d’ordre éthique.
Du consentement à la recherche
Réaliser une observation participante dans le champ de la santé et de la maladie
signifie que le chercheur est amené à occuper une position où il est à la fois
observateur et co-acteur (en tant que soignant). Il existe ainsi plusieurs travaux
ayant conjugué, le temps d’une recherche, un regard clinique et une démarche
anthropologique en médecine générale (Helman, 1978 ; Lagadec, 1985) ou en
psychiatrie (Kleinman, 1980 ; Pandolfi, 1993).
Dans l’ethnographie hospitalière ou réalisée à l’hôpital, en France, on trouve aussi
plusieurs exemples de chercheurs ayant occupé un emploi pendant une période
plus ou moins longue de brancardier (Pennef, 1992), d’agent hospitalier (Ménoret,

4
ethnographiques.org
, numéro 1
7
,
novembre
2008 version pdf, page
1999 ; Vega, 2000), ou qui adoptent le port de la blouse pour mieux se fondre dans
le groupe social qu’ils étudient, rendant quelques “services” aux soignants (Vega,
2000 ; Hoarau, 2000 ; Amiel, 2005 ; Pouchelle, 2003 ; Paillet, 2007). L’intérêt de
cette technique d’enquête est d’acquérir par imprégnation une connaissance
« sensible » de son terrain « au plus près des situations habituelles des sujets »
(Olivier de Sardan, 1995 : 73), d’avoir accès à des pratiques occultées, mais aussi
très visibles et familières auxquelles les individus ne portent pas attention, à de
l’implicite ou du trop banal pour pouvoir être dit (Schwartz, 1993). Si la portée
heuristique de ce type d’approche empirique n’est plus à démontrer, les problèmes
éthiques et méthodologiques qu’elle soulève sont rarement abordés par les auteurs.
Les usages
Sjaak van der Geest et Kaja Finkler soulignent, dans une brève revue de la
littérature anglo-saxonne sur l’observation participante en milieu hospitalier, le
danger de cette méthode sur la production scientifique en ne restituant que le point
de vue des professionnels. En effet, les auteurs relèvent que le rôle de patient
(“faux” ou “vrai” patient) est moins souvent assumé par les chercheurs. Ils insistent
sur les difficultés de cette double posture, à l’hôpital peut-être davantage que sur
d’autres terrains « l’observation participante, au vrai sens du terme, est un
oxymoron » (2004 : 1998-1999). Plus généralement, le fait que le soignant endosse
le rôle de chercheur est discuté dans la littérature en sciences sociales d’un point de
vue épistémologique (impact de la « double posture » sur la nature des matériaux
recueillis ou sur l’orientation de l’analyse), et non d’un point de vue éthique. En
particulier, la question du consentement des personnes à la recherche n’est pas
examinée.
Les études citées ci-dessus réalisées en France ont pour objet d’étude “les
soignants”, et plus généralement le “système de soins”. En l’absence de précision de
la part des auteurs, on peut supposer que les professionnels sont informés de la
présence du chercheur parmi eux. Néanmoins, il est peu probable qu’ils aient tous,
individuellement, donné leur accord à l’ethnographe introduit par le chef de service
ou la surveillante, ce qui, dans l’institution hospitalière caractérisée par sa
hiérarchie pyramidale, revient à imposer la présence du chercheur [5]. Dans ma
seconde étude décrite brièvement en introduction, l’ethnographe était dans la
même position que ces chercheurs, s’intéressant au travail du médecin, à ses
relations avec les autres professionnels, et plus généralement à la “culture
professionnelle” d’un sous-groupe social (les généralistes libéraux). Examinons le
dispositif mis en place.
Chacun des dix médecins a été informé individuellement des objectifs de la
recherche et de son déroulement. Ils ont signé un formulaire de consentement leur
garantissant le respect de l’anonymat (le leur, et celui des patients). Concernant les
patients de ces médecins, plusieurs situations ont été rencontrées. Pour une partie
des personnes venant en consultation, une information (orale et écrite) sur les
objectifs de la recherche (étude des interrelations professionnelles) a été donnée.
De plus, une information était donnée aux patients sur la présence d’un chercheur,
soit oralement par les secrétaires, soit par une affichette apposée dans les salles
d’attente. Même si les patients n’étaient pas directement sujets de la recherche, un
consentement écrit et signé leur a été demandé dont la formulation s’est calquée
sur les normes de la recherche biomédicale. Cette précaution nous a semblé
nécessaire lorsque les consultations ont été enregistrées au magnétophone avec

5
ethnographiques.org
, numéro 1
7
,
novembre
2008 version pdf, page
l’objectif d’une analyse fine de l’interaction médecin-patient à partir des
transcriptions. Néanmoins, nous avons renoncé à demander un consentement écrit
(et donc renoncé à l’enregistrement) lorsque nous sentions que la demande était
anxiogène pour certains patients, notamment pour les étrangers en situation
irrégulière.
Lorsque les consultations (et visites au domicile des malades) n’étaient pas
enregistrées, l’ethnographe était présenté par le médecin, ce dernier se chargeant
d’obtenir un consentement oral [6]. Je reviendrai sur la présentation de
l’ethnologue aux usagers et sa signification. Cette manière de procéder peut
paraître insuffisante si l’on considère l’asymétrie — encore forte — de la relation
médecin-patient pouvant restreindre l’autonomie du patient et sa liberté de refuser
la présence d’un enquêteur lorsque la demande émane du médecin. Néanmoins,
nous avons constaté d’une part que certains patients refusent la présence de
l’ethnographe, et d’autre part que les médecins ont été sensibles au langage non-
verbal de leurs patients et ont écarté l’enquêteur de la consultation lorsqu’ils
sentaient une gêne, ou lorsqu’ils anticipaient que sa présence pouvait perturber les
échanges avec les malades.
La troisième situation concerne les situations d’urgence médicale, ou des visites au
domicile de personnes présentant des troubles cognitifs, ou encore lorsque le
rythme de travail s’accélère et que le médecin ne prend plus le temps de demander
au malade son accord, imposant la présence du chercheur comme un assistant ou
un stagiaire. Par exemple, lorsque l’on suit le travail quotidien d’un médecin de
campagne et que l’on étudie son activité dans toute sa diversité, on peut être
amené, comme cela m’est arrivé, à observer l’intervention du praticien auprès
d’une personne présentant un arrêt cardiaque, et poursuivre l’observation dans le
véhicule des pompiers emmenant le malade à l’hôpital. Dans ces situations, on ne
peut pas envisager de demander au malade son accord, et l’on peut alors considérer
que le chercheur enfreint le principe éthique du respect de la personne et de son
autonomie. Dès lors, s’interdire l’observation dans ces circonstances, c’est aussi
interdire l’observation directe de tout un pan de l’activité médicale : urgence,
réanimation, bloc opératoire, soins auprès de personnes en fin de vie ou très
affaiblies.
Les exceptions à la règle
Informer le patient de la situation d’enquête peut entrer en conflit avec le principe
éthique de non-malfaisance. Ainsi, ma première enquête a consisté principalement
en une ethnographie du malade en situations de soins afin d’analyser la dimension
narrative de l’expérience de la souffrance et de la maladie lorsque celles-ci sont
confiées au médecin, et d’en saisir ses significations sociales. Étant moi-même le
médecin traitant — et donc le destinataire de la parole des malades —, je n’ai pas
informé les patients de ma démarche d’enquête. Cette « pratique de l’insu »
(Urbain, 2003 : 26) correspondait à une double préoccupation éthique et
méthodologique. Méthodologique, car il s’agissait d’éviter les interférences de la
situation d’enquête sur le comportement spontané du malade au cours de la
consultation [7]. Éthique car il me semblait que, dans la position duelle que
j’occupais d’acteur-observateur, les informer au préalable et demander leur
consentement comportait un risque de perturbation de la relation thérapeutique.
Je ne redoutais pas tant une méfiance envers le praticien, mais plutôt une
autocensure de la part des malades. En effet, certaines consultations pour des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%