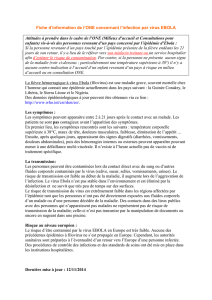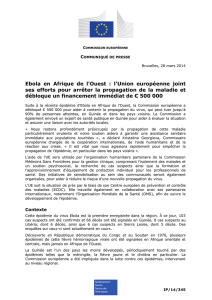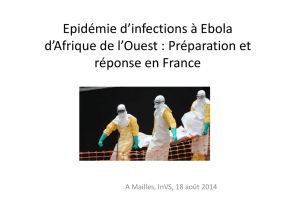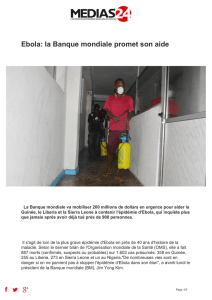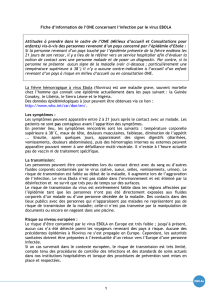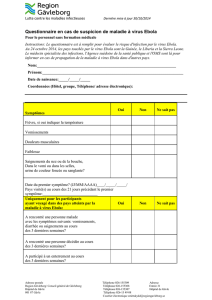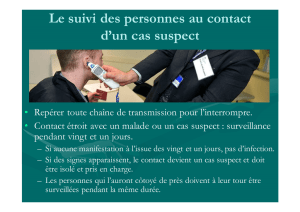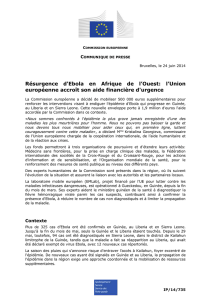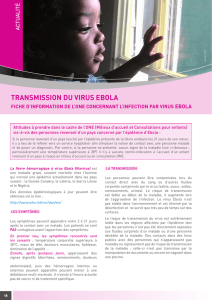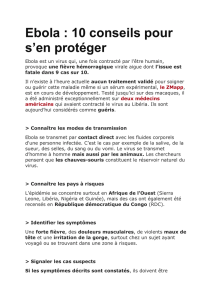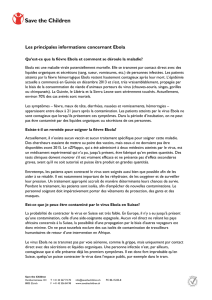07 Migliani R. Maladie à virus Ebola en Guinée

médecine et armées, 2016, 44, 2, 149-160 149
Maladie à virus Ebola en Guinée : évolution de l’épidémie de son
émergence en décembre 2013 à novembre 2015
Objectif : présenter l’évolution et le bilan de l’épidémie à virus Ebola en Guinée depuis son émergence en décembre 2013
jusqu’à novembre 2015 et les principales stratégies de lutte mises en œuvre. Méthode : analyse spatio-temporelle des cas
et des décès, à partir des données du système de surveillance épidémiologique de l’épidémie dans la population de Guinée.
Résultats : l’épidémie a évolué en plusieurs phases : une phase d’émergence silencieuse sans identification des tout premiers
cas et du virus de décembre 2013 à février 2014, une première recrudescence épidémique à partir de mars 2014 où le virus
est détecté et l’alerte mondiale est lancée qui va durer jusqu’en juillet 2014, une deuxième recrudescence après une phase
d’accalmie relative à partir d’août 2014 jusqu’à janvier 2015 centrée principalement sur la Guinée Forestière et une dernière
recrudescence à partir de février 2015 centrée sur la Basse Guinée et la capitale Conakry. Les moyens de lutte mis en
œuvre se sont adaptés à cette évolution. Conclusion : cette épidémie par son ampleur tant au niveau du nombre de victimes
que de sa diffusion géographique a permis de faire des progrès dans la lutte contre ce fléau qui faisait encore partie avant
son émergence en Guinée des maladies orphelines. Ces progrès concernent tous les domaines de contrôle d’une maladie
à potentiel épidémique : le développement d’un véritable système d’alerte et de riposte réactif à dimension régionale qui
commence à se mettre en place ainsi que toutes les avancées en termes de diagnostic, de prise en charge, de traitement, de
prévention vaccinale, d’organisation et de coordination de la lutte.
Mots-clés : Ebola. Épidémie. Guinée.
Résumé
Objective: To present the evolution of the Ebola epidemic in Guinea since its emergence in December 2013 until November
2015, its assessment and the main control strategies implemented. Method: Analysis of spatiotemporal cases and deaths
from the epidemiological data of the epidemic surveillance system of the population of Guinea. Results: The epidemic has
evolved in several phases: a silent emergent phase without any identification of the initial cases of the virus from December
2013 to February 2014; the first epidemic outbreak from March 2014 when the virus was detected and the global alert
launched, that lasted until July 2014; a second phase of resurgence after a relatively quiet period from August 2014 until
January 2015 focused primarily on the Forest area of Guinea (Guinée forestière); and a final upsurge in February 2015 that
was predominantly centered in Lower Guinea (Basse Guinée) and the capital Conakry. The control measures implemented
were adapted to the situation as it evolved. Conclusion: The scale of the epidemic, both in terms of the number of victims
and in geographical spread created opportunities for new knowledge in the fight against the Ebola virus disease, a neglected
disease until its emergence in Guinea and the neighbouring countries. These developments affect all areas for the control of
diseases with epidemic potential, starting with the establishment of an efficient warning system and the regional dimension
of an effective response; they also include establishing and improving the skills and knowhow for better diagnoses, care,
treatments, vaccines, organization and coordination of the response before the outbreak.
Keywords: Ebola. Outbreak. Guinea.
Abstract
Introduction
Après sa première émergence identifiée en 1976, au
sud Soudan et simultanément en forêt équatoriale du
Zaïre (République démocratique du Congo actuelle),
le virus Ebola (Sudan ebolavirus (SUDV) et Zaïre
ebolavirus (EBOV)), du nom de la rivière proche du
village du premier cas humain de l’épidémie zaïroise,
a été à l’origine de plus de vingt flambées épidémiques
R. MIGLIANI, médecin chef des services hors classe (R), praticien professeur agrégé
du Val-de-Grâce, conseiller du coordinateur national de la lutte contre Ebola en
Guinée d’octobre 2014 à juin 2015. S. KEITA, médecin, coordinateur national de la
lutte contre Ebola en Guinée. B. DIALLO, médecin épidémiologiste de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en Guinée. G. RODIER, médecin épidémiologiste de
l’OMS Genève. W. PEREA, médecin épidémiologiste de l’OMS Genève. B. Dahl,
médecin épidémiologiste des Centers for Diseases Control and Prevention d’Atlanta.
Correspondance : Monsieur le médecin chef des services R. MIGLIANI, 48 rue Victor
Hugo – 33290 Le Pian-Médoc.
E-mail : [email protected]
R. Migliani, S. Keita, B. Diallo, G. Rodier, W. Perea, B. Dahl
EBOLA VIRUS DISEASE IN GUINEA: THE EVOLUTION OF THE OUTBREAK FROM DECEMBER 2013 TO NOVEMBER 2015.
Maladie à virus Ebola
MEA_T44_N2_09_Migliani_C2.indd 149 14/03/16 11:26

150 r. migliani
d’ampleur modérée dans plusieurs pays d’Afrique
centrale (1-4). En Afrique de l’ouest un premier épisode
d’infection à virus Ebola a provoqué en 1994 un seul
cas humain non mortel, chez une primatologue infectée
après la nécropsie d’un chimpanzé décédé lors d’une
épizootie, dans la forêt de Taï en Côte d’Ivoire (Taï
Forest ebolavirus (TAFV)) (4-6). Les deux autres
espèces de virus Ebola, identifiés jusqu’à présent, sont
le virus Bundibugyo responsable d’épidémies humaines
en Ouganda (Bundibugyo ebolavirus (BDBV)) et le
virus Reston (Reston ebolavirus (RESTV)) isolé en 1989
en Virginie chez des macaques d’élevage, provenant
des Philippines, non pathogène et jamais isolé chez
l’homme (4, 7, 8).
L’épidémie humaine qui sévit toujours en
novembre 2015 en Afrique de l’Ouest en Guinée et au
Liberia mais plus en Sierra Léone, est la plus importante
jamais observée. C’est en décembre 2013 que le virus
Ebola a émergé dans le village de Méliandou, tout proche
de la frontière libérienne en zone forestière guinéenne.
Le cas index était un jeune garçon de 2 ans décédé
dans un tableau de fièvre hémorragique (9). L’alerte est
donnée en Guinée par le directeur régional de la santé au
début du mois de mars 2014 après l’apparition de décès
suspects chez des personnels de santé. Le virus est isolé
fin mars à Lyon par l’Institut Pasteur et le laboratoire P4
Inserm Jean Mérieux. Il s’agissait d’un nouveau variant
du virus Ebola-Zaïre, dénommé Makona du nom de la
rivière proche du village du cas index (Zaïre ebolavirus
var. Makona (EBOV/Mak)) (4, 9).
Cet article a pour objectifs, après un rappel sur la
maladie à virus Ebola (MVE) et les principales stratégies
de lutte, de décrire les mesures de riposte mises en œuvre
par la coordination nationale en Guinée et ses partenaires
ainsi que l’évolution de l’épidémie depuis son apparition
fin décembre 2013 jusqu’à novembre 2015.
Maladie à virus Ebola
Cycle de transmission
Le rôle des chauves-souris frugivores comme hôtes
naturels du virus Ebola est maintenant bien démontré
(10-12). Au début d’une épidémie, l’homme se contamine
en zone de forêt tropicale par le contact avec du sang,
des sécrétions ou des liquides biologiques de chauves-
souris frugivores ou d’autres animaux de brousse (singe,
antilope des bois, porc-épic…) porteurs du virus, vivants
ou trouvés morts. À partir de ce(s) premier(s) cas, la
transmission est ensuite interhumaine par contact direct
des muqueuses ou de la peau lésée avec le sang, les
sécrétions et liquides biologiques des malades ou des
défunts, par contact indirect avec des surfaces et des
matériaux (literie, vêtements) contaminés, par injection
parentérale avec du matériel contaminé ou par voie
maternelle. Les rites funéraires, pratiqués en Afrique,
sont très favorables à la transmission du virus chez les
parents et les amis par le contact étroit avec le défunt et
ses effets personnels (8, 11-12).
Les personnels de santé et les guérisseurs traditionnels,
en première ligne face à des cas suspects de MVE, sont
particulièrement exposés lorsqu’ils n’appliquent aucune
mesure de protection anti-infectieuse en particulier
l’usage d’Équipements de protection individuelle
(EPI). Ces épuipements font souvent défaut en
contexte africain. En Afrique centrale ces personnels
ont été nombreux à être infectés et souvent à l’origine
d’épidémies nosocomiales (3).
Évolution clinique
La MVE débute généralement, après une incubation
silencieuse non contagieuse de 2 à 21 jours (4 à 10 jours
en moyenne), par une fièvre à début brutal associée à des
symptômes non spécifiques pseudo-grippaux (malaise
avec grande fatigue, frissons, céphalées, douleurs
musculaires), rappelant la fièvre palustre. La diffusion
rapide du virus dans tout l’organisme est ensuite
responsable d’un tableau clinique multiviscéral associant
troubles cutanéomuqueux, digestifs avec vomissements
et diarrhées profuses, respiratoires et neurologiques
(prostration). Dans la phase terminale prédominent les
signes neurologiques d’encéphalite (coma, convulsions)
et les manifestations hémorragiques (épistaxis,
gingivorragie, pétéchies, ecchymoses, saignements
aux sites de ponction veineuse, hématémèse, méléna).
Le décès survient dans un état de choc favorisé par
les pertes hydro-électrolytiques liés aux vomissements
et à la diarrhée avec, dans la moitié des cas, une
coagulopathie diffuse. La MVE est une maladie grave
avec une létalité proche, sans prise en charge, de 90 %
avec l’espèce EBOV. Dans les formes non fatales, le
tableau clinique s’amende jusqu’à la guérison, au fur
et à mesure de la disparition du virus dans le sang sous
l’effet de la réponse immunitaire. La convalescence est
marquée par une asthénie prolongée. Le virus peut rester
présent chez certains convalescents pendant plusieurs
semaines dans les sécrétions sexuelles, le lait et l’humeur
aqueuse. Des études, portant sur les convalescents des
épidémies de Kikwit au Gabon, ont permis l’isolement
du virus dans le sperme de l’un d’entre eux, 81 jours
après le début de la maladie et la mise en évidence
d’ARN viral chez un autre, 93 jours après le début de
la maladie. La transmission sexuelle du virus Ebola a
donc été suggérée sans être démontrée formellement.
Cependant la protection des rapports sexuels pendant
trois mois après la guérison et la sortie des centres de
prise en charge est recommandée et des préservatifs
sont fournis aux convalescents (2, 3, 8, 12-14). Enfin
parmi tous les sujets exposés au virus, un certain nombre
développe une infection asymptomatique. Une étude,
menée au Gabon, a montré que sur 24 sujets exposés
sans protection à des fluides et matériels contaminés
de cas mortels ou non de MVE lors des deux épidémies
survenues au nord de ce pays en 1996, 11 (46 %) avaient
développé une réponse immunitaire protectrice sans être
malades. Ces résultats suggéraient l’existence de formes
asymptomatiques dans l’infection à virus Ebola (15).
MEA_T44_N2_09_Migliani_C2.indd 150 14/03/16 11:26

151
maladie à virus ebola en guinée : évolution de l’épidémie de son émergence en décembre 2013 à novembre 2015
Stratégies de lutte
La riposte à une épidémie d’Ebola est globale et
s’appuie sur différentes stratégies complémentaires
nécessitant, pour leur mise en œuvre, une forte
coordination et des moyens financiers, matériels,
logistiques et humains adaptés à l’importance de la
flambée (16). Les principales stratégies de lutte sont :
– la mobilisation de la population et de ses leaders
crédibles pour l’engagement communautaire associée
à la communication sanitaire pour faire connaître la
maladie, ses modes de transmission et ses modalités de
prévention ; pour l’adhésion individuelle et collective
aux stratégies de lutte, pour lutter contre les rumeurs et
pour la prévention des réticences (refus parfois violent
des activités de riposte) ; par l’écoute et le dialogue
avec l’aide de socio-anthropologues, de mobilisateurs
sociaux, de spécialistes de la communication sanitaire
et de ressortissants (personnalités ne vivant plus dans la
localité) ; ces activités s’appuient sur les médias et divers
supports (messages, débats et causeries radiodiffusés
en langues vernaculaires, distribution de dépliants,
utilisation de boîte à images,…) ;
– la mise en place d’un système d’alerte précoce par
les agents de santé, les agents communautaires, les
tradipraticiens et les comités de veille des villages et
des quartiers des villes, lors de l’apparition de cas et/
ou de décès communautaires suspects pour une prise
en charge médicale en Centre de transit (CDT pour
l’isolement et la confirmation biologique du cas) ou
Centre de traitement Ebola (CTE), tous centres mettant
en œuvre des procédures de biosécurité maximales ; la
formation des soignants, l’organisation du triage des cas
suspects, la fourniture de moyens pour la Prévention
et le Contrôle des infections (PCI) complètent cette
stratégie (kits de lavage des mains, gants, tenues de
protection individuelles (TPI)) ;
– la mise en place d’un réseau de laboratoires de
qualité pour la confirmation de l’infection à virus Ebola
chez les cas suspects et tous les décès communautaires ;
– la mise en place d’un système de notification des
cas et des décès confirmés et probables pour suivre
l’évolution de l’épidémie et guider la riposte ;
– la sécurisation, dans la dignité, des enterrements
des sujets décédés d’Ebola associés à des mesures
d’accompagnement aux familles des défunts
(sensibilisation préalable par les comités et les autorités
traditionnelles de village/de quartier, condoléances,
offrandes) ;
– l’identification des sujets contacts des cas et décès
confirmés, leur suivi médical biquotidien pendant une
durée maximale de 21 jours avec des mesures d’incitation
au maintien à domicile par la fourniture de denrées
alimentaires adaptées ; l’alerte par l’entourage, le comité
de village/de quartier ou les agents communautaires en
cas de départ d’un contact ;
– la prise en charge médicale rapide et l’isolement
des cas suspects, probables ou confirmés vivants et des
contacts présentant des signes de MVE avec transport
médical sécurisé dans le CDT ou le CTE le plus proche.
Le pronostic des patients infectés est influencé par la
rapidité et la qualité de la prise en charge, notamment
la réhydratation.
Lutte contre Ebola en Guinée
Ces stratégies de lutte sont celles mises en œuvre
en Guinée pour lutter contre l’épidémie d’Ebola. La
coordination de la lutte, dans la première période de
l’épidémie, a été assurée par la cellule nationale de crise
du ministère de la Santé. Puis elle a été restructurée et
renforcée avec l’aide des partenaires internationaux après
la déclaration d’Urgence de santé publique de portée
internationale (USPPI) en août 2014 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) (17). Un coordinateur
national, placé sous l’autorité directe du chef de
l’État, a été nommé en septembre 2014, ainsi que des
coordinateurs préfectoraux dans les zones actives à partir
de novembre 2014. Les coordinations sont composées
d’unités techniques (communication, surveillance, prise
en charge, gestion des corps) et d’unités de soutien
(finances, logistique, sécurité, formation, recherche).
Plusieurs milliers de personnes, des centaines de
véhicules et près d’une quarantaine d’organisations
nationales et internationales, notamment les agences de
l’organisation des nations unies (OMS, UNICEF, PAM,
OCHA, FNUAP…) et les « Centers for Disease Control
and Prévention » (CDC), sont déployés sur le terrain
pour aider à la mise en œuvre de ces stratégies (18). Les
nations unies ont créé en septembre 2014 une mission
pour l’action d’urgence contre Ebola (MINUAUCE –
« UNMEER ») pour renforcer la lutte contre le virus
sur le terrain et rassembler sous une même bannière les
différents intervenants en appui des pays épidémiques.
Quinze centres de prise en charge (CDT et CTE)
ont été construits au fur et à mesure de l’évolution
de l’épidémie, notamment à partir d’octobre 2014.
Le programme alimentaire mondial (PAM), plusieurs
pays et organisations non gouvernementales (ONG)
en ont assuré le financement, la construction et le
fonctionnement : Médecins sans frontières Belgique
(MSF-b) (3 CTE), Croix rouge française (3 CTE), Alima
(1 CTE), Guinée-Cuba (1 CTE), Service de santé des
armées-France (SSA) (1 CTS-Centre de traitement des
soignants), Waha-France (1 CTE), Russie (1 CTE),
Guinée (3 CDT), MSF France (1 CDT). En dehors des
cadres des ONG en charge de la gestion de plusieurs
centres et de quelques Cubains et africains, les personnels
étaient et sont en majorité des Guinéens (médecins,
infirmiers, hygiénistes, lavandières, magasiniers,
ambulanciers, gardiens). En novembre 2015, trois
centres, tous situés en Basse Guinée, continuent à
prendre en charge essentiellement des cas suspects
tous négatifs pour le moment. Le CTS du SSA a pris
en charge des personnels de santé infectés entre le
19 janvier et le 19 juillet 2015. Depuis la fermeture du
CTS, les personnels de santé infectés sont pris en charge
par le CTE de Conakry dirigé par MSF-b. Différents
laboratoires sont intervenus dans le cadre du diagnostic
et en soutien des centres (Instituts Pasteur de Dakar,
Institut Pasteur de Paris, laboratoire mobile européen,
Institut national de santé publique de Guinée, laboratoire
mobile russe, laboratoire mobile canadien, laboratoire
mobile des armées belges, laboratoire mobile du SSA,
MEA_T44_N2_09_Migliani_C2.indd 151 14/03/16 11:26

152 r. migliani
laboratoire K-Plan). L’OMS est en charge du contrôle
de qualité de ces laboratoires.
La Croix-Rouge guinéenne (CRG) a été en charge
des enterrements dignes et sécurisés (EDS) de la
communauté. Depuis mars 2014, les équipes de
volontaires ont ainsi réalisé environ 24 000 EDS
principalement dans les zones épidémiques du pays,
pour les personnes mortes d’Ebola et pour celles
décédées d’une autre cause.
Pour prévenir la diffusion de l’épidémie hors de la
Guinée et l’introduction de sujets infectés venant des
autres zones épidémiques, des actions de surveillance
des frontières et des mouvements de population ont
été mises en œuvre. Ainsi le contrôle des voyageurs
a été rapidement organisé au niveau de l’aéroport
international de Conakry, avec l’appui des CDC et des
équipes de la réserve sanitaire française mises en place
par l’Établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (EPRUS), et des aéroports intérieurs.
Des équipes médicales ont été mises en place au cours du
dernier trimestre 2014 dans une cinquantaine de postes
frontaliers terrestres et de débarcadères. En 2015 des
barrages ont été déployés sur les principaux axes routiers
de Basse Guinée. L’Organisation internationale des
migrations (OIM) a contribué à améliorer ces contrôles
frontaliers en 2015.
Les actions de formation ont concerné tout le champ
de la lutte en Guinée. Les formations ont été réalisées
par de nombreux partenaires notamment dans des
domaines particulièrement importants que sont la PCI,
les soignants et hygiénistes œuvrant dans les centres de
prise en charge Ebola, la communication et la logistique.
La France, par exemple, a financé un centre de formation
des soignants Ebola à Manéah près de Conakry. Ce
centre a permis la formation de 270 personnes dans
plusieurs spécialités : instructeurs (13), médecins (92),
infirmiers (59), hygiénistes (78), laborantins préleveurs
(18) et moniteurs de recherche clinique (10) en quatre
mois et demi à partir de novembre 2014 (19).
Plusieurs projets de recherche ont été développés en
Guinée durant l’épidémie, dont certains sont toujours en
cours principalement dans trois domaines : le diagnostic,
le traitement et la prévention. Tout protocole d’étude
devait être soumis en Guinée au Comité national
d’éthique pour la recherche en santé (CNERS) et à
la Commission de recherche scientifique avant d’être
mis en œuvre en cas d’avis favorable. C’est ainsi que
plusieurs Tests de diagnostic rapide (TDR) ont été
évalués depuis 2014. Un TDR, le eZYSCREEN®,
mis au point par le Centre d’essai atomique (CEA),
avec l’appui du laboratoire P4 Inserm Jean Mérieux
de Lyon, a été validé en Guinée. Ce test, certifié CE,
simple d’utilisation, robuste et stable aux températures
tropicales présente une spécificité élevée et une
sensibilité suffisante pour un test de première ligne
(données non publiées). Il permet ainsi en 15 minutes le
diagnostic d’Ebola sur une goutte de sang ou de sérum.
Il est utilisé depuis octobre 2015 en Guinée pour le
diagnostic des cas suspects. Un procédé de PCR rapide
a également été validé en Guinée, le Xpert® (20).
Un essai clinique de phase II non comparatif (« JIKI
assay ») mené par l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM) a montré à partir des
80 premiers patients inclus que la favipiravir, un anti-
viral utilisé dans le traitement de la grippe, en traitement
oral chez l’adulte pendant 10 jours réduirait de manière
significative la létalité chez les patients ayant une charge
virale peu élevée (21).
Un essai vaccinal de phase III, mené par l’OMS et
les autorités guinéennes avec le candidat-vaccin rVSV
ZEBOV-GP (Merck-Sharp-Dome), a débuté en Guinée
le 7 mars 2015. La vaccination est réalisée en ceinture
(ou anneau ou « ring ») chez les sujets contacts et les
contacts des sujets contacts de chaque cas confirmé de
façon immédiate ou retardée de 21 jours, après tirage
au sort. Les résultats préliminaires sur 90 ceintures
montrent que ce vaccin est très bien toléré et que
l’efficacité vaccinale au dixième jour de la vaccination
immédiate variait de 76 % chez les contacts en intention
de vaccination à 100 % chez les contacts éligibles et
consentants (22).
Enfin une étude de cohorte ouverte sur les sujets
déclarés guéris (étude PostEboGui) a été initiée en
mars 2015 par l’INSERM et l’Institut de recherche et
développement (IRD) avec les partenaires guinéens.
Cette étude a pour objectifs de documenter les séquelles
liées à la MVE et de mesurer la fréquence, la durée et les
sites du portage viral après la phase aiguë à la maladie.
Des mesures d’accompagnement sociales et médicales
des sujets de la cohorte complètent l’offre de suivi (23).
Surveillance de l’épidémie en Guinée
La surveillance épidémiologique est un élément
important dans la riposte à une épidémie de MVE. Elle
s’appuie sur un système d’alerte par la communauté et
les structures de santé face à des cas suspects, un système
de confirmation par les laboratoires et un système de
recueil, de contrôle, de saisie numérique et d’analyse
des informations collectées sur les cas de MVE. Trois
niveaux de définition standardisée des cas, élaborés par
l’OMS, sont utilisés en Guinée et dans les autres pays
pour surveiller l’épidémie : cas suspect, cas probable et
cas confirmé (Encadré) (24). Pour les communautés,
l’alerte rapide vers les structures de lutte est essentielle
avec des critères de définition des cas suspects adaptés
et simples (Encadré). Des lignes téléphoniques dédiées,
dont le numéro « 115 », ont été mises en place au plan
national et local à cet effet. Par ailleurs la mobilisation
sociale et la communication sanitaire ont parmi leurs
objectifs de favoriser l’adhésion communautaire à cette
stratégie. Les laboratoires utilisent comme technique
de confirmation sur sérum pour les suspects vivants
et sur prélèvement buccal pour les sujets décédés, la
RT-PCR avec le kit Filovirus, et depuis 2015 le kit Zaïre
Ebolavirus (25).
Cette surveillance est complétée par le suivi médical
quotidien des sujets contacts (« contact tracing ») d’un
cas confirmé ou probable. L’objectif de ce suivi est
de prendre en charge, dans un centre spécialisé (CDT
ou CTE), un contact dès qu’il présente les premiers
MEA_T44_N2_09_Migliani_C2.indd 152 14/03/16 11:26

153
maladie à virus ebola en guinée : évolution de l’épidémie de son émergence en décembre 2013 à novembre 2015
symptômes de la MVE et donc devient contagieux, pour
confirmer le diagnostic et arrêter la transmission en cas
de positivité. Une fois un cas confirmé ou probable
notifié, une enquête est réalisée pour recueillir toutes
les informations sur l’exposition des personnes ayant
eu un contact avec ce cas (Encadré). Les informations
sur l’exposition doivent être vérifiées, puis leur
cohérence et leur exhaustivité revérifiées lors des visites
ultérieures. Ceci pour s’assurer que toutes les chaînes
de transmission ont bien été identifiées et sont suivies,
MEA_T44_N2_09_Migliani_C2.indd 153 14/03/16 11:26
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%