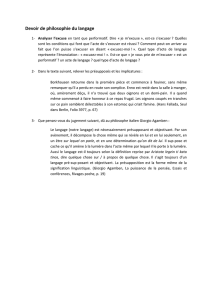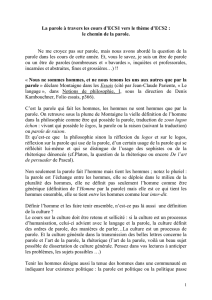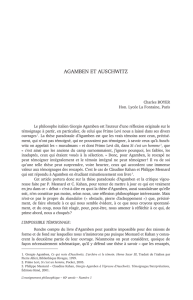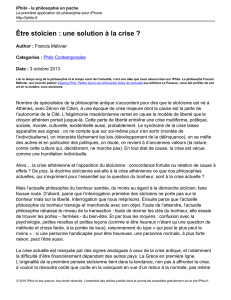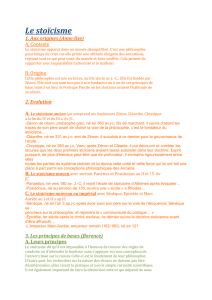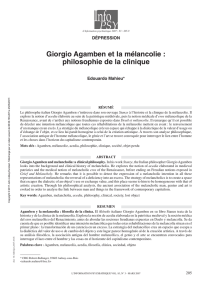ontologiques ».

1
Ontologie et langage entre Chrysippe et Agamben
Nicoletta Di Vita
I. 1 Philosophie et langage
De la conjonction qui, dans le monde ancien, noue philosophie et langage, une façon
a été depuis longtemps reconnue et copieusement recherchée. Il s’agit de la manière
selon laquelle la philosophie a intégré le langage dans ses propres tonalités, et
qu’aujourd’hui – à cause d’un oubli que l’on peine à admettre – nous comprenons
avec difficulté.
L’expression λόγον δίδοναι, que l’on peut retrouver à plusieurs reprises chez
Platon
1
, représente probablement la forme la plus complète dans laquelle cette
rencontre est exprimée. Ella a son origine dans le cadre musical duquel
descend également toute réflexion sur le langage : comme Johannes Lohmann l’a
bien montré, les relations entre tonalités sonores étaient nommées, à l’origine,
« logoi »
2
. Ces derniers, en « donnant la tonalité », créaient une relation harmonique
entre la forme musicale et la tonalité émotive, entre le son donné à l’extérieur et les
« Stimmungen ». C’est précisément ce « phénomène acoustique-musical », cette
exigence d’harmonisation, qui devint bien tôt, selon son hypothèse, un « modèle,
parmi les grecs, pour toute connaissance et expérience » (p. 8).
C’est une conviction plutôt répandue que toute la philosophie grecque postérieure
avait fini par faire du λόγον δίδοναι sa tâche propre
3
. La conséquence en fut une
configuration de toute réflexion philosophique sur le logos comme réflexion sur le
logos correct, sur l’ὀρθὸς λόγος, vouée à une ὀρθὴ φιλοσοφία.
Quand Platon, dans le Cratyle et dans le Sophiste, désigne mots et énonciations
comme objet d’étude, ce qu’il recherche en fait c’est la forme dans laquelle le langage
peut être correct : il met à l’épreuve le medium de ses propres dialogues, la forme
que l’exercice philosophique assume, – non pas pour évaluer la puissance du
langage, mais celle de la ilosophie même, de son rapport avec la réalité.
Aussi, lorsque Chrysippe affirme que seulement le διαλεκτικός – c’est-à-dire, au sens
large, le logicien – possède la vertu
4
, et qu’il faut donc travailler sur le langage dans
la mesure où il mène à la connaissance, (qui mène au τὸ ὁμολογουμένως τῇ φύσει
ζῆν (D.L. VII.87 / SVF I.179, Zénon), c’est-à-dire à la vie éthique en cohérence avec la
1
Cfr. Plat. Phaedr. 95d 7 ; Crat. 426a 2 ; Theaet. 175c 8 ; Resp. 533c 2.
2
J. Lohmann, Musiké und Logos. Ansätze zur griechisch. Philosophie und Musiktheorie, 1970, p. 8s.
3
F. Ildefonse, La naissance de la grammaire dans l’Antiquité grecque, 2004, p. 15 et 38.
4
Διαλεκτικὸν μόνον εἶναι τὸν σοφόν (D.L. VII.83 / SVF II.130).

2
nature), il est bien possible que le recours au langage ait eu des finalités qui sont au
langage même, strictement dit, extérieures.
5
Il est possible, comme cela a été fait, d’interpréter le tout comme une avancée
agressive vers l’hétéronomie : la philosophie à l’âge classique a imposé au langage
ses propres normes d’après ses exigences. On a ainsi parlé d’un « blocage
linguistique »
6
, d’une ombre projetée par la philosophie sur le langage, qui a été
remis en question essentiellement en ce qui concerne « die instrumentale Rolle beim
Ausdruck des Gedankens », ou la « mediale Funktion bei der Abbildung der
außersprachlichen Realität »
7
, et cela, afin de « pourvoir à un système d’expression
qui saisît ‘les choses telles qu’elles sont’ »
8
. Et c’est une hypothèse bien soutenue que
le retard de la naissance des disciplines linguistiques (grammaire, philologie,
linguistique), c’est-à-dire des disciplines explicitement vouées à l’enquête sur le
langage et en vue de rien d’autre que lui, ait été dû à une telle « mainmise » originaire
« de la philosophie sur le langage »
9
.
La circonstance est, sur certains points, tellement évidente, qu’il a été possible de
parler d’une sorte de ‘pillage’ des structures fondamentales du langage par la
philosophie : Benveniste, dans un très célèbre article de 1958, croyait pouvoir lire à
contre-jour, dans les catégories aristotéliciennes, le squelette des formes verbales
en usage dans le grec de l’époque : « [Aristote] pensait définir les attributs des
objets », dit-il, mais « il ne pose que des êtres linguistiques : c’est la langue qui, grâce
à ses propres catégories, permet de les reconnaître et de les spécifier ». « C’est ce
qu’on peut dire qui délimite et organise ce qu’on peut penser. La langue fournit la
configuration fondamentale des propriétés reconnues par l’esprit aux choses ».
10
La
mainmise serait donc, pour ainsi dire, indirecte : une tacite mais intense réflexion
sur le langage aurait été déguisée en enquête sur les catégories de la pensée, et
asservie à celles-ci.
5
Cas d’école : la grammatique. Ildefonse a bien montré comment les stoïciens n’auraient pu que
« refuser, empêcher une autonomie » de la grammaire ou d’autres disciplines linguistiques, et ça
exactement « pour des raisons philosophiques », liées à leur projet d’une « philosophie
systématique » (p. 139). Cfr. aussi M. Frede, The origins of traditional grammar, p. 337, dans Essays in
Ancient Philosophy, 1987, où il est bien montré que la grammaire n’était que « une partie de leur
philosophie ».
6
H. Joly, « Platon et les grammata », dans Joly (éd.), Philosophie du langage et grammaire dans
l’Antiquité, 1992, p. 308, cité par Ildefonse, Grammaire, p. 15.
7
E. Coseriu, Geschichte der Sprachphilosophie von den Anfängen bis Rousseau, 2003, p. 14. (« Le rôle
instrumental dans l’expression des pensées »; « la fonction médiale dans la représentation de la réalité
extralinguistique »).
8
C. Imbert, Phénoménologie et langues formulaires, 1993, p. 308.
9
Ildefonse, Grammaire, p. 15; cfr. aussi E. Coseriu, Geschichte der Sprachphilosophie, p. 1.
10
E. Benveniste, Catégories de pensée et catégories de la langue (1958), dans Problèmes de linguistique
générale I, 1966, p. 70.

3
Au-moins deux considérations peuvent s’ensuivre de ces questions. La première est
qu’une implication du langage dans la philosophie et dans les choses de la
philosophie n’a pas nécessairement déterminé une négligence de ses traits les plus
propres. Bien au contraire : elle a chaque fois permis d’en entrevoir la nature
éthique, épistémologique, politique, religieuse ; d’aller donc au-delà de l’isolement
du langage, tout en le saisissant dans la constellation effective de ses relations. Elle
a ouvert la possibilité de considérer le langage dans sa participation au tout, en
montrant la complexité de sa nature. Et la seule question philosophique autour du
langage n’est-elle pas celle qui, puisqu’elle le conçoit et le saisit dans sa totalité, va
finalement au-delà du langage même ?
Comme cela a été bien compris, il y a des années, par Eugenio Coseriu, les disciplines
qui ont pour objet le langage « beginnen » proprement « dort, wo die
Sprachphilosophie aufhört » (p. 13) : elles ont arrêté de se poser la question autour
du langage pour commencer à donner, chacune dans sa partialité, des réponses
spécifiques.
Une telle affection de la philosophie pour le langage contient donc quelque chose de
plus. Et cela dégage aussi, avec la seconde des observations, l’autre façon du lien
entre logos et philosophie.
I. 2 La tâche de la philosophie : une passion « indicible »
Dans une affirmation attribuée par Platon à l’Étranger, dans son dialogue Le
Sophiste, on trouve une expression plutôt éloquente : « la privation du logos ferait,
ce qui serait le plus grave, que nous serons privés de la philosophie même » (260a)
11
.
L’intuition de Giorgio Agamben et sa lecture du monde ancien débutent précisément
à partir d’ici : non seulement le langage est compris à travers une perspective
philosophique, mais, dans le monde ancien comme dans celui d’aujourd’hui, la
philosophie est à comprendre exactement dans le rapport qu’elle instaure avec le
langage.
L’affirmation est forte et prend immédiatement position, mais d’autant plus
intéressante : si l’on admet l’urgence, pour la philosophie et pour le langage, de
considérer à nouveau leur lien, et si on veut comprendre dans quelle mesure
l’exigence de l’enquêter a traversé l’antiquité jusqu’à notre temps, alors la recherche
conduite par Agamben se révèle être une proposition incontournable : en en
reconnaissant la matrice originaire dans l’espace théorétique qui lie Platon et le
Stoïcisme Ancien, il la pose, en même temps, comme fondement de toute pensée.
11
« Τούτου γὰρ στερηθέντες, τὸ μὲν μέγιστον, φιλοσοφίας ἂν στερηθεῖμεν ».

4
Dans un texte de 1984 Agamben avait posé très clairement la question de la tâche
propre à la philosophie, en disant : « La tâche de l’exposition philosophique est de
venir, avec la parole, en aide à la parole, pour que, dans la parole, la parole même ne
reste pas présupposée à la parole, mais, en tant que parole, vienne à la parole »
12
.
Dans cette curieuse formulation, la référence est au βοηθεῖν du Phèdre (278 c 6).
Dans le passage platonicien, y est dit « savant » seulement celui qui sait rendre
raison, avec son propre discours, du discours même, même s’il est écrit. Ça veut dire,
avec des termes qu’Agamben définie comme « contemporains » : rendre compte du
fait même de parler. C’est-à-dire : se rendre compte, parvenir à la connaissance du
« fait même du langage » (ibid.) – de ce présupposé qui demeure comme un apriori
de chaque acte linguistique.
Mais, parce que cette présupposition précède encore et toujours l’homme qui parle
et l’acte même de la parole, elle en est le fondement proprement « indicible »,
inexprimable
13
. La question est alors la suivante : concevoir philosophiquement et
essayer d’exprimer cet avoir-lieu du langage, cette impossibilité originaire.
La formulation est certes proche de la maxime wittgensteinienne selon laquelle
« was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden » (Wittgenstein, Tractatus
4.1212) : il n’est pas possible avec le langage de dire le langage même. Et la
médiation de Martin Heidegger n’est pas non plus cachée : il avait assigné à cet avoir-
lieu, qu’on ne peut pas exprimer dans ni avec le langage, l’ouverture du Dasein à soi-
même : « Die primäre Entdeckung der Welt » (Heidegger, Sein und Zeit, p. 138). « Non
pas comme le monde est, mais », dit Agamben, « que le monde est » – non pas ce
qu’on dit « dans des propositions à l’intérieur du langage, mais que le langage
soit »
14
.
Mais si la question est un caractère propre à la pensée contemporaine, le mérite de
la recherche agambenienne consiste, surtout, en le développement de la trace
archéologique : la découverte de la matrice de cette exigence, propre au vingtième
siècle, dans ce que déjà Platon avait indiqué comme la marque, dit-il, « de
l’authentique exposition philosophique », mais que seulement le Stoïcisme, selon sa
lecture originale, serait arrivé à exprimer d’une façon exemplaire.
Dans le pressentiment d’une impossibilité, Agamben s’adresse en fait une première
fois aux Stoïciens. Il s’agit de la théorie stoïcienne des passions, avec une inédite
participation à la théorie du Dasein heideggérien. Le Dasein, nous rappelle Agamben,
se pose face à l’ouverture – qui est une ouverture au langage – avec Angst, angoisse
12
En italien : « compito dell’esposizione filosofica è quello di venire con la parola in aiuto alla parola,
perché, nella parola, la parola stessa non resti supposta alla parola, ma venga, come parola, alla
parola », dans La cosa stessa, texte d’une conference à Forlì en 1984, publié dans La potenza del
pensiero, 2010, p. 18.
13
Cfr. Agamben, L’idea di linguaggio, dans La potenza del pensiero, p. 30-34.
14
« Non come il mondo è, ma che il mondo è », - non pas ce qu’on dit « in proposizioni all’interno del
linguaggio, ma che il linguaggio sia », dans Vocazione e voce, texte d’une conference à Pavia en 1980,
dans La potenza del pensiero, p. 80.

5
: « cette ouverture se révèle depuis toujours traversée par une négativité et un
malaise » (Vocazione e voce, p. 82), car le « Dasein » n’est jamais maître de cette
ouverture, de cet événement qui l’assaille et le détermine (et qui « coïncide avec le
lieu propre de l’être de l’homme, avec son da » (p. 83).
Or, que l’ouverture originaire soit, pour Heidegger, une tonalité émotive, a sa
correspondance dans le monde ancien : Heidegger même signale comment la
théorie aristotélicienne des passions fût l’objet de la Rhétorique et non pas d’un
traité « psychologique »
15
, mais, Agamben le souligne, le lieu effectif est finalement
à repérer chez les Stoïciens (p. 84).
Chez Chrysippe, il retrouve un lien fondamental entre langage et passions, λόγος et
πάθη : seulement l’homme est celui qui peut tomber sur les passions, puisqu’elles
sont proprement un certain grade du logos, une krisis. Elles sont à définir dans leur
relation, et jamais vraiment en contraposition, avec le logos. C’est ici qu’Agamben,
avec une radicalisation, entend la théorie stoïcienne des passions comme un excès
du λόγος, c’est-à-dire comme son émersion. En tant qu’origine et en tant que
« passion », le langage demeure, pour les individus, excessif : les Stoïciens en
donnent la définition suivante, citée par Agamben : πάθος δὲ πλεονάζουσα ὁρμὴ ἢ
ὑπερτείνουσα τὰ κατὰ τὸν λόγον μέτρα : « la passion est une impulsion excessive
qui transgresse la mesure du logos » (Clemens Al., Strom. II, SVF III.377). « Ὁρμή »,
qui « a la même racine du latin orior et origo » (ὄρνυμι), signifie l’émersion, l’origine,
l’apparition toute primaire – qui dépasse donc la mesure du langage (p. 84-5). Et si
la passion n’est autre que le logos même, « l’origine excessive ne peut être que celle
du langage même » (p. 85)
16
.
Ainsi, Agamben peut conclure que « la théorie des passions, des Stimmungen – est
depuis toujours le lieu où l’homme occidental pense son rapport fondamental avec
le langage »
17
. Et cette pensée est toujours la pensée d’une impossibilité : l’origine
excédante du langage, qui en contient le fait même d’exister, semble insaisissable.
Elle échappe, à cause de son excessivité même, et cependant elle n’arrête pas – pour
la philosophie qui l’a posée comme sa propre tâche fondamentale – de manifester sa
propre exigence, que la relation aux passions identifie et précise, mais n’arrive pas
à accomplir.
La question, à l’époque ancienne comme aujourd’hui, peut finalement être ainsi
formulée : est-il possible de développer un discours qui, en ne se réduisant pas à une
métalinguistique et ne s’arrêtant pas en face de l’indicible, dise le langage et ses
limites ? – qu’il soit à la hauteur d’une philosophie comme « vision du langage »
18
?
15
M. Heidegger, Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, dans Gesamtausgabe, vol. 18.
16
Agamben précise que « dans les fragments des Stoïciens [..] nous ne trouvons nulle part une
affirmation aussi explicite ; et pourtant elle est la seule qui ne contredise pas les prémisses de leur
théorie des passions » (p. 85).
17
En italien : « La teoria delle passioni è da sempre il luogo in cui l’uomo occidentale pensa il proprio
rapporto fondamentale col linguaggio » (1980, p. 95).
18
Agamben, L’idea di linguaggio, p. 29.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%