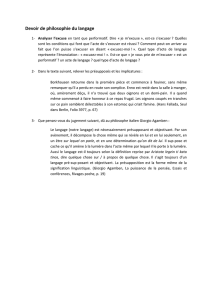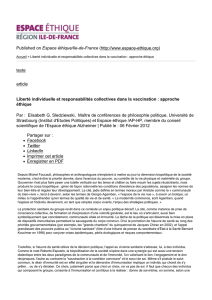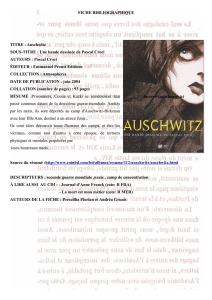0 – EDITO n° 57-1

L'enseignement philosophique – 60eannée – Numéro 1
1. Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin. Homo Sacer III, Traduit de l’italien par
Pierre Alferi, Bibliothèque Rivages, 1999.
2. Primo Levi, Si c’est un homme, Pocket, 2005.
3. Philippe Mesnard – Claudine Kahan, Giorgio Agamben à l’épreuve d’Auschwitz. Témoignages/Interprétations,
Éditions Kimé, 2001.
AGAMBEN ET AUSCHWITZ
Charles BOYER
Hon. Lycée La Fontaine, Paris
Le philosophe italien Giorgio Agamben est l’auteur d’une réflexion originale sur le
témoignage à partir, en particulier, de celui que Primo Levi nous a laissé dans ses divers
ouvrages 1. La thèse paradoxale d’Agamben est que les vrais témoins sont ceux, précisé-
ment, qui n’ont pas témoigné, qui ne pouvaient pas témoigner, à savoir ceux qu’à Ausch-
witz on appelait les « musulmans » et dont Primo Levi dit, dans Si c’est un homme 2, que
« c’est ainsi que les anciens du camp surnommaient, j’ignore pourquoi, les faibles, les
inadaptés, ceux qui étaient voués à la sélection. » Donc, pour Agamben, le rescapé ne
peut témoigner intégralement et le témoin intégral ne peut témoigner ! Il va de soi
qu’une telle thèse peut surprendre, voire heurter, ceux qui accordent une immense
valeur aux témoignages des rescapés. C’est le cas de Claudine Kahan et Philippe Mesnard
qui ont répondu à Agamben en étudiant minutieusement son livre3.
Cet article portera donc sur la thèse paradoxale d’Agamben et la critique vigou-
reuse faite par P. Mesnard et C. Kahan, pour tenter de mettre à jour ce qui est vraiment
en jeu dans ce « débat » c’est-à-dire en quoi la thèse d’Agamben, aussi scandaleuse qu’elle
soit, n’en constitue pas moins, selon nous, une réflexion philosophique intéressante. Mais
n’est-ce pas le propre du skandalon (« obstacle, pierre d’achoppement ») que, précisé-
ment, de faire obstacle à ce qui nous semble évident, à ce que nous croyons spontané-
ment, et du coup, nous fait réagir, pour, peut-être, nous amener à réfléchir à ce qui, de
prime abord, nous a choqués?
L’IMPOSSIBLE TÉMOIGNAGE:
Rendre compte du livre d’Agamben peut paraître impossible pour des raisons de
forme et de fond sur lesquelles nous n’insisterons pas puisque Mesnard et Kahan y consa-
crent la deuxième partie de leur ouvrage. Néanmoins on peut considérer, quoique de
façon nécessairement schématique, qu’il y défend une thèse à savoir « que les rescapés,

AGAMBEN ET AUSCHWITZ 21
donc, témoignaient d’une chose dont on ne pouvait témoigner », ou dit autrement,
qu’une « lacune » constitue la « part essentielle » du témoignage. Thèse qu’il défend en
s’appuyant, en particulier mais pas uniquement, sur le témoignage de Primo Levi, en
affirmant que, paradoxalement, les vrais témoins sont ceux qui n’ont pas pu témoigner, à
savoir les « musulmans ». Ce serait alors lui, le « musulman », qui serait le « témoin inté-
gral » – ce qu’Agamben nomme le « paradoxe de Levi » – car, alors que les SS ont été
incapables de témoigner puisque sont restés des « hommes », alors que « les victimes
témoignaient de leur inhumanisation », « le musulman est le non-homme qui se présente
obstinément comme homme, et l’humain qu’il est impossible de distinguer de
l’inhumain. » Donc la question qu’il aborde est : « Qui est le sujet du témoignage ? »
puisque le rescapé peut parler mais n’a rien à dire (d’essentiel ?) alors que le
« musulman » a beaucoup à dire mais ne peut parler! D’où « le rescapé témoigne pour le
musulman » car « le sujet du témoignage est celui qui témoigne d’une désubjectivation ». Ce
qui suppose, selon Agamben, qu’il n’y a pas de sujet (substantiel) mais « des flux de sub-
jectivation et de désubjectivation ». Dit autrement, sa thèse, en la matière, est que « les
hommes sont des hommes en tant qu’ils ne sont pas humains » ou, plus précisément,
« les hommes sont des hommes en tant qu’ils témoignent du non-homme ». Ce qu’il justi-
fie en se référant à la linguistique de Saussure et de Benveniste, à l’analyse existentielle
de Binswanger et à Heidegger. Conception du « sujet » non-cartésienne puisque « Le
mode d’être du je, le statut existentiel du vivant-parlant est donc une espèce de glossola-
lie ontologique, une rumeur absolument sans contenu, où vivant et parlant, subjectiva-
tion et désubjectivation ne peuvent jamais coïncider. »
Quoi qu’il en soit, cela lui permet de défendre l’idée que le témoignage ne peut
être ce que l’on pense d’habitude puisqu’il n’y a pas de sujet-témoin et que le vrai témoin
est le musulman qui ne peut témoigner! D’où les formules paradoxales qui peuvent lais-
ser perplexes: « l’homme est celui qui peut survivre à l’homme » c’est-à-dire « l’homme est
le non-homme; est véritablement humain celui dont l’humanité fut intégralement détruite ».
Il en déduit que si le musulman est le seul à vraiment témoigner alors cela veut dire
« qu’il n’est pas possible de détruire intégralement l’humain, que toujours reste quelque
chose. Le témoin est ce reste. » Ce qui constitue la justification du titre de son essai. Ce
reste s’explique donc par le fait qu’il n’y a pas d’essence humaine, pas de relation humai-
ne, mais « l’homme a lieu dans le non-lieu de l’homme, dans l’articulation manquée entre le
vivant et le logos. L’homme est l’être qui manque à soi, consiste seulement dans ce man-
quement et dans l’errance qu’il ouvre. » Pour conclure que l’homme est « toujours en
deçà ou au-delà de l’humain, il est le sas par lequel passent sans cesse les courants de
l’humain et du non-humain, courants de subjectivation et de désubjectivation, du deve-
nir-parlant du vivant, du devenir-vivant du logos. »
Ainsi, dans le témoignage, le sujet est problématique puisqu’il y a « dans la possi-
bilité même de parler, une impossibilité de la parole. Et c’est pourquoi la subjectivité se
présente comme témoin, peut parler pour ceux qui ne peuvent parler. » Dit autrement,
l’autorité du témoignage ne relève pas de sa vérité – comme on le pense d’habitude –
mais dans la relation entre dicible et indicible, il « apparaît seulement où est apparue une
impossibilité de dire, parce qu’il y a témoin seulement où il y eut désubjectivation ». C’est
pourquoi le « musulman » est le « témoin intégral » mais c’est pourquoi aussi, on ne peut
le séparer du rescapé comme Levi ou Antelme. D’où sa conclusion sur le reste: « le reste
d’Auschwitz – les témoins – n’est ni les morts ni les survivants, ni les naufragés ni les res-
capés, mais ce qui reste entre eux. » Cela permet de comprendre pourquoi il achève son
livre par les témoignages d’ex-« musulmans ».

22CHARLES BOYER
SONDERKOMMANDO VERSUS MUSULMAN :
Or, c’est cette place privilégiée qu’Agamben accorde au « musulman » que Phi-
lippe Mesnard et Claudine Kahan contestent : « pour exemplaire que soit le “musul-
man”, la vérité qu’il délivrerait sur la réalité concentrationnaire n’en est pas moins
partielle et cette vérité est inadéquate à la réalité des centres de mise à mort et à la
destruction des juifs et du judaïsme européen », affirment-ils d’emblée. Ils y opposent
le témoignage des rescapés et particulièrement des Sonderkommandos d’Auschwitz,
c’est-à-dire des « brigades chargées des phases précédant et suivant les gazages ». Ils
écrivent: « Alors, il ne s’agit pas seulement de mener une critique de l’usage agam-
bien du musulman, mais de soutenir que s’il y a à exemplariser une figure du témoin,
c’est dans les Sonderkommandos qu’il faudrait venir la chercher ». Ils procèdent alors à
une analyse critique minutieuse du texte d’Agamben qu’ils confrontent à la réalité his-
torique et qui est tout à fait justifiée. Exemple : Agamben parle d’Auschwitz alors qu’il
y avait trois camps, le premier de concentration, le second Birkenau fut le « centre de
mise à mort », et le troisième, le Lager Buna, où travailla Primo Levi. Ils montrent
comment il interprète le texte de ce dernier et d’autres, et surtout comment il les utili-
se dans son optique alors que, pour eux, le « musulman » n’est peut-être pas « repré-
sentatif du système concentrationnaire ». Et sans entrer dans le détail de cette cri-
tique, ils affirment que les « erreurs » d’Agamben viennent de sa théorie
« biopolitique », issue de Michel Foucault 4, qui « le coupe d’une compréhension du
politique en tant que le politique ne puisse s’appréhender en dehors de son articula-
tion avec le social », ce qu’ils n’explicitent pas vraiment. Quoi qu’il en soit, au para-
doxe agambien d’Auschwitz, ils opposent le « paradoxe de Birkenau » et font des Son-
derkommandos les vrais témoins alors que le musulman d’Agamben n’est qu’une
construction intellectuelle. Il est vrai aussi, qu’ils n’ont pas la même conception de la
subjectivité et de l’éthique, ce que nous aborderons plus loin. Notons, pour le
moment, que cela leur permet d’opposer : « La subjectivité du Sonderkommando ver-
sus la désubjectivation du musulman. » 5
À cette partie historique de la critique, ils ajoutent une seconde pour montrer
que le discours d’Agamben « révèle une affinité avec l’esthétique du sublime : comme
elle, il opère plutôt par la fascination que par la démonstration. » Seconde critique
tout aussi justifiée même si elle est plus difficile à suivre. Retenons qu’ils reprochent
à Agamben, à propos de la Gorgone 6, de transformer une expérience vécue et souf-
4. Rappelons que Foucault à la fin de La volonté de savoir (Gallimard, 1976) explique que depuis le XVII-XVIIIe
siècle il y a eu transformation du pouvoir : « On pourrait dire qu’au vieux droit de faire mourir ou de laisser
vivre s’est substitué un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort. » Ce pouvoir contrôle le corps humain
(disciplines) et la population (natalité et mortalité, santé, durée de vie, etc.) ; c’est pourquoi « il faudrait parler
de « bio-politique » pour désigner ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs expli-
cites et fait du pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie humaine » ; d’où « l’importance croissante
prise par le jeu de la norme aux dépens du système juridique de la loi. »
5. On trouve dans Georges Didi-Huberman, Images malgré tout (Les édit. de Minuit, 2003), un « débat » simi-
laire à propos des 4 célèbres photographies de l’enfer d’Auschwitz-Birkenau prises par Alex, un Sonderkom-
mando. L’auteur y fait part – mais l’ouvrage ne se réduit pas à cela - de la polémique avec le psychanalyste
Gérard Wajcman et aussi avec Claude Lanzmann car pour eux la Shoah est irreprésentable. L’un affirme qu’« Il
n’y a pas d’image(s) de la Shoah »; l’autre, oppose aux images d’archive la parole des témoins ; il cite aussi
Lanzmann allant même jusqu’à déclarer que s’il avait trouvé un film des SS montrant l’extermination, « je l’au-
rais détruit »! On voit donc que là, la question n’est plus celle du sujet du témoignage, mais du moyen de sa
transmission : images (malgré tout) ou paroles ?
6. Gorgone (Méduse) avait des yeux si étincelants et un regard si pénétrant que quiconque la voyait était
changé en pierre. Elle était un objet d’horreur et d’épouvante.

AGAMBEN ET AUSCHWITZ 23
ferte, celle des rescapés, en une expérience intellectuelle, « un jeu de la pensée et du
concept ne laissant nulle place à l’incontrôlé ». C’est, en effet, dans Les naufragés et
les rescapés 7que Levi écrit : « nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins »
car, ajoute-t-il, nous sommes ceux qui « n’ont pas touché le fond. Ceux qui l’ont fait,
qui ont vu la Gorgone, ne sont pas revenus pour raconter, ou sont revenus muets, mais
ce sont eux, les « musulmans », les engloutis, les témoins intégraux, ceux dont la déposi-
tion aurait eu une signification générale. Eux sont la règle, nous, l’exception. » (Souli-
gné par nous). Or, Agamben pense que voir la Gorgone signifie « l’impossibilité de
voir propre à qui habite le camp, à qui, dans le camp, « a touché le fond », est deve-
nu un non-homme », c’est-à-dire le musulman. Et, selon lui, c’est cela qui nous inter-
pelle : « voilà le témoignage, et il n’est rien d’autre. » Mesnard et Kahan rétorquent
que « l’évocation de la Gorgone, pour ce dernier [Levi], se justifie par l’affect qu’elle
signale, autant chez celui qui parle que chez celui qu’il décrit. Chez Agamben, le
recours à cette figure démontre surtout l’exploitation radicale d’un terme qui n’a
plus valeur de témoignage mais de mine philologique, produisant les trésors dont
nous devenons ici lecteurs et “bénéficiaires” ». Ils ajoutent qu’« apprendre à la regar-
der », comme le propose Agamben, n’a pas de sens car le « traumatisme se subit, il
ne peut s’apprendre ». 8
Ainsi pour eux, l’écriture d’Agamben relève « de la rhétorique du sublime, qui
vise précisément à effacer les limites identitaires, à engendrer la rupture avec ce qui
est familier, à plonger le lecteur dans une confusion fébrile, à le stupéfier et à l’em-
porter d’un geste vaste dans l’incommensurable. » Ils lui reprochent ainsi de se référer
à la linguistique structuraliste, de revenir « à un modèle théorique qui de toute
manière invalide et la communication et le témoignage. » Ils peuvent écrire alors :
« Pour résumer : Exemplarité, préfiguration, interprétation figurale sont tous des
modes de lecture hypotactiques qui, construits sur la dépendance réciproque de leurs
éléments, surdéterminent la réalité qu’ils subordonnent à une autre dimension, théo-
rique, qui la transcende. »
De ces deux critiques, ils concluent qu’Agamben réduit « le témoignage à une
pure abstraction » parce que fondamentalement, on l’a déjà noté, il conçoit « la politique
in abstracto, en faisant l’impasse sur le social et sa pluralité », en enfermant le monde
« dans la catastrophe, et la politique dans un « tout ou rien » dévastateur. » Ainsi ses
« erreurs et errances […] viennent sans doute, d’une pensée qui privilégie l’exception à la
normalité, faisant l’impasse sur tout ce qui concerne la question de la conformité aux
normes, et qui cherche à découvrir dans l’histoire une fonction paradigmatique unique
ou centrale. » Ils font là référence, semble-t-il, à un précédent ouvrage d’Agamben dans
lequel il affirmait que « Le camp, qui s’est désormais solidement implanté en elle [la
Cité], est le nouveau nomos biopolitique de la planète. »9. En effet, précisons rapidement
qu’il y oppose au modèle traditionnel de la cité, le modèle du camp, « nomos de la
modernité », paradigme de la « politisation de la vie nue » – zôè, c’est-à-dire le simple fait
de vivre commun à tous les êtres vivants – qui est devenu, selon lui, l’ordinaire du pou-
voir. Mais, laissons là la « biopolitique » et revenons à notre propos.
7. Primo Levi, Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, p. 82/83, traduit de l’italien par
André Maugé, Arcades Gallimard, 1989/99.
8. Didi-Huberman, op. cit, précise, contre Wajcman, que si Persée arrive à tuer la Gorgone sans la regarder, « il
l’affronte malgré tout » et « ce malgré tout […] se nomme image : le bouclier, le reflet ne sont pas seulement sa
protection, mais son arme, sa ruse, son moyen technique pour décapiter le monstre. »
9. G. Agamben, Homo Sacer, Le pouvoir souverain et la vie nue, III, 7, Coll. L’ordre philosophique, Edt. du Seuil, 1997.

24CHARLES BOYER
«EN DEÇÀ DU BIEN ET DU MAL » :
Or, autant ces deux critiques nous paraissent justifiées, autant elles nous sem-
blent insuffisantes pour épuiser le texte d’Agamben. En effet, elles ne mettent pas assez
l’accent sur ce qui en fait la finalité. Pourtant, dès l’avertissement, il la précisait: « une
recherche sur l’éthique et le témoignage » et non un livre d’histoire – les travaux d’Hil-
berg font, dit-il, autorité en la matière. Le problème, pour Agamben, est celui « de la
signification éthique et politique de l’extermination » et « de la compréhension humaine
de l’événement ». Comment imaginer cela ? Comment le communiquer ? Est-ce
possible? Certes, ce qu’il appelle « l’aporie d’Auschwitz » est assez ambigu: c’est « l’apo-
rie même de la connaissance historique: la non-coïncidence des faits et de la vérité, du
constat et de la compréhension », comme si vérité et compréhension étaient
synonymes! Reste qu’il y pose qu’il s’agit bien, pour lui, de penser à nouveau l’éthique,
« la terre neuve éthique ».
En effet, Agamben distingue, dès le début, le droit, la morale et l’éthique. Le
témoin est un rescapé, non un juge; de plus, la découverte par Primo Levi de la « zone
grise », zone de « non-responsabilité », montre qu’on est « en deçà du bien et du mal »10.
Levi conclut ce chapitre en écrivant: « Nous voudrions dès lors inviter le lecteur à s’inter-
roger: que pouvaient bien justifier au Lager des mots comme « bien » et « mal », « juste » et
« injuste » ? À chacun de se prononcer d’après le tableau que nous avons tracé et les
exemples fournis; à chacun de nous dire ce qui pouvait bien subsister de notre monde
moral en deçà des barbelés. » (Souligné par nous). Agamben en déduit que le témoigna-
ge ne relève ni du droit ni de la morale mais d’un « nouvel élément éthique » puisque,
selon lui, « responsabilité et faute ne sont que les deux faces de l’imputabilité pénale »;
c’est pourquoi l’éthique ne doit pas se fonder sur ces deux concepts. En effet, « l’éthique
est la sphère qui ne connaît ni faute ni responsabilité: elle est, Spinoza le savait, la doc-
trine de la vie heureuse. Reconnaître une faute et une responsabilité – chose qu’il faut
parfois faire – signifie quitter la sphère de l’éthique pour pénétrer dans celle du droit. »
Mais quelle éthique au juste? Il s’agit pour lui de ce qu’il nomme « l’aporie propre à
Auschwitz: un lieu où il est indécent de rester décent, où ceux qui ont cru conserver
leur dignité et leur respect de soi n’éprouvent que honte devant ceux qui les ont sur le
champ perdus » à savoir les « musulmans ». Ce qui est la preuve que « la morale elle-
même, l’humanité elle-même sont remises en question ». Et même que: « Auschwitz
signe l’arrêt de mort de toute éthique de la dignité ou de l’adéquation à une norme ».
Reste néanmoins l’éthique au sens « d’une forme de vie » en deçà de toute morale
puisque « la dignité bafouée n’est pas celle de la vie, mais bien celle de la mort ». Le
problème éthique d’Auschwitz est celui « de l’avilissement de la mort » car à Auschwitz
« on ne meurt pas, on produit des cadavres ».
DE LA HONTE:
Si on laisse de côté la référence à la pensée de Heidegger, on voit que le problè-
me qu’il soulève s’enracine dans le fait que les rescapés ont honte, non d’avoir survécu
comme on le dit d’habitude, mais d’« une honte sans culpabilité et même, pour ainsi
dire, sans temps »! Qu’est-ce à dire? Il prend comme exemple le cas de cet étudiant de
Bologne que rapporte Robert Antelme11 et qui, choisi au hasard par les SS pour être tué,
« est devenu rose » lorsqu’il comprit que c’était bien lui « qui était désigné ». Si Antelme
10. Primo Levi, Op. Cit. Chapitre 8.
11. Robert Antelme, L’espèce humaine,II La route p. 241/242, TEL Gallimard, 1978/91.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%