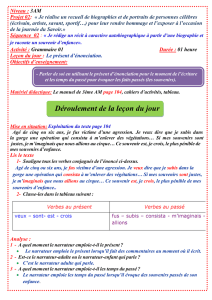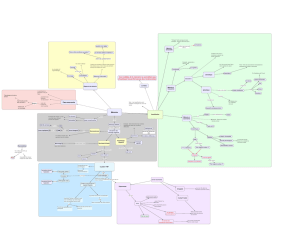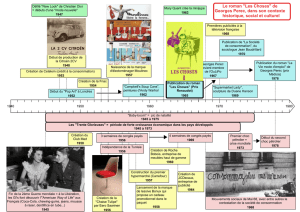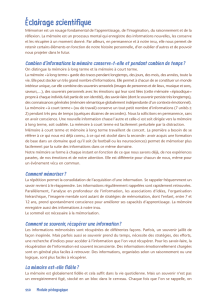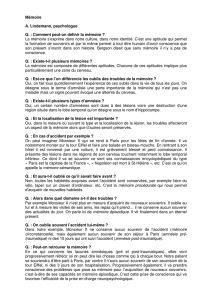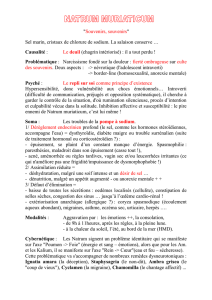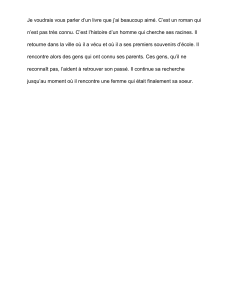Séance 1 : W ou le souvenir d’enfance, Georges Perec
I. Une enfance oubliée
L’extrait s’ouvre sur cette affirmation définitive, indiscutable, péremptoire : « Je n’ai
pas de souvenirs d’enfance ». L’utilisation de la négation ancre l’énoncé dans
l’absence, l’inexistence du souvenir. Selon Perec, son «histoire tient en quelques
lignes » (L2). Il perd son « père à quatre ans », sa « mère à six ».
Cette absence de souvenirs le sécurise et le protège comme nous pouvons le lire
aux lignes 6 et 7 : « Cette apparente sécheresse m’a longtemps rassuré : sa
sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence me protégeaient
(…) » (L5/6).
Par ailleurs, Perec indique lui-même poser « cette affirmation avec assurance, avec
presque une sorte de défi ». En effet, elle lui permet de contourner les questions
qu’on pourrait lui poser sur son enfance : « L’on n’avait pas à m’interroger sur cette
question. Elle n’était pas inscrite à mon programme. J’en étais dispensé ». Selon lui,
« l’Histoire avec sa grande hache » répond à sa place : « la guerre, les camps ».
L’image de la hache n’est pas sans rappeler l’allégorie de la faucheuse.
Toutefois, Perec nuance par la suite ses propos. Ainsi, il déclare après : « Mon
enfance fait partie de ces choses dont je sais que je ne connais pas grand-chose »

(L22/23) puis en vient à évoquer deux souvenirs « pas totalement
invraisemblables » (L35).
Il finit par changer de regard sur son enfance : « elle m’a appartenu, quelle que soit
ma ténacité à affirmer qu’elle ne m’appartient plus » (L24/25).
Pour G.Perec, l’enfance devient alors « horizon, point de départ, coordonnées à
partir desquelles les axes de sa vie pourront trouver un sens ». Ainsi, retrouver son
enfance lui permettra de trouver le sens de son existence, de se connaître.
II Des souvenirs ………………………
=> La quête de son enfance s’avère compliquée parce que le narrateur ne peut
s’appuyer que sur des « souvenirs improbables », et des « témoignages rares », les
« documents dérisoires ». Les adjectifs utilisés ici insistent sur le caractère flou et
incertain de ses souvenirs. Lui-même qualifie ses souvenirs de « pas entièrement
invraisemblables ».
=> C’est donc entre hésitation et contradiction que le narrateur se lance dans
l’évocation de ses deux « premiers souvenirs ». Il insiste sur le fait qu’il n’est
pas sûr de leur authenticité : «pas entièrement invraisemblables », «improbables»,
« dérisoires ». De plus, on remarque l’usage du mode conditionnel qui permet de
modaliser les propos (nuancer et indiquer qu’il existe un doute quant à leur
vérité) «aurait ».
L’évocation du souvenir du narrateur est contradictoire comme le souligne
l’interrogative « n’ai-je pas dit il y a un instant que j’avais trois ans ? ». De plus, il
utilise le verbe …………………. . Il assimile ce souvenir de famille à un tableau de
………………………. car son atmosphère est ………………… et …………… .
Je retiens
G. Perec dans son autobiographie W ou le souvenir d’enfance alterne fiction et
autobiographie. Il croise les deux récits. L’extrait étudié est ……………………..
(début) de la partie autobiographique de l’œuvre. Petit à petit un rapport se noue
entre les deux parties dans l’œuvre.
Perec fait le choix de se raconter entre ……………… et …………………., réalité et
……………… dans un style neutre sans ……………… .
1
/
2
100%