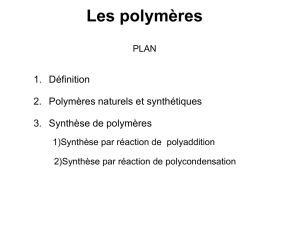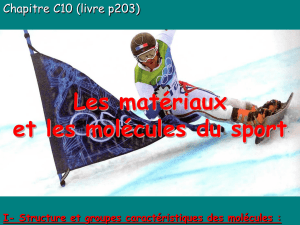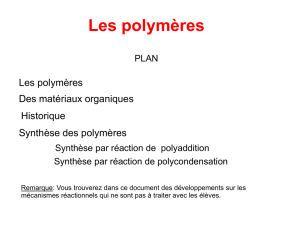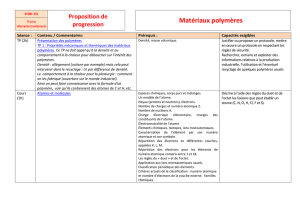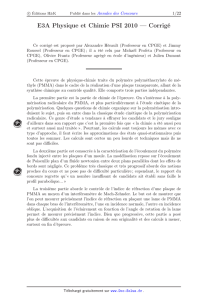Telechargé par
shalom guedekousseng
Actions chimiques et biologiques des radiations -- Paris, Masson et Cie Editeurs -- Volume 3, 1955 -- Paris, Masson et Cie [etc ] -- 592552943 -- b926f108988809f3c4b4a911090cb6c2 -- Anna’s Archive
publicité
![Actions chimiques et biologiques des radiations -- Paris, Masson et Cie Editeurs -- Volume 3, 1955 -- Paris, Masson et Cie [etc ] -- 592552943 -- b926f108988809f3c4b4a911090cb6c2 -- Anna’s Archive](http://s1.studylibfr.com/store/data/010211851_1-53cffbbecc9e34453a0f66e0fe551e26-768x994.png)
ACTIONS CHIMIQUES
ET
BIOLOGIQUES
DES
RADIATIONS
COLLECTION DIRIGÉE PAR M.
SINSKY
TROISIÈME SÉRIE
1
:
.:
'.:.''
.;!;!;
;
Ù
MASSON
!
!
iii'
li
& C' E ÉDITEURS
m*
\ù\iÙV-.i'.-\Ù\\{.'.M[ À-A
,
-_
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SAN FRANCISCO MEDICAL CENTER
LIBRARY
SGf
ACTIONS
CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
DES RADIATIONS
-
(TROISIÈME
SÉRIE)
-
-
RADIOLYSE
II.
-
POLYMÉRISATIONS AMORCÉES
RADIATIONS IONISANTES
III.
- EFFETS DES RAYONNEMENTS DE GRANDE
I.
DE
LIQUIDES
ORGANIQUES
ÉNERGIE SUR LES POLYMÈRES
PAR
LES
A LA MÊME LIBRAIRIE
ACTIONS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
dirigée par M. Haissinsky)
DES RADIATIONS (Collection
:
Première série
I. Aspects physiques de la radiobiologie, par
II. Chimie des radiations des solutions aqueuses.
L.-H. Gray.
III.
Aspects actuels des résultats expérimentaux, par M. Lefort.
Modern trends in radiation-biochemistry, par W. M. Dale. 1955.
254 pages, 70 figures.
:
—
—
Deuxième série
Les effets chimiques produits par les rayons
II. Phénomènes de
luminescence provoqués par les rayonnements de grande énergie,
III. Introduction à la dosimetric des radiations,
par M. Agéno.
par N. Miller. 195G. 222 pages, 39 figures.
:
I.
ionisants en phase gazeuse, par W. Mund.
—
—
I.
Radiolyse de liquides organiques, par
Polymérisations amorcées par les radiations
ionisantes, par A. Chapiro et M. Magat.
III. Effets des rayonnements de grande énergie sur les polymères, par A. Charlesby. 1958.
Troisième
M. Burton.
série
—
:
II.
—
Quatrième série. Les Peroxydes organiques en Radiobiologie.
par R. Latarjet et Collaborateurs. (Colloque sur les peroxydes
organiques formés par les radiations et leur rôle en radiobiologie.
Institut
du Radium, Paris.
<>
et 10 janvier 1957).
195K.
La chimie nucléaire et ses applications, par M. Haissinsky. 1057.
Un volume de 652 pages, avec figures.
Principes de radiobiologie, par Z. -M. Bacq et Peter Alexander.
1955. Un volume de 478 pages, avec 136 figures et nombreux
tableaux.
MÉCANISME DE L'ACTION BIOLOGIQUE DES RADIATIONS, par ERRERA
et Hervé. 1951. Un volume de 108 pages, avec 4 tableaux (Collection Médecine et Biologie, n° 10).
Les isotopes radioactifs en médecine et en biologie, par
M. Tubiana. 1950. Un volume de 392 pages, avec 84 figures.
Le danger des radiations pour l'homme. Actions des radiations
ionisantes sur les organismes vivants, par H. Ramioul. 1957. Un
volume de 146 pages, avec 33 figures.
ACTIONS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
DES RADIATIONS
COLLECTION DIRIGÉE
PAR
TROISIÈME
MILTON
A.
BURTON.
—
HAÏSSINSKY
SÉRIE
DE
RADIOLYSE
LIQUIDES
ORGANIQUES
CHAPIRO ET M. MAGAT. — POLYMÉRISATIONS AMORCÉES PAR
LES
A.
M.
CHARLESBY.
RADIATIONS IONISANTES
— EFFETS DES RAYONNEMENTS DE GRANDE
ÉNERGIE SUR LES POLYMÈRES
C^DCOI
AI
A S
1
3. se
1S5S
MASSON
C
le
Éditeurs
et
Libraires de l'Académie de Médecine
120, boul. Saint-Germain, Paris (VI e )
,
1958
227916
Tous droits de traduction,
d'adaptation
et
de
reproduction,
par tous procédés, y compris
photographie et microfilms,
réservés
pour tous pays.
©
by Masson et
(Printed in France.)
1958
C
le
RADIOL YSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
par
Milton BURTON
Radiation Project of the Department of Chemistry
University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana.
(Traduit de l'anglais par
HAISSINSKY.
III.
Mme A. BERNAS).
—
DE
RADIOLYSE
LIQUIDES ORGANIQUES
INTRODUCTION'
D'un point de vue pratique, la radiolyse des liquides organiques est particulièrement intéressante, car les résultats obtenus permettent de clarifier le domaine
de la radiobiologie, car ils sont liés à la dosimétrie des radiations et sont direc-
tement utilisables à des synthèses industrielles ou à la modification de composés
ou de mélanges importants. D'un point de vue théorique, les études des composés
organiques, dont les propriétés sont comprises dans un domaine vaste et presque
continu,
effets
aident à la compréhension des
primaires et secondaires
—
et
effets
physiques des rayonnements
—
à la connaissance détaillée des processus chi-
miques consécutifs.
Une interprétation poussée des résultats actuellement connus sur la radiolyse
un traitement complet de sujets
des substances organiques pourrait entraîner
très divers.
Bien que cet
article
ne néglige pas
les
acquises dans des domaines de recherches voisines,
il
connaissances intéressantes
ne peut pas prétendre à un
exposé complet des résultats relatifs, par exemple, aux réactions Szilard-Chalmers
aux processus consécutifs aux conversions internes nucléaires, ou à la signi-
et
fication des données de spectro graphie de masse, en particulier en ce qui concerne
solutions aqueuses de composés organiques.
les
Bien qu'on ne puisse évidemment pas comprendre parfaitement la radiochimie**
des composés organiques sans se référer aux phénomènes observés en phase vapeur,
les résultats
de tels travaux (cf.
Mund, Essex, Hamill et Williams et leurs colla-
borateurs, Stephenson et al.***) seront délibérément exclus de ce chapitre, à moins
(*)
L'auteur désire exprimer sa reconnaissance en particulier au Dr Judith M. Nos-
worthy et au Dr. Sanford Lipsky, pour l'aide inappréciable qu'ils lui ont apportée dans
préparation de ce texte.
Pour ne pas alourdir le texte on a souvent utilisé le terme radiochimie au lieu de
chimie des radiations (n. d. 1. t.)
(***) Il est nécessaire de remarquer que les résultats trop limités dont on dispose n'ont
pas permis d'essayer de déterminer la portée, pour la chimie des radiations des liquides,
de réactions d'ions avec des molécules, analogues à celles observées en spectrométrie de
masse, par exemple
CH 3+ + CH 4 - y C 2 b+ + 2
la
(**)
:
H
H
.
apparaît cependant qu'une telle réaction présente une section efficace très élevée (cf.
F. H. Field, J. L. Franklin and F. W. Lampe, J. Am. Chem. Soc, 78, 5697, 1956) et peut
ainsi jouer un rôle important, en particulier dans des processus d'agrégations moléculaires.
Il
INTRODUCTION
4
qu'ils
ne se
rap portent directement aux recherches correspondantes effectuées
dans les liquides. Trois mises au point récentes et détaillées fournissent heureusement au lecteur une longue liste de références (1, 2, 2 a).
L'auteur désire souligner que
plus haut
fait que,
—
— outre
les
omissions délibérées, soulignées
ce chapitre ne peut pas prétendre épuiser le sujet. Il est conscient du
pour des raisons diverses, de nombreux articles, dans la liste rapidement
Chimie des Radiations, ont pu lui échapper ou
croissante des publications en
larder à lui parvenir.
En particulier, il exprime ses regrets aux auteurs (améri-
cains ou étrangers) dont les travaux lui sont restés inaccessibles jusqu'à une date
récente.
Auprès de ces collègues scientifiques, l'auteur tient à s'excuser des omis-
sions ou des déductions erronées qui pourraient en résulter.
(1)
Tolbert (B. M.) et Lemmon (R. M.), Rad. Res. 3, 53, 1955.
Swallow (A. J.), Chem. Rev. 56, 473, 1956.
(2) Collinson (E.) et
(W), Actions
(2 a)
Mund
195(5.
chimiques
et
biologiques des radiations, 2 e série,
Masson
éd.,
CHAPITRE PREMIER
THÉORIE
Pour l'essentiel, une interprétation de la radiolyse des liquides organiques,
se réduit à essayer de comprendre les points fondamentaux suivants
a.
:
Le très large étalement des valeurs de G (rendements par 100 eV d'énergie
absorbée) rapportées dans la littérature, qui sont comprises entre des valeurs
presques nulles dans certains cas et des valeurs qui traduisent, dans d'autres
cas, la participation de processus en chaîne.
b.
Les raisons des ruptures préférentielles de liaisons, des réorganisations,
des additions et des réactions métathétiques obtenues par irradiation avec
des rayonnements de grande énergie.
1.
— EFFETS PHYSIQUES
De nombreux aspects des effets physiques des radiations ont été discutés
Gray dans le premier volume de cette collection. Cependant, quelques
par
aspects qualitatifs méritent d'être soulignés ou redits.
Les distances entre les effets physiques primaires dans les système condensés
sont déterminés dans une large mesure par la nature de la particule ou du
rayonnement incident. Les ionisations induites par des particules de grande
vitesse (par exemple des électrons de 1 MeV, que ce soit des électrons incidents
ou de recul) sont situées à des distances de l'ordre de quelques milliers d'angstrôms, tandis que les ionisations induites par des particules de faible vitesse
(par exemple a, protons, deutons, atomes de carbone totalement ionisés, etc.)
peuvent être séparées par des distances qui n'excèdent pas 1 ou 2 Â. Ces faits
sont résumés dans le tableau
I
qui dérive directement d'anciens calculs de
Lea (3).
Le nombre des processus d'excitation électronique simple est d'environ 1,5
à 2 fois aussi élevé que le nombre des processus d'ionisation (4,
(3)
Ainsi,
la
Lea (D. E.), Actions of Radiations on Living Cells, Cambridge University Press 1947,
Chap.
I.
Burton (M.) et Magee (J. L.), Natunviss., 19, 433, 1956.
(5) Fano (U.), Phys. Rev., 52, 44, 1946.
(4)
5).
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
6
trace (l'une particule lourde ionisante, par opposition à celle correspondant
à une particule légère, apparaît comme une région presque continue de forte
dissipation d'énergie.
Néanmoins, cette différence
est
moins marquée
qu'il
n'apparaît superficiellement
Tableau
I.
— Parcours, dissipation d'énergie
et
distance entre
les
ionisations primaires
dans un tissu de densité 1 g/cm* pour diverses particules incidentes (3).
PARTICULE
Électron
ÉNERGIE
PARCOURS
en
d'énergie
DE PARCOURS
dissipation
PAR
[x
[i.
en keV/fx
DISTANCE ENTRE
IONISATIONS
primaires en A
100 eV
keV
50 keV
100 keV
450 keV
5,9
0,053
1
Proton
1
Alpha
43
141
0,67
0,417
1
500
0,21
23
211
27,7
1
MeV
10 MeV
1
MeV
10 MeV
42,8
138
2 150
4 600
25
191
4,7
264
56
5,3
108
1,9
14
A la production d'une ionisation primaire, se trouve associée la production
d'un électron, d'une énergie type voisine de 75 éV. Les plus énergiques de
ces électrons secondaires ont été appelés rayons S mais il est également com-
mode en radiochimie des liquides d'appeler S tous les électrons secondaires.
La plupart des 8 sont diffusés au hasard et, en s'écartant de quelques diamètres moléculaires de leur lieu d'origine,
ils
dissipent leur énergie par la
production de nouveaux ions et de molécules excitées. Ces régions où sont
concentrées les ionisations et les excitations, dont le diamètre total dans les
liquides est de l'ordre de 5 Â, sont appelées des « grappes* ».
La composition de la grappe est connue approximativement à partir d'une
estimation de Kara-Michailova et Lea (6), basée sur d'anciennes expériences
chambre à détente de C. T. R. Wilson. Ces auteurs ont rapproché le
nombre des ions dans une grappe de la fréquence de production des grappes
à la
ainsi peuplées et
ils
ont obtenu les valeurs suivantes
Nombre des ions
Fréquence
:
1
2
3
4
> 4
0,43
0,22
0,12
0,10
0,13:
on trouve ainsi que la grappe contient en moyenne 3 ions.
La fraction des grappes qui contient 4 ions ou davantage est étonnamment
élevée mais ce qui est encore plus surprenant c'est l'estimation que 5 p. 100
de cette fraction contient 16 ions. Même dans le cas d'un bombardement par
particules rapides, la grappe moyenne représente une région où la dissipation
d'énergie est assez forte, c'est-à-dire de l'ordre de 100 eV dans un volume d'en(*) Les ouvrages plus anciens utilisent indifféremment le terme essaim d'ions (« ioncluster ») pour une concentration d'ions de ce type (cf. Lea) et pour un groupe de molécules polarisées par et liées à un ion central (cf. S. G. Lind, chemical effect of alpha par-
and electrons, New York, 1929).
Kara-Michailova (E.) et Lea (D.
ticles
6)
E.),
Proc. Cambridge Phil. Soc, 36, 101, 1940.
THÉORIE
7
vinrn 125 A 3 Ainsi, dans la grappe moyenne, L'énergie dissipée esl suffisante
pour rompre environ 25 liaisons covalentes. Le fait que les valeurs de <- pu
.
bllées ne sont pas toutes de Cet ordre de grandeur n'est pas tellement (tun
nant quand on l'envisage par rapport à la situation similaire qui existe en
photochimie. Dans ce dernier Cas, Oïl devrait S'attendre à des rendements
quantiques de L'ordre de 1* d'après la loi de Stark Einstein suivanl Laquelle,
il
se produit un processus primaire par plioton absorbe. En t'ait, les rende
ments quantiques de décomposition peuvent être nuls, par exemple pour le
benzène irradié à 2 537 À (8), l'aeroleine à 3 660-2 537 À (9) OU la erotonalde
hyde
à
3 660-2 399
À (10). Comme, dans ees différents cas, une quantité
Insignifiante de lumière est réémise sous forme de fluorescence,
Le
faible ren-
dement chimique doit résulter d'un autre proeessus
de dissipation de l'énergie.
La nature
^__
des autres
processus possibles est suggérée par la disposition
relative des niveaux d'énergie potentielle telle qu'elle
est
représentée sur la figure
indiqués
:
1.
Trois états sont
un état fondamental G et 2 états d'exci-
tation électronique E' et E". La flèche 1 correspond
à une excitation photochimique initiale vers un
état d'excitation électronique; dans l'exemple illus-
G
tré, le passage se fait vers le second état excité E".
schéma (mais ce
cas) à un niveau
L'excitation conduit, sur notre
,
FlG
-
c
E
Représentation
*•
schématique
des
niveaux
nest pas nécessairement le
d'énergie potentielle pour 3
états électroniques
d'une
d'énergie supérieur au niveau de dissociation D G
™léculeM, illustrant une
de l'état fondamental, mais nettement inférieur
excitation
photochimique
au niveau de dissociation de l'état excité. Le proavec un rendement quantiaue nul et sans faorescessus le plus probable (des alternatives moins
courantes ne seront pas discutées ici) est alors une
conversion interne « immédiate » [(c'est-à-dire en 10 _13 sec environ (11) vers
le premier état excité E
(flèche 2)J. Ensuite, a lieu une désactivation par
collision qui conduit à des niveaux de vibration moins élevés, jusqu'à ce
que la molécule, par une conversion interne (flèche 4) vers un niveau d'énergie
inférieur à D G atteigne l'état fondamental. Une désactivation par collisions
reconduit finalement la molécule à la température ambiante, avec un rendement quantique nul, et sans émission de lumière.
L'existence en photochimie de rendements quantiques supérieurs à zéro
mais inférieurs à l'unité s'explique par différents processus qui entrent en
compétition, chacun d'entre eux tendant à abaisser le rendement fluores7
,
:
(*)
En vertu du principe Franck-Condon d'excitation verticale
7
(
)
la
rupture d'une
une absorption d'énergie qui est en général de beaucoup supérieure à
l'énergie de cette liaison. Une valeur moyenne est de 5-6 év. Ainsi, un rendement quantique
de l'ordre de 1 en photochimie correspond à une valeur de G = 100/5 (ou 100/6) soit à enviliaison nécessite
ron 16-20.
Rollefson (G. K.) et Burton (M.), Photochemistry and the Mechamism of Chemical
Prentice-Hall Inc. New- York, 1939.
(8) Wilson (J. E.) et No yes (W. A.), Jr., J. Am. Chem. Soc, 63, 3025, 1941.
(9) Blacet (F. E.), Fielding (G. H.) et Roof (J. G.), ./. Am. Chem. Soc, 59, 2375, 1937.
(10) Blacet (F. E.) et Roof (J. G.), J. Am. Chem. Soc, 58, 73, 1936.
(7)
Reactions,
(11)
Kasha (M.), Disc. Far. Soc, 9, 14, 1950.
RAD10LYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
8
cence, désactivation par collision et conversion interne vers des niveaux qui
peuvent être ou non situés au-dessus des niveaux de dissociation des états
électroniques finaux,
fluorescence sensibilisée d'une autre espèce présente,
composé
désensibilisation par formation intermédiaire d'un
instable, effets
cage de Franck-Rabinowitch, et réactions inverses (7).
De même des rendements quantiques très élevés
réaction
d'EDER
(7))
:
de l'ordre de 10 5 (cf. la
s'expliquent aisément par des réactions radicalaires
en chaîne.
Il pourrait
sembler, au premier abord, que tous les phénomènes de la chimie
des rayonnements ionisants peuvent s'expliquer par analogie avec les situations
correspondantes en photochimie. Cependant, une
telle
analogie est
mise en doute a) par la quantité d'énergie libérée et dissipée dans un volume
restreint en chimie des radiations et b) par le fait qu'en chimie des radiations
quantité d'énergie libérée dans un
seul acte d'excitation est souvent
pour conduire à une ionisation (cf. Gray, cette collection vol. 1)
et même à une décomposition ultérieure des ions (cf. la multiplicité des
pics obtenus dans un spectre de masse type.) Quoi qu'il en soit, que les
mécanismes des réactions soient similaires ou non, les résultats de photochimie
et de radiochimie ne sont pas très différents en grandeur, bien qu'ils puissent
l'être en qualité. C'est un des objectifs principaux dans l'interprétation théola
suffisante
rique des résultats en chimie des radiations de rendre
compte de la simili-
tude essentielle qui semble exister dans des situations tout à fait dissemblables.
la.
— ÉTATS EXCITÉS
Les états excités produits au cours de la dissipation d'énergie de particules
primaires ou de rayons delta ne sont pas tous de même qualité. Une distinction manifeste peut être établie entre des états de différente énergie mais qui
possèdent tous l'énergie nécessaire à une rupture de liaison. Le plus bas de
ces états est un état singulet dans les molécules normales (mais pas dans des
radicaux libres ou des molécules anormales telles que l'oxyde nitrique). Cepen-
quand un électron a son énergie cinétique tellement réduite par des
impacts successifs qu'il n'est plus capable d'exciter un état singulet, il peut
dant,
encore exciter des états d'énergie inférieure (par exemple des états triplets)
qui ne possèdent pas assez d'énergie pour une rupture de liaison mais qui
peuvent conduire à une décomposition par réorganisation intramoléculaire
(12-14).
Considérons un liquide irradié dont l'état singulet le plus bas est E' et l'état
triplet le plus
Soit
bas est
Ew
.
:
n le nombre d'actes d'ionisation, c'est-à-dire le nombre d'électrons produits.
n', n'" le
nombre d'actes d'excitation portant respectivement sur les états
singulet et triplet
du solvant.
Wiener (H.) et Burton (M.), J. Am. Chem. Soc, 75, 5815, 1953.
Devins (J. C.) et Burton (M.), J. Am. Chem. Soc, 76, 2618, 1954.
(14) Burton (M.), J. Chim. Phijs., 52, 543 (1955).
(12)
(13)
THÉORIE
Pour de nombreuses raisons, on
a
estimé que, dans un liquide, n
in.
Quand un électron n'a plus l'énergie suffisante pour excitei un état singulet,
encore exciter un étal triplet. Le nombre des électrons qui peuvenl
il peut
induire des excitations de triplets à un stade quelconque de leur activité esl
Légèrement inférieur à n. Nous désignerons par l la fraction
«les
produisent effectivement des excitations de triplets. Ainsi, n
La valeur de
;
nécessiterait
pas de
ici
(15).
faire
électrons qui
Inst 2 n
une estimation soigneuse que nous n'essayerons
-
1
Cependant pour de nombreuses raisons, L'auteur
est
d'avis (pie Ç st 1/6.
L'importante conclusion à tirer est (pie, en général, un nombre faible mais
non négligeable d'états excités de basse énergie sont produits par excitation
directe.
A ces derniers il faut ajouter ceux qui résultent soit d'une conversion
interne à partir d'états singulels excités* soit d'antres processus de dégradation de l'énergie**.
Ces processus de dégradation de l'énergie sont particulièrement importants
en radiochimie des systèmes liquides. Ainsi, bien que
—
n', le
n'"
soit de l'ordre de
nombre des états excités de basse énergie impliqués dans les réactions
chimiques consécutives peut être assez grand et atteindre une valeur voisine de n'. Dans la plupart des cas, ces états n'ont pas assez d'énergie pour
donner lieu à une décomposition par rupture de liaison. Des explications
mécanistes des résultats observés doivent donc faire appel à des réorganisations ou à d'autres processus moins courants, par exemple des réactions
mé-
tathétiques de molécules excitées.
\b.
— EFFETS SUR UN SOLUTÉ
Un autre aspect des excitations d'états de basse énergie est le rôle spécial
que des traces de certains solutés peuvent ainsi être amenées à jouer (12, 19,
20, 4). La figure 2 est basée sur des considérations développées longuement
(15) Magee (J. L.), Kamen (M. D.) et Platzman (R. L.), Basic Mechamisms in Radio
biology. II. Physical and Chemical Aspects. Nat. Acad. Sci., N. R. C. publ. 305, Washington, D. C, 1953.
Gilmore, Gibson et Mc dure ( 16 ) ont noté que les rendements quantiques de fluorescence et de phosphorescence de certaines substances organiques en solution solide dans
des verres à basse température s'interprètent bien par une forte probabilité de conversion
interne d'un singulet excité vers l'état triplet le plus bas.
(16) Gilmore (E. H.), Gibson (G. E.) et Mc Clure (D. S.), J. Chem. Phys., 20, 829, 1952.
(**) En considérant l'effet cage de Franck-Rabinowitch ( 17 ) en relation avec la radiolyse de grosses molécules organiques, on est conduit à la conclusion qu'une caractère
tique importante de tels systèmes liquides réside en une contribution accrue des états
excités inférieurs relativement aux états d'énergie plus élevés. Ceci est vrai non seulement
parce que ces derniers sont rendus inefficaces mais parce que, pour un nombre appréciable
d'entre eux, des processus de dégradation de l'énergie conduisent à un état excité infé(*)
rieur ( 18 ).
(17)
(18)
(19)
(20)
Franck (J.) et Rabinowitch (E.), Trans. Far. Soc, 30, 120, 1934.
Burton (M.), J. Phys. Colloid Chem., 52, 810, 1948.
Weiss (J.), Nature, 174, 78, 1954.
Platzman (R. L.), Rad. Res., 2, 1, 1955.
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
Il)
Burhop (21).
par Massey et
sente
des
variation
la
repré-
efficaces
impact électronique, de
d'excitation, par
d'un
transitions
Elle
sections
singulet
état
inférieur
un état plus élevé qui peut être tri-
vers
plet (énergie E'")ou singulet (énergie E'). La
transition singulet-triplet est interdite dans
un processus optique mais est permise pour
une excitation par des électrons def aible éner-
Energie
gie (voir la forme de la courbe en trait plein
—
Diagramme schématique
Fig. 2.
des relations entre sections efficaces
Q et énergie pour l'excitation d'états
triplet et singulet par chocs électroniques.
aux basses énergies), où la relation entre les
spins des
électrons
incidents
et
expulsés
qui entrent en interaction avec une paire
d'électrons dans la molécule peut s'écrire
*
'
t I
1
1*
singulet
+
t
triplet
+
i
:
:
Singulet
Quand l'état triplet possède une forte composante singulet (comme pour
Hg 63 P!), la section efficace pour une excitation « triplet » par un impact électronique est plutôt représentée par la courbe en pointillé; c'est-à-dire que,
même pour une substance pure, des électrons
d'énergie
à E' peuvent
supérieure
contribuer pour une faible part à l'excitation du niveau triplet
(cf.
paragraphe 1 b).
Dans le domaine d'énergie compris entre
E'" et E', seule l'excitation
avoir lieu.
Il
la différence
du triplet peut
que
est intéressant de noter
d'énergie e min
—
E'" est d'en-
„,,,,,
viron 1 eV.
Le cas d'un liquide à 2 composants où
les potentiels d'excitation du soluté sont
situés plus bas que ceux du solvant présente
un intérêt particulier
(v.
figure
F
,
;nergie
Fig. 3.
— Relations entre sections
-
effi-
caces Q d' excitation par chocs électroniques pour un solvant 1 et un
3).
soluté 2.
En dessous de l'énergie E|, les états singulets
du solvant ne peuvent pas être excités. Platzman et Weiss ont porté une
attention particulière à la situation qui se présente à un électron dont l'énergie e
est
comprise dans
le
domaine*
EJ(E'< e < E'). La probabilité d'exci-
E^,
tation de l'état E^ par un tel électron est donnée par
Pi
L N
:
N Q'(z)n(e)de
N Q';'(£)n(£) + N Q:( £ )n(e) +<D(N ,N
2
2
Q:'(e)n( £ ) -f
1
2
1
{1,1)
2,
e)
Massey (H. S. W.) et Burhop (E. H. S.), Electronic and Ionic Impact Phenomena,
Oxford Press, 1952, en particulier chapitres III et IV.
(*) Platzman, s'attachant à l'énergie requise pour exciter le composant principal delà
(21)
THÉORIE
Q'>( e )>
Qî( £ )>
Qi"(e)
represent on
I
respectivement
i
sections effieaces d'excitation de L'étal
pour
composant
2
triplet,
|m>ui
Le
slngulet, de L'étal
l
etc.
les
une énergie c de l'électron incident;n(c) es1 Le nombre d'électrons dont l'éner
comprise entre e et e -f dz, pour une distribution d'énergie station
gie est
naire des électrons; ^(Nj, N.2
est
s)
,
probabilité de diffusion élastique et
N
dans un mélange contenant
«
une fonction compliquée qui décril La
d'un électron d'énergie e
semi-élastique
•
molécules de solvant
x
molécules
N,
et
de
La diffusion « semi-élastique » comprend des processus d'excitation
purement vlbrationnelle, d'excitation de rotation, de même que La polarisoluté.
sation.
Dans des circonstances normales les deux premiers termes du dénominateur sont tellement inférieurs au
troisième,
qu'on
peut
porter l'attention
presque exclusivement sur l'excitation du niveau singulet, ainsi que
l'a fait
Platzman (20).
Pour un calcul rigoureux, il faut naturellement avoir des renseignements
sur la probabilité avec laquelle un électron pénètre dans la région E^
< e < E'
Platzman (20) a donné
une fonction qui s'applique à He, Ne et peut-être à Ar gazeux. Mais on ne conen fonction de
e
(c'est-à-dire sur la fonction n(e)).
naît pas cette fonction pour des liquides moléculaires. Cependant,
que
si
il
est clair
un électron d'énergie initiale E[ -f- e perd l'énergie E[ par excitation
d'une molécule de solvant et pénètre dans le domaine E', <
< E',
e
il
aura
une forte probabilité d'exciter l'état singulet d'une molécule de soluté. Ainsi,
comme Platzman (20) et Weiss (19) l'ont tous les deux souligné, la probabilité d'une excitation singulet-singulet pour une catégorie particulière de soluté
(c'est-à-dire qui possède des niveaux d'excitation bas) n'est aucunement proportionnelle à sa concentration*. Cette conception est naturellement basée
sur la supposition préalable que
le
soluté ajouté peut
faible énergie. Selon la conception de
«
voir
»
l'électron de
Samuel et Magee (22), l'électron con-
sidéré subit environ 1 000 collisions dans le voisinage immédiat de l'ion-parent
avant d'être ralenti jusqu'à la température ambiante et de nouveau capté.
Ainsi, d'après ce point de vue, si la fraction molaire d'un composant est infé-
rieure à 10
3
,
il
semble improbable qu'il puisse être affecté par les électrons
de « sous-excitation » à moins que la section efficace du processus d'excitation
Cependant, sous cette réserve, il apparaît en fait qu'un soluté
soit très élevée.
présent en concentration relativement faible peut accuser une participation
à la radiochimie d'un système à 2 composants presque équivalente à celle du
composant principal. Quand le composant principal est lui-même intrinsèquement stable, l'effet peut être augmenté par un processus de transfert d'excitation tel que
:
Y +2
—
<
1
+ 2' + énergie cinétique
solution, appelle électrons de sous-excitation les électrons
dont l'énergie
(1)
est inférieure à
E', et il les représente par le symbole sse. Weiss préfère la terminologie plus générale d'élec-
trons de « faible énergie ». Dans ce chapitre, les électrons sont désignés de façon spécifique
E^ < s < K[.
en fonction de leur énergie; par exemple dans le cas précédent
:
(*)
On considère comme négligeable le 4 e terme du dénominateur chaque fois qu'une
excitation de résonance peut avoir lieu.
Samuel (A. H.) et Magee (J. L.), ./. Chem. Phys., 21, 1080, 1953.
(22)
liADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
12
(cf.
paragraphe 3#), si bien que le soluté peut être l'espèce principale ou même
la seule espèce qui soit excitée à un niveau chimiquement efficace. Inversement,
soluté peut être stable et le solvant réactif. Dans ce cas, une réaction telle
que 1 aboutit à une protection. Ce processus peut être important même quand
le
soluté est présent en concentration relativement faible.
le
Quand un électron quitte le domaine des énergies supérieures à E' avec une
2
que E^ >
> El, les états singulets ne peuvent plus être
énergie
s
excités.
Les probabilités d'excitation des niveaux triplets E™ et
telle
e
sont
EJ'
données par des expressions similaires à (1, 1). Si les états excités du solvant
ne conduisent pas à
une décomposition, un processus de transfert d'énergie
peut ainsi se produire avec une certaine probabilité
1"'
+2
->
1
:
+ 2'" + énergie cinétique
avec une décomposition ultérieure du soluté.
(2)
Un tel processus de désensibi-
semble effectivement avoir été observé dans le mélange à 2 composants propionaldehyde-benzène (cf. paragraphe 8 a). Le phénomène de lumilisation
nescence induite semble également mettre en jeu des processus de transfert
d'excitation (cf. paragraphe 3h).
le.
_ FIXATION D'ÉLECTRONS ET PROCESSUS DE NEUTRALISATION*
Dans un liquide, quand un électron a été ralenti jusqu'à posséder une vitesse
am-
d'environ 4/cT (c'est-à-dire 4 fois l'énergie thermique à la température
biante), il peut participer à un processus de capture dissociative ou bien être
capté par n'importe quelle molécule pourvu que le seuil de capture soit assez
bas; il peut par exemple être fixé sur une molécule pour donner un ion négatif
ou sur un ion positif pour donner une molécule neutre. Ces processus entrent
en compétition; si l'électron se trouve dans le voisinage immédiat d'un ion
positif, le processus de neutralisation est plus probable que le processus de
formation d'un ion négatif. Or, la distance qui sépare un électron de l'ion positif le plus proche peut être faible, s'il est impossible à l'électron de s'éloigner
beaucoup de la molécule parente après le processus d'ionisation. On peut
concevoir aussi qu'un électron thermique puisse être capté en polarisant le
liquide autour de lui, sans s'associer de façon spécifique à une molécule parti-
culière**.
La durée du processus de ralentissement, la trajectoire, la distance parcourue et le sort de l'électron sont autant de points qui ont suscité l'intérêt
des radiochimistes préoccupés par les mécanismes détaillés des réactions (25,
22).
Pour élucider le comportement et le sort des électrons dans des liquides
organiques, on a eu recours à l'addition d'une substance susceptible de fournir des ions négatifs
(*)
par capture dissociative ou par capture simple.
Pour une discussion plus détaillée de ces processus voir Magee et Burton ( 23
Magee (J. L.) et Burton (M.), J. Am. Chem. Soc, 72, 1965, 1950.
(24) Magee (J. L.) et Burton (M.), J. Am. Chem. Soc, 73, 523, 1951.
(23)
(**) Cf. la « couleur bleue
(25)
»
de l'électron dans l'ammoniac liquide.
Burton (M.), Magee (J. L.) et Samuel (A. H.), J. Chem. Phys., 20, 760, 1952.
-
24
).
THÉORIE
id
La façon dont Burton, Magee et Samuel (25) em Isagenl le comportement
de l'électron dans un processus d'ionisation est basée sur L'estimation (22)
que L'électron est ralenti jusqu'à une vitesse thermique en un temps court
par rapport à 10 w see. D'après ce point de vue, L'attraction entre L'ion paient
et l'électron est
prépondérante. Aussi, sauf en présence de puissants Inter
Le processus de neutralisation de l'ion parent par
cepteurs d'électrons, c'est
l'électron émis qui est considéré
comme le processus quasi immanquable.
en résulte un état fortement excité et
les
11
réactions ultérieures sont celles de
eel état excité.
Les processus qui se déroulent
suite des réactions
à
partir de l'ionisation soul
résumés par La
:
A
A+ + e
mm_>
A*
A+ + e
(1)
A*
(2)
produits
<:>)
Le point de vue de Magee et Samuel (22) selon lequel l'étape (2) suit l'étape (1)
après environ 10 3 collisions de l'électron est étayé par des expériences de Wil-
liams et Hamill (26), où des intercepteurs d'électrons tels que halogènes, halogénures d'alcoyles et anhydride sulfureux ont été introduits dans des solvants
organiques tels que cyclohexane et benzène. Leurs résultats s'accordent avec
le point de vue que l'électron n'est capté avec une forte probabilité qu'après
10 3 collisions environ. Ces auteurs citent les résultats de
Minder et Hey-
drich (27) et de Schuler qui peuvent être interprétés d'une manière analogue.
Quand on remarque que le seul processus physique primaire autre que la
réaction 1 consiste en une excitation (cf. paragraphe 1 b) vers un état de
faible énergie
:
A -mk^ A*
il
s'en suit, comme l'ont souligné Burton,
(4)
Samuel et Magee, que, dans des
liquides organiques purs, les processus chimiques primaires essentiels font
intervenir presque exclusivement des molécules excitées (c'est-à-dire non ionisées).
Massey a résumé les différents processus qui peuvent conduire à la formation d'ions négatifs (28). Celui qui est le plus susceptible d'avoir des consé-
quences chimiques immédiates est le processus de capture dissociative
RX + e
—> R + X-
où l'énergie de dissociation D R_X de la liaison
affinité électronique
:
(5)
R — X est inférieure à E
x
,
de l'ion négatif.
(26)
Williams (R. R.) et Hamill (W. H.), Rad. Res., 1, 158, 1954.
(27)
Minder (W.) et Heydrich (H.), Disc. Far. Soc, 12, 305, 1952.
probable dans les gaz, ainsi qu'on peut en juger
par la complexité des spectres de masse. Dans le cas des liquides, les indications dont
on dispose sont peu nombreuses. Cependant, il semble certain, d'après les faibles valeurs
de G trouvées pour la décomposition du benzène, que les ions initialement formés dans
les liquides ne se décomposent pas nécessairement avec une probabilité appréciable.
(28) Massey (H. S. W.), Disc. Far. Soc, 12, 24, 1952.
(*) L'instabilité des ions positifs est
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
14
Il
lieu
est peu probable que la formation d'un ion négatif sans dissociation donne
à des réactions chimiques. Tout processus
B +e
H
(6)
qui produit un ion négatif sans décomposition doit finalement conduire à une
neutralisation.
A moins que l'ion positif soit lui-même instable*, le processus
met en jeu A+ et B~. Des calculs effectués par Magee (29) indiquent qu'on
ne doit pas s'attendre à des processus métathétiques du type
:
A+ + B
G + D.
(7)
Ce qui se produit c'est la neutralisation, alors que les ions sont encore à une
assez grande distance l'un de l'autre et
le
véritable processus de neutrali-
sation est la conversion interne
A+ +-B
—> A, +B
(8)
fc
où les indices y et k représentent les états excités formés. Si pour les réactions
A,
(9)
(10)
nous écrivons
— AE = E,(A)
9
et
AE 10 = E^B),
il
s'en suit que pour les pro-
cessus de neutralisation qui peuvent avoir lieu, l'état
f(A*B")
A%B"
A,- est
moins
égale à
E (B). Les courbes
fc
A+, B- et A
1 ./
àA +
au
quantité
d'énergie potentielle des états
eVr, k
£"(A if B k ) _
inférieur
d'une
intersection
3
et
B
(pour
À.
et leur
laquelle
une conversion interne telle
que (8) peut se produire)
Aj*B k
sont
représentées,
d'après
Magee, sur la figure 4. Dans
')k
"1
le
'AB
Fig. 4.
cas de molécules polyato-
miques (soit A, soit B, soit
les deux) il existe un certain
!
— Courbes d'énergie potentielle dans
nombre de points
les processus
section
de neutralisation ionique.
qui
d'inter-
correspondent
aux différents états de vibration-rotation des produits.
La neutralisation peut se produire quand, d'un
point de vue chimique, les molécules sont encore loin l'une de l'autre, par
exemple 15 Â (29). La réaction est alors représentée par l'équation (8). L'état
d'énergie le plus élevé auquel on est conduit pour A, est celui pour lequel B k
Gomme A est inférieur à A + (cf. réaction 3) d'une quantité au moins égale à E (B), la probabilité de sa décompo-
représente la molécule non excitée.
t
fc
sition ultérieure
(29)
peut se trouver diminuée. Ainsi,
Magee fj. L.), Disc. Far. Soc., 12, 33, 1952.
la
neutralisation des ions
THÉORIE
15
non seulement s'effectue sans naît ion métathétlque, mais
peut en fait résulter en une protection de L'espèce chimique qui avait donné
l'un par l'autre,
naissance à l'ion positif.
Id.
— DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE DISSIPÉE DANS DES MÉLANGES
Quelle que soit la nature
du rayonnement primaire
particule chargée, la première entité sur laquelle
Le
:
photon, neutron ou
radiochimiste doit porter
son attention est une particule chargée; par exemple, un électron d'énergie
élevée (électron de recul ou photoélectron) clans Le cas de rayonnement X
ou y; l'électron primaire lui-même dans le cas de rayons [i\ une particule
un deuton, etc. De telles particules chargées
interagissent
avec
oc,
atm<
Les
sphères électroniques des systèmes moléculaires qu'elles traversent et en pre-
mière approximation, la probabilité de « voir » un atome particulier, une molécule, une substance, est proportionnelle au nombre d'électrons qu'il ou qu'elle
renferme. Ainsi dans un mélange de n composants, la fraction de l'énergie
dissipée dans un
composant particulier 1, est déterminée par sa fraction élec-
tronique définie par
:
Nn
1
1
(1,2)
n
2
i
N«n,
=1
où N x N sont les nombres de molécules des composants 1 et i, respectivement,
n l9 n, sont les nombres d'électrons par molécule des composants 1 et i. Cette
approximation semble convenir pour des mélanges d'hydrocarbures (cf. paragraphe 3 g). Cependant, pour des composés contenant des atomes lourds où
,
les
t
électrons intérieurs sont
liés
plus fortement,
il
semble difficile de con-
server l'hypothèse simple que la probabilité de dissipation d'énergie dans un
composant dépend de sa fraction électronique totale.
2.
— PROCESSUS CHIMIQUES
Deux conclusions d'un grand intérêt se dégagent du paragraphe 1.
L'énergie dissipée par l'interaction d'une particule chargée avec la matière
est en général notablement supérieure à celle qui est nécessaire pour produire
un effet chimique.
La probabilité pour que l'énergie se dissipe en un endroit particulier de la
molécule est proportionnelle en première approximation à sa fraction électronique. Il s'en suit que, dans la mesure où l'on peut négliger certaines caractéristiques chimiques spécifiques, le principe statistique suivant s'applique
(ou principe de distribution au hasard)
:
la
quantité et la nature des produits
résultant de la radiolyse d'un composé sont simplement liés à la quantité
et
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
16
En fait, ce prin-
à la nature des groupements parents dans la molécule (30).
cipe s'applique de façon très grossière aux hydrocarbures linéaires et aux acides
gras inférieurs. Pour les acides gras supérieurs, il est impossible à appliquer.
Et si la radiochimie des liquides organiques offre tellement de problèmes intéressants au théoricien, c'est précisément parce que le principe énoncé ne peut
s'appliquer que dans un domaine aussi restreint et surtout parce que les produits de la radiolyse ont tendance à être
beaucoup plus spécifiques que ce
à quoi on pourrait s'attendre, étant donné que l'énergie dissipée présente ini-
tialement une distribution spatiale au hasard.
Dans une large mesure, mais pas totalement loin de là, les produits de la
radiolyse des liquides ressemblent à ceux de la photolyse.
On peut suggérer
diverses explications, mais comme elles sont toutes essentiellement spéculatives,
nous les présenterons sans les développer.
1° Seule une fraction relativement faible des ions fortement excités formés
initialement se décomposent sans neutralisation préalable en entités plus
petites (31). Ce résultat pourrait être dû pour une large part aux très rapides
processus de neutralisation des ions discutés au paragraphe
le.
un rôle particulièrement important chaque
fois que l'énergie disponible pour une décomposition est à peine supérieure
au niveau de dissociation de l'état considéré. Des arguments ont été avancés,
(23) basés sur une étude théorique du sort de H 3 excité formé par la neutralilisation de H/, comme quoi la conséquence la plus probable de la neutralisation par un électron d'une grosse molécule-ion est sa rupture en deux radicaux dont l'un est excité. Si on peut montrer que ce sont les états les plus
2° Les effets cage (17) jouent
excités qui se forment avec la plus grande probabilité, il s'en suivrait qu'une
rupture produite à partir de ces états fortement excités aurait tendance à
fournir des produits de dissociation ayant une énergie cinétique minimum.
Dans de
telles
circonstances, l'effet-cage
de
Franck-Rabinowitch
serait
particulièrement efficace pour conduire à une recombinaison de radicaux
sans effet chimique observable.
3°
La probabilité accrue d'un effet-cage pour des états fortement excités
a pour résultat qu'un mécanisme est ainsi fourni qui permet de passer effec-
tivement, par désactivation par collision, d'un état d'énergie élevée à un
état inférieur par le seul intermédiaire de processus de conversion interne qui,
en phase gazeuse, pourraient conduire à une décomposition. La combinaison
de tels effets et d'autres processus de conversion interne serait de ramener un
grand nombre de molécules fortement excitées à un niveau énergétique inférieur, caractéristique
d'une excitation optique. Ainsi ces réactions chimiques
ultérieures ont tendance à ressembler aux réactions photochimiques.
Si on suit une telle idée, on peut s'attendre à ce que tout processus ou tout
mécanisme dont l'existence a été bien établie en photochimie, ait son analogue en chimie des radiations. Avec une telle façon de voir, la radiochimie
des liquides est une extension de la photochimie où l'on dispose de davantage
d'énergie, où les impuretés peuvent jouer un rôle particulier, parfois prépon-
(30) Burton (M.), J. Phys. Colloid Chem., 51, 7b6, 1947.
(31) Burton (M.), Research Council Israel, L. Farkas Memorial Volume, 205, 1952.
THÉORIE
17
déran t et où (dans certains cas) on doit considérer Les propriétés spéciales
où n'importe quelle molécule peul être excitée des
d'états fortement excités,
hydrocarbures par exemple, ne peuvent être photolyses directement que dans
l'ultraviolet de Schumann), OÙ les effets des états triplets peuvent être importants et où, d'un point de vue plus pratique, un grand
même disposées en couches épaisses peuvent
Par opposition à
la
commodité de
ce
être
nombre de molécules
affectées
dernier facteur,
La
simultanément.
photochimie des
substances fortement absorbantes (donc fortement affectées) se réduit à la
couche superficielle de la substance irradiée. En chimie des radiations, on
observe ces inconvénients seulement quand des liquides sont irradiés par
des particules a, des rayons
de très faible énergie, ou des rayons X mous.
Ci
HAISSINSKY.
CHAPITRE II
OBSERVATIONS ET INTERPRETATIONS
3.
HYDROCARBURES
Bien que les hydrocarbures constituent la classe la plus simple des compocomprise ni complètement étu-
sés organiques, leur radiochimie n'est ni bien
diée.
Ils
présentent un intérêt particulier cependant car, contrairement aux
autres substances organiques, leur radio-
chimie
lysée
été plus
a
abondamment ana-
que leur photochimie.
Schoepfle et Fellows (32) ont effec-
CK
tué une étude systématique des effets
produits par des électrons de 170 kéV.
Leurs
résultats
sont
résumés
sur
la
figure 5 et le tableau II. La figure 5 montre
—
C-H
C-CH 3
Fig.
5.
— Rendement de produits en
fonction de la longueur de chaîne des
hydrocarbures selon les données de
Schoepfle
et
que le rapport des produits H 2 /CH 4 est
une fonction presque linéaire du rapport
H aux liaisons G CH3
des liaisons C
dans la molécule-mère, du moins quand
Fellows (30).
Les points A et B se rapportent aux isomères en G 8
.
il s'agit
—
d'hydrocarbures linéaires. L'exis-
tence d'un effet chimique spécifique se
manifeste par l'obtention d'une courbe
au lieu d'une droite, par le fait que
rapport
H /GH
rapport G
2
4
est
très
— H/C — GH
3
et
différent
par
le
le
du
fait
que les points correspondant aux octanes non linéaires se placent nettement
en dehors de la courbe.
Schoepfle et Fellows ont aussi trouvé que la radiosensibilité d'hydrocarbures aromatiques irradiés par des électrons de 170 kéV, évaluée par la
production gazeuse totale, est considérablement inférieure à celle des hydrocarbures aliphatiques, tandis que les hydrocarbures non saturés présentent
une fragilité intermédiaire. De plus, leurs résultats ont montré qu'un mélange
de cyclohexane et de benzène se comportait plus comme le benzène quant à
sa radiorésistance que comme la moyenne arithmétique des deux composants.
(32)
Schoepfle (C. S.) et Fellows (C. H.), Ind. Eng. Chem. 23, 1396, 1931.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
09
19
O O ' 2 2 «"
X
M
/.
S
?\
-
jg
M
en
™ M
ri
>~
iilll!
l«-^
M M
.--
— ~
(M M
M
n n M M
ro
_
io
pp
•**
n*
—
— ^
_
ï*
w "3 g 2 "g g
—
ri
o <A t; io *- —
X
£
-â
ro
—
o"
j-j.
CM
n
ri
Z
zr
o
q
o
Jsjïa
t oj-o ce— S
o
©^
o" o"
©
aO gs 5 .S 5
g
oj
M
—
J
o
C5
eu
x
.
ce
ô « ft® *
.g
fl
•-;
o .2
in
T-t
S o
£
w
« 2 2h^"S ce
o -^ 5 K eu £
— *. —h
r_ s ce
M
£ P, o -
-
'
'
-,
</>
«
.
c^
cd
cd
CO
O
fj
vi
h
o ft X
-eu '<" ^
g "O "S Ol «j eu S
g « 3 « § 2 •c2 u
S eu
,,
.2
»
s
3
CN
*—
-H
co
«*
C. CN
C'
o Ci
o O
©^ O © O
o O
cl
—3» S3
o
u
_
S?|ï!ii
g
g
G
ce
cm
cm
t>
l>
o
O
S CO l> l>
c o o ©
rH
— M o O ce X c
o O o" o o o o
cs
«eu
-C -O
l-H
ri
S. 2
Z^V
C5
CN
CD
o o o o o"
—
^
g
J2
««
,2 ts
^ «
es
S
—2
J^ceâ^& |l
S
o ^ *Z o
^
««
.
fH
4h
eu
eu
aS * gu s «
tic
'éT
ce
&;>
eS
X
l>
CN
CO
o
V
05
Tf
CN
tC
^f
Tf*
rc
ro
CO
CN
Cl
1-1
OS
iO
cô
n
'
CM
tH
rH
w
ro
X
F-
•r-t
fH
T-l
tH
<*
CN
o O O © © O
o"
©^ •o
ri
v>
eu
+j
% G
woo „A&
m S
i
2S S
1
-S-Ss
t* g s w
w SX^i
tH
ce
^ m
eu
«^«cu
o
^S35s
1
N
â
A
n
CO
ro
"«*
CC
T_l
CO
Tf<
iO
"*
CM
O
©~
o
CT>
CM
rH
CO
CN
O o" o"
eu
."S
eu
a
«*->
ce
^ > fl° «> T3 euC Co
H
g
^
<u
£5
^^
eS
-3 »4i
«o
eu £ g p, +j
« â
M fe "S -2 «
-2
c ^ 2 -S .2
g
o eu E -g -m o o
T3
>-<
eu
^
ce
ce
o
"
t £ « 2 S "3
| ft S ^ £2 '2ft s
o M O H ft
-S3
•eu
'ce'
«^
eu
«h
|
,
(3
« « «
ms
5-
fi£s1§
ce
CU
•o
^ C
y.
<
ce
y.
eu
eu
eu
ft
ce
'A
>>
0)
«a;
—cS
X
E
eu
eu
CU
S
Q
-
c
c
c
«*
O
X
o
O
o
Tu
Tl
M
CO
CN
c
o
Ë
-o
CU
CO
ri
V
X
CD
c
.eu
N
C
'S
o
co
A
.eu
a
N
»03
U O S m
eu
N
c
o
PQ
N
eu
eu
co
C
S3
.eu
•J«Ss°.£
N
O
c
-C!
.eu
"S
PQ
*t«
eu
O
H w
Oh
eu
eu
o ^
r?
ce
s
i
>>
ft
O
1
^
ce
a 3
•S
|
w
|
<£
>>w
cl-2
1
_
,
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
20
3
— RENDEMENTS EN PRODUITS BRUTS
.
Les résultats quantitatifs concernant les rendements en produits gazeux
formes par la radiolyse de divers hydrocarbures sont résumés dans le tableau II
Ils confirment en gros les résultats antérieurs de Schoepfle et Fellows.
Les hydrocarbures aliphatiques sont en général sensibles aux rayonnements*
— y compris ceux qui possèdent des
— sont généralement résistants.
tandis que les composés aromatiques
groupements aliphatiques latéraux
La conception classique de la radiochimie des hydrocarbures repose sur
que la décomposition primaire consiste en une rupture en radicaux
que les expériences utilisant des intercepteurs (cf. paragraphe 3 é) étayent le point de vue que les radicaux libres jouent un grand rôle.
Cependant, les conclusions portées sur le mécanisme des réactions peuvent
être basées aussi sur les rendements observés. Dewhurst (44) par exemple,
suggère que la simplicité relative des produits liquides dans la radiolyse du
cyclohexane (voir tableau II) indique une rupture préférentielle des liaisons
GH, tandis que le cycle subsisterait relativement intact. D'autres travaux,
sur des mélanges par exemple (cf. paragraphe 3 g) attestent une décomposition appréciable où, dans l'acte primaire, les molécules obtenues seraient
l'idée
libres. Il est certain
formées par réorganisation.
La faible production gazeuse totale à partir du cyclohexène (cf. tableau II)
est sans
aucun doute caractéristique de réactions entre les produits intermé-
Tableau III.
— Production de polymères, dans des hydrocarbures
de grande énergie (a)
irradiés par des électrons
:
Nombre de molécules converties pour 100 eV d'énergie absorbée soit
GP
COMPOSÉ
Cyclohexane
Cyclohexène
1,66
12,4
Méthylcyclohexaiie
1,2
n-Heptane
Benzène
Toluène
1,7
(a) électrons
0,75
1,28,0,92
:
Gp
RÉFÉRENCE
35
35
34
34
45
40, 35
de 1,5 à 2 MeV.
(*) Les données peu nombreuses qu'on possède sur l'heptane normal et le méthylcyclohexane comportent probablement une erreur par défaut.
(33) Krenz (F. H.), Nature, 176, 1113, 1955.
(34) Burton (M.), ./. Phys. Colloid Chem., 51, 611, 1947.
Manion (J. P.) et Burton (M.), J. Phys. Chem. 56, 560, 1952.
Burton (M.) et Patrick (W. N.), J. Phys. Chem. 58, 421, 1954.
(37) Gordon (S.) et Burton (M.), Disc. Far. Soc, 12, 88, 1952.
(38) Schuler (R. H.), J. Phys. Chem., 60, 381, 1956.
(39) Patrick (W. N.) et Burton (M.), J. Phys. Chem., 58, 424, 1954.
(40) Hentz (R. R.) et Burton (M.), J. Am. Chem. Soc., 73, 532, 1951.
(41) Sworski (T. J.), Hentz (R. R.) et Burton (M.), J. Ain. Chem. Soc, 73, 1998, 1951.
(42) Chang (J. Y.), résultats non publiés.
(43) Schuler (R. H.) et Allen (A. O.), ./. Am. Chem. Soc, 77., 507, 1955.
(44) Dewhurst (H. A.), J. Chem. Phys., 24, 1254, 1950.
(35)
(36)
OBSERV iTIONS ET INTERPRÉTATIONS
Tmu.i.m
i<»,
I
il)
21
l\.
Comparaison entre les effets produits duns diners hydrocarbures liquides
pur des électrons de grande énergie (a) et pur irradiation dans le domaine optique
des effets sont chiffrés en pourcentages, sauf indication contraire).
IKK \1>I \
1
ln\
1
m; III
•
COMPOS]
CH,
H,
Cyclohexane
Cyclohexène
Benzène
Benzène, d u
Toluène
Ethylbenzène
l-Propylbenzène
t-Butylbenzène
95
88,3
62
50(e)
Mesitylène
92
91,5
si
67
58
M.
1
(b)
i
I
RON
R]
l
l
1,1
3.")
10,3
3.-,
5,4
38
35
50 (1) 37, 39
3,2
40, 35
2,0
3,7
4,7
0,8
29
37
6,9
CH,
H,
RENCE
1,0
1,4
14,2
[RRADIATION
93
H)
94
41
41
96
96
89
40
\
C,l [y
10«y
ki'.i
.1».
(c)
RBN Cl
(i
8
1,1
40
40
4,1
2,6 (d)
3,4
3,1
2,6
2,4
6,8
2 ;»:i7 \
l,0(d)
1,6 (d)
4,0
3,4
2,4
1,2
3,8
i
41
41
40
—
1,.">
à 1,8 MéV.
()>) probablement des liydrocarbures en C 2
voir aussi le tableau II.
120° C.
(d) Dans ces cas pary représente le rendement quantique d'un gaz volatil à
culiers C^H,, est de l'éthane.
(e) D 2
(f) C 2 D 2
(a)
(c)
—
.
—
—
;
—
.
diaires radicalaires et les doubles liaisons.
vue est présentée dans le tableau
La confirmation d'un tel point de
montre que dans le cyclohexène
un nombre exceptionnellement élevé de molécules sont converties en polyIII qui
mère, sûrement par la suite de réactions
:
—
(1)
R(C 6 H 10 )7t^ï
(2)
R(C 6 H 10 ) n R'
(3)
R(G 6 H 10 )
R + C H 10
6
Propagation
R(C 6 H 10 )— + C 6 H 10
-
Terminaison de la chaîne
R(G 6 H 10 )7
+ R'
-
D'autres aspects de la production de polymères indiquée dans le tableau VIII
seront discutés au paragraphe 3 c. Le tableau IV résume certains autres résultats relatifs à la reticulation de divers hydrocarbures non saturés. Tout comme
pour le cyclohexène, les rendements sont assez élevés.
Un rapprochement intéressant a été effectué dans les tableaux IV et V
entre les effets radiochimiques et photochimiques. Ni le cyclohexane, ni le
cyclohexène n'absorbent dans la région 2 537 Â; le benzène absorbe mais n'est
pas affecté chimiquement. En ce qui concerne les produits formés, le toluène
Tableau V.
— Composition des produits formés par
ta photolyse de
quelques substances
aromatiques à l'état gazeux (40, 41).
(en pour cent).
H
2
Toluène
Ethylbenzène
i-Propylbenzène
t-Butvlbenzène
86
14
17
12
Mesitylène
84
(a)
CH
4
10,8
50
27
32
8,7
C XH4
10 4 y (a)
3,0
0,6
1,4
36
56
56
7,0
1,7
Les valeurs données sont des valeurs relatives, approximatives, probablement inférieures
aux valeurs réelles.
RADIOL Y SE DE LIQUIDES ORGANIQUES
22
et le mésitylène liquides sont affectés de la
même manière par des électrons
de grande énergie et la lumière de 2 537 À. L'éthylbenzène, l'isopropylbenzène et le butylbenzène tertiaire liquide produisent proportionnellement moins
d'hydrogène par irradiation avec des électrons d'énergie élevée qu'avec la
A cet égard, ils se comportent plutôt comme les composés gazeux.
raie 2 537 À.
On peut interpréter ces résultats en supposant que l'énergie absorbée dans le
noyau benzénique a une plus grande probabilité de conduire à la rupture d'une
par rapport au noyau, plutôt que de liaisons a. Dans l'éthylbenzène,
liaison
(3
l'isopropylbenzène et le butylbenzène tertiaire, c'est la dissociation primaire
GH3 et un autre radical, qui a lieu de préférence (cf. la
en deux radicaux
photolyse des substances gazeuses transcrite dans le tableau Y). Cependant,
:
dans les liquides, l'effet cage de Franck et Rabinowitch (17) tend à diminuer
chances d'évasion des radicaux libres volumineux issus de la photolyse.
La production d'hydrogène est relativement favorisée par suite de la relati-
les
vement forte probabilité de diffusion des atomes d'hydrogène et des réactions
ultérieures qui conduisent à la formation d'hydrogène moléculaire
(cf.
réfé-
rence 7, p. 357). Si les énergies d'excitation plus élevées atteintes en chimie
des radiations augmentent la probabilité pour que les couples de radicaux
libres
formés dans le processus initial de rupture possèdent un grand excès
d'énergie, la probabilité pour que ces radicaux puissent s'échapper de la cage
est* corrélativement augmentée. Ainsi, dans les cas où les atomes
H sont pro-
du processus primaire (toluène, mésitylène)
on observe la formation de produits très semblables en radiochimie et en photochimie. Quand ce sont surtout les radicaux méthyle qui sont produits, les
duits préférentiellement au cours
effets
GH
4,
cage sur
CH
3,
qui limitent sa diffusion et la formation ultérieure de
sont moins limitatifs dans les radiolyses que dans les photolyses.
Ni la radiolyse ni la photolyse des composés aromatiques portant des groupements alcoyles ne conduit à des rendements très élevés. Cependant, les
tableaux II, IV et V montrent que, rapportée à l'énergie absorbée, la radiolyse est approximativement 50 fois plus efficace que la photolyse*. Ce résultat traduit peut-être, dans une certaine mesure l'effet d'une absorption initiale de l'énergie dans la chaîne latérale. Pour des détails complémentaires
d'interprétation, le lecteur est prié de se référer aux articles originaux.
3 b.
— INFLUENCE DE LA VITESSE DE LA PARTICULE INCIDENTE
Les tableaux VI et VII résument les effets comparés obtenus par irradiation
à la pile et par bombardement avec des électrons de grande énergie. Le rayon-
nement de la pile comporte à la fois du rayonnement y (de 1 MeV environ)
(*) Dans le paragraphe 2, il a été indiqué pourquoi les résultats en radiochimie et en
photochimie sont aussi semblables. Ici, nous nous préoccupons davantage d'expliquer
les
différences observées.
(45)
Patrick (W. N.) et Burton (M.), J. Am. Chcm. Soc, 76, 2626, 1954.
Ce résultat est en contradiction avec les situations habituelles, discutées au paragraphe 2, où la photochimie et la radiolyse conduisent en général à des effets similaires.
(*)
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
et
des neutrons très énergiques, qui, par transfert de
23
momenl cinétique, pro-
duisent des effets qui pourraient être associés à un faisceau de proions
0,5 à
l
<ic
M eV, c'est-à-dire à des particules beaucoup plus lentes que des électrons
Tableau VI.
Rendements, en %, obtenus dans l'irradiation de substances aromatique
Ki).
liquides par le rayonnement global de la pile
(
Cil,
C,
G f (a)
87,6
3,1
S 'A, 2
8,0
18,5
0,0 (b)
8,2
77,.")
72,1
20,0
0,18
0,27
0,27
0,22
IL
COMPOSÉ
Toluène
Bthylbenzène
l-Propylbenzène
t-Butylbenzène
1,0
8,3 (c)
—
120° pour 100 èV.
(b) Le gaz en C 2 comprend 58 p 100
(a) Rendement en gaz volatils à
(c) Le gaz en C a comprend 79 p. 100 de C 2 S et 21 p. 100 de C 2 H 2
de C,H 4 42 p. 100 de C,H,.
—
,
Tableau VII.
—
H
H
.
CH
et
Rapport des rendements en
2
X pour des irradiations par des électrons de grande énergie et par le rayonnement global de la pile (41,46).
IRRADIATION A LA PILE IRRADIATION PAR ÉLECTRONS
COMPOSÉ
Toluène
Ethylbenzène
i-Propylbenzène
t-Butylbenzène
(P)
(e)
25,9
16,4
5,9
2,3
9,7
4,2
3,5
pie
1,58
1,64
1,83
2,09
1,6
de même énergie. Des particules lentes forment dans un milieu liquide une
colonne d'ionisation et d'excitation plus dense et aussi conduisent dans l'acte
ions
primaire à un rapport
quelque peu différent. Tandis que
molécules excitées
l'influence sur les valeurs de
les rapports
des rendements
affecte les réactions
G n'est pas très accusée,
H /CH
2
4,
chimiques ultérieures
3 c.
il
est manifeste, d'après
que la vitesse de la particule incidente
(46).
PRODUCTION DE POLYMÈRES
Les résultats relatifs à ce que nous nommerons « production de polymères »
dans la radiolyse de divers hydrocarbures sont résumés dans le tableau III.
Le terme « polymère » couvre ici indifféremment tous les produits non volatils
de la radiolyse et possède évidemment une signification différente pour les
composés aliphatiques
et les
composés aromatiques.
Les résultats obtenus pour le cyclohexane et le méthyleyelohexane indiquent
seulement que certains des radicaux les plus volumineux formés initialement
rendements d'hydrogène, tab. II) se combinent l'un à l'autre pour
donner des produits plus lourds non volatils. Dans le cas du cyclohexène,
(cf. les
(46) Sworski (T. J.) et Burtox (M.), J.
Am. Chem. Soc.. 73, 3790, 1951
RAD10LYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
24
une réaction de polymérisation initiée par radicaux libres intervient sûrement
(cf. paragraphe 3 a).
Le polymère formé au cours de la radiolyse du benzène présente un rapport
atomes H
,
., que ._
nA et jamais moindre
- qui n est en aucun cas supérieur a 1,04
1,0
atomes G
(45), les résultats ne permettant pas d'établir si le rapport est égal à l'unité
ou supérieur à 1. Le nombre de molécules converties en polymère pour 100 eV
absorbés (soit G p ) est petit mais néanmoins 20 fois plus grand que G(H 2 ).
Le mécanisme envisagé doit rendre compte du fait que G„ paraît indépendant
de la dose et du débit, tandis que la masse moléculaire moyenne augmente de
façon non linéaire avec la dose. Ceci implique qu'une fraction déterminée des
molécules excitées du benzène, et seulement des molécules excitées, interviennent dans la formation du polymère, quelles que soient les conditions
expérimentales, tandis que les dimensions du polymère dépendent d'autres
facteurs (par exemple la présence de polymère formé antérieurement). Des
résultats récents, obtenus par Gordon et Van Dyken (47), indiquent également que le phénylcyclohexadiène et le phénylcyclohexène font partie
des produits primaires. Le premier composé peut résulter de la combinaison de
2 molécules de benzène mais le dernier nécessite encore l'addition de 2 atomes
,
,
.
.
.,
.
d'hydrogène.
Pour expliquer tous ces résultats, on a suggéré les étapes suivantes
G 6H6
G6H
-mm->
-
t)
C 6 H,, + C 6 H 6
:
C 6 H*
(1)
G 6H5 + H
(2)
G 6H5 + C 6 H7
(2 a*)
La formation de phénylcyclohexadiène peut ensuite provenir de la combinaison immédiate des radicaux produits dans la réaction (2 a), soit
C 6 H 5 +C 6 H
C 6 H 5 .C 6 H
7
7
:
(2 b)
ou bien peut-être, résulter d'un processus élémentaire unique, autre que (2 a)
soit
:
C 6 H; + C 6 H 6
C 6 H 6 peut aussi donner lieu à
C 6 H 5 .C 6 H
7
(2 a')
:
GoH:
— CeHj
>
(3)
La réaction (1) représente une excitation initiale vers différents états électroniques excités. Une fraction déterminée / 2 de ces molécules excitées participe à la réaction (2) (ou (2 a) -f (2 a')) et une fraction déterminée /3 à la réac(47)
Gordon (S.) et Vax Dyken (A. R.), communication privée.
(*) La réaction (2 a) est suggérée par les études à basse température de Gibson, Blake et
Kalm ( 48 ) sur la photolyse de solutions solides de benzène. Ces auteurs pensent qu'un
des produits initiaux de la photolyse à 2400-2600
est probablement du transhexatriène, cependant la validité de leur analyse a été mise en doute. D'après ces auteurs le
benzène excité peut réagir avec le solvant pour donner C 6 8
(48) Gibson (G. E.), Blake (N.) et Kalm (M.), J. Chem. Phys., 21, 1000, 1953.
À
H
.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
tion
(3).
25
Dans la réaction (3), C 6 H, représente une catégorie particulière de
molécules excitées (formées éventuellemenl par conversion Interne) qui cou
(luisent nécessairement à la formation de polymères. Parmi Les radicaux nines
ou atomes produits dans la réaction (2) (ou (2 a) f(2a / ) une fraction déterminée peut donner naissance à d'autres radicaux libres. Les réactions précises
importent peu. 11 suffit de dire qu'une fraction /., des radicaux Libres K est
disponible pour une nouvelle réaction
:
RG H —
R fGeH:
6
Une autre réaction d'initiation peut être
C«Il-
:
+C H;
6
(4)
6
(C.H 6) a
;
—
(5*)
La croissance de la chaîne est ensuite supposée se dérouler suivant une série
de réactions telles que
:
Ri
+G H:
6
Ri(C 6 H 6 ) n + C 6 Hu
R—GH—
ou R x représente soit
6
6
ou
-
RAH—
(6)
R^CgHg^+i
(7)
— (C H —
6
La réaction de terminaison correspondante est
R (C H
1
6
6) n
+ R (ou R
x)
6)2
:
terminaison
(8)
Ce type de croissance de chaîne est inhabituel mais les faits eux aussi sont
inhabituels et il semble que l'état excité inférieur du benzène soit très persistant
(cf.
paragraphes 3 a, 3 / et 3 i), ainsi que le nécessite le mécanisme proposé.
Charlesby (49) a irradié dans un réacteur nucléaire plusieurs alcanes à
longue chaîne et de nombreux hydrocarbures non saturés à longue chaîne
et il a mesuré la dose nécessaire pour rendre le produit infusible. « L'infusibilité »
correspond, d'après l'auteur à une reticulation par molécule.
Le tableau VIII donne le nombre des reticulations formées par 100 eV,
calculé à partir des résultats de Charlesby; si, seule une formation de dimère
intervenait, le
nombre G de molécules consommées dans le processus serait
égal à 2 fois les chiffres donnés. Il est intéressant de noter que le G des reticulations pour les hydrocarbures saturés est proche de la valeur G (H 2 ) à laquelle
on doit s'attendre pour ces composés (voir tableau II) et que la facilité avec
laquelle s'effectue la reticulation augmente avec l'insaturation (cf. les valeurs
de G pour la série des composés en C 10 ou en G 18 ).
Le tableau VIII montre aussi que, pour les hydrocarbures oléftniques, la
reticulation a lieu plus facilement quand la double liaison est voisine de l'ex-
trémité de la molécule; c'est-à-dire quand la distance moyenne qui sépare la
liaison double
du lieu de l'excitation initiale est maximum. La reticulation
semble se produire avec un peu plus de facilité pour les composés trans que
pour les composés cis (sauf dans le cas de l'octadécène 9).
(*)
(49)
La réaction (5) ne correspond pas à la suggestion initiale de Patrick et Burton ( 45 ).
Charlesby (A.), Rad. Res., 2, 96, 1955.
6
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
26
A
partir de certaines expériences,
Charlesby a aussi conclu que, après
une irradiation avec une dose d'environ 2,3. 10 22 cY.g~ l les isomères cis,
comme les isomères trans, conduisaient à des mélanges contenant environ
35 p. 100 de composés trans; c'est-à-dire que la réaction cis -> trans est
,
environ deux fois moins probable que la réaction inverse. Charlesby a
également conclu que la probabilité de reticulation dans l'octadécène est à
peu près égale à la réaction d'isomérisation*.
le
—
Valeurs des G pour la reticulation de divers hydrocarbures irradiés par
rayonnement global de la pile calculées à partir des résultats de Charlesby (49) a
Tableau VIII.
.
VALEURS DE G
NOMBRE D'ATOMES DE C
Alcanes :
Décane
Octadécane
Octacosane
Dotriacontane
10
18
28
32
6,4
6,6
6,7
8,1
Oléfines :
10
18
Décène- 1
Octadécène-1
Octadécène-2
Octadécène-3
Octadécène-4
Octadécène-6
Octadécène-7
Octadécène-8
Octadécène-9
à partir du
composé
cis
trans
9,2
7,0
6,9
6,3
5,8
6,0
6,2
9,8
7,6
7,0
6,3
6,0
10,5
9,8
5,9
Acétylènes :
Décyne-1
Heptadécyne-1
Octadécyne-1
Docosyne-11
Octacosyne-9
Dotriaconty ne- 1
10
17
18
14,0
17,1
16,1
22
28
32
7,4
7,3
7,8
8
13,2
Diène :
2,5 Diméthylhexadiène-1,5
(a)
Ces valeurs sont légèrement différentes de celles données par Tolbert et Lemmon (1).
3d.
— MÉCANISMES DÉTAILLÉS
Les mécanismes de la radiolyse des hydrocarbures ne sont pas très bien
Les études sur le comportement radiolytique d'un mélange de cyclo-
établis.
hexane et de benzène d 6 faites par Burton et Patrick (36) ont été interprétées
par Hentz (50) en admettant que pas moins de 8,6 p. 100 du cyclohexane se
décompose pour donner de l'hydrogène moléculaire H 2 en un processus élémentaire. Les quantités de H 2 HD et D 2 produites par la radiolyse d'un mé,
(*) Pour d'autres résultats obtenus par Charlesby et leur discussion voir le mémoire
de cet auteur dans ce volume (p. 143).
(50) Hentz, J. Phys. Chem. 59, 380, 1955.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
27
lange de benzène e1 de benzène d 6 (37) ne peuvent pas s'interpréter de façon
simple sur
la
base d'une intervention simultanée de deux réactions élémen
taires primaires, l'une
formant des atomes, l'autre des molécules, soit
C.H.*
C,H 6
—
G 6 H5 + H
G 6 H4 + H 2
>
*
réactions équivalentes pour
:
(1)
(2)
C 9 D 9 Pour expliquer la formation de
II,
et
les
et
des autres produits, il faut aussi considérer des réactions plus compliquées,
.
y compris des réactions niétathétiques faisant intervenir une ou plusieurs
molecules de benzène excitées.
En général, les seuls rendements ne fournissent pas d'indices suffisants pour
décider du mécanisme d'une radiolyse. Mais on peut acquérir une connais-
sance plus poussée du mécanisme si les intermédiaires radicalaires formés au
premier stade de la transformation chimique peuvent être interceptés, identifiés et comptés. Les méthodes qui ont été utilisées pour cette interception
comprennent
:
l'emploi d'halogènes radioactifs (analyse par dilution isoto-
pique) de Hamill et Williams (voir paragraphe 3 e, 1°), la technique du 2,2-
diphényl-7-picrylhydrazyle (DPPH) (paragraphe 3 e, 2°) et l'initiation de réactions de polymérisation (paragraphe 3
e,
3°).
Toutes présentent des limita-
tions, cependant la méthode de Hamill et Williams permet un examen satisfaisant et plus détaillé de tous les radicaux supposés formés au premier stade
de la réaction.
Le mécanisme réactionnel est caractérisé aussi par les étapes précises de la
dégradation de l'énergie et par son transfert qui serait responsable de la faible
sensibilité
au rayonnement des hydrocarbures aromatiques et de la grande
Des renseignements sur la formation
fragilité des hydrocarbures aliphatiques.
des intermédiaires radicalaires produits sous différentes conditions contribuent
naturellement beaucoup à la compréhension des processus de transfert d'énergie.
Enfin, on peut aborder le problème en étudiant la protection et la sen-
sibilisation dans les mélanges (paragraphes 3 g et 9) et la luminescence induite
par des rayonnements de grande énergie (paragraphe 3 h).
3e.
— DÉTECTION ET ÉVALUATION DES RADICAUX LIBRES
1°
Interception des radicaux libres par des halogènes.
Une méthode très précieuse pour intercepter les radicaux libres (51) conavant irradiation, de faibles quantités de brome
ou d'iode radioactif. Après la radiolyse, on ajoute un mélange connu de tous
les halogénures d'alcoyles correspondant aux composés radioactifs susceptibles d'avoir été formés par la réaction
siste à ajouter à la solution,
:
R + X*
(51)
—
y
RX* + X
Hamill (W. H.) et Williams (R. K), Jr., ./. Am. Chem. Soc, 72, 1857, 1950.
(1)
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
28
L'addition est effectuée soigneusement de manière à éviter la perte, par evaporation, d'un quelconque composé radioactif RX*. Puis le mélange est soi-
gneusement séparé par une distillation fractionnée et on mesure la radioacchaque fraction. Le taux de comptage par unité de volume, correspondant à chaque entraîneur,
est multiplié par le volume total
tivité de
600
de l'entraîneur initialement présent et le rapport de ce nombre
au nombre total de coups enre-
pour tous
gistrés
400
entraî-
les
neurs peut permettre la déter-
mination des quantités relatives
des différents radicaux produits
200
dans les actes primaires de la
radiolyse. Cette méthode a été
appliquée (avec du radio-iode)
à
me
et
Volume du distillât
radiolyse
la
du n-pentane
liquide, et on a obtenu les résul-
am
bu
pr
tats représentés sur la figure 6.
portions de 2 cm*
—
On
Fig. 6.
Identification des radicaux libres produits dans la radiolyse du n-pentane liquide, par la
technique au radio-iode (51). L'activité est portée
en fonction du point d'ébullition du liquide entraîneur.
n'a
vinylique
daire,
pas
ou
ajouté
d'iodure
amylique-secon-
mais on a tenté d'iden-
tifier, par leur température d'é-
bullition, les composés correspondant aux 2 maximas accusés. Le premier travail de Hamill et Williams
s'était limité à la détection (et non l'estimation) des radicaux libres produits
dans la radiolyse du /i-pentane liquide à savoir les radicaux méthyle, vinyle
(en forte concentration), éthyle, propyle, butyle, s-amyle (en très forte con-
centration) et n-amyle.
Gevantman et Williams (52) ont appliqué la même technique à l'étude de
la radiolyse
des halogénures d'alcoyles (voir paragraphe 4 a) et d'un certain
nombre d'hydrocarbures gazeux, y compris le n-pentane sous une pression
de 120 mm. Dans ce cas, la courbe d'activité a été interprétée par ces auteurs
comme une indication que les radicaux avaient été formés dans les proportions relatives suivantes
:
Radical
CLL
C 2 H5
Nombre de moles p. 100
24
30
n-C 3 H 7
n-C 4 H 9
n-^U,
CH,
22
13
On n'a pas trouvé de radicaux vinyle en quantité appréciable, malgré l'addition d'un entraîneur vinyle. L'iso-propyle,
s'il
y en avait, était masqué dans
l'entraînement par l'iodure d'éthyle au cours de la distillation. Dans le distillât, l'acide iodhydrique actif correspondait à 3 p.
totale,
indiquant ainsi une réaction du type
H +
(52)
I2*
—>
100 de l'activité organique
:
HI* + I
Gevantman (L. H.) et Williams (R. H.) Jr., J. Phys. Chem. 56, 569, 1952.
(2)
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
en compétition avec des réactions telles que
H+C H
5
:
H +C H U
12
29
2
5
(3)
Dr même que dans l'étude des liquides, un maximum sit né* entre les pies
et au n-amyle m été attribué au radical s-amyle.
Ainsi, la principale différence notée dans les radiolyses du n-pentane gazeux
et Liquide a résilié dans l'absence apparente de radicaux vinyle pour le gaz
et dans la production continue d'hydrogène atomique dans le cas du liquide.
Si les résultats relatifs aux radicaux vinyle ont été correctement interprétés.
ils signifient probablement que, dans la radiolyse du /i-pentane liquide, les
radicaux vinyle sont produits par un processus secondaire.
Quand on utilise comme intercepteur un halogène non radioactif, les radicaux libres individuels ne peuvent pas être déterminés quantitativement.
Néanmoins, moyennant certaines restrictions dans l'interprétation (qui sont
également valables pour les composés radioactifs), de tels intercepteurs se
correspondant au n-butyle
sont révélés être des outils qualitatifs de valeur (53, 54). Williams et Hamill
en particulier, ont attiré l'attention sur les complications qui peuvent se
(26),
présenter
si
le
soluté ajouté est
un intercepteur non seulement de radicaux
mais aussi d'électrons libres. Une molécule de soluté peut alors capter
un électron avant que celui-ci ait pu se recombiner avec l'ion parent (24).
libres
M -mm^ M + e
M +e
+
+
—
(4)
y
M^
(5)
y
A-
(6*)
M* + A
(7)
ou
A +e
Les ions sont en définitive neutralisés
M + A"
+
->
et l'effet global réside dans le fait que le rendement en produits de la réaction
(formé à partir de M*) peut être légèrement inférieur au rendement obtenu
quand des ions négatifs n'ont pas la possibilité de se former (cf. paragraphe 1 c).
Pour le cyclohexane liquide irradié avec des rayons X de 120 kV Max Schubert et Schuler (55) ont rapporté que, quand la concentration en iode ajouté
M
-4
(d'après les auteurs, la dissipation d'énergie dans l'iode
à 10 3
peut alors être négligée), le rendement en hydrogène n'est pas affecté bien
est de 10
que tous les radicaux primaires hydrocarbonés semblent être interceptés.
Fessenden et Schuler (56) trouvent que dans le domaine 10 -5 à 5.10 -3 M
en I 2 le rendement pour 100 eV en iode lié est de 5,6 dans des solutions dégazées. En supposant que chaque molécule organique contient un atome d'iode
les auteurs trouvent la valeur G (RI) = 5,6. Ils indiquent aussi que, pour une
concentration en iode inférieure à 10 ~ 2 M, l'oxygène présent dans les solutions
,
Hamill (W. H.) et Schuler (R. H.), J. Am. Chem. Soc, 73, 3466, 1951.
Schuler (R. H.) et Hamill (W. H.), J. Am. Chem. Soc, 74, 6171, 1952.
(*) Quand I constitue le piège à électrons, le processus impliqué est une capture dissociative
I 2 -f e ->
+ I~. CL paragraphe 1 c.
(55) Schubert (C. C.) et Schuler (R. H.), J. Chem. Phys., 20, 518, 1952.
(56) Fessenden (R. W.) et Schuler (R. H.), J. Am. Chem. Soc, 79, 273, 1957.
(53)
(54)
2
:
I
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
30
aérées entre en compétition avec l'iode pour la capture des radicaux libres.
Chang (42) a trouvé que G(H 2 ) diminue à partir d'une concentration en iode
Pour une concentration en iode d'environ 10 ~ 2 M, G(H 2 )
diminue et atteint une valeur constante égale à 3,6*. Ce résultat concorde
avec l'interprétation que la production d'hydrogène dans la radiolyse du
cyclohexane s'effectue en plusieurs étapes distinctes, par exemple
2,5. 10-
de
4
M.
:
C 6 H 12
C 6 H 12
MM_>
MM—>.
G 6 HU + H
C 6 H 10 + H 2
(1)
(2**)
La figure 7 montre que l'addition d'iode au benzène diminue à la fois G(H 2 )
H 2 ) mais cet effet est beaucoup moins marqué que dans le cas du cyclo-
et G(G 2
/-»
hexane (38); d'après Schuler, le rapport
/TT \
*'
^
G(C 2 H 2 )
reste assez constant (^ 2,1)
dans tout le domaine de concentrations en iode. L'effet de réduction de G
n'est pas linéaire et semble atteindre une
0,0*i
valeur limite pour la plus forte des conceni
^^^-^^J^
trations en iode. Ce dernier résultat semble
© _
0,03 "
nécessiter l'interprétation que la radiolyse
du benzène procède par deux mécanismes
au moins. Le mécanisme représenté par le
palier n'est apparemment pas inhibé par
6
0,02
•
C,H 2
•
présence d'iode.
La réduction initiale
des rendements en
H et C H suggère que
la
0,01
<
0,1
)
cr,2
2
2
2
m,\ 2
l'iode interfère avec au moins un des méca-
Influence de l'iode sur la
Fig. 7.
radiolyse du benzène par les rayons y
de 60 Co (57).
nismes de décomposition à un stade primaire et pas simplement au stade de
—
l'observation des produits formés.
pas satisfaisant de conclure que la diminution du rendement en
Il
n'est
H résulte de
2
atomes d'hydrogène par l'iode avant que ceux-ci aient pu forH 2 et C 2 H 2 à moins de supposer également
que, quelle que soit la nature de cette dernière réaction, elle donne H 2 et C 2 H 2
dans le rapport 2,1, de même que l'autre processus représenté par le palier de
la figure 7. Une autre hypothèse plus simple consiste à supposer que I 2 agit
à un stade primaire dans la série des processus physiques précédant le premier
effet chimique et que cet effet atteint un maximum quand la concentration
en iode est suffisamment élevée. Cette façon de voir implique la notion que
le rôle de l'iode est dans une large mesure un rôle de protection et pas simplement d'interception. L'iode peut agir comme protecteur par l'intermédiaire
de deux mécanismes bien connus
a. par un processus de conversion interne qui ne conduirait pas à un pro-
la capture des
mer, par un processus quelconque,
,
:
duit de réaction***,
(*)
Un travail non publié de R. H. Schuler (cf. références 56, 57, 38) indique que l'effet
G(H commence à se manifester dans le domaine de concentrations 10~ 3
de l'iode sur
2)
à 5.10- 2 M.
(**) Cf. paragraphe 3 d.
(***) Un tel comportement est caractéristique d'atomes lourds; cf. l'auto-prédissociation
de l'iode à pression élevée ( 57 ) ( 58 ).
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
par capture d'électrons, dissociation, formation de
b.
C eH a
ce dernier dans la neutralisation des ions
,
1
et
31
Intervention de
ce qui conduit à abaisser
niveau d'énergie des molécules de benzène excitées
(et.
paragraphe
1
le
c).
D'après Schubert et Schuler, dans le domaine de concent rations 10
en I 2 tous les radicaux sont captés dans la radiolvse du evelohexane
à 10 3
ou du 2,2,4-triméthylpentane, avec un rendement en CH< ou en II 2 qui dans
l
M
,
l'un et l'autre cas, n'est pas affecté par la présence de l'iode.
Le fait empirique
que l'iode n'interfère pas est important Schuler et coll. ont utilisé ce résultat
pour estimer le rendement initial en radicaux libres dans différents hydrocarbures.
D'après Forsyth, Weber et Schuler (59), G(H 2 ) dans l'heptane normal
;
de 5,2 et n'est pas affecté par
est
I
2,
jusqu'à des concentrations de 10
G(-I 2 ) = 3,4. Le mécanisme par lequel l'iode disparaît est le suivant
R +
—*
I2
RI + I
3
M;
:
(8)
avec une énergie d'activation E 8 et les résultats indiquent que les atomes H,
s'il s'en forme, disparaissent (alors qu'ils disposent encore d'une énergie élevée) plutôt en réagissant avec la substance de départ que par une réaction
,
avec I 2 *. Vraisemblablement les réactions
R + R'H
R +R
/
et
:
—^ RH + R'
—> RR'
entrent en compétition avec la réaction (8).
(9)
(10)
La réaction (10) ne fournit pas
une contribution appréciable à la disparition des radicaux si la concentration
en iode est supérieure à une valeur minimum (déterminée en partie par l'énergie d'activation
E ). L'intervention de la réaction (9) n'a pas d'effet sur la
8
disparition de l'iode par la réaction (8) (ou son équivalent). Les résultats de
Schuler et al. montrent que la réaction (9) a lieu, à l'exclusion de la réaction (8), quand
R est de l'hydrogène atomique, bien que E « E
E -E — 6 kcal. Le
que
9
8
8
rapport des constantes spécifiques
9.
Supposons
de vitesse
—
(en négligeant les facteurs d'entropie d'activation) est alors de l'ordre de
M
ou d'environ 10 ~ 4 en fraction
10 4 3 Avec une concentration en iode de 10 3
molaire, le rapport des vitesse v 8 /v 9 (c'est-à-dire le rapport des nombres d'atomes
'
.
H conduisant respectivement à HI ou H
2 ) serait cependant quelque peu supépour des atomes d'hydrogène thermalisés. Pour rendre compte de
l'absence d'effet de I 2 sur G(H 2 ) dans le travail de Schuler et al., on peut
invoquer des atomes « chauds » d'hydrogène, c'est-à-dire non thermalisés**.
rieur à 2
Turner (L. A), Phys. Rev., 41, 627, 1932.
Burton (M.) et Rollefson (G. K.), J. Chem. Phys., 6, 416, 1938.
Forsyth (P. F.), Weber (E. N.) et Schuler (R. H.), J. Chem. Phys., 22, 66, 1954.
(57)
(58)
(59)
Les auteurs soutiennent l'opinion que la quantité de liaisons rompues est au moins
+ G(-I 2 ) ûi 8,6 et qu'il existe probablement une décomposition supplémentaire
de 5-10 p. 100 par d'autres mécanismes. Cependant la conclusion de Hentz (cf. paragraphe
3d) que, dans la radiolyse du cyclohexane 8,6 p. 100 au moins de l'hydrogène est formé
par un processus de réorganisation, montre qu'une interprétation simple des résultats
peut ne pas être sûre.
(**) Des résultats non publiés de Hamill et Nash mettent en doute la validité d'une
interprétation fondée sur des atomes chauds.
(*)
G(H
2)
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
32
Cependant, quand on essaie d'interpréter ces résultats, il faut souligner le fait
qu'une fraction appréciable de l'iode initialement présent est consommée
dans les expériences qui servent à Schuler et al. pour déterminer G(-I 2 ).
Le tableau IX résume les valeurs de G(-I 2 ) obtenues par ces mêmes auteurs
dans la radiolyse de différents hydrocarbures avec des rayons X de 120 kV max
Bien que de plus amples détails soient nécessaires pour formuler une inter.
prétation exacte, on peut penser que les résultats indiquent un nombre de
liaisons rompues par 100 eV à peu près égal ou supérieur à G(-I 2 ). L'accord
approximatif entre les valeurs basées sur une telle estimation et celles obtenues par d'autres méthodes (cf. paragraphes 3 e, 2° et 3 e, 3°) est interprété
comme une confirmation de cette façon de voir.
—
Nombre de molécules de 7 ? consommées pour 100 eV dans différents liquides
de 120 kVmax;
orqaniques renfermant de faibles quantités d' iode; irradiation par des rayons
Tableau IX.
X
Weber, Forsyth et Schuler (60).
G(—
COMPOSÉ
I
COMPOSÉ
2)
2,4-Diméthylhexane
4,0
4,0
2, 2, 4-Triméthylpentane
n-Nonane
3,8
3,4
2, 2, 5-TriméthyJhexane
Cy dopent ane
3,7
Cyclohexane (b)
4,0
Méthylcyclopentane
4,2
3,4 (a) Méthylcyclohexane
Benzène
4,3
Toluène
4,0
n-Pentane
i-Pentane
n-Hexane
2-Méthylpentane
3-Méthylpentane
2, 2-Diméth\ibutane
2, 3-Diméthylbutane
n-Heptane
2, 3-Diméthylpentane
2. 4-Diméthylpentane
n-Octane
2, 3-Diméthylhexane
o-Xylène
Ethylbenzène
3,7
4,4
g (-y
3,8
4,2
3,7
4,2
3,6
3,2
3,8
3,2
0,33
1,18
1,23
1,41
—
(b) Des résultats plus récents et non publiés de
Tous les G sont basés sur cette valeur.
Fessenden Jr. et R. H. Schulkr donnent G(RI) = 5,6 à la l'ois pour des rayons y de 60 Co
(a)
R. VY.
et des électrons
de 2 MeV.
2°
Emploi du DPPti pour l'estimation des rendements
en radicaux libres*.
Le diphénylpicrylhydrazyle (DPPH)
NO,
c6
r-NO
h/
N0
est
s
2
un radical libre relativement stable. Le DPPH cristallisé est paramagné-
tique (61) et il est facile de dissoudre ce radical dans des solvants organiques.
(*)
Les paragraphes 3e, 2° et 3e, 3° ont été rédigés en collaboration avec le Dr J. M. Nos-
WORTHY.
(60)
Weber (E. N.), Forsyth (P. F.) et Schuler (R. H.), Rad. Res., 3, 68, 1955.
(61)
Turkevitch (J.) et Selwood (P. W.), J. Am. Chem. Soc, 63, 1077, 1941.
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
En solution,
il
réagit
33
rapidement avec d'autres radicaux libres. Si on suppose
réaction est stoechiométrique, on peut utiliser la vitesse de disparition
que
du DPPH comme mesure de La vitesse de production des i;idic;ui\. BaWN ri
MELLISH (62) oïd suggéré son utilisation pour compter les radicaux libres
la
tonnes en solution par dissociation thermique, lue méthode essentiellement
similaire a été introduite en chimie des radiations pour compter les radicaux
formés au cours de l'irradiation de liquides ((>i>).
La vitesse de disparition du DPPH est facile à mesurer par coloriinél rie.
se combine à un autre
Le DP1M1 lui-même est d'un violet intense; quand
il
moins intense. On trace les courbes d'étalonnage
à partir de solutions standard de DPPH et on tient compte, dans L'évaluation
radical, sa couleur devient
du nombre de radicaux, de la couleur du produit d'addition radical-DPPH.
déterminée dans chaque cas en mesurant la densité optique
obtenue quand la totalité d'une quantité connue de DPPH a réagi avec les
Celle-ci peut être
radicaux produits au cours du processus considéré.
est
ainsi
Une correction appropriée
apportée à chaque mesure de densité optique. On trouve en général
que cette correction est minima quand les mesures d'absorption sont conduites
dans la région rouge du spectre (8 000-8 500 Â).
Pour qu'un intercepteur S puisse être utilisé à la mesure de radicaux libres
R produits dans la radiolyse de liquides, la réaction de l'intercepteur avec les
radicaux
:
S
+ R
—
SR
(1)
doit pouvoir l'emporter sur la réaction compétitive de recombinaison des
radicaux entre eux
:
R +R
-> R
(2)
2
même quand la concentration [S] est assez faible pour que l'effet direct soit
négligeable. Si
on suppose que
la réaction d'interception
DPPH + radical
possède une énergie d'activation de 5 kcal (64), la réaction de recombinaison
on suppose une concen= 10 - 12 mole. cm- 3 une
~7
3
concentration [S] = 10
de DPPH serait suffisante pour
mole, cmcapter 99 p. 100 des radicaux produits (64). On peut penser que le DPPH
en solution peut être affecté par le rayonnement de 3 manières a. par action
directe, b. indirectement par un mécanisme de transfert d'énergie qui peut
avoir lieu si le DPPH a une action protectrice sur le solvant (cf. paragraphes
1 b et 1 c), c. indirectement par l'intermédiaire des radicaux prenant naissance
dans le solvant. L'effet direct est négligeable aux concentrations employées
pour le DPPH* (cf. paragraphe 1 d). S'il est possible de supposer que le DPPH
ne joue pas de rôle protecteur, il en résulte que l'absence d'effet direct sur le
DPPH, lui confère un avantage sur l'iode qui a un poids atomique élevé. Le
des radicaux une énergie d'activation nulle, et
si
tration stationnaire et uniforme en radicaux [R]
,
:
(62)
(63)
Bawn (C. E. H.) et Mellish (S. F.), Trans. Far. Soc, 47, 1216, 1951.
Chapiro (A.), Compt. rend. 233, 792, 1951.
Cousin (C), Landler (Y.) et
(64) Prevost-Bernas (A.), Chapiro (A.),
Disc. Far. Soc, 12, 98, 1952.
(*)
Si le
Ma gat (AI.),
DPPH agit comme piège à électrons lents (cf. paragraphe le) l'effet direct
peut n'être pas tout
haissinsky.
à fait négligeable.
— m.
3
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
34
coefficient
photoélectrique relativement grand qui en résulte,
d'absorption
dans le cas de l'iode, à effectuer une correction pour l'effet direct.
Si on irradie des solutions dans des conditions d'irradiation uniforme et
oblige,
qu'on porte la vitesse de disparition du DPPH en fonction de sa concentration
initiale, on obtient des courbes du type de celle tracée sur la figure 8 (64). Le
domaine dans lequel la vitesse de disparition du DPPH cesse d'augmenter
avec la concentration initiale (c'est-à-dire au palier) correspond à la situation
que pratiquement tous les radicaux libres sont captés par le DPPH. On définit
une concentration initiale [DPPH] (Ii telle que, pour une concentration initiale supérieure, une fraction faible déterminée des radicaux (soit < 2,5 p.
est
100) échappe à la capture par l'intercepteur. La valeur de [DPPH],
déterminée alors par la vitesse de production des radicaux et par la compel ition entre les deux réactions de
,
ri i
disparition (1) et
d[DPPH]
69 r. min.
rise
2 7, 5 r. m n
Une forte
(2).
concentration en radicaux favoréaction
(2).
Cependant,
production de radicaux libres
est
non uniforme à l'échelle mi-
.'
i
la
la
croscopique,
conduisant
de
à
fortes concentrations locales ins-
foPPHl
Fig.
8.
— Effet de
,
la
I0'
tantanées le long des trajectoires
200
100
8
dans les grappes (cf. paragraphe 1). Étant donné que c'est
et
moles cm"
concentration
initiale de
la
ma-
concentration radicalaire
DPPH dans le chloroforme sur la vitesse de sa xima qui est déterminante, une
disparition avec des rayons X de 190 keV de
variation dans la distri bution
différents debits.
des radicaux résultant d'irradia__._
_
_
Le rapport entre la valeur dc/dt et le debit au plations par des particules de vitesses
teau est une mesure directe de g r (64).
,
,
différentes
observées pour la concentration
affecter les valeurs
également
devrait
[DPPH]
cli t
(65).
Il
est
évident que les concentrations très élevées en radicaux, atteintes le long des
trajectoires de particules a, conduit à une valeur tellement grande de [DPPH] ri i>
(
.
que l'emploi du DPPH pour évaluer un nombre de radicaux dans de telles
conditions aboutirait à un résultat confus à cause d'un effet direct très impor-
tant sur le
DPPH lui-même (64).
L'effet d'une distribution
non uniforme dans la production des radicaux
est bien illustrée par des expériences de Chapiro (66), sur l'effet de l'intensité
sur la valeur [DPPH],. „
ri
dans
le
chloroforme
et l'acétate
de méthyle.
La
résume ses résultats. Pour de faibles intensités I, [DPPH] ni est
indépendant de l'intensité pour les rayons X ou y utilisés, dont l'énergie variait
au-dessus de 37 kV. Cependant, pour des débits plus élevés, [DPPH]
devient
L'explication proposée par Chapiro est la suivante. La
proportionnel à I
concentration [R°] en radicaux qui détermine la valeur requise pour [DPPH] (rit
figure 9
,
.
(
lit
1/L>
.
(65)
Chapiro (A.), Boag (J. W.), Ebert (M.) et Gray (L. H.), J. Chim. Phys., 50, 469,
1953.
(66)
Chapiro (A.), J. Chim. Phys., 51, 165, 1954.
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
elle-même la somme de deux termes
tsi
[it"]'
35
ou concentration radicalaire
,
moyenne dans Les grappes qui onl partiellement diffusé et K" ou concen
tration radicalaire moyenne dans le fond continu (22, <>7). car les grappes nr
'
sont que des régions en expansion, à forte concentration radicalaire, Implan-
dans
tées
à
des
régions
40 °
concentration
faible
moyenne
en
y/
radicaux,
200
c'est-à-dire que
:
[dpph]
crlt
[Ro]"
[Ro]
'00
- 80
r
'•»
+ [R°] (3 e, 1)
Chloroforn^o^
60
[dpph]*,
Il
©
€>•
C
En conséquence, [DP
PH]crit est la
somme de
-
deux termes correspon10
dants, soit
'
/
/
radicaux
dans
(partiellement
dilatées)
est
Fig. 9.
/
— Influence de
de
l'intensité.
Pour
des
intensités
IO"
10
I
8
moles
l'acétate de
100
litre"' sec'
la production non uniforme des radicaux-
libres sur [DPPH]crl\ dans la radiolyse
du chloroforme et de
X et y de différentes
méthyle par des rayons
énergies (66).
O T de
indépen-
dante
,
t Ima%
/
/
I
0,1
,01
les
grappes
/
i
(Ii t
faibles, [r°]
/
/
/
It
/
La concentration [r°]
des
^m
i^J^^
:
= [DPPHJt,!
+ [DPPH]!,, (3 e, 2)
[DPPH]
Ac
80
Go
O y de Ra
# rayons X de 1,2 MeV
3 rayons X de 200 kV
w rayons X de 37 kV
concentra-
fond continu, est faible et peut être négligée dans l'expression
(3 e, 1). Il en résulte, qu'à faible intensité [DPPH],,. est indépendant de l'intensité. Pour des débits élevés, [R 7 (qui est approximativement proportiontend alors vers
nel à I 1/2 ) devient relativement plus important et [DPPH]
tion dans
le
it
]
.
(
une fonction linéaire de
I
ri ,
1/2
.
La réactivité chimique du DPPH limite les types de composés qui peuvent
Il réagit avec l'eau; il faut donc que
composés analysés soient fortement déshydratés et de soigneuses mesures
de contrôle sont nécessaires. Il réagit avec les groupements oxhydryle et, d'une
façon générale, avec les hydrogènes mobiles. Il réagit assez rapidement avec
les doubles liaisons (64); il est donc vraisemblable qu'il peut réagir aussi avec
des composés non saturés, susceptibles de se former au cours de l'irradiation.
Le lent effet prolongé observé par irradiation de solutions de DPPH dans
l'acétate de méthyle, le chloroforme et le benzène peut être dû à une réaction
lente entre le DPPH et des produits moléculaires formés à partir du solvant.
être étudiés par son intermédiaire (64).
les
L'existence de telle réactions lentes souligne la possibilité de réactions rapides
du même type. Dans le cas du benzène, il est possible que la « réaction lente » ait
Par ailleurs, des irradiations dans
lieu avec le « polymère » non saturé (66, 68).
(67)
(68)
Magee (J. L.), ./. Am. Chan. Soc, 73, 3270, 1951.
Bouby (L.) et Chapiro (A.), J. Chim. Phys., 52, 645, 1955.
36
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
l'ultraviolet,
de solutions de
DPPH dans le benzene, le toluène, le chloro-
benzène et le bromobenzène ont amené Griffith (69) à suggérer que le DPPH
réagit avec les molécules de solvant excitées à l'état triplet le plus bas (cf.
/>), ce qui conduit à la disparition du DPPH.
paragraphe
Dans une récente publication (70), l'idée a été avancée que le DPPH pou1
vait être
un intercepteur de radicaux libres moins efficace que l'iode ou l'oxy-
gène. Le butyl-mercaptan, le DPPH, l'iode, l'oxygène ont été utilisés
intercepteurs pour estimer le
ciation
solvants
comme
nombre de radicaux libres formés par la disso-
thermique de l'azo-bis-isobutyronitrile en solution dans différents
:
(CH8) 2 C(CN)N=NC(CN) (CH 3 2
)
2(CH3 ) 2 C(GN) + N 2
Tous ces intercepteurs ont indiqué un rendement en radicaux libres variable
et, dans tous les cas, inférieur à la quantité correspondante
Cependant les rendements mesurés par DPPH étaient régulièrement
inférieurs à ceux évalués par l'iode ou l'oxygène, qui, eux, fournissaient des
résultats concordants. C'est pourquoi Hammond et coll. ne recommandent pas
avec le solvant*
d'azote.
d'utiliser le
DPPH comme intercepteur de radicaux.
le DPPH peut enregistrer un rendement
Ainsi, suivant les circonstances,
en radicaux libres trop élevé ou trop faible.
Malgré les nombreuses critiques portées sur la technique du
DPPH pour
mesurer les rendements en radicaux libres, et en dépit des écarts obtenus dans
les mesures absolues des rendements (71), les résultats relatifs pour différents
solvants mesurés par DPPH ou d'autres méthodes (60, 71 a) sont en assez bon
accord.
Le tableau X est extrait de l'article de Bouby et al. dans lequel les rendedements pour 100 eV ont été recalculés sur la base G = 15,6 pour le dosimètre
de Fricke. Des expériences antérieures avaient montré que l'oxygène n'affectait pas les réactions étudiées. Cependant le tableau X comporte des résultats
plus récents qui montrent que les rendements de radiolyse du chloroforme, de
l'acétate de met h vie, du benzène dépendent de la présence d'oxygène, à la
fois pour les solvants purs et pour les mélanges de ces solvants (cf. paragraphe 9).
:
3°
Méthodes de polymérisation pour l'estimation du nombre
des radicaux libres.
Une 3 e technique pour la mesure des rendements en radicaux libres est la
méthode de polymérisation. L'emploi parallèle du DPPH et des réactions de
Griffith (L. K.i. Sud. Sri. Abs., 10, Xo. 21, Abs. 10060, l!».r>(i.
Hammond (G. S.) Sen (J. X.) et Boozer (C. 1-:.). J. Am. Chem. Soc, 77, 3244, 1955.
(*) Cette variation est attribuée à une influence inégale de l'effet cage.
.71) Wild (W.), ./. Chim. Phys., 52, 653, 1955.
(71 a) Bouby (L.), Chapiro (A.), Magat (M.),Migirdicyan (E.), Prevot-Bernas (A.),
Reinisch (L.j, et Sebban (.J.h Conférence de Genève sur l'utilisation pacifique de
(69)
(70)
l'énergie nucléaire, vol. 7, p. 612, 1955.
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
37
\) a été discuté dans deux publications du Laboratoire
les résultats sont
a). La méthode et
de Chimie Physique de Paris (64, 7
qui
suit.
dans
le mémoire
discutés par Chapiro el Magat
pol\ mérisation (tableau
1
v
Tabli m
par les rayons
-.
Comparaison des rendements G H en radicaux libres produits par irradiation
" radium et mesurés par les techniques du DPPH et de la polymérisation.
(/
(71
a) a
.
DIM
POLYM
i
ims \
i
[ON 6
en présence
d'air
Sulfure de carbone
0,6
M
0,51
Benzène
0,59
1,4
0,56 a 0,89
Styrolène
«i.;»
1,3
Toluène
ni- Xylene
Ethylbenzène
0,9
2,1
2,28
5,5
3,3
8,3
Acrylonitrile
(8,2)
(1,9)
2,4
Nitrobenzene
n-Heptane
n-Octane
Cyclohexane
2,8
(1,3)
(3,1)
Acétone
Chlorobenzène
o-Dichlorobenzène
(2,6)
(6,3)
8,7
5,2
12,6
15,1
6,9
12,2
14,7
18,3
14,1
12,3
16,1
19,5
11,9
(33)
6,06
16,1
(7,9)
10,7
14,6
18,3
Chlorure de cyclohexyle
Chlorure de méthyle
20
Dichlorométhane
Chloroforme
27
Tétrachlorure de carbone
1,2 -Dichloréthane
Bromure d'éthyle
Bromoforme
0,71
6,0
Dioxane
Methanol
Propanol
Méthanol-d;
Acétate de méthyle
Acétate de méthyle-d G
Acétate d'éthyle
Méthacrylate de méthyle
sous vide
1,9
Propionitrile
p:ther
n
16
(22)
(54)
(66)
(159)
37
25
24,4
18,3
18,3
9,8
17
2,3
44
i
rendements en radicaux pour 100 eV d'énergie absorbée ont été recalculés sur
base G = 15,6 pour le dosimètre au sulfate ferreux.
b) Les deux valeurs de G R
données par Bouby et coll., dans leurs études de polymérisation, constituent des valeurs
limites obtenues en ^adoptant différentes valeurs pour les constantes de vitesse de la
réaction de polymérisation employée. Les valeurs entre parenthèses sont celles que les
auteurs considèrent comme plus douteuses.
a) Les
la
—
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
38
3 f
m
_ RÉACTIONS DE MOLÉCULES EXCITÉES
Quand une molécule stable absorbe de la lumière, elle passe à un niveau
excité pour retomber ensuite à l'état fondamental. La diversité des processus
qui entrent en compétition dépend en partie de l'état obtenu et du niveau
d'excitation atteint (cf. paragraphe 1). Comme le processus d'excitation a lieu,
le
processus corrélatif d'émission de lumière (ou de fluorescence) est toujours
permis. Aussi, dans ce cas, c'est l'absence de fluorescence et non son existence
qu'il s'agit d'expliquer.
En chimie des radiations (contrairement au cas de la photochimie) l'excitation peut être
un processus optiquement interdit (cf. paragraphe 1
b) et,
de ce fait, la durée pendant laquelle la stabilisation par émission de lumière
peut s'effectuer est souvent considérablement
augmentée. Pour de telles molécules excitées métastables, non seulement les
(c'est-à-dire la luminescence)
processus habituels de désactivation peuvent se produire, mais des processus
moins courants tels que réarrangement interne, excitations en cascade (72)
Stern-Volmer (73) peuvent commencer à jouer aussi un rôle.
et réactions
Ces dernières sont des réactions du type
:
—> produits
A* + B
(1)
Ces considérations sur la chimie des molécules excitées sont introduites à ce
stade de l'exposé, car elles interviennent dans l'interprétation des expériences
de chimie des radiations qui comportent l'utilisation d'un intercepteur ajouté
à dessein au mélange réactionnel (cf. paragraphe 3 e). L'objet de cette addition
est d'intercepter et d'éliminer les intermédiaires radicalaires. Cependant, si une
molécule excitée (par exemple une molécule excitée métastable) peut réagir
avec l'intercepteur, l'interprétation des réactions est rendue délicate. Même
pour des liquides purs, la possibilité de réactions entre molécules excitées (74)
(cf. aussi paragraphe 3 c) a pour effet de compliquer les interprétations. Un
exemple en est fourni par l'anthracène irradié par de la lumière ultraviolette.
On considère que la molécule excitée métastable disparaît dans un processus
de dimérisation (référence 7, pp. 352-3)
III
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I.
I
(2)
Le cas du benzène liquide pur en fournit aussi une illustration. Le benzène
pas manifestement affecté si on l'irradie avec la raie 2 537 A. Une
n'est
Burton (M.) et Magee (J. L.), J. Chem. Phys., 23, 2194, 1955.
Reddy (M. P.) et Burton (M.), J. Am. Chem. Soc, 79, 813, 1957.
(74) Dewhurst (H. A.), Samuel (A. H.) et Magee (J. L.), Rad. Res., 1, 62, 1954.
(72)
(73)
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
irradiation
39
en présence d'air ou d'oxygène fournit une quantité
de produits oxygénés (75); d'autre part
qu'un radical per-oxydyle intermédiaire se forme
négligeable
ScHENCK
(76)
presque
signale
OO
G.HÎ + 0,
—>
^
Z
(3)
qui induit une oxydation en chaîne en présence de cyclohexane, Phung (77)
une étude directe de la consommation d'oxygène dans le benzène
 et a conclu que le rendement quantique de consommation à l'équilibre n'excédait pas 0,01; ce résultat confirme
celui de Allsopp (75) mais n'est pas incompatible avec le point de vue de
a effectué
en solution aqueuse photolyse à 2 537
Schenck qui considère le radical benzène-peroxydyle comme très instable. Il
également possible que l'extinction de la luminescence dans le benzène
ou des solutions de benzène irradié avec les rayons y de Rd-Go (78, 79) soit
attribuable à une réaction Stern-Volmer telle que 3, suivie d'une décomposition presque immédiate du composé intermédiaire en benzène normal et
en oxygène excité.
Un meilleur exemple de réaction Stern-Volmer est fourni par le crotonaldéhyde (10). Le rendement quantique de photolyse pour une irradiation dans
l'ultraviolet de 3 660 à 2 399 À est nul. Cependant, si on ajoute délibérément
de l'oxygène, une réaction avec ce dernier est nettement décelable à 3 130
et 2 804 À et présente des indices d'un mécanisme en chaîne à 2 537 Â (80).
est
3 g.
— MÉLANGES D'HYDROCARBURES
On sait depuis de longues années (32) que le rendement en produits gazeux
dans la radiolyse d'un mélange de benzène et de cyclohexane à l'état liquide
est très inférieur à ce à quoi on peut s'attendre d'après la relation
G = eBGB + sc Gc
:
(3 g, 1)
où G représente la production gazeuse totale, e B et s c les fractions électroniques
respectives du benzène et du cyclohexane. Manion et Burton (35) ont soumis ce
système et d'autres au bombardement d'électrons de 1,5 MeV et ils ont obtenu
les résultats résumés en partie par les figures 10, 11 et 12. La figure 10 montre
que si l'addition de cyclohexène ou de benzène au cyclohexane amène G(H 2)
à s'écarter notablement de la relation simple (3 g, 1), le benzène est presque
sans effet sur le cyclohexène. Pour un mélange toluène-benzène, le rendement
(75) Allsopp (C. B.) et Szigeti (B.), J. Chem. Ind., 63, 30, 1944.
(76) Schenck (G. O.), communication privée.
(77) Phung (P. V.), et Burton (M.), Rad. Res. 7, 199, 1957.
(78) Burton (M.), Berry (P. J.) et Lipsky (S.), J. Chim. Phys., 52, 657, 1955.
(79) Berry (P. J.) et Burton (M.), J. Chem. Phys., 23, 1969, 1955.
(80) Blacet (F. E.) et Volman (D. H.), J. Am. Chem. Soc, 61, 582, 1939.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
40
en hydrogène obéit à la relation (3 g, l)dans les limites des erreurs expérimentales. La figure 11 montre que les rendements en méthane sont sujets aux
mêmes variations que les rendements en hydrogène pour les quatre cas étudiés.
La figure 12 montre, par contre,
que
même
S(H 2
)
une
quantité
faible
de
?C 6 H,
^C 6 H 6
0,4
0,2
— Valeurs de G(H pour mélanges
Fig. 10.
—
2)
Valeurs de GiCH^) pour des
11.
mélanges liquides de divers hydrocar-
Fig.
de divers hydrocarbures (35)
fraction électronique du composant
e2
qui figure à droite.
liquides
0,6
:
=
bures (35):
fraction électronique du composant
qui figure à droite.
=
s2
O Gyclohexane + benzène
Gyclohexane + benzène
| Gyclohexane + cyclohexène
|
comme pour la figure 10.
Notations
toluène semble diminuer le rendement en acétylène formé à partir du benzène.
Les résultats de Manion et Burton suggèrent deux possibilités
a. La diminution de l'hydrogène produit comporte une compétition entre
:
les
deux réactions
R +H
H + RH
(1)
2
H
H +—C
b.
I
(2)
Un véritable phénomène de protection est réalisé, impliquant un transfert d'énergie intermoléculaire.
i
0,02
les deux
interviennent.
mécanismes
La production de polymère (cf. para-
semble actuellement que
Il
types
G(C 2 H 2 )
o
„-""''
o
+~"
0,01
O
0,4
0,6
0.8
1.0
€ (C 6 H 6 )
- G(C 2 H 2 ) pour des mélanges
Fig. 12
liquides de divers hydrocarbures (35).
O Cyciohexane + benzène
€) Cyclohexène + benzène
I
c)
fait
certainement intervenir
réaction
(2).
Au
graphe 3
f'*
la
0,2
de
Toluène + benzène
portant
sur
aqueuses
de
ton
(77) ont
la
cours
radio lyse
benzène,
d'un
de
Phung
montré que
les
travail
solutions
et
Bur-
atomes
H
thermalisés réagissent presque exclusive-
ment de cette manière. Par contre,
PATRICK et BURTON Ont étudie la radio-
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
M
lysed'un mélange de propionaldéhy de et de benzène d 8 (cf. paragraphe 9) pom
calibrer
les
probabilités relatives des
c,D
ti
H +CD
a
H
réactions
G e H,
111)
(1 a)
et
e
et
ces auteurs ont conclu
(1
</)
que
la
C 6 D.H
probabilité
(2a)
•elative de (2 a) par rapporl
à
inférieure ou égale à 7,3*.
est
Celte valeur est utilisée par Patrick
et
Burton (36) pour interpréter les
résultats d'expériences relatives à un mélange de cyclohexane et de benzène dt
Le rendement en
sert
à
déterminer
III),
le
vraisemblablement formé suivant
rendement initial en
la
réaction
(1
.
r/),
atomes d'hydrogène dans la radiolyse du
cyclohexane et celte valeur ajoutée à G(H 2 )
fournit une estimation du rendement primaire
total en atomes H à partir de C 6 H 12 (voir
figure 13). Les résultats montrent qu'apparemment le benzène interfère de façon notable
dans l'acte primaire de la radiolyse du cyclohexane. Burton et Patrick interprètent ce
fait par un transfert d'énergie du cyclohexane
G 6 D 6 avant que C 6 H 12 ait eu le
décomposer, conformément au
point de vue avancé antérieurement par
M anion et Burton.
Plus récemment, Chang (42) a étudié
l'effet de l'iode sur les rendements observés
dans la radiolyse du cyclohexane, du benexcité vers
temps de
se
—
G(hydrogène) pour un
mélange cyclohexane + benzène-d6
Fig. 13.
(36).
O rendement de Hj, observé
rendement maximum de H a pri-
maire calculé.
de Schuler, Chang signale que la présence d'iode réduit les
rendements gazeux dans les deux cas (cf. paragraphe 3 é). Pour le cyclohexane, Chang trouve que pour [I 2 > 10~ 2 G(H 2 ) atteint un minimum
égal à environ 60 p. 100 de la valeur obtenue en absence d'iode**; quand
on ajoute du benzène au mélange cyclohexane + I 2 G(H 2 ) peut être réduit
davantage. Ici encore, les faits confirment l'idée d'un mécanisme de
dissipation de l'énergie auquel les molécules de I 2 n'auraient apparemment pas participé. On peut faire appel soit à un transfert d'ionisation, soit
à un transfert d'excitation pour rendre compte de la protection observée
dans le mélange cyclo-hexane-benzène ou des mélanges analogues. Le potentiel
d'ionisation du cyclohexane est de 11 eV, celui du benzène d'environ 9,2 eV
et les spectres d'absorption U. V. de ces deux substances montrent clairement que l'état excité le plus bas du cyclohexane est également beaucoup
résultats
]
,
,
(*) Le travail plus récent de Phung et Buhton montre que le chiffre de 7,3 est luimême fonction de l'énergie à laquelle les atomes H sont produits, si bien que les conclu-
sions portées par Patrick et Burton ne présentent, de ce fait, qu'une valeur qualitative.
(**) H. L. Dewhurst a obtenu un résultat similaire (communication privée).
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
42
plus élevé que celui du benzène. Ainsi, l'ionisation ou l'excitation est transférée d'un composé sur l'autre par une réaction qui peut être schématisée par
G 6 H|2 + G 6 H 6
—
:
G 6 H 12 + C 6 H(j
y
Les transferts d'ionisation et d'excitation sont loin d'être les seuls mécanismes
Williams et Hamill (26) suggèrent que la
grande affinité électronique du benzène favorise le processus de capture
possibles de transfert d'énergie.
électronique
G6H6 + e
et que la
—
>
C 6 Hr
diminution consécutive en énergie libérée dans le processus de neu-
tralisation, c'est-à-dire
C6 Hr + M +
y
C 6 H 6 + M*
permet d'interpréter, au moins partiellement, la diminution de rendements
que l'on observe (cf. paragraphe 1 c).
Dans le cas du cyclohexane (= C) + benzène (= B) Manion et Burton
ont montré que la cinétique de la réaction est convenablement représentée
par le schéma
:
C*
C
— MM-> G*
B
— AI\«-> B*
+B
G*
B*
—>
C +B
-> H
-+ H
2
2
(5)
L'expression qui en résulte pour G(H 2 ) s'écrit
G (H ) =
2
où
e c et e B
C ° Gc < Hl)
(3)
(4)
:
+ e„G„(H
2)
(3 g 2)
sont les fractions électroniques du cyclohexane et du benzène res-
les indices B et C caractérisent les rendements G(H 2 ) relatifs
aux substances pures, où /c3 /c4 sont les constantes de vitesse et N B la fraction
molaire du benzène. L'expression (3 g 2) représente les résultats dans tout
le domaine considéré; cependant, n'importe quel type d'interaction entre
molécules de cyclohexane et de benzène qui interférerait avec le rendement
pectivement,
,
H
2 cadrerait avec la même expression.
Les autres mélanges étudiés par Manion et Burton (35) comprennent
toluène + benzène, cyclohexène + benzène et cyclohexane + cyclohexène.
Les rendements G(H 2 ) et G(GH 4 ) à partir des mélanges toluène + benzène
en
:
irradiés avec des électrons de 1,5
MeV suivent la loi d'additivité (voir fig. 11
mais les rendements en G 6 H 6 (voir fig. 13) mettent clairement en évidence une protection due au toluène. Dans les mélanges cyclohexène-benzène
on peut peut-être discerner un léger effet protecteur du benzène sur le cycloet 12)
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
hexène*, cependant le rendement en Ca
cyclohexène sur
benzène. Dans
43
H traduit un eflel protecteur nel du
a
mélanges cyclohexane-cyclohexène, il
est peut-être plus correct d'attribuer l'effet protecteur apparenl «lu cyclohexane
traduit par les rendements G(H t) et GCCHJ (voir ftg. 10 et il), à un effet
le
d'interception par
le
les
cyclohexène des atonies
11 et
autres radicaux. Les ren-
dements en ethylene ont été étudiés également pour tous les mélanges;
benzène présente un effet protecteur marqué vis-à-vis du cyclohexane.
Plusieurs recherches ont été entreprises pour déterminer si
particulièrement
également
étaient
radiolyses.
Ni
dans
les
p-triphényle (26)
le
protecteur dans
effet
la
systèmes liquides
ni
(cf.
et
'A
1,26 électrons p. 100 à la
h)
les
l'anthracène (81) n'ont manifesté un
radiolyse du benzène par des électrons de t,5
à des concentrations inférieures à leurs solubilité limite,
1,125
Les scintillateurs
paragraphe
des agents protecteurs particulièrement actifs dans
efficaces
le
soit
Me Y,
respectivement
température ambiante. Par contre, une
solution saturée de m-triphényle dans
le
benzène, solution plus concentrée
(soit 7,32 électrons p. 100), montre clairement que le soluté protège le solvant.
Dans ce cas, Burton et Patrick suggèrent un mécanisme analogue à celui
de la radiolyse de la solution benzène-cyclohexane, mais, comme c'est le tri-
phényle qui a le potentiel d'excitation le plus bas, le transfert d'énergie s'effectue dans ce cas à partir du benzène.
Krenz (33) a trouvé que l'anthracène dissous dans l'hexane n'affecte pas
les rendements en
H CH ou C H mais que la quantité du produit non saturé
2,
4
2
6
(ayant à peu près la même volatilité que l'hexane) est réduite. En même temps,
spectre de l'anthracène diminue d'intensité et un nouveau spectre apparaît,
le
similaire à celui
du dianthracène.
faut signaler les résultats de Gordon et Burton (37) sur des mélanges de
Il
benzène et de benzène d 6 irradiés par des électrons de 1,5 MeV. Bien que les
résultats fournis soient assez limités, ils semblent montrer un faible effet pro-
tecteur de
G 6 H 6 sur G 6 D 6 et inversement ainsi qu'une réaction directe dans
HD dans un acte
grappes, entre C 6 H* excité et G 6 D 6 avec production de
les
primaire.
3h.
Il
— LUMINESCENCE DANS DES MÉLANGES D'HYDROCARBURES
n'est pas dans notre intention d'essayer de traiter l'ensemble du domaine
de la luminescence de façon détaillée**. Nous porterons seulement une attention rapide sur quelques cas particuliers, étudiés dans le cadre du « Radiation
Project » et qui apparaissent liés aux phénomènes rencontrés en chimie des
radiations. Les résultats seront décrits de façon qualitative. Pour des rensei(81)
Burton (M.) et Patrick (W. N.), J. Chem. Phys., 22, 1150, 1954.
Manion et Burton attribuent le faible effet observé à l'intervention de deux réactions
opposées dans leurs conséquences
(*)
:
et
C 6 H G + G 6 H 10
C 6 H 6 + C 6 H 10 *
G 6 H 6 + G 6 H|
(cf réactions 3)
C8H * + C 6H
(**) Un traitement complet en a été donné par M. Ageno dans le volume II de cette
collection.
-
y
y
6
OBSER VA TIONS ET INTERPRÉTA TIONS
11
gnements quantitatifs détaillés, le Lecteur esl
originaux. Sous L'angle
<»ù
aux articles
prié de se reporter
nous l'envisageons, le principal intérêt des résultais
en Luminescence esl qu'ils ont trait au mécanisme de transfert d'énergie dans les
Liquides.
Les solutions dans différents hydrocarbures, ou autres solvants, de certaines
substances appelées scintillateurs deviennent luminescentes quand elles sont
Irradiées (par exemple par des rayons gamma) et émettent un spectre caractéristique du scintillateur et non du solvant. Cette situation se présente même
quand le scintillateur correspond à une concentration inférieur à 0,01 p. 100
en poids, c'est-à-dire, quand, pratiquement, toute l'énergie est dissipée dans
le solvant et non dans
le soluté. Pour expliquer
un tel phénomène on a
fait
appel à toutes sortes
de processus de transfert d'énergie
:
transfert
d'excitation d'une molécule excitée
P
P
)le%X
mole%X
€(S 2 )
(ù)
ic)
(a)
Fig.
14.
mélange
vers
de
I-intensité
la
du solvant
molécule
de
soluté qui a diffusé jus-
qu'à elle, transfert d'un
— Luminescence induite par rayons y dans un
ternaire;
une
photon virtuel d'une mo-
luminescence portée
lécule de solvant à toute
en fonction de la concentration.
une série d'autres molé-
contenant des concentrations variables de X.
(b) S 2 contenant des concentrations variables de X.
(c) Solution contenant des fractions électroniques variables de
Sj et S 2 et /) moles pour 100 de X.
(a) S,
cules de solvant et fina-
lement au
scintillateur,
fluorescence sensibilisée
par un transfert à longue distance, capture d'électrons par
le
avec formation d'un ion négatif qui serait impliqué dans
phénomène de
luminescence, action préférentielle des électrons
de
le
scintillateur
sous-excitation
sur
le
Les deux dernières hypothèses peuvent être rejetées sur la
base d'observations effectuées par Lipsky (81 a) selon lesquelles certains paramètres cinétiques de la réaction possèdent exactement les mêmes valeurs
numériques que l'irradiation soit conduite avec les rayons y de 60 Go ou la
scintillateur.
lumière ultra-violette.
Une loi qualitative particulièrement intéressante apparaît pour un mélange
contenant 2 solvants S x et S 2 un scintillateur X et un extincteur de fluorescence Q. La figure 14 représente une relation schématique, valable en absence
,
de corps Q. L'augmentation de luminescence dans un mélange ternaire, audessus de ce à quoi on est en droit de s'attendre en appliquant une simple loi
d'additivité, a été prédite pour le premier mélange étudié (S x
S 2 = benzène,
chimie des radiations
(cf.
paragraphe 3 g), suivant laquelle
transfère son énergie d'excitation au benzène
sr + s 2
(81 a)
= cyclohexane,
X = p-triphényle) à partir de l'interprétation avancée en
Lipsky (S.), travail non publié.
—>
Si
le
cyclohexane
:
+ sï
(1)
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
i;>
Étanl donné que, dans ce cas, le benzène apparaîl comme un solvant plus
c
pour le scintillateur, le type de courbe représenté sur la ligure
efficace
I
avait été prévu. Cependant
c'est-à-dire
il
i
faut noter que le phénomène d'extinction Interne
:
s*
énergie cinétique
2 Sa
s.,
(Upend de la concentration. Aussi le résultai représenté ne suffit pus à prouver
L'existence de
la
réaction (1).
Les résultats obtenus en présence d'un extincteur de fluorescence
et
ras-
semblés sur la figure 15, sont direc
lenient liés au mécanisme. Le mini-
mum obtenu pour une faible conde S a
centration
a
été étudié
particulier pour le système S,
en
cy-
benzène, X — poxygène. La proQ
fondeur du minimum est fonction
clohexane, S a
triphényle,
de
la
concentration en extincteur
de fluorescence (79). PourQ
gène,
le
minimum
est
oxy-
au moins
au moins aussi
des ordonnées
(c'est-à-dire si 2 moles p. 100 benzène) que sur la courbe donnée
aussi accentué et
proche
dans
la
trouve
de
l'axe
publication
également
On
minimum
initiale*.
un
quand S a est du toluène (82) ou X
du diphénylbutadiène(82)ou quand
Q est du bromure de phényle (83).
Pour expliquer ces résultats on a
—
1").
Influence d'un agent extincteur sur
luminescence induite par rayons y dans
un système contenant deux solvants (S, et S.)
et un p. cent molaire fixe du scintillateur.
Fig.
la
Courbe supérieure, sans extincteur; courbe
infé-
rieure, présence d'un extincteur.
le solproposé l'image suivante
vant S 2 peut toujours recevoir aisément de l'énergie par la réaction (1), mais
la facilité avec laquelle cette énergie est transférée au scintillateur dépend
:
de la concentration S 2 (ici on ne donne pas davantage de détails à ce sujet).
Ainsi, une molécule isolée S 2
,
si elle
est présente en faible concentration, peut-
être désexcitée avant de céder son énergie au scintillateur.
Un certain nombre d'autres résultats ont été obtenus dans ce laboratoire,
mettant en évidence un comportement particulier quand, dans un mélange,
un des constituants est présent en faible concentration. Un très intéressant
exemple d'un comportement analogue est aussi fourni par le travail de Bouby
et Chapiro sur la production de radicaux libres dans la radiolyse d'un mélange
d'acétate de méthyle et de benzène (cf. paragraphe 9).
(*) Des résultats récents de Lipsky ont maintenant établi que le minimum se place a
Si 1 vol p. 100 benzène (Si p. 100 électrons) dans une solution saturée en air et contenant
5,08. 10 -a moles p. 100 de /;-triphényle clans le cyclohexane et. le benzène.
(82) Berry (P. J.), travail non publié.
(83) Nosworthy (J. M.), travail non publié.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
46
31.
HYDROCARBURES SATURÉS D'OXYGÈNE
Manion et Burton (35) ont trouvé que des traces d'oxygène, de l'ordre de
celles qui
peuvent éventuellement se dissoudre lors du transfert d'un liquide,
G déterminées dans la radio-
n'ont pas d'effet perceptible sur les valeurs de
lyse du benzène*. Par contre, les résultats de Allsopp (75) sur l'irradiation
du benzène dans l'ultra-violet (de même que les résultats photochimiques
de Schenck (76)) et l'extinction de luminescence provoquée par l'oxygène
(cf. paragraphe 3 h), ont conduit à penser que des solutions plus concentrées
en oxygène devaient affecter la nature et la quantité des produits de radiolyse.
Bach (84, 85) et ses collaborateurs ont cherché à maintenir des concen-
trations stationnaires d'oxygène au cours de la radiolyse de différents hydro-
carbures* irradiés par des rayons
800-900 keV;
les résultats les
X de 70-85 kV,
llilx
ou par des électrons de
plus reproductibles ont été obtenus avec les
layons X. En général les irradiations ont été conduites dans un domaine de
doses de 10 30 à 10 21 eV.cm- 3
eux-mêmes
initiaux sont
;
indiquent que les produits
rayonnement. Le tableau XI ras-
les résultats obtenus
affectés par le
semble les rendements obtenus pour 100 eV, calculés à partir des conditions
d'irradiation. Bach note que les produits formés peuvent résulter
initiales
de l'interaction de l'oxygène, soit avec les radicaux libres primaires, soit avec
molécules excitées. Elle suggère que les hydroperoxydes sont formés par
les
le
second mécanisme, c'est-à-dire
G 6 H 12 +
Tableau XI.
:
(G 6
2
H
12
2
C 6 H n OOH.
)*
—
Quantités de produits oxydés formés pour 100 eV par irradiation d'hydrocarbures saturés d'oxygène avec des rayons
de 70-85 kV mA \ ou des électrons de 800900 keV.
(d'après Bach et coll. (84, 85)).
X
n-Heptane
RiOORg
i
-Octane
Cyclo-
hexane
Toluène
Benzène
0,2-0,3
1,3
0,7
0,3
2,3
0,2
1,2
1
0,4
0,2
Peroxyde total
Composés carbonylés
2,2
1,2
0,3
3,7
2
1,2
1,8
1,2
Acides
Total
0,4
6,1
0,6
4,1
0,6
0,2
2,0
ROOH
H 0,
2
0,2-0,3
0,5
0,45
1
Voir cependant le tableau X pour un effet possible de l'air sur le G u déterminé par
technique du 1)1 M 'II dans l'irradiation du benzène.
(<S4) Bach (X. A.), Sbornik Rabot Radiatsionnoi Khimi, Akad. Nauk S. S. S. H., 1, 145,
1955; Traduction anglaise
Symposium on Radiation Chemistry, Acad, Sci. USSR,
1, 119, 1955. Cet article résume le travail expérimental de R. S. Rychkov, X. I. Popov
et M. M. Flisky.
(<S5) Bach (X. A.) et Popov (X. I.), Sbornik Rabot Radiatsionnoi Khimi, Akad. Nauk
S. S. S. R., 1, 156, 1955; Traduction anglaise
Symposium on Radiation Chemistry,
Acad. Sci. USSR, 1, 129, 1955.
(*) Excepté dans le cas du cyclohexane qui a été irradié en tube scellé.
(*)
la
:
:
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
47
— HALOGENURES
4.
Le tableau \li rassemble Les résultats quantitatifs relatifs aux rendements
obtenus dans la radiolyse d'halogénures d'alcoyles purs. Liquides. Sue el SaeLANDonl montré que, dans la radiolyse d'iodures par les du radium, des doutons rapides ou des neutrons rapides, les rendements globaux sonl propor[3
tionnels à
la
dose (86). Cette proportionnalité a également élé observée dans
des expériences effectuées en présence d'oxygène où
les
échantillons étaient
X de. Longueur d'onde moyenne 0,95 ou 4 Â (c'est-
irradiés soit avec des rayons
à-dire d'environ 310 ou 73 keV respectivement) soit avec les rayons a de
Po
ou de Ra (87). De même que Zimine et Egorova (voir tableau XII) l'ont
observé un peu plus tard, Lefort, Bonet-Maury et Frilley (87) ont trouvé
que Les rendements en iode étaient indépendants de la température dans le
domaine
— 196° à 18
°C.
Hornig et Willard (91) ont de même trouvé que la vitesse de production
d'iode dans la radiolyse de l'iodure d'éthyle par les rayons y de 60 Go était indé-
pendante de la température dans le domaine
— 78° à + 108 Ces auteurs
— 190 °G ont
°C.
ont aussi étudié différents iodures d'alcoyles cristallins à
et
comparé les vitesses de production d'iode à l'état cristallisé et à l'état liquide
~ 190 °
à 25°. Les rapports des vitesses
sont les suivants
GH I
0,25
C 2 H5 I
0,20
3
i
-G H I
3
n-C H
4
7
0,11
9 I
1,1
:
—
190° la
Pour l'iodure d'éthyle et l'iodure d'isobutyle à l'état vitreux à
environ
fois
obtenue
était
2
la
vitesse
observée
pour
vitesse
les cristaux.
Hornig et Willard en ont conclu que le comportement de l'état solide dépend
de l'orientation moléculaire.
Firestone et Willard (91) ont suivi la production de Br 2 dans la radiolyse de CGl 3 Br par les rayons y de 60 Co en mesurant le point de fusion (- 5,6 °G)
et le point de transition à l'état solide
discontinuité.
(
—
35,5°). Ils n'ont
observé aucune
La vitesse de production de Br 2 était indépendante de la tem-
pérature en dessous de
—
78°, mais au-dessus elle augmentait avec une énergie
d'activation apparente d'environ 2 kcal. mole- 1
.
(86) Sue (P.) et Saeland (E.), Bull. Soc. Chim. (France), 437, 1949.
(87) Lefort (M.), Bonet-Maury (P.) et Frilley (M.), Compt. rend., 226, 1904, 104S.
(91) Cf. Willard (J. E.), Ann. Rev. Phys. Chem., 6, 141, 1955.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
18
Valeurs de
XII.
I'\i:u;ai:
(>
obtenues dans
RAYONNEMENT
COMPOSÉ
rayons y de
(1,3
NX
H„
CH,
c,
-M"
Bel.
88
3,3
2,7
88, 89
Co
MeV)
1,9
rayons [i de U C
*
d' irradiation.
1/2X,
[odure de méthyle électrons de 1,5 MeV
rayons X de 120 k\"
(CH 8 I)
80
radiolyse de quelques halogénures sous
la
différentes conditions
(),()()
0,98
89 d
0,44
(50 keV)
3,6
[odure
de méthylène
(CM,i,)
Tétrachlorure
de carbone
électrons de 1,6 MeV
élecl ions
de 410 keV
2,5
88
1,92 e '/
90
0,28 e
90
(CCI,)
Tétrabromure
électrons de 410 keV
de carbone
(CBr4 )
Bromure d'éthvle
(C 2
H Br)
B
électrons de 1,6 MeV 0,2
rayons X de 1,6 MeV
électrons de 1,6 MeV 4,1
0,6-0,9
2,0 e
88
88
88
rayons X de 1,6 MeV
4,1 e
88
17,8 e
88
88
Iodure d'éthyle
(C 2 H 5 I)
Chlorure
d'éthylène
(C a 4 Cl 2 )
H
Bromure
électrons de 1,6 MeV
d'éthylène
(C 2 4 Br 2 )
H
rayons
0,5
X de 1,6 MeV 0,0
Hexachloroét liane électrons de 410 keV 0,14e>9
(C 2 G1 6 )
1
Iodure
de /î-propvle
(C 3 H 7 i/
électrons de 1,6 MeV
iromobenzène
rayons X de 1,6 MeV
(C 6
H Br)
90
88
2,5
88
2,0 e
6
Hexachlorobenzènc
électrons de 410 keV
90
0,04 e
(C 6 C1 6 )
—
(a) -M désigne la disparition du produit de départ.
(b) Les rayons X donnent les mêmes
rendements relatifs que les rayons y de 60 Co pour de faibles débits.
(c) Rendement qui
suppose g( -I a = 4,1 pour l'iodure d'étbyle décomposé par les rayons X.
(d) Recalculé
)
—
—
—
—
=
> Fe +++ )
sur la base de G(Fe ++
(e) Les techniques
15,6 pour le dosimètre de Fricke.
décrites dans ce travail ne garantissent pas que l'oxygène est complètement éliminé; voir
paragraphe é-b pour l'etTet de l'oxygène dans la radiolyse de CHG1,. En général, les différents
expérimentateurs donnent des valeurs moyennes de G en négligeant le fait que initialement, de
nombreuses études ont conduit à des valeurs de G beaucoup plus faibles que celles obtenues
dans des irradiations prolongées ou à de fortes intensités. Les auteurs donnent aussi les résul- 187 °C.
tats d'irradiation pour des rayons y et a.
(f) Température
(g) Indépendant de
—
la température
:
:
—
- 187°G et + 18 °C.
Schuler(B. H.) et Hamill (W. H.), ./. Ain. Chem. Soc, 74, 6171, 1952.
Petrey (R. C.) et Schuler (R. H.), J. Am. Chem. Soc, 75, 3796, 1953.
(90) Zimine (A. V.) et Egorova (Z. S.), Sbornik Rabot Radiatsionnoi Khimi, Akad. Nauk
S. S. S. R., 1, 241, 1955. Traduction anglaise
Symposium on Radiation Chemistry,
Acad. Sei. r.S.S.H., 1, 207, 1955.
(88)
(89)
:
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
4a.
19
— PRODUCTION DE RADICAUX LIBRES
DANS LES HALOGÉNURES D'ALCOYLE
Gevantman e1 Williams ont étudié la radiolyse de quelques iodures d'alcomme Intercepteur (52). Les radicaux
coyle en présence d'iode radioactif
produits dans la radiolyse réagissent avec le radio-iode pour donner des iodures
d'alcoyle radioactifs qui peuvent être séparés par la technique des entraîneurs, permettant ainsi une estimai ion du
nombre relatif de radicaux libres
primaires formés à partir de chaque substance. Le tableau XIII résume
pour
résultats de ces auteurs
les
halogénures d'alcoyle liquides
et
les
gazeux.
Ces résultats montrent clairement que la rupture initiale peut se faire sur une
liaison autre que la liaison G - 1, mais ne permettent pas de déterminer si
l'iodure de méthylène radioactif se forme à partir d'un CH 2 primaire, de CH 2 I
ou des deux.
Tableau XIII.
Radicaux libres produits <l<ins la radiolyse d'iodures d'alcoyles <>l évalués
par interception avec du radio-iode.
(d'après Gevantmw et \\ illiams (52)).
IODURE
tïAl
RAYONNEMENT
PHYSIQUE
POURCENTAGE DE L' ACTIVITÉ TOTALE DE
RADIO-IODE PORTÉ PAR L'ENTRAINE UR
mentionné (valeurs moyennes)
CH
Méthyle
Co
électrons de 2 MeV
Gaz
Ethyle
60
Liquide
Liquide
60
Co ou
X de 2 MeV
rayons X de 2 MeV
3I
C2 H5 I
66
15
82
5
15
77
30
60
i-C 3
H
7I
n-C 3 H 7 I n-C,H 9 I CH2I2
a
19
—
—
13
4
2
1
2
3
4
2
1
rayons
Gaz
ou de 50 KV m;u
7
6
—
80
5
de 50 KV mai
16
6
8
6
6
Co
14
9
—
58
7
70
—
rayons X de 50 KV maI
10
1
2
2
72
8
n-Propyle Liquide
n-Butyle
«°Go
rayons X
Gaz
60
Liquide
Gaz
(a) Les tirets indiquent que l'entraîneur correspondant n'a pas été employé.
4b.
— CHLOROFORME EN PRÉSENCE D'OXYGÈNE
Ce système, irradié par les rayons y de 60 Co, a été étudié par Schulte, Suttle
et Wilhelm (92). Bien que les valeurs données permettent de calculer les
doses et que les produits de la radiolyse aient été estimés quantitativement,
aucune valeur de G n'est fournie dans l'article. Les auteurs pensent que la
quantité et la nature des produits formés prouvent l'intervention d'une réaction en chaîne mettant en jeu l'oxygène. Ils suggèrent la formation de deux
produits intermédiaires les peroxydes CCl 3 OOH et CG1 2 2 Celle de peroxydes
:
(92)
.
Schulte (J. W.), Suttle (J. F.) et Wilhelm (H.), J- Am. Chem. Soc, 75, 2222, 1953.
HAISSINSKY.
III.
4
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
50
à plus faible teneur en chlore est considérée comme improbable. Les auteurs
posent comme étape chimique primaire la réaction
CHCI3
4c.
-**-> CHC1 2
:
+ Cl.
— MÉLANGE D'HALOGÉNURES
Les mélanges CG1 4 + C 2 G1 6 et GC1 4 + GBr4 ont été étudiés par Zimine et
Egorova (90). Les études ne présentent pas d'analogie avec les recherches sur
de protection (cf. paragraphe 3 g). Les mélanges CC1 4 + C 2 C1 6 dans les
20° avec électrons de 410 keV et
rapports 10/1 et 2/1 ont été irradiés à
ont donné G(C1 2 ) = 0,96 et 0,80 respectivement, écart qui n'est vraiseml'effet
—
blablement pas significatif à cause des erreurs expérimentales possibles. Dans
le cas des mélanges chlorure + bromure (irradiés par des particules a) les
auteurs ont montré que l'interprétation des rendements obtenus est compliquée
par l'intervention de réactions secondaires qui comportent une interaction
entre chlore atomique et bromure.
Des études où le tétrachlorure de carbone et l'iodure d'éthyle (de même que
cyclohexane et CS 2 ) subissaient une irradiation interne par du radio-iode
131
I) ont été signalées (93). Mais aucune valeur de G n'a été publiée.
(
le
5.
ALCOOLS
L'étude systématique la plus marquante, effectuée jusqu'ici en chimie des
radiations sur des produits de radiolyse à la fois liquides et gazeux, est peutêtre celle
due à Me Donell et Newton (94) qui a porté sur 10 alcools ali-
phatiques. Les auteurs ont bombardé leurs échantillons avec des ions He + +
de 28 MeV à environ 2(jiamp. h., c'est-à-dire de manière à obtenir 2-3 p. 100
de décomposition. Les valeurs de
G données, et reproduites seulement en
partie dans le tableau XIV, sont basées sur les rendements obtenus après des
irradiations de cette importance et négligent la faible contribution apportée
par des réactions secondaires. Bien que les auteurs attirent l'attention sur
quelques désaccords de stoechiométrie (en particulier dans le cas des alcools
butyliques), on est beaucoup plus frappé par la quantité des résultats dignes
de foi que Me Donell et Newton ont obtenus.
Les conclusions générales qu'on peut tirer de leur travail sont que les prindes
cipaux produits gazeux consistent en
2 et en hydrocarbures (c'est-à-dire
H
(93)
Miller (\V. M.), Rack (E. P.), Burreli (E.) et Trumbore (C. N.), J. Chem. Phys.,
23, 2457, 1955.
(94)
Me Donell (W. R.) et Newton (A. S.), J. Am. Chem. Soc, 76, 4651, 1954.
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
produits
réduits
)
el
oxydés
Les produits
51
que le (i (de réduction totale) est compris entre 7 el .s.
»
sont
suivants
les
:
Alcools primaires
Aldéhydes
Alcools secondaires
Aldéhydes, glycols
Alcools tertiaires
faibles quantités
el
glycols
<le
el
cétones
glycols mais surtout des
cétones.
Tabu u \iy.
Rendements en produits de radiolyse lors du bombardement de
(drools par des ions He
de 28 MeV.
(d'après Me >onell et Newton (9 1").
différents
I
Méthyle
II,
3,5
CO
0,23
0,36
Cil,
C..M,
CI
C,H
C,H 8
I.
0,01
l
éthyle
3,5
0,11
0,43
0.17
0.17
11,00:5
fl
o,o:5
n-propyle
i-pro-
n-bii-
i-bu-
sec-
tert-
n-oc-
pyle
tyle
tyie
buli/lc
butyle
tyle
cyle
2,8
2,7
2,0
1,2
3,5
0,OS
3,0
0,07
0,06
2,8
0,10
0,07
0,30
0,54
0,14
0,14
0,10
0,00
0,37
0,38
0,86
0,05
0,11
0.0;,
0.0:»
3,5
0,01
1,6
0,02
0,03
0,02
1,1
0.02
0,17
0,27
0,09
0,10
Acide
H
2
Aldéhyde
4,5
0,01
0,9
1,4
4,5
0,01
0,8
2,2
0,21
0,46
<»,!
1
0.02
0,017
0,81
0,65
0,04
4,4
0,005
4,3
0,01
0,09
0,9
0,06
0,16
4,0
0,05
0,6
1,5
1,7
2,1
Cétone
O.O!)
0,52
0,02
0,02
2,0
dé
0.02
0,0.")
0,01
0,01
0.01
0,02
0,03
0,18
0,22
3,9
0,01
L-C4H10
Gaz total
0,(K5r»
0,09
0,12
total
Q-C4H10
0,0!)
/>
0,07
0,01
4,5
0,11
3,5
0,26
0,003
0,6
1,0
1,8
1,1
2,8
3,7
0,01
0,4
0,7
3,6
0,01
0,3
0,6
0,5
1,0
Glycol
—total
M"
(a)
1,6
5,8
1,0
4,7
1,5
6,1
0,04
4,7
4,2
Tous les résultats donnés par Me Donell et
— (b) Substance
0,9
4,8
0,2
6,1
0,1
4,1
Newton ne figurent pas dans ce tableau.
initiale transformée de façon définitive. Calcul effectué par Tolbert etLEMMON
(1).
Les glycols a prédominent en général. En se basant sur la nature des produits formés, les auteurs concluent que la coupure de liaison a lieu surtout
sur le carbone du carbinol.
Quelques résultats relatifs à la production de radicaux libres à partir d'alcools irradiés en présence d'air figurent dans le tableau X.
5 a.
— METHANOL
L'effet de la nature du rayonnement sur les rendements dans la radiolyse
du methanol est résumé par le tableau XV. Il apparaît que cet effet est faible
mais non nul. D'après McDonell et Gordon (95) les rendements sont tous
des fonctions linéaires de la dose (pour une énergie dissipée de 3.0. 10 20 eV.l- 1
mn- 1 ). Ces auteurs suggèrent que la formation de HCHO peut impliquer des
.
(95)
McDonell (\V. R.) et Gordon (S.), J. Chem. Phys., 23, 208, 1955.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
:>2
réactions qui auraient lieu seulement dans les grappes,
le
long des colonnes
chimiquement actives qui difseraient
responsables
de la formation du glycol.
grappes
hors
des
fusent
d'ionisation primaire, tandis que les espèces
Tableai
R VYONNEMEN
W
Valeurs de
Y
1
60
IL
4,0
0,16
0,24
Cil,
HCHO
60
Go
CO
Co
P"C(49keV)
He++(28 MeV)
5,4
0,11
0,54
5,3
3,46
0,23
0,36
1,67
y
0,1
1,8
1,3
3,0
(;,n,(OH),
Références
G dans la radiolyse de l'alcool méthyliqm
3,0
1,74
97
96
95
94
McDonell (98) a aussi irradié aux rayons y de 60 Co des solutions aqueuses
de methanol;
il
a obtenu des résultats qui sont partiellement transcrits sur
la figure 16. Il faut noter que la production de formaldehyde, contrairement à
de l'éthylène-glycol, est directement proportionnelle à la concentration
celle
CHgOH dans la solution. On peut évidemment avancer l'interprétation
de
que CH 2
est produit
par des réactions qui
ne font intervenir que GH 3 OH (par exemple
une
décomposition
tandis que
avec
réarrangement),
glycol pourrait être formé, au
le
moins en partie, par des mécanismes radioù la radiolyse primaire de l'eau
pourrait jouer un rôle. McDonell explique
ces résultats par la suite des réactions
calaires
:
_mm-> h + OH
H
H + GH3OH
H + GH OH
OH + CH OH
H + CH OH
G H (OH)
2
Fig.
10.
— Rendements pour des
mélanges eau-méthanol irradiés
aux rayons y de 60 Co (104).
m.
d. = pour cent de densité moléculaire d'un methanol en solution
aqueuse, relatif à celle du methanol
%
2
3
2
et il conclut
2
4
2
que les résultats confirment le
point de vue de
pur.
2
2
Me Donnell et Gordon
d'après lequel, la formation de formaldehyde
serait localisée à l'intérieur des grappes.
Meshitsuka et coll. (99) ont étudié la composition de l'hydrogène produit
par l'irradiation de CH 3 OD avec les rayons y de 60 Co. Les résultats observés
et les valeurs calculées à partir de l'hypothèse que les ruptures de liaison ainsi
que les réactions secondaires sont distribuées de façon uniforme sont les suivants
:
(96)
(97)
Meshitsuka (G.), à paraître.
Skraba (W. J.), Burr (J. G.) et Hess (D. N.), J. Chem. Phys., 2i, 1296, 1953
(98)
(99)
Meshitsuka (G.), Ouchi (K.), Hirota (K.) et Kusumoto (G.), ./. Chem. Soc. Japan
McDonell (W. R.), J. Chem. Phys., 23, 208, 1955.
78, 129, 1957.
,
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
',,
53
de l'hydrogène total
obsen é
calculé
un
36
60
56
38
1),
l
(i
IL
Les explications qui peuvent traduire quantitativement
suivantes
a.
caux
ni les
les
résultats sont les
:
coupures initiales de liaisons ni
libres qui en résultent
les
réactions secondaires des radi-
ne présentent une distribution tout à
fait
uni-
forme.
/>.
la
radiolyse peut
comporter, au stade primaire, un réarrangement en
molécules finales à côté d'une décomposition en radicaux libres.
Une étude
du methanol (voir égamécanisme de la réaction (96).
directe des radicaux libres, produits dans la radiolyse
lement
le
tableau X), aiderait à élucider
5
b.
le
— ÉTHANOL PUR ET EN MÉLANGE
Newton et McDonell (100) ont commencé
à clarifier
le
mécanisme de
radiolyse deFéthanol en étudiant à la fois les effets de la durée des irradiations
et de la présence de corps ajoutés sur la nature des produits formés. Le tableau
XVI rassemble leurs résultats. De même que Bach et Sorokine (101) ils ont
trouvé que
le
rendement en méthane était indépendant de la dose. Cepen-
dant, les résultats de Newton et
McDonell portent sur des doses six fois
plus fortes que celles utilisées par Bach et Sorokine. Les expériences de ces
derniers ont aussi
montré que pour des électrons de 0,8
— 0,9 MeV
et des
énergies absorbées inférieures à 10 21 eV cm- 3 , la radiolyse conduit à des rende-
ments en H 2
,
H 0, aldéhyde et CO qui sont à peu près constants. D'après
H est assez tentant de conclure,
2
l'observation de produits tels que CO et C 2
4 , il
comme l'ont fait Newton et McDonell ainsi que Bach et Sorokine, que
des processus de réorganisation et de rupture de liaisons interviennent à la
fois.
D'après les effets obtenus en ajoutant certaines substances à la solution
(tableau XVI), il semble bien qu'une partie au moins de l'hydrogène provient
d'un mécanisme radicalaire, de même que certains des hydrocarbures.
Les résultats de Bach et Sorokine (101) sur l'alcool éthylique transcrits
sur le tableau XVII sont relatifs à des radiolyses par électrons et rayons X.
Les différences numériques entre ces rendements et ceux obtenus par Newton
et McDonel (cf. tableau XVI) doivent, peut-être, être attribuées à la nature
différente des sources de rayonnements. Une remarque intéressante a été
faite
par Bach et Sorokine sur l'effet de température dans
la
production
d'aldéhyde par les rayons X. La valeur de G trouvée pour la formation d'al(100) Newton (A. S.) et Me Donnell (W. R.), J. Am. Chem. Soc, 78, 4554, 1956.
(101) Bach (N. A.) et Sorokine (Yu. L), Sbornik Rabot Radiatsionnoi Khimi, Akad. Nauk.
Symposium on Radiation Chemistry,
S. S. S. R., 1, 163, 1955; Traduction anglaise
Acad. Sci. U. S. S. R., 1, 135, 1955.
:
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
54
Influence de la quantité d'énergie absorbée sur les valeurs de G obtenues
Tableau XVI.
dans la radiolyse de l'éthanol et de ses mélanges, bombardés par des ions He ++ de 28 MeV
-
d'après
Newton et McDonell (100).
éthanol
éthanol
+
1%
0,72%
CH CHO
3
Énergie absorbée
(en 10-- eV. cm- 3 )
0,029
4,10
0,3
3,8
G(CO)
(1.093
G(CH4)
0,43
0,22
0,18
3,00
1,40
9,3
4,92
0,097
0,43
0,20
0,18
G(H
i
GiCJI.)
(.(Cil,)
G (groupements carbonyle)
(i
i
glycols -a)
G (produits réduits) ( a )
(i
<
produits gazeux)
2,6
1,33
8,8
4,62
0,6
3,46
0,11
0,43
0,17
0,17
0,028
3,52
0,090
0,40
0,20
0,16
0,10
0,40
1,33
8,18
1,07
7,67 b
2,2
1,3
8,19
4,34
Hexcne-1
désignent les corps qui ne contiennent pas d'oxygène.
(a) Les produits n réduits
valeur exclut la production d'hexane.
m,;»!)
2, S3
11.211
0,17
2,20
—
(b) Cette
déhyde est de 0,8 en l'absence d'oxygène et n'est pas affectée par la température dans le domaine 0-50° C, tandis qu'elle augmente de 1,9 à 2, S en la
présence d'oxygène. Cet effet d'oxygène semble clairement montrer qu'un
mécanisme radicalaire intervient dans la formation de tous les produits de
radiolyse que ces auteurs mentionnent. Cependant l'augmentation du rendement en H 2 en présence d'oxygène, est plutôt surprenante et n'est pas possible à expliquer par des mécanismes radicalaires. A moins que l'oxygène,
par sa seule présence, favorise un processus de réorganisation initiale, au stade
primaire, il est difficile d'expliquer un tel résultat. Cette éventualité n'a pas
été examinée dans le travail cité, cependant elle mérite d'être analysée plus
,
en détail.
Burr (102) a étudié l'échange entre l'hydrogène gazeux et l'hydrogène de
léthanol irradié par les rayons y de 60 Co à raison de 10 23 eV environ (c'est-à-dire
de l'ordre de 4 kcal) par mole d'éthanol. Le tritium était utilisé comme indicateur.
Avec des pressions
partielles
d'hydrogène allant jusqu'à une atmo-
sphère, G (échange d'atomes H) était d'environ 0,1. On peut expliquer ce résul-
admettant soit que les radicaux du type C 2 H 4 OH ne réagissent pas
efficacement avec H 2 mais qu'ils réagissent avec les molécules d'éthanol
avoisinantes quand ils sont encore très « chauds », soit qu'ils sont produits en
tat en
,
très faible quantité.
Dans une publication
ultérieure,
Burr (103) a comparé les rendements
d'hydrogène produit par la radiolyse de divers éthanols (tableau XVIII). Il
est remarquable de constater que le G (hydrogène total) baisse notablement
quand les atomes D se trouvent sur l'atome C du carbinol et (b) que le contenu
en deuterium du produit formé à partir de
(102)
(103)
Burr (J. G.), ./. Chem. Phys., 25, 587, 1956.
Burr (.1. G.), ./. Am. Chem. Soc., 79, 751, 1957.
CH CH OD est étonnamment
3
2
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
Tableai
Effets de l'oxygène sur les valeurs des
éthylique.
XVII.
)'après
I
1
1
1
\<
m:si \.
\
de
0,8
0,9
d'oxygèn
I
electrons
MfV
Sorokine
el
ii
i
rayons X
de
::.
80 kV„, 0X
|
55
G dans la radiolyse de l'alcool
loi ).
EN PRÉS! \<
electrons
de
0,8
0,9MeV
i»'<p\ voèn]
i
a
rayons X
de
NO kVma,
75
Produits formés
ll.o
2,1
1,2
11.
6,0
0,3
0,2
6,0
0,2
CO
CM,
Aldéhyde
0,1
0,8
1
6,6
12,0
6,5
11,1
1,8
1,1
0,9
o,7
2,1
2,1
Peroxj de
Acide
0,9
1,8
1,5
CO..
0,1
11,3
0,10
Absorption d '()._,
2,1
1
1,0
.
en Les auteurs signalenl que dans ce travail les rendements dépendent fortement dcl'intensité,
dépendance vraisemblablement due à la difficulté de maintenir eonstante aux intensités élevées la concentration en oxygène dans le liquide.
élevé.
A partir des résultats transcrits sur le tableau XVIII, et de son interpré-
tation de certains spectres de masse, Burr conclut que la plupart des atomes
produits initialement à partir de C 2
binol (cf.
H
H OH proviennent de l'atome C du car5
McDonell et Newton (104). Il conclut également d'après la teneur
en deuterium des différents produits hydrogénés que la formation d'hydrogène
due uniquement à un mécanisme
non moléculaire ». Il est difficile de
l'effet oxygène décrit par Bach et
Sorokine (101). Cependant, d'après l'interprétation de Burr, le radical
C 2 H 4 OH serait un intermédiaire à durée de vie relativement longue dans la
suite de réactions qui conduit au glycol-a (cf. tableau XVI).
est
«
concilier cette
dernière conclusion avec
Tableau XVIII.
— Rendement en hydrogène dans
par les rayons y de
Éthanol
CH CH OH
CD CH OH
3
2
3
2
CH,GD OH
2
CH CH OD
GD CD OD
104)
3
2
3
2
,i0
la radiolyse de divers éthanols irradiés
Co, d'après Burr (103).
G (hydrogène total)
% de D dans l'hydrogène formé
3,66
3,90
2,81
3,67
2,98
4,27
42,0
34,2
93-95
Sheppard (G. V.) et Burton (V. L.), ./. Am. Chem. Soc., 68, 1636, 1946.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
56
— ACIDES
6.
Bien que beaucoup d'études d'un caractère phénoménologique aient été
effectuées sur la radiolyse de différents types d'acides gras solides (et autres
acides organiques) par des particules a (104-107) et des deutons (104-106)
et également sur la radiolyse de l'acide acétique gazeux (106) par des rayons a,
on a publié relativement peu de travaux sur les acides gras liquides à l'état
pur. En général, pour les solides, la decarboxylation qui conduit à un hydro-
carbure et la déshydrogénation qui conduit à un acide non saturé, constituent
les principales réactions
observées.
De l'oxyde de carbone et de l'eau sont
produits en faible quantité.
6 a.
— ACIDE ACÉTIQUE
Le tableau XIX fournit une comparaison de plusieurs études effectuées sur
les
produits de radiolyse de l'acide acétique liquide. Les résultats obtenus
avec différentes sources de rayonnement ne présentent qu'un accord qualitatif
:
montrent que G0 2 est le principal produit gazeux. Récemment, Newton (108)
a analysé soigneusement par le réactif de Fischer la fraction liquide des produits formés et il a établi que, dans ses conditions de travail, G(H 2 0) = 2,15*.
ils
Tableau XIX. — Valeurs
Rayonnement
Gaz total
He + + de 27 MeV
a de Rn (6 MeV)
Rayons X de 70-85
V ax
lU
5,4
de
C,
dans
la
radiolyse
co.
CO
H
4,0
2,8
0,4
0,5
0,52
2,4
2
CH
de
l'acide
acétique
liquide.
4
C 2 H„ Acétone
Réf.
1,38
0,85
109, 110,
1
107
0,9
0,45
111
(105) Honig (R. H.), Science, 104, 27, 1940.
(100) Rreger (I. V.), J. Phys. Colloid Chem., 52, 551, 1948.
(107) Whitehead (W. L.), Goodman (C.) et Breger (I. V.), ./. Chim. Phys., 48, 184,
1951.
(108) Newton (A. S.), J. Chem. Phys., sous presse.
(*) En se basant sur ses propres résultats, Newton a exprimé l'opinion que les faibles
quantités d'eau signalées antérieurement dans la radiolyse des acide aliphaliques de bas
poids moléculaire provenaient peut-être du fait que les expérimentateurs recherchaient
l'eau produite plutôt dans la phase vapeur que dans la phase liquide.
(109) Newton (A. S.), Univ. of Calif. Radn. Lab., Chem. Diu. Quarterly Report UCRL2455 (mars 1954).
(110) Newton (A. S.), Univ. of Calif. Radn. Lab., Medical and Health Physics Quarterly
Report UCRL-2605, 28 (mai 1954).
RADÏOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
57
Bach et Saraéva (ill) Interprètent leurs résultats sur la base de dissociations
primaires conduisant aux radicaux
GH CO, CH
:
3
3,
Oïl
processus possibles suivants
et
COOH. Os auteurs
décomposition condul
sant à la formation de radicaux CH 3 COO ou d'atomes 11, réorganisation de
CH3COOH ou de (GHjCOOH), conduisant aux molécules finales par une réacn'ont
pas envisagé
tion élémentaire
Les
:
unique (112).
Garrison et coll. (113) ont étudié les effets de bombardement par des par
ticules lourdes (lie
de 35 MeVet 1) de 18 MeV) de solutions aqueuses d'acide
comprises dans un vaste domaine et atteignant 16 M).
(concentrations
acétique
Ainsi qu'on pouvait s'y attendre à partir du travail de Bach ci Saraéva,
Garrison et al. ont trouvé (pie pour la concentration la plus élevée, le prin!
Quand la teneur en eau est augmentée,
on ne trouve pas d'aldéhyde en quantité appréciable. Quand on extrapole
les résultats de Garrison et al. à une concentration nulle en eau on trouve
que leurs résultats sont en bon accord avec ceux de Newton (108).
cipal produit carbonylé est L'acétone.
6 b.
— ACIDE ACÉTIQUE SATURÉ D'OXYGÈNE
Pour la radiolyse par des rayons X de 70-85 kV m;lx de l'acide acétique traversé par un courant d'oxygène, Bach et Saraéva (111) donnent les valeurs
:
G(H
+ hydroperoxyde d'acétyle) = 0,36
= 0,30
G (peroxyde d'acétyle)
= 0,83
G(GH3 COOH)
= 0,53
G(HCHO)
= 0,45
G(GH 3 COCH
2
2
3)
- 2,4
= 2,4
G(G0 2 )
G (gaz total)
De même que pour les réactions conduites en absence d'oxygène, les auteurs
ont recours à des mécanismes radicalaires pour expliquer tous
obtenus, y compris l'égalité des valeurs
6 c.
les résultats
G(C0 2 ) et G (gaz total).
— ACIDE PROPIONIQUE
Une étude de ce composé irradié par des ions hélium de 32 MeV a été récemment menée à bien par Newton (108). Les résultats sont en général conformes
à ceux trouvés pour l'acide acétique.
(111)
Bach
(N.
A.
et
Saraéva (V. V.), Sbornik Rabot Radiatsionnoi Khim., Ak<ul.
Traduction anglaise Symposium on Radiation Clic
Nauk. S. S. S. IL, 1, 175, 1955
:
:
mistry, Acad. Sci. U. S. S. R., 1, 135, 1955.
(112) Burton (M.), J. Am. Chem. Soc, 58, 1645, 1936.
(113) Garrison (W. M.), Bknnett (W.), Gole (S.), Hayward (H. R.) et Weeks (R. M.).
J. Am. Chem. Soc, 77, 2720, 1955.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
58
éd.
— AUTRES ACIDES
Miss V. L. Burton (114) signale que la radiolyse de l'acide oléique par des
rayons a de 6 MeV conduit à un G de décomposition égal à 2,2. Une certaine
quantité d'acide stéarique se forme, que l'irradiation soit conduite avec des
rayons a (114) ou des deutons (106).
Divers autres acides organiques ont été étudiés, soit à l'état gazeux, soit
à l'état solide,
par le groupe de chercheurs de MIT (cf. 104, 106, 115) qui se
préoccupaient surtout de la genèse du pétrole. Les renseignements fournis ne
sont pas très abondants car
ils
se limitent essentiellement à l'analyse des
produits formés. Néanmoins, quiconque s'intéresse à la question devra com-
mencer par consulter ce travail.
Duggan et Landis (116), au cours d'une étude sur les processus qui se
déroulent durant la stérilisation par rayonnement, ont trouvé que les rayons y
du 60 Co accélèrent l'oxydation de l'acide oléique à 20° G avec production de
peroxydes et de composés qui semblent être des cétones a,
non saturés.
Une substance « pro-oxydante » telle que le stéarate de cobalt augmente les
(3
rendements.
7.
- ESTERS
Le travail publié sur la radiolyse des esters n'est pas très détaillé. Le groupe
de MIT a décrit les résultats de quelques études essentiellement qualitatives
en relation avec le problème de la genèse du pétrole (106). Duggan et Landis
(cf. paragraphe 6) sont signalé que les rayons y de 60 Co produisent, en substance,
le
même effet sur l'oléate de méthyle que sur l'acide oléique. Les rendements
en peroxydes et en produits carbonylés augmentent avec la température dans
l'intervalle
7,5-56° C.
Le rendement en peroxyde augmente avec
la dose
de façon plus linéaire pour l'oléate de méthyle que pour l'acide oléique; dans
ce dernier cas, la diminution dans l'efficacité de production
quand la durée
d'irradiation augmente, apparaît déjà pour des doses plus faibles.
On a éga-
lement étudié l'effet d'électrons de 1,2 MeV sur le stéarate de méthyle, l'oléate
de méthyle et le linoléate de méthyle, de même que sur la tristéarine commerciale (117). Bien que le mémoire ne le précise pas explicitement, on peut penser
que les irradiations ont été conduites en présence d'air, car les auteurs se
préoccupaient des processus qui se déroulent au cours de la stérilisation des
aliments. Des composés ont été formés qui présentaient des caractéristiques
de peroxydes. Le linoléate gelé à
70° C a présenté après absorption de
—
2.10 6 rep un effet de gel attribué à une polymérisation.
(114)
(115)
(116)
(117)
Burton (V. L.), J. Am. Chem. Soc, 71, 4117, 1949.
Breger (I. A.) et Burton (V. L.), ./. Am. Chem. Soc, 68, 1639, 1946.
Duggan (L. B.), Jr., et Landis (P. W.), J. Am. Oil Chemists' Soc, 33, 152, 1956.
Hannan (B. S.) et Boag (J. W.), Nature, 168, 152, 1952.
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
ÊTHERS
8.
mesuré
\i.\vto\- (KM)) a
1rs
rendements gazeux totaux obtenus dans
les
suivantes
la
de 27 MeV. Les valeurs de G trouvées
radiolyse de 2 éthers par des ions Eie
sont
59
:
H
Éther de diisopropyle
Éther de dibutvle
2
CH
4
Ca
C3
2,3
0,88
0,16
1,6
0,16
0,25
2,7
('-,
Polymère
0,38
2.5
ALDÉHYDES ET CÉTONES
<.).
Très peu de recherches ont été effectuées dans ce domaine. Les produits
gazeux formés par la radiolyse du propionaldéhyde liquide par des électrons
de 1,5 MeV ont été étudiés par Patrick et Burton (39) avec les résultats
suivants
:
G (gaz total) = 4,57; G(H = 1,26; G(GH4 = 0,114; G(CO) = 1,60;
G(C H ) = 1,12; G(gaz en C = 0,05. Les auteurs ont
2)
G(C 2 H 4 ) = 0,34;
2
)
3)
6
expliqué leurs résultats en supposant un certain nombre de réorganisations
La décomposition peut
benzène (cf. paragraphe 10 b).
primaires et des réactions avec coupure de liaisons.
être radiosensibilisée par le
D'après les résultats anciens de Kailan (118), une irradition prolongée d'acé-
tone par les rayons p et y du radium aboutit à la formation d'un acide qui
n'a pas été identifié.
10.
10 o.
— MÉLANGES VARIÉS
— ACÉTATE DE MÉTHYLE ET BENZÈNE
Boury et Ghapiro (68) ont étudié de façon détaillée un certain nombre de
mélanges et utilisé le DPPH pour intercepter les radicaux libres et évaluer
leur nombre (voir paragraphe 3 e 2°). Des résultats particulièrement curieux
ont été obtenus pour un mélange d'acétate de méthyle et de benzène
irradié en absence d'air par les rayons y de 60 Co. Il est à remarquer que les
rendements en radicaux pour 100 eV sont supérieurs à ce à quoi on peut
s'attendre d'après la règle d'additivité, aussi bien pour les solutions aérées
118)
Kailan (A.), Monats. Chem. 35, 859, 1914.
OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
60
quo pour les solutions dégazées. On peut suggérer que le benzène B sensibilise
la décomposition de l'acétate A bien qu'il soit lui-même peu affecté par le
rayonnement.
B
-«/^ b*
(1)
—> B + A*
B* + A
A*
>-
(2)
produits
(3)
Un tel comportement du benzène n'est pas sans précédent. Il a été observé
également lors de la décomposition photosensibilisée de l'iodure d'éthyle (119)
et aussi dans la décomposition du propionaldéhyde apparemment radiosensibilisée
par l'intermédiaire de ses niveaux excités les plus bas (39) (cf. para-
graphe 10 b).
10 b.
— PROPIONALDÉHYDE ET BENZÈNE
Patrick et Burton (39) ont étudié la radiolyse d'un mélange de propionaldéhyde et de benzène d 6 et ils ont trouvé que ce dernier n'exerce apparemment
H
pas un effet protecteur puissant sur la production de 2 parle propionaldéhyde,
bien que, par une réaction d'interception, on puisse détecter une légère dimi-
H
nution dans le rendement en
H +GD
6
2.
formation de polymère
6
(1)
Cependant, d'après l'interprétation des auteurs, la probabilité relative de la
réaction (1) par rapport à (2) est inférieure ou égale à 7,3
H+CD
6
:
G 6 D 5 + HD
6
(2)
Il apparaît aussi que le benzène peut sensibiliser la décomposition du propionaldéhyde par la suite de réactions
:
C 6 D»? + C 2 H 5 CHO
G 2 H 5 GHO*
—v
->
G 6 D 6 + C 2 H 5 CHO*
C 2 H 6 + CO
(3)
(4)
La réaction (4) est un processus de décomposition avec réorganisation à basse
énergie et seuls des états excités de basse énergie sont mis en jeu dans les
réactions (3) et (4).
10 c.
— SOLUTIONS DE CHLORURES
Minder et Heydrich (120) ont passé en revue les résultats des radiolyses
X de 31,5 keV des chlorures d'alcoyle et d'aryle en solution
par des rayons
(10
-3
à 0,1
établi
la
M) dans des solvants organiques (alcool, acétone). Les auteurs ont
loi
qui régit la vitesse de production de
HG1
et
trouvé que les
résultats pouvaient s'interpréter correctement par l'intervention d'un effet
(119)
(120)
West (W.) et Paul (B.), Trans. Faraday Soc, 28, 688, 1932.
Minder (W.) et Heydrich (H.), Disc. Faraday Soc, 12, 305, 1952.
RADIOLYSE DE LIQUIDES ORGANIQUES
indépendant
indirect,
effel
de
La
concentration dans un large domaine,
direct proportionnel à la concentration en soluté.
vraisemblablement déterminé par
La
el
d'un
Ce dernier effet
était
quantité d'énergie rayonnante
pris naturellement celle «les électrons secondaires, etc.) absorbée
lui-même.
L'effet
61
Indirect était attribué,
(j
com
dans le soluté
comme pour u-s solutions aqueuses,
aux réactions des radicaux libres produits par la radiolvse directe du solvant.
Pour des solutions contenant les mêmes concentrations d'atomes de chlore
et dans le domaine où l'effet indirect était prédominant, les rendements en
HG1 (exprimés sous la tonne M/N) étaient environ 2,7 fois plus élevés pour les
chlorures aliphatiques que pour les chlorures aromatiques. Les rendements
ou
fois plus faihles que pour les solutions aqueuses des
étaient environ
mêmes solutés. Une quantité d'eau atteignant 12,5 à 25 vol. p. 100 ajoutée aux
solutions dans l'acétone n'affectait pas le rendement observé. SuTTLEet Schulte
d'il) ont commenté le l'ait que Minder et Heydrich n'ont pas fait mention
de tentatives particulières pour éliminer les traces d'oxygène de leurs systèmes. Dans leurs propres expériences sur des solutions irradiées de chloroforme sec, Suttle et Schulte ont trouvé que la présence d'une trace d'oxygène était nécessaire pour observer une décomposition appréciable (cf. para'A
graphe
Il
1
1).
est
particulièrement intéressant de remarquer que, pour les systèmes
où les solvants principaux étaient l'acétone et l'alcool, Minder et
Heydrich ont interprété de façon satisfaisante la cinétique de formation de
discutés,
HG1, sans avoir recours à des mécanismes de transfert d'énergie
graphes 3 g, 10 a, 10 b).
(121)
Suttle (J. F.) et Schultk (J. W.), Disc. Far. Soc, 12, 317, 1952.
(cf.
para-
Il
POLYMERISATIONS AMORCEES
PAR
LES
RADIATIONS
IONISANTES
par
Adolphe CHAPIRO et Michel MAGAT
Laboratoire de Chimie Physique de la L'acuité des Sciences de Paris.
POLYMERISATIONS AMORCEES
PAR LES RADIATIONS IONISANTES
INTRODUCTION
On sait que les réactions conduisant à la formation des hauts polymères peuvent
être divisés
en deux grandes classes : les réactions de polycondensation et les réac-
de polymérisation.
tions
Chimiquement la polycondensation est une suite de condensations successives
entre molécules de bas poids moléculaire (« monomères ») conduisant à la formation de substances
«
polymères » de haut poids moléculaire. L'addition de chaque
nouveau maillon de la chaîne croissante est accompagnée de l'élimination d'une
molécule de bas poids moléculaire, généralement de Veau. Rentrent dans
catégorie
les
cette
polyestérifications, les polyamidifications, les réactions de conden-
sation entre halogénures organiques en présence de
métaux alcalins avec élimi-
nations d'halogénures alcalins, etc..
Les polymérisations par contre sont des réactions d'addition en chaîne entre
molécules de
monomère possédant des liaisons doubles. Ces monomères s'addi-
tionnent les uns aux autres par suite de l'ouverture des doubles liaisons et la for-
mation de liaisons simples. Dans
molécules d'aucune sorte.
ce
type de réaction
il
n'y a élimination de
Les réactions de polycondensation s'effectuent en général à la température ordinaire sans nécessiter de catalyseurs. Elles peuvent être toutefois accélérées par
une élévation de température ou par addition d'ions
H
+
,
ces ions intervenant
au
cours de chaque stade de condensation.
Les réactions de polymérisation par contre nécessitent pour se dérouler soit
une élévation de température assez importante, soit l'addition de catalyseurs qui
jouent le rôle d'une amorce et ne servent qu'à provoquer l'ouverture d'une première double liaison sans intervenir directement dans
successives.
Ces catalyseurs de polymérisation peuvent
les
réactions d'addition
soit des radicaux
ou des substances pouvant facilement donner naissance à des radicaux
libres, soit encore des acides-bases dans le sens de Lewis. Selon la nature du cataêtre
libres
lyseur utilisé qui détermine
le
mécanisme des réactions d'addition consécutives,
on distingue les polymérisations radicalaires et les polymérisations ioniques.
est soumise à un rayonnement ionisant on
forme à la fois des ions et des radicaux libres. Cependant on peut
Lorsqu'une substance chimique
sait qu'il se
HA.ISSINSKY.
—
III.
5
INTRODUCTIOX
66
affirmer à priori que les rayonnements ionisants ne produisent pas de variation
sensible du
D'autre
(k
pH car les ions H + et 0H~ sont formés en quantités équivalentes.
part
= 1,3. 10
11
la
vitesse
1/mol. sec) (1)
recombinaison
de
de
ces
ions
est
trop
grande
pour qu'ils puissent exercer une action catahjtique
appréciable avant leur recombinaison. Il ne faut donc pas s'attendre en générât
à une action catalytique des rayonnements sur
Il
n'en va plus de même pour
les
les
réactions de condensation.
réactions de polymérisation
par addition.
En effet, vu que les rayonnements ionisants produisent des radicaux libres, parfois avec des
rendements très appréciables,
et
également des ions carbonium et
peut-être aussi carbenium, on peut prévoir à priori que les rayonnements pourront
amorcer les réactions de ce type.
Dans le présent article, nous n'examinerons que l'amorçage des polymérisations
radicalaires qui seules ont été étudiées expérimentalement jusqu'à ce jour.
Après avoir rappelé quelques éléments de la théorie des polymérisations
I) nous étudierons les caractères généraux des polymérisations radiochimiques (Chapitre II) et nous examinerons en détail les données expérimentales
(Chapitre
sur la polymérisation des monomères purs en milieu homogène (Chapitre III)
et
en milieu non homogène (Chapitre IV).
la polymérisation des monomères
Nous examinerons ensuite le cas de
en solution (Chapitre V). Enfin nous décrirons
une méthode de synthèse des copolymères greffés par voie radiochimique (Chapitre VI) et nous montrerons comment il est possible d'effectuer le calcul de quelques
réacteurs de polymérisation
(1)
industriels (Chapitre
VII).
Eigen (M.) et de Malger (L.) Naturwissenschaften, 1955, 42, 413.
CHAPITRE
I
ÉLÉMENTS DE LA THÉORIE
DES POLYMÉRISATIONS (*)
Les deux modes de polymérisation radiealaire et ionique sont couramment
dans l'industrie, toutefois les polymérisations radicalaires sont actuel-
utilisés
lement nettement prédominantes et ce sont elles qui ont été le plus étudiées.
Ainsi si nous connaissons bien le mécanisme et la cinétique des polymérisa-
deux aspects de la question sont encore très controDans ce qui suit nous allons
exposer d'abord la cinétique des polymérisations radicalaires et nous résumerons ensuite brièvement ce qui paraît être acquis jusqu'à présent au sujet
des polymérisations ioniques. Ceci est d'autant plus justifié que, comme nous
le verrons plus loin, les polymérisations amorcées par les rayonnements ionisants s'effectuent par le mécanisme radiealaire, avec éventuellement quelques
exceptions sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
tions radicalaires, ces
versés dans le cas des polymérisations ioniques.
/.
CINÉTIQUE DES POLYMÉRISATIONS
RADICALAIRES
A.
— GÉNÉRALITÉS
La réaction de polymérisation radiealaire est une réaction en chaîne typique
qui comprend par conséquent plusieurs stades bien caractérisés. Dans le premier stade une molécule quelconque, molécule de monomère, d'un solvant
ou d'un corps ajouté (catalyseur), est transformée par un agent physique
(chaleur, lumière ou rayonnement ionisant) en radicaux libres. Ce stade est
appelé la réaction d'amorçage, et nous pouvons le symboliser par
X -A
(*)
Pour plus de
détails voir par exemple
1954.
reactions, Interscience Publishers,
R*.
Burnett (G. M.), Mechanism of polymer
THÉORIE DES POLYMÉRISATIONS
68
Dans le stade suivant le radical R* réagit avec une molécule de monomère
R—
C, la valence
en ouvrant la double liaison et en formant une liaison simple
du deuxième carbone restant libre, de sorte que le produit d'addition cons-
titue
un nouveau radical libre RM* capable d'attaquer et d'additionner une
autre molécule de monomère et ainsi de suite
:
k
-\
R* + M
RM*
kp.y
RM* + M
RM*
k*n+l
RM* + M
fcM*+t.
un seul monomère est présent dans le système tous les radicaux RM* auront
il est donc probable que
si aucun événement physico-chimique perturbateur tel que la précipitation du
polymère par exemple n'intervient, toutes les constantes k p k p ... A p
Si
même groupement M* à l'extrémité de la chaîne et
le
,
,
.
,
.
.
demeurent constantes au cours de la réaction et soient égales entre elles. Elles
pourront alors être remplacées par une constante de vitesse unique k P que
l'on appelle « constante de propagation ». Si le radical R* est un radical aussi
réactif
que les radicaux RM*, la vitesse de la réaction
R* + M
RM*
qui n'apparaît qu'une fois au cours de la réaction de croissance de la chaîne,
n'influencera pas la vitesse globale de la polymérisation et l'on pourra écrire
k V[ = "p (
)•
La situation est différente si deux monomères A et B sont présents simultanément. La chaîne croissante peut alors être terminée soit par un radical
B*. Les constantes de vitesse k aa k ab k ba k bb
A*, soit par un radical
—
—
-
des réactions
,
,
,
:
kaa
— A* + A
— A* +B
— B* + A
— B* + B
kab
ha
hb
-A'
— B*
— A*
— B*
ne sont pas égales entre elles et il est nécessaire de les distinguer. La polymérisation d'un tel mélange de deux monomères conduit à un « copolymère »
c'est-à-dire à un polymère comportant les deux monomères dans la même
#
types de radicaux R*, S # T etc.. sont produits au cours de l'amorçage,
radiochimique on peut être amené à
l'amorçage
pour
le
cas
généralement
comme c'est
distinguer plusieurs constantes kPl w, kpj&; A^t*, etc..
(*) Si plusieurs
,
,
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
chaîne.
<i<>
De même, si la polymérisation est effectuée dans un milieu dans lequel
mesure où son degré de polymérisation
le polymère n'est
soluble que dans
moyen D.P.
nombre moyen de molécules de monomère dans
(
la
n'excède pas une certaine valeur m,
les
différentes des constantes
fr /.„,,.,
fr»
m+i »
constantes
A-
J(>
.
.
.
chaîne)
la
peuvent être
A„
•••
Le troisième stade est constitué par la réaction de terminaison des chaînes
cinétiques, c'est-à-dire par
radicaux.
recombinaison ou
la
Le
disproportionnemenl des
On sait en effet qu'un radical ne pent disparaître qu'en réagissant
avec un antre radical, c'est-à-dire que les valences libres disparaissent par
Nous pouvons écrire d'une manière générale
paires.
:
RM,; + RM;„
Les constantes k
t
—> P
>t,m
(ou 2 P).
seront en général des fonctions des degrés de polyméri-
sation n et m, mais dans beaucoup de cas on pourra admettre quelles sont
suffisamment proches les unes des autres pour pouvoir être confondues en
Exception doit être faite toutefois
une seule constante de terminaison k
t
.
pour les réactions mettant en jeu les radicaux primaires R*
RM* + R*
R-+R-
:
P
s-
*%
Q
en raison de la différence des dimensions et de la nature chimique des groupe-
ments terminaux des radicaux R* et RM*.
A côté de ces réactions, qui en général sont les seules à intervenir dans le
existe encore une réaction des radicaux RM*
calcul de la vitesse globale,
il
dont il faut tenir compte pour le calcul du degré de polymérisation du polymère formé; c'est la réaction de transfert de chaîne qui est en compétition
avec les réactions de propagation et de terminaison. En effet le radical RM*
BX en lui arrachant un atome
est capable de réagir avec une molécule stable
(X = H, Cl, Br...) de manière à donner une molécule de polymère stable RM n X
et
un radical B*
:
k
RM*+BX —-y RM X+B\
f
n
Le radical B* peut à son tour additionner une molécule de monomère
B* + M
et
les
-^
:
BM*
amorcer une nouvelle chaîne de polymérisation. Remarquons que toutes
molécules de polymère issues d'un même radical primaire R* font partie
de la même chaîne cinétique. A cause de cette réaction de transfert
donc une différence entre
la
longueur de
la
partir des concentrations et des constantes k a
chaînes matérielles.
Si,
il
existe
chaîne cinétique (calculable à
,
k v et k t ) et la longueur des
comme c'est souvent le cas k vb > k v
,
l'existence
de
THÉORIE DES POLYMÉRISATIONS
70
la réaction
de transfert ne se répercutera pas sur la vitesse globale; mais il
peut arriver que k pb 4\ A,,; dans ce cas à chaque transfert la réaction de propagation subira un coup de frein et la vitesse globale peut être fortement diminuée. On parle dans ce cas de transfert désactivant.
— SCHÉMA CINÉTIQUE GÉNÉRAL
B.
Ce qui précède nous conduit à écrire le schéma cinétique suivant pour l'ensemble de la réaction de polymérisation radicalaire.
M
(la)
(lô)
X
(1 c)
(2)
\
chaleur, hv, e~
S
R" + M
(3)
RM,! + M
(4)
RM: + RM:
R
'
rf(R')
#
dt
—±
RM*
RM*
-
d(RM')
d(n m
dt
dt
)
=
k 9l (R')(M)
=
À„(RM*)(M)
d(M)
,
rf(RM)'
= 2A^ (RM-)
-^p_.di5M2 = _^!
(RM-)(R-)
P
2
(
-
(5)
RM ,+R-
->
P
==A:<
dt
(6)
dt
-^P = k
R* + R*
->
Q
RM*, + BX
-r
RM X+ B*
2
<°°(
Ry
^5J = k RM
(
ft
«)
(BX
)
dt
Pour obtenir une expression exacte de la vitesse globale de la consommation
du monomère (grandeur généralement mesurée quand on étudie la cinétique
des polymérisations), il faut résoudre le système des équations différentielles
correspondant. Une telle solution ne peut pas être obtenue à l'aide de fonctions mathématiques connues et on est obligé de recourir à des approximations
et simplifications. Une simplification très appréciable du calcul peut être
obtenue grâce à l'hypothèse de l'état quasi-stationnaire. Cette hypothèse
peut être formulée de la manière suivante par unité de temps et de volume
:
il
disparaît autant de molécules réactives intermédiaires (en l'occurrence de
radicaux libres) qu'il s'en forme, ou encore
libres est égale à leur vitesse
:
la vitesse de formation des radicaux
de disparition.
La condition de validité de cette hypothèse, introduite par Bodenstein
(1913) a été précisée par Benson (2), qui a montré que l'état quasi-stationnaire ne s'établit rapidement que
si
la
constante de vitesse de terminaison
est très grande par rapport à la constante de vitesse d'amorçage. Si ceci n'est
pas le cas, l'état quasi-stationnaire ne sera atteint que pour des degrés de
conversion assez élevés et à la limite pourra ne jamais être atteint.
(2)
Benson (S. W.), J. Chem. Phys.,1952, 20, 1605.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
71
Les réactions de terminaison qui Interviennent dans notre schéma sont des
réactions de recombinaison de radicaux. Elles n'exigent pas d'énergie d'actl
vation et sont donc à priori rapides. La situation change toutefois quand
milieu devient très visqueux, c'est-à-dire lorsque c'est
qui devient
si
les
le
l'acteur déterminant
le
vitesse de diffusion
la
dans ces réactions (« elïet de gel ») OU encore
chaînes croissantes précipitent avant que
la
réaction de terminaison
temps d'intervenir. Nous devons par conséquent nous attendre à
ce que l'hypothèse de l'état quasi-stationnaire ne soit valable qu'aux faibles
conversions pour les polymérisations effectuées dans un milieu homogène
pas trop visqueux et qu'elle devienne inapplicable à des polymérisations effec
tuées en milieu précipitant pour Le polymère. Des déviations des lois obtenues
n'ait
eu
le
en se servant de L'hypothèse de l'état quasi-stationnaire doivent être observées
dans tous les cas aux conversions élevées, quand le milieu se transforme en
un gel trop visqueux.
C.
— CAS DES POLYMÉRISATIONS EN MILIEU HOMOGÈNE
a.
Comme nous venons de le voir
il
Vitesse globale.
est possible dans ce cas d'appliquer l'hypo-
thèse de l'état quasi-stationnaire. Nous allons nous limiter d'abord au début
de la réaction, quand la quantité de polymère présent est faible, inférieure à
10 p. 100 par exemple, et nous admettrons que les radicaux R* sont produits
exclusivement par photolyse ou par radiolyse du monomère et du solvant,
ou encore par décomposition thermique d'un « catalyseur » et que tous ces
radicaux ont la même réactivité vis-à-vis du monomère. Le radical R* produit aura le choix entre les réactions (2), (5) et (6). La réaction (2) exige une
certaine chaleur d'activation (3-7 kcal) de sorte que k Pi est sensiblement plus
petit que k„nuo ou k tll0t0 (pour le styrolène à 30° G par exemple k v = 110 1/mol.
sec, ktam,n = 10,8. 10 7 1/mol. sec); par contre la concentration en monomère
M est, dans le cas des polymérisations en masse, tout au moins, beaucoup
plus élevée que la concentration stationnaire des radicaux RM* et R* donnée
par (R«) = (js
,
sauf pour les très fortes concentrations en catalyseur ou
aux très fortes intensités de rayonnement. On peut donc en général négliger
les réactions (5) et (6) par rapport à (2), la terminaison des chaînes s'efîectuant
par (4).
Si l'on
suppose en outre k vl
ou
#k
M, S
schéma général se réduit à
rf(R')
X
RM*, -f M
P , le
=y
rf(RM ')
dt
dl
-^ RM;
_ d(M)
*,(RM')(M)
dt
RM*,
-f
RM*,
P
:
rf(RM')
dl
MRIVT) 2
R
THÉORIE DES POLYMÉRISATIONS
72
d'où l'on déduit
:
Si l'amorçage est effectué par la radiolyse du monomère, l'équation
-? =
^(Oi')" W'
!
devient
!
:
(1,2)
où I est l'intensité du rayonnement exprimée en 100 eV.l- 1 sec- 1 et G R le
rendement radiochimique en moles/100 eV.
Nous examinerons ultérieurement le cas des polymérisations radiochimiques
en présence d'un solvant.
b.
Degré de polymérisation.
En absence de réactions de transfert, les chaînes matérielles et les chaînes
cinétiques se confondent. Selon que la réaction de terminaison est une réaction
de recombinaison
z
x
:
x
UY
I
I
X
G
>
YU
I
I
I
ou une réaction de disproportionnement
Z
zxxz
III
R— — — — —
UYYU
z
Il
II
R — G — G— + — G — C — R
X
G
I
I
C
:
z
II
R — G — G— + — G — G — R —
II
II
YU
UY
I
G
I
R
>
— III
— —
—
Z
X
X
G
G
Z+G = C
II
UY
II
YU
R,
chaque chaîne portera un ou deux radicaux primaires R. Si n radicaux sont
produits par unité de temps (V„) il y aura n (ou n/2) chaînes formées. Soit V
ff
la vitesse globale mesurant le nombre de molécules de monomère consommées
par unité de temps, le nombre moyen de molécules de monomère par chaîne
où le degré de polymérisation, DP
,
sera donné par
:
V
v
En substituant dans cette expression V
ff
a
par sa valeur (I, 1) nous obtenons
5^ = ^(M)
:
d.3)
Le degré de polymérisation moyen est donc inversement proportionnel à la
plus grandes seront la concentration
racine carrée de la vitesse d'amorçage
du catalyseur ou la vitesse de sa décomposition (ou l'intensité du rayonne:
POLYMÉRISATIONS
ment), plus courtes seront
les
RADIATIONS IONISANTES
7:*
chaînes. Si la réaction de transfert sur le
mono-
I>M{
mère intervient elle va contribuer à raccourcir les chaînes matérielles, dont
la longueur, connue déjà dit, ne coïncidera plus avec la Longueur de la chaîne
cinétique. Si l'on désigne par DP,,,
dans ces conditions, on trouve (pie
le
degré de polymérisation
moyen obtenu
:
+
DP
DP m
A"""
(1,4)
kv
où kfm est la constante de vitesse de transfert sur le monomère. Si un deuxième
composé solvant ou agent de transfert S, est présent en concentration (S),
on aura
:
kfm
|
DP m
c.
DP
kfs
(S)
kP
(M)
gv
,j
|
kv
Polymérisations avec des vitesses d'amorçage élevées.
La situation est différente si la vitesse de production de radicaux devient si
grande (l'intensité de rayonnement si élevée) que les réactions (5) et (6) entrent
en compétition avec (2) pour la consommation des radicaux libres primaires
(R*)
(3).
Si
nous passons à la limite et considérons que la terminaison des
chaînes par la réaction (4) peut être négligée par rapport aux terminaisons
par les réactions (5) et (6) le schéma se réduit à
:
M(S)
X
R* + M
^5!) = Va
R*
—
— RM*
dt
R.
y
__^5!) = ^iSM!) = k
dt
RMl + M
rm; + rr* +r*
et l'on obtient
— ^jP = k (RMl) (M)
-y RM; +1
—
(Br> (M)
dt
dt
9
_^_) = _^) = WRM
P
—> q
-)(R-)
— ^p = 2kt (ny
dt
00
:
_
Vg ~
d(M) _ kJc Pl (M)*
~ k
dt
'
(
b}
'
t
Un calcul élémentaire (3) montre de même que le degré de polymérisation
moyen est alors donné par
:
Jt,^£-(M)V.^
DP = if =
v a ~ H,n ,
J
(I, 7)
Chapiro (A.), Magat (M.), Sebban (J.) et Wahl (P.). Symposium International de
Chimie Macromoléculaire. Milan-Turin 1954. Supplément à la Ricerca Scientifica, 1955,
(3)
p.
73.
THÉORIE DES POLYMÉRISATIONS
74
On voit que pour les vitesses d'amorçage élevées la vitesse de polymérisation tend vers une valeur limite, indépendante de l'intensité du rayonnement
(ou de la concentration
du catalyseur) tandis que la masse moléculaire du
comme rr-^p, mais les constantes de
polymère obtenu continue à décroître
* a
vitesse qui figurent dans l'expression ( 1, 7) sont différentes des constantes de ( 1, 3).
Si l'on
porte le logarithme de la vitesse de polymérisation et de la masse
moléculaire en fonction du logarithme de l'intensité du rayonnement, on doit
obtenir aux faibles intensités des droites de pentes 1/2 et
— 1/2 respectivement.
Aux très fortes intensités on doit obtenir une droite parallèle à l'axe des abscisses pour les vitesses et une autre droite de pente
culaires.
— 1/2 pour
les masses molé-
Dans le domaine intermédiaire on observera une courbe reliant les
deux droites asymptotiques. Les expressions pour ce domaine intermédiaire
ont été données par ailleurs (3)
:
/
—_
(2k tnoyi*
4 A-,
V\
1/2
4 k tn .oVa
k; (M) 2
k9
(I,
8)
(I,
9)
On doit donc s'attendre à ce que, au-dessus d'une certaine intensité (ou concentration de catalyseur) apparaisse une déviation des
v, = kv;/-
et
DP = KVr
classiques
lois
1/2
.
L'intensité (ou la concentration de catalyseur) à laquelle cette déviation
deviendra observable dépend de l'importance relative des réactions (2) d'une
part, et (5) et (6) d'autre part, qui
est facile
consomment les radicaux primaires.
Il
par exemple de défavoriser la réaction (2) en diminuant la concen-
tration du monomère (M). C'est-à-dire que la déviation de la loi en
I
1/2
se fera
sentir à des intensités d'autant plus faibles que les solutions seront plus diluées
en monomère.
Il
est possible ainsi d'arriver
avec des intensités
finies à la
—
k k\
]
situation où l'équation (I, 6) est valable et de déterminer le rapport -?
ktn,o
Nous verrons dans ce qui suit (fig. 2 et 4) que ces déviations de la loi en I 1/2
ont été mises en évidence dans la polymérisation radiochimique du styrolène,
du méthacrylate de méthyle et de l'acétate de vinyle.
D'autre part la réaction (2) exige comme nous l'avons dit une énergie d'acpour les réactions de com-
tivation, tandis que cette dernière est voisine de
binaison de radicaux (5) (6), une élévation de la température favorisera donc
2
à des intensités
d. Effet de la
température.
la réaction (2) et fera apparaître la déviation de la loi en
I
1
'
et à des concentrations plus élevées.
Il
est aisé de prévoir les effets de la température sur les vitesses de réaction
globales et sur les poids moléculaires en remplaçant dans les équations corres-
pondantes les constantes de vitesse par les expressions classiques k = Ae~ K//,T
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
en regroupant
et
les
termes dépendant de
la
température.
75
On trouve ainsi
que l'énergie deactivation globale est donnée par
L/2E. + E,-
i:„
1/21:,
(|,
LO)
dans le eas d'un amorçage par un rayonnement ionisant ou par la lumière
et
U. v. (K„
0)
E, = E,— 1/2 E,
On
sait
que
est
assez
élevée,
liaison.
En
L'énergie
fait
d'activation
car
elle
dans
le
propagation pour
vation de
la
3-7
tandis
kcal,
la
dissociation
d'un
il)
peroxyde
correspond à l'énergie de dissociation d'une
cas de l'amorçage par peroxydes on trouve
30 kcal. Nous avons déjà
Ea
de
(I,
Indiqué d'autre part que l'énergie d'actila
plupart des monomères est de l'ordre de
que l'énergie d'activation de
la
terminaison
est
voisine
de OC).
En substituant ces valeurs dans (I, 10) et (I, 11) on trouve que l'énergie
d'activation globale sera de l'ordre de 20 kcal dans le cas d'un amorçage chi-
mique et de l'ordre de 5 kcal dans le cas de l'amorçage par les rayonnements.
On peut donc prévoir que la vitesse de la réaction va décroître beaucoup plus
rapidement avec la température dans le premier cas que dans le second.
Il
en résulte qu'il est possible d'obtenir des polymères à des températures sensi-
blement plus basses par amorçage radio- ou photochimique que par amorçagechimique.
Pour les poids moléculaires on trouve en substituant les valeurs ci-dessus
(I, 3) que dans le cas d'un amorçage chimique l'énergie d'activation
globale sera de l'ordre de
10 kcal, c'est-à-dire que le poids moléculaire
s'abaisse quand la température augmente. Dans le cas d'un amorçage photoou radiochimique par contre, on trouve une énergie d'activation de l'ordre de
5 kcal, c'est-à-dire que le poids moléculaire augmente avec l'élévation de la
température. Toutefois ceci n'est rigoureusement exact que si l'on néglige
dans
—
les réactions
de transfert. En effet, les énergies d'activation des réactions de
transfert sont en général plus élevées que les énergies d'activation de propagation, de sorte que les 2 e et 3 e termes de l'équation (I, 5) croissent très vite
avec la température, ce qui correspond à une diminution des poids moléculaires.
En raison de l'existence des réactions de transfert il est difficile de pré-
manière générale si une élévation de la température va
une augmentation ou une diminution du poids moléculaire
dans le cas de l'amorçage par des rayonnements. Mais on peut dire
que dans le cas d'une diminution du poids moléculaire, avec l'élévation
de température cette diminution sera plus faible dans le cas de l'amorçage par des rayonnements que dans le cas d'un amorçage chimique, à
moins que le poids moléculaire ne soit entièrement déterminé par la réaction
voir
d'une
produire
de transfert.
(*) Elle sera légèrement supérieure pour les réactions de terminaison par disproportionnement, ce qui fait que la terminaison par disproportionnement sera relativement plus
importante aux températures élevées qu'à basse température.
THÉORIE DES POLYMÉRISATIONS
76
D.
— CAS DES POLYMÉRISATIONS EN MILIEU PRÉCIPITANT
Nous avons déjà dit que dans ce cas l'hypothèse d'état quasi-stationnaire
n'est plus valable.
Les résultats expérimentaux confirment cette conclusion. Les courbes de
conversion ne sont plus linéaires mais présentent une accélération au cours
de la réaction. La vitesse n'est donc plus constante et dans l'expression des
résultats cinétiques il est nécessaire de préciser ce que l'on désigne par vitesse
vitesse initiale, vitesse
:
moyenne, vitesse instantanée pour un taux de con-
version donné, etc..
Plusieurs systèmes de ce type ont été étudiés en amorçant la réaction soit
par des catalyseurs chimiques, soit par la lumière ultra-violette, soit enfin par
des radiations ionisantes. L'expérience a montré
comme on pouvait le pré-
voir que les équations « classiques » (I, 1) et (I, 2) ne s'appliquent plus et qu'en
particulier la vitesse n'est plus proportionnelle à
Va
1/:i
mais à V° où l'expo-
sant a est compris entre 1/2 et 1. D'autre part, la polymérisation ne s'arrête
pas immédiatement après l'arrêt de l'irradiation, c'est-à-dire que l'on observe
une post-polymérisation qui peut être très importante et durer plusieurs mois
(4,
5,
6).
Différentes interprétations de ces
phénomènes ont
été proposées
(4, 5, 7, 8).
E.
— INHIBITEURS DE LA POLYMÉRISATION RADICALAIRE
La croissance des chaînes par un mécanisme radicalaire peut être interrompue en ajoutant au monomère soit un radical libre stable tel que NO, le diphénylpicrylhydrazyle, etc.. ou une substance capable de fixer rapidement les raditrouve alors que la réaction de
caux libres tels que
2 et les quinones. On
polymérisation ne se produit pas ou ne se produit que très lentement, aussi
longtemps que l'inhibiteur n'est pas consommé, mais l'inhibiteur une fois
consommé la réaction reprend normalement.
L'existence de ces inhibitions nécessite de soumettre tous les réactifs à
une purification très soignée si l'on désire obtenir des résultats parfaitement
reproductibles. Il est en particulier indispensable d'éliminer complètement
toute trace d'oxygène.
Enfin, ces inhibiteurs étant spécifiques des polymérisations par
le
méca-
nisme radicalaire, il est possible de préciser le mécanisme de la réaction dans
les différents cas en étudiant la réaction en présence de ces inhibiteurs.
D'autres substances peuvent produire une inhibition incomplète en ralenou moins la polymérisation. On désigne ces substances sous le
tissant plus
(4)
Chapiro (A.), J. Chim. Phys., 1950, 47, 747, 764.
(5)
Bamford (C. H.) et Jenkins (A. S.), Proc. Roy. Soc, 1953, A-216, 515; 1955, A-
228
,
220.
(6)
Bensasson (R.) et Prevot-Bernas (A.), J. Chim. Phys., 1957, 54, 479.
(7)
Magat (M.), J. Polym. Se, 1955, 16, 491.
Durup (J.) et Magat (M.), J. Polym. Se, 1955, 18, 586.
(8)
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
nom de
retardateurs
en deux groupes
d.
les
les
Les inhibiteurs et retardateurs peuvent être classes
:
Les inhibiteurs
amines,
.
(et
retardateurs) par
«
transfert
phénols, etc.. qui réagissent avec
transformant en radicaux peu
b.
77
les
désactivant
i
tels
que
radicaux libres en
les
réactifs.
Les inhibiteurs (ou retardateurs) par COpolymérisation qui sunt capables
d'additionner les radicaux libres en donnant également un radical peu réactif.
Ce groupe comprend les quinones qui retardent ou inhibent la polymérisation
de presque tous les monomères, niais également le benzène, le toluène et d'autres
solvants aromatiques dans le cas particulier de la polymérisation de l'acétate
de vinvle.
//.
— POLYMÉRISATIONS IONIQUES
Comme nous l'avons déjà dit les polymérisations ioniques ont été beaucoup
moins étudiées que les polymérisations radicalaires en partie à cause de
la
difficulté d'obtenir des résultats bien reproductibles avec ce type de poly-
mérisation.
A.
— POLYMÉRISATION CATIONIQUE (OU PAR IONS CARBONIUM)
Certains catalyseurs
Friedel et Crafts, tels que BF 3 A1C1 3 TiCl4 etc.
,
,
,
sont capables d'amorcer la polymérisation d'un certain nombre de composés
oléfiniques tels que le p-méthoxystyrolène, l'isobutylène, l'a-méthylstyrolène,
le
styrolène, etc... La réaction, pour se produire, exige en général un cocataly-
seur, constitué soit par des traces d'eau, soit par de faibles quantités d'acide
chlorhydrique, d'alcool, etc.. ces cocatalyseurs étant
de la polymérisation.
consommés au cours
De telles polymérisations se déroulent à des tempéra-
tures très basses et possèdent des énergies d'activation globales négatives c'est-à-dire qu'elles sont ralenties
par une élévation de température.
D'autre part dans certains cas l'ordre de la réaction par rapport au mono-
mère est élevé, et dépend de la concentration du monomère et du cocatalyseur, indiquant que différents mécanismes peuvent coexister ou devenir prépondérants.
Contrairement au cocatalyseur, le catalyseur lui-même n'est pas consommé,
ou plus exactement ne se retrouve pas dans le produit final comme c'est par
exemple le cas dans les polymérisations radicalaires amorcées par des peroxydes.
La vitesse de la réaction dépend enfin de la constante diélectrique du milieu.
Le mécanisme exact de ce type de réaction est encore très controversé, mais
le tableau suivant paraît émerger de l'ensemble des travaux publiés à ce sujet.
Le catalyseur Friedel et Crafts AX n réagit avec le cocatalyseur RH pour
donner un complexe acide
,
AX n + RH
— AX.R-H
y
+
POLYMÉRISATIONS RADIOCHIMIQUES
78
Ce complexe réagit avec le monomère RxRaC = CH 2 en donnant un ion car-
bonium selon
Ri
AX n RH+ + R^C = GH
—> CH — C
I
2
3
+
+ AX n R-
I
R
2
l'ion carbonium peut réagir avec une autre molécule de monomère et s'y addi-
tionner avec migration de la charge. Le contre-ion
AX n R~ reste toujours au
voisinage immédiat de la charge positive, la constante diélectrique du milieu
étant en général trop faible pour permettre un grand éloignement des charges.
La chaîne est terminée et le catalyseur régénéré par la décomposition de
la paire d'ions, l'anion
R- se recombinant avec le cation
Ri
Ri
I
-C + +R-AX n
I
-G — R+AX n
I
I
R2
R2
Si à première vue il paraît possible que les ions carbonium qui sont très
probablement formés par les rayonnements ionisants dans les composés organiques puissent amorcer une polymérisation cationique, un examen plus
attentif rend ce type de réaction peu probable. En effet il est essentiel pour
qu'une telle polymérisation se produise que l'ion carbonium ait une durée
de vie comparable à celle de la chaîne croissante, soit au minimum 10 ~ 14 DP
sec = 10 11 sec. Ceci n'est possible que si un composé ou un complexe anionique ayant une affinité électronique comparable au potentiel d'ionisation
de l'ion carbonium existe au voisinage de la chaîne croissante, et la « protège »
contre la recombinaison avec les électrons « libres » du milieu. Or, ce n'est pas
le cas dans la plupart des substances dont la polymérisation radiochimique
.
a été étudiée.
Dans les milieux de faible constante diélectrique il est peu probable que
« solvates » dans le sens
de Platzman (9).
des électrons thermiques soient
Il
est beaucoup plus probable
dans ces conditions que la situation examinée
par Magee (10) soit réalisée, c'est-à-dire que l'ion positif soit neutralisé par
son propre électron « thermalisé » dans un temps voisin de 10 - 14 sec, c'est-àdire avant que l'addition d'un premier monomère ait eu lieu.
Il
n'est donc pas étonnant que ce type de polymérisation ne soit pas obser-
vable, sauf éventuellement dans des conditions très particulières.
B.
— POLYMÉRISATION ANIONIQUE (OU PAR IONS CARBÉNIUM)
La polymérisation des oléfines par des bases, procédant par conséquent
par un mécanisme anionique ou par l'intermédiaire des ions carbénium a été
(9)
Franck (J.) et Platzman (R.), Radiation biology, édité par A. Hollaender.
Me Graw-Hill, Book Co. volume 1, Chap. Ill, p. 191.
(10)
Samuel (A. M.) et Magee (J. L.), J. Chem. Phys., 1953, 21, 1080.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
jusqu'à
toutes
ces
catalyseurs
de
tels
aimées
dernières
moins
encore
que
le
bicarbonate
Grignard, le triphénylméthyl-sodium ou
Le
que
La
polj
préparés
à
l'aide
étudiée
Toutefois des polymères ont
mérisation cationique.
été
potassium,
de
7«>
réactifs
Les
sodium dissous dans L'ammoniac
liquide.
La seule étude détaillée sur ce sujet est celle de M. G. EVANS, W. C. E. lu.
ginson et N. S. Wooding (11) concernant la polymérisation du styrolène,
du méthacrylate de méthyle et de L'acrylonitrile par l'amidure de potassium
été proposé
en solution dans l'ammoniac liquide. Le mécanisme suivant
I
;i
par ces auteurs
Amorçage
:
NH GH
NH7 + CH = CHR
2
2
Propagation
— GHR
2
:
NH (GH — CHR) m GH (-GHR + CH = GHR
-> NH (CH — GHR) W + GH -GHR
2
2
2
2
(
2
Terminaison (transfert)
2
2
1
:
NH
NH (CH CHR) CH GHR +
— NH
(GH GHR) CH — GH — R + NH7
>
2
2
n
2
2
2
n
2
3
2
La vitesse globale de la réaction est donnée expérimentalement par
— d{M)/dt =
,
/c
(M) 2 (KNH 2) /-#/c (M) 2 (NH 2")
1
,,
(I,
:
12)
en accord avec l'équation à laquelle on aboutit à partir du schéma indiqué
en admettant l'existence d'un état quasi-stationnaire. C'est en irradiant des
solutions ammoniacales de monomère que l'on aurait une chance d'observer
ce type de réaction en chimie des rayonnements. Ces expériences restent encore
à faire.
III.
— COPOLYMÉRISATIONS
Nous avons déjà indiqué que dans le cas de la copolymérisation de deux
monomères A et B on doit tenir compte de quatre constantes de propagation
Kaa> ^aby
^ ba
^ ^bb'
La composition du copolymère ne sera pas nécessairement la même que
Evans (M. G.), Higginson (W. C. E.) et Wooding (N. S.), Rec. Trav. chim. PaysBas 1949, 68, 1069.
Higginson (W. C. E.) et Wooding (N. S.), J. Chem. Soc, 1952, p. 760.
(11)
POLYMÉRISATIONS RADIOCHIMIQUES
80
celle du mélange des monomères. Plusieurs auteurs (12, 13, 14) ont montré
que le rapport des monomères dans le copolymère est donné par
:
p(A)"|
,
:=
ld(B)_\ p
nu
r
modes de polymérisation
r
,
+(B)
(B)(A) +r 2 (B)
— --
Or, les constantes de vitesse k aa
trois
(A) r1 (A)
—
V
;
'
^
k ab k ba et k hb sont différentes pour les
,
radicalaire,
anionique et cationique.
Il
en
résulte que la composition des copolymères obtenue à partir d'un mélange de
monomères de composition donnée variera avec le mode d'amorçage utilisé.
C'est ainsi qu'en partant d'un mélange contenant 50 p. 100 de styrolène et
50 p. 100 de méthacrylate de méthyle, on obtient un polymère contenant cette
même proportion des deux monomères si la polymérisation procède par un
mécanisme radicalaire; par contre le polymère renferme 99 p. 100 de styrolène
et 1 p. 100 de méthacrylate de méthyle si la polymérisation est effectuée par le
mécanisme cationique et 99 p. 100 de méthacrylate de méthyle et 1 p. 100 de
styrolène si l'amorçage est anionique (15).
IV.
— POLYMÉRISATION EN EMULSION
La chaleur dégagée au cours de la réaction de polymérisation risque d'élever
température du milieu et de changer ainsi les conditions de travail. C'est
pour pouvoir dissiper plus facilement cette chaleur que l'on a essayé d'effectuer la polymérisation d'un monomère dispersé dans une grande masse d'eau.
Pour obtenir une dispersion stable le monomère est émulsionné par addition
d'un savon ou d'un autre agent émulsifiant. L'expérience a montré que dans
ces conditions la polymérisation procède avec une vitesse sensiblement plus
élevée et que les poids moléculaires moyens du produit obtenu sont plus élevés
si l'amorçage est fait par un catalyseur soluble dans l'eau et insoluble dans
la
la phase hydrocarbure.
La cinétique de la polymérisation en emulsion n'est pas définitivement
établie.
On pense toutefois (16, 17, 18) que la polymérisation a lieu dans les
micelles d'émulsifiant gonflées de
monomère, l'émulsifiant permettant aux
Alfrey (T.) et Goldfinger (G.), J. Chem. Phgs., 1944, 12, 205.
Mayo (F. R.) et Lewis (F. M.), J. Am. Chem. Soc, 1944, 66, 1594.
Wall (F. T.), J. Am. Chem. Soc., 1944, 66, 2050.
(15) Walling (C), Briggs (E. R.), Cummings (N.) et Mayo (F. R.), J. Am. Chem. Soc.,
(12)
(13)
(14)
1950, 72, 48.
Landler (Y.), C. R. 1950, 230, 539.
(10) Harkins (W. D.), J. Chem. Phys., 1945, 13, 381; 1946, 14, 47.
Harkins (W. D.) et Stearns (R. S.), J. Chem. Phys. 1946 14, 215.
(17)
(18)
Ewart (R. H.) et Smith (W. V.), ./. Chem. Phys., 1948, 16, 592.
Cheinker (A. P.) et Medvedev (S. S.), Zh. fiz. khim. U. R. S. S., 1955
29, 250.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
81
le catalyseur décomposé en phase aqueuse d'entrer
monomère. Le nombre de micelles initiales est BUffisam
ment grand pour qu'il y ait en moyenne à chaque instant moins d'un radical
par micelle. La chaîne amorcée croît donc- pendant un temps assez long jusqu'à ce qu'un deuxième radical pénètre dans la micelle. La terminaison est
radicaux produits par
en contact avec
le
par conséquent
très lente et la
minée
longueur des chaînes matérielles n'est déter-
par les réactions de transfert sur
éventuellement présent dans la micelle.
(pie
HÀISSINSKY.
III,
le
monomère
cl
le
polymère
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
SUR LES POLYMÉRISATIONS RADIOCHIMIQUES
/.
Si l'on fait abstraction
— HISTORIQUE
de quelques travaux préliminaires sur la polyméri-
sation de l'acétylène et de l'éthylène (1, 2, 3) qui ne font pas partie à propre-
ment parler des polymérisations vinyliques, seules examinées ici, on peut dire
que la polymérisation amorcée par les rayonnements ionisants a été découverte presque simultanément par Hopwood et Phillips (4) et par Joliot (5).
Hopwood et Phillips ont montré que certains monomères tels que le styrolène, l'acétate de vinyle et le méthacrylate de méthyle pouvaient être poly-
merises aussi bien par des rayons y que par des neutrons, tandis que Joliot
a décrit la polymérisation du méthacrylate de méthyle par le rayonnement
mixte du cyclotron.
Toutefois ces auteurs se sont contentés d'une description semi-quantitative des phénomènes, et l'étude quantitative et systématique n'a
commencé
qu'après la guerre, avec les travaux de Dainton (6) et de Landler et Magat
Depuis un assez grand nombre de publications ont été consacrées à cette
(7).
question, mais malheureusement beaucoup de ces travaux sont très incomplets
et les expériences ont été souvent faites dans des conditions peu satisfaisantes,
soit
du point de vue radiochimique (dosimetric douteuse, champ d'irradia-
tion inhomogène...), soit du point de vue de la polymérisation (produits insuf-
fisamment purifiés, oxygène incomplètement éliminé, etc.). Seuls quelques
monomères, comme le styrolène, le méthacrylate de méthyle et le nitrile
acrylique ont été étudiés avec une variation suffisante des paramètres pour
permettre une discussion quantitative. C'est en partant des données obtenues
(1)
Mund (W.) et Koch (W.), Bull. Soc. Chem. Belg., 1925, 34, 241.
Lind (S. G.) et Bardwell (D. G.), Science, 1925, 62, 422, 593.
(3) Goolidge (W. D.), Science, 1925, 62, 441.
(2)
Hopwood (F. L.) et Phillips (J. T.), Proc. Phys. Soc, 1938, 50, 438.
Joliot (F.), Br. F., 966, 760 (1940).
(6) Dainton (F. S.), Nature, 1947, 160, 268; J. Phys. colloid chem., 1948, 52, 490.
(7) Landler (Y.) et Magat (M.), C. R., 1948, 22è, 1720.
(4)
(5)
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
83
avec ces monomères que l'on j>eut tenter de dégager un tableau général
et de tirer des renseignements concernant 1rs processus radiochimiques élé
mentaires.
//.
— MECANISME DES POLYMÉRISATIONS
AMORCÉES PAR RADIATIONS
Le premier problème qu'il faut considérer est celui du mécanisme de La
réaction. La polymérisation amorcée par les rayonnements procède-t-elle par
un mécanisme radicalaire ou ionique?
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour essayer de trancher cette question
effet des inhibiteurs, copolymérisation, influence de l'intensité et de la tempé:
rature sur la vitesse de la réaction.
a.
Ghapiro (8), Landler (9), Schmitz et Lawton (10) et Tobolsky et coll.
(11) ont montré que la polymérisation radiochimique du styrolène était entièrement inhibée par addition de benzoquinone et par l'oxygène, inhibiteurs
spécifiques
b.
des polymérisations radicalaires.
Plusieurs auteurs (11, 12, 13, 14) ont montré que la copolymérisation
d'un mélange équimoléculaire de styrolène et de méthacrylate de méthyie
donnait un polymère qui contenait les deux monomères en quantités égales,
ce qui, comme nous l'avons vu, est caractéristique de la copolymérisation
radicalaire.
c.
Ballantine et coll. (13) ont montré que l'énergie d'activation globale
de la polymérisation par rayonnement était positive dans le cas du styrolène
et du méthacrylate de méthyie. Schmitz et Lawton (12) ont trouvé un résul-
tat analogue pour l'acrylate de méthyie. Or, on sait que c'est le cas des poly-
mérisations radicalaires, tandis que pour les polymérisations ioniques, on a
trouvé des énergies d'activation négatives.
d. Toutes les tentatives de polymériser par irradiation à la température
ambiante l'isobutylène, monomère qui ne polymerise que par un mécanisme
ionique, se sont soldées par un échec (15, 16). De même l'a-méthyl styrolène ne
donne pas par irradiation de produits de poids moléculaire élevé (17).
e.
Aucune relation n'a pu être établie entre la vitesse de polymérisation du:
styrolène en solution et la constante diélectrique du solvant.
(8)
Chapiro (A.),
C. R., 1949, 228, 1490.
Landler (Y.), Thèse, Paris, 1952.
(10) Schmitz (J. V.) et Lawton (E. J.), Science, 1951, 113, 718.
(11) Seitzer (W. H.), Goeckermann (R. H.) et Tobolsky (A. V.), J. Am. Chem. Soc,
(9)
1953, 75, 755.
(12)
Schmitz (J. V.)
et
Lawton (E. J.), XII e Congrès de VI. U. P. A. C, New- York,
1951.
(13)
Ballantine (D. S.), Colombo (P.), Glines (A.) et Manowitz (B.), Chem. Eng. Progr.
1954, 50, 267.
(14) Lindsey (H.), Brown (D. E.) et Pletcher (D. W.), Bull.
14.
(15)
(16)
(17)
Lewis (J. G.), Thèse Université de Michigan, 1954.
Grosmangin (J.). Résultats non publiés.
Chapiro (A.). Résultats non publiés.
Am. phys. Soc, 1954, 29,
POLYMÉRISATIONS RADIOCHIMIQUES
81
/.
Les vitesses de polymérisation du styrolène, du méthacrylate de méthyle
et de l'acétate de vinyle sont, dans un vaste domaine d'intensité, proportionJ
nelles à I'' (voir figures 2 et 4).
On peut donc en conclure que la polymérisation amorcée par les rayonnements procède par un mécanisme radicalaire, les ions formés ne pouvant pas,
peut-être à cause de leur durée de vie trop courte, amorcer une polymérisation
ionique.
III.
EFFET DE LA DISTRIBUTION NON
HOMOGÈNE DES CENTRES ACTIFS
La cinétique des polymérisations, telle que nous l'avons développée dans
le
chapitre précédent, suppose que les radicaux libres primaires soient dis-
homogène dans tout le volume contenant le monomère.
Or lorsque les radicaux primaires sont produits par un rayonnement, une
tribués de manière
double inhomogénéité doit apparaître
:
D'une part le rayonnement étant absorbé dans le milieu, son intensité
décroît rapidement avec l'épaisseur de substance traversée ce qui entraîne
une variation comparable de la concentration stationnaire des radicaux primaires. Cet effet se superpose à la décroissance en 1/R 2 dans le cas où l'échantillon est placé à une faible distance d'une source ponctuelle. Rappelons qu'un
phénomène semblable se rencontre dans les polymérisations photochimiques;
a.
b.
D'autre part, et ceci est spécifique des radiations ionisantes, les radicaux
libres primaires se produisent en
grappes le long des trajectoires des parti-
cules ionisantes, ce qui produit un deuxième type d'inhomogénéité à l'échelle
microscopique dans tout le volume irradié.
Le premier type d'inhomogénéité peut être réduit à un effet de deuxième
ordre à l'échelle du laboratoire en utilisant des récipients d'épaisseur E suf-
fisamment faible et en les plaçant à une distance R de la source suffisamment
grande pour que, d'une part
#
_
et d'autre part pour
que e~ aE ne dépasse pas quelques pour cent. Ceci est facile dans le cas des
rayons y et X pénétrants. Ainsi s'il s'agit par exemple du rayonnement y du
cobalt-60, une épaisseur de 1 cm d'un liquide de densité 1 ne réduit l'intensité
du faisceau que de l'ordre de 4 p. 100, et l'inhomogénéité par rapport au
plan médian n'est que de 2 p. 100 seulement. D'autre part si l'ampoule
d'irradiation est placée à 10 cm de la source, l'inhomogénéité introduite par
la distance est de
± 10 p. 100*).
Nous reviendrons ultérieurement (Chapitre VII) sur une tentative de tenir
compte de cette inhomogénéité dans le cas de réacteurs industriels.
(*) Pour le calcul et la détermination expérimentale de l'inhomogénéité dans les récipients placés plus près de la source voir par exemple Chapiro et coll. (18).
(18) Chapiro (A.), Boag (J. W.), Ebert (M.) et Gray (L. H.), J. Chim. Phys., 1953, 50,
468.
POLYMÉRISATloXS PAR RADIATIONS IONISANTES
La situation est plus difficile dans
Le
85
cas de rayonnements corpusculaires
plus fortement absorbes. La vraie solution consiste là aussi à limiter L'épaisseur
irradiée à
une faible fraction du parcours moyen dans
le
milieu
envisagé.
Étant donné que l'absorption passe par un maximum, l'épaisseur de l'échan
tillon doit être choisie de manière à se limiter à une variation de l'intensité
± 10 p. 100 autour de
de
la
moyenne. Dans le cas d'électrons de 2 Me Y par
mm
d'eau. La courbe de
exemple, elle ne doit pas dépasser L'équivalent de 5
la figure 1 représente le pouvoir d'ionisation relatif d'un faisceau d'électrons
de 1
MeV en fonction de l'épaisseur d'eau traversée (19).
Passons maintenant au problème de l' inhomogénéité à l'échelle microscopique, dette question a déjà été discutée
en
détail
(20).
Étant
donné
que
l'ab-
sorption des radiations ionisantes conduit
des
à
radicaux libres localisés
dans des
grappes distinctes, il est nécessaire de déter-
miner si la terminaison des chaînes croissantes se fait entre macroradicaux provenant
d'une même grappe ou si les macroradicaux
ayant leur origine dans deux grappes différentes peuvent participer à cette réaction.
1
En d'autres termes, la question se pose de
savoir
est
si
la
diffusion
des valences
Fig.
la
1
l'homogénéisation
bution
radicalaire.
Cette
de
la
question
1.
l'eau
— Absorption des électrons de
•
MeV dans l'eau. (D'après Ebert
et Boag (19)).
durée de la croissance d'une chaîne pour
assurer
3
pénétration dans
libres
insuffisamment importante pendant
2
Frofondeur (mm) de
distri-
a
pu
être
résolue expérimentalement.
En effet, si la terminaison s'effectue uniquement entre chaînes ayant leur
origine dans une même grappe, une augmentation de l'intensité aura pour
conséquence l'augmentation du nombre de grappes et par conséquent des
chaînes croissantes, sans que cette augmentation se répercute sur la vitesse de
terminaison car cette dernière sera uniquement fonction de la concentration
moyenne des chaînes croissantes dans une grappe isolée. La vitesse globale
devrait alors être proportionnelle à l'intensité.
Dainton, qui, à notre connaissance a été le premier à attirer l'attention sur
ce point (21), a cru avoir trouvé un exemple de polymérisation pour laquelle
presque proportionnelle à I; il s'agissait de la polymérisation
de l'acrylonitrile en solution aqueuse amorcée par des rayons
et y (22).
Toutefois en examinant de plus près cette question on a trouvé que l'exposant
la vitesse était
X
de l'intensité pour ce système est égal à 0,85 (23), valeur très voisine de celle
que l'on obtient pour la polymérisation de l'acrylonitrile pur (a = 0,8) (24).
D'autre part cet exposant élevé est lié non pas au mode d'amorçage, mais au
fait que le polymère est insoluble dans le milieu réactionnel et précipite au
(19)
(20)
Ebert (M.) et Boag (J. \V.), Farad. Soc. Discus., 1952, 12, 189.
(21)
(22)
(23)
(24)
Dainton (F. S.), J. phys. colloid chem., 1948, 52, 490.
Collinson (E.) et Dainton (F. S.), Farad. Soc. Discuss., 1952, 12, 212.
Bensasson (R.) et Prevot-Bernas (A.), J. Chim. Phys., 1956, 53, 93.
Prevot-Bernas (A.) et Sebban-Danon (J.), J. Chim. Phys., 1956, 53, 418.
Chapiro (A.), Radiation Research, 1957, 6, 11.
POLYMÉRISATIONS RADIOCHIMIQUES
86
En effet pour l'acrylonitrile pur, le même
exposant de la vitesse d'amorçage avait été observé pour la polymérisation
amorcée par des catalyseurs chimiques (peroxyde de benzoyle, azobisisobutyronitrile) ou par voie photochimique (cf. I, 1-D).
Enfin, si la polymérisation radiochimique de l'acrylonitrile est effectuée en
fur et à mesure de sa formation.
solution
dans
le
diméthylformamide, solvant du polymère, l'exposant de
l'intensité tombe à 0,55 (23). En fait, dans aucun cas de polymérisations effec-
tuées en milieu solvant, on n'a observé de dépendance linéaire entre la vitesse
globale et l'intensité (voir plus loin les résultats obtenus pour le styrolènele méthacrylate
de méthyle, l'acétate de vinyle). Dans tous ces cas on trouve,
même aux plus faibles intensités utilisées (0,2 r/min.), la loi
«
classique
»
en r/-(*).
On peut donc en conclure que si l'on amorce la polymérisation d'un monomère liquide avec des rayons X ou y, la terminaison s'effectue par recombinaison de chaînes croissantes provenant de grappes différentes et on peut par
conséquent considérer pour les besoins de la cinétique que la distribution des
radicaux primaires est homogène dans l'espace.
Il n'est pas exclu d'ailleurs
que la rapidité de l'homogénéisation soit due en partie à la croissance même
de la chaîne.
La situation peut être différente si on utilise pour l'amorçage des rayonnements à trajectoires plus denses comme les particules a ou des protons accélérés. Malheureusement on manque de toute donnée expérimentale à ce sujet.
L'effet des trajectoires pourrait
également se faire sentir dans le cas des
polymérisations à l'état solide, où la diffusion est fortement réduite. L'observation de Restaino et coll. (27) selon laquelle la vitesse de polymérisation de
l'amide acrylique à l'état solide est proportionnelle à l'intensité, pourrait être
une indication dans ce sens. Toutefois des expériences avec un autre mode
d'amorçage, photochimique par exemple, sont nécessaires afin de pouvoir
juger si cette loi est spécifique de la polymérisation radiochimique ou non
(voir IV-4-B).
(*) Dans un premier travail Manowitz et coll. (25) avaient trouvé que la vitesse de
polymérisation du styrolène par les rayons y était proportionnelle à l'intensité. Cependant
dans un travail ultérieur, des chercheurs du même laboratoire ont examiné un intervalle
d'intensités de rayons y plus étendu et ont trouvé une loi en I 2 (2Q). On ne saurait trop
mettre en garde contre la détermination de la loi V = /(I) à partir d'expériences effectuées
dans un faible intervalle d'intensités.
(25) Manowitz (B.), Horrigan (R. V.) et Bretton (R. H.), Rapport B. N. L., 141 (T-27),
l
l
1951.
Ballantine (D. S.), Glines (A.), Metz (D. J.), Behr (J.), Mesrobian (R. B.) et
Restaino (A. J.), J. Polym. Se, 1956, 19, 219.
(27) Restaino (A. J.), Mesrobian (R. B.), Morawetz (H.), Ballantine (D. S.), Dienes
(G. S.) et Metz (D. J.), J. Am. Chem. Soc, 1956, 78, 2939.
(26)
CHAPITRE III
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
EN MILIEU HOMOGÈNE
Dans ce qui suit nous allons étudier successivement les monomères dont la
polymérisation s'effectue en milieu homogène
:
styrolène, méthacrylate de
méthyle, acétate de vinyle, acrylate de méthyle.
POLYMÉRISATION DU STYROLÈNE
I.
Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, le styrolène est le monomère dont la polymérisation radiochimique a été le plus étudiée et nous allons
examiner en détail les résultats obtenus, car cette réaction peut servir d'exemple
typique de polymérisation en milieu homogène.
A.
— GÉNÉRALITÉS SUR LA RÉACTION
La polymérisation du styrolène par les rayons X et y a été étudiée dans un
grand intervalle d'intensités (0,27 à 34 000 r/mn) par plusieurs auteurs
L'accord entre les différents résultats est assez bon comme le montre
la figure 2. Nous avons porté sur cette figure en échelles logarithmiques la
variation de la vitesse initiale de la polymérisation (pour des taux de convertrès
(1-6).
sion inférieurs à 10 p. 100) et la masse moléculaire moyenne
(1)
(2)
M n du polymère
Chapiro (A.), J. Chim. Phys., 1950, 47, 747, 764.
Ballantine (D. S.), Colombo (P.), Glines (A.) et Manowitz (B.), Chem. Eng. Progr.,
1954, 50, 267.
(3)
Chapiro (A.) et Wahl (P.), C. R., 1954, 238, 1803.
(4) Nikitina (T. S.) et Bagdasarian (Kh. S.). Rcueil de travaux sur la chimie des radiations. Académie des Sciences de VU. R. S. S. Moscou 1955, p. 183.
Voir aussi
:
Medvedev (S. S.), J. Chim. Phys., 1955, 52, 677.
Ballantine (D. S.), Glines (A.), Metz (D. J.), Behr (J.), Mesrobian (R. B.) et
Restaino (A. J.), J. Polym. Se, 1956, 19, 219.
(6) Chapiro (A.) et Sebban-Danon (J.), J. Chim. Phys., 1957, 54, 763.
(5)
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
88
obtenu en fonction de l'intensité du rayonnement. Tous les résultats ont été
pour 19° en admettant pour l'énergie d'activation E v
1/2 E
—
recalculés
t
valeur 6,5 kcal.
la
On voit sur la figure que les points expérimentaux se placent sur deux droites
de pentes 1/2 et
— 1/2 pour
les vitesses et les masses moléculaires respective-
ment, ce qui est en accord avec les équations (I, 1) et (I, 3). Cependant aux
intensités élevées (supérieures à 100 r/mn) apparaissent des déviations de ces
droites. Ces déviations sont d'autant plus importantes que l'intensité est
plus élevée (voir I-l-C-c).
Des expériences ont été également effectuées par Landler (7) et par Cou-
Mn
0,1
-I
£ 0,01
10 6
l
!0
0,001
0,1
Fig. 2.
—
1
10
100
1000
10000
i
r/mn
Vitesses de polymérisation du styrolène et masses moléculaires moyennes du poly-
mère formé en fonction de l'intensité des rayons y.
(Résultats recalculés pour 19° G d'après 1, 2, 3, 4, 5, 6).
sin (8) en utilisant le rayonnement mixte d'un réacteur nucléaire et par To-
bolsky et coll. (9, 10) avec des rayons (3. Ces résultats ne peuvent pas être
comparés directement avec les résultats précédents, car les conditions d'irradiation étaient moins bien définies. En effet, dans le cas du rayonnement mixte
de la pile on ne connaît qu'approximativement le flux de neutrons lents associé au rayonnement total, tandis que la contribution des rayons y et des neutrons rapides de la pile ainsi que des rayons y de capture n'a pu être qu'évaluée
par ces auteurs; elle peut d'ailleurs varier d'une expérience à l'autre. Cependant Landler (7) a trouvé que la vitesse de polymérisation était proportionnelle à la racine carrée du flux de neutrons lents calculé à partir des caractéristiques de fonctionnement de la pile. En recalculant les résultats de ces
expériences (effectuées à 40°) pour 19° on trouve une équivalence entre les
(7)
Landler (Y.), Thèse, Paris 1952.
(8)
Cousin (C), Thèse, Paris 1953.
Seitzer (W. H.), Goeckermann (R. H.) et Tobolsky (A.
(9)
V.), J.
Am. Chem. Soc.
1953, 75, 755.
(10)
Seitzer (W. H.) et Tobolsky (A. V.), J. Am. Chem. Soc, 1955, 77, 2687.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
chimiques de
effets
un
rœntgen
1
et
1,74. 1010 n/cm*.
du rayonnement mixte de
La
89
associée
pile
que Ton a
obtenues en étudiant parallèlement d'autres rendions chimiques dansla même
pile et avec des rayons y (11). Les points obtenus en tenant compte de cette
à
flux
de
Ce résultai
est
voisin des valeurs
équivalence figurent également sur la courbe. On peut en déduire quelesrésu]
tats de Landlkr cadrent bien avec l'ensemble des résultats des autres auteurs.
Seitzkh
et
Tobolsky (!)) ont
une source ponctuelle de Sr
utilisé
Le
—Y
monomère qui absorbait totalement
placée au centre d'une sphère remplie de
rayonnement émis. Étant donné l'importance des résultats obtenus par ces
auteurs, pour ce qui va suivre nous allons analyser de plus près leur travail.
Rappelons que
source Sr
la
— Y émet deux rayonnements
d'énergies
[i
MeV.
Lorsqu'on utilise un champ d'irradiation non uniforme comme clans le cas
respectives 0,61 et 2,24
de ces expériences, il est nécessaire pour interpréter les résultats de connaître
l'intensité
moyenne intégrée dans tout le volume irradié. Cette valeur peut
s'obtenir par exemple en effectuant
une dosimetric chimique dans un réci-
pient identique au vase de réaction. Malheureusement ces auteurs n'ont pas
utilisé cette technique mais ont essayé de calculer l'intensité intégrale en décou-
pant le volume réactionnel en tranches et en admettant une loi d'absorption
exponentielle avec un coefficient d'absorption unique moyen pour les deux
émis par la source. Pour pouvoir effectuer le
composantes du rayonnement
calcul, les auteurs ont admis en outre que les chaînes de polymère sont amorcées et terminées à l'endroit où l'acte radiochimique primaire se produit, sans
que la diffusion vienne perturber les phénomènes. Dans ces conditions, dans
chaque couche sphérique de rayon r, la vitesse de production de radicaux primaires R, est donnée par
(3
/cXE exp.(
où E
est l'énergie totale
ficient
d'absorption
— Xr)
du rayonnement absorbée dans le milieu, X le coef-
moyen et A: une constante de proportionnalité, fonction
de G R En introduisant dans le calcul les constantes de propagation et de terminaison de chaîne et en intégrant par rapport à r entre et l'infini, les auteurs
trouvent que la vitesse de conversion
(en mol/sec) est donnée par
.
W
:
Ay(l
W = 4 7r&XE (M)
2k
2
t
z)~]
J
1/2
4
X*
mesure le rapport du nombre de terminaisons par disproportionnement à
par recombinaison).
Nous pensons qu'un tel calcul est erronné pour plusieurs raisons
est une
a. La loi exponentielle d'absorption d'énergie du rayonnement
approximation très grossière comme le montre la courbe d'ionisation d'un
(x
celui des terminaisons
:
(î
faisceau d'électrons de la figure 1.
b.
(11)
Chaque rayonnement p doit être traité séparément.
Chapiro (A.), C. R., 1954, 239, 580.
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
90
L'hypothèse de la non diffusion des chaînes croissantes n'est sûrement pas
Il en résulte que les valeurs des rendements
radiochimiques calculés dans ce travail sont assez douteuses (voir III-l-E
c.
valable à l'échelle microscopique.
et III-2-D).
B.
_ POLYMÉRISATION AUX INTENSITÉS ÉLEVÉES
L'examen des courbes de la figure 2 montre que pour des intensités supérieures à 100 r/mn. environ, les vitesses sont plus petites et les masses moléculaires sont plus grandes que ne le voudraient les équations cinétiques (I, 1)
et (I, 3).
En examinant ces deux équations on voit qu'un tel résultat serait
atteint si pour les intensités élevées la vitesse d'amorçage effective
V a n'était
plus porportionnelle à I et s'il apparaissait une sorte d' « effet de saturation ».
Un phénomène analogue est bien connu dans de nombreuses réactions radiochimiques où il accompagne 1' « effet de dilution »; il est causé par une compétition entre la recombinaison des radicaux libres primaires et la réaction avec
substrat. Dans le cas de la polymérisation radiochimique, on peut considérer
que les radicaux libres formés par radiolyse du monomère peuvent réagir en
principe selon les trois réactions compétitives que nous avons déjà indiquées
le
ci-dessus (I-l-B) (12)
R*
(2)
(6)
Il
—>
+M
R* + RM,*
R* + R*
(5)
:
RM*
-> P
-> Q
(réaction d'amorçage des chaînes)
(terminaison d'une chaîne croissante)
(recombinaison).
est évident que si l'intensité est petite, la concentration stationnaire des
radicaux primaires R* et des chaînes croissantes RM* sera faible et tous les
radicaux réagiront selon (2). Dans ce cas la vitesse d'amorçage sera bien donnée
par
V a = G R I(M)
et l'équation (I, 2) sera vérifiée.
Par contre si l'intensité augmente (R*) et (RM*) croissent et il doit arriver
un moment où les réactions (5) et (6) ne seront plus négligeables devant (2).
Dans ce cas l'utilisation des radicaux primaires pour la polymérisation ne
sera plus totale et on doit bien observer les déviations que l'on peut voir sur
la figure 2.
Si l'intensité
devient très élevée, les chaînes seront très courtes (inférieures
à 10 unités de monomère par exemple) et il sera nécessaire dans le calcul de
globale (mesurée par la consommation du monomère) de tenir
compte de la réaction (2). On aura donc à la limite (12)
la vitesse
:
V, =
— 4®p = * (R')(M) + MRM*)(M)
P1
Chapiro (A.), Magat (M.), Sebban (J.) et Wahl (P.), Symposium international de
Chimie Macromoléculaire. Milan-Turin 1954. Supplément de la Ricerca Scientifica 1955,
(12)
p.
73.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
«m trouve pour la vitesse
et
:
v = *" (M),
'
[È + *ë£j]
pour le degré de polymérisation
el
91
DP
(II,,1)
:
(M)
kin.»
ky
.
1
I
'*,m V a
(111,2)
(M)
Ces deux équations montrent que lorsque les chaînes de polymère deviennent
très courtes, la vitesse de la réaction croît
de nouveau avec la racine carrée de
mais on n'obtient plus de polymères proprement dits mais des
dont le degré de polymérisation tend vers 1 lorsque I -> oo
telomeres
l'intensité,
«
-
(équation
III, 2).
Si l'on augmente la température, la réaction (2) sera favorisée par rapport
aux deux autres réactions compétitives (5) et (6). Il en résulte que la loi en
I
sera valable dans un domaine d'intensités plus grand. Cette remarque
n'a
explique probablement pourquoi la déviation de la loi classique en V a
jamais été observée dans les polymérisations amorcées par catalyseurs chimiques qui s'effectuent généralement au-dessus de 40-60°. Si d'autre part
on considère la polymérisation radiochimique à une intensité où la compétition est déjà effective, la vitesse doit croître plus vite que ne le supposerait l'énergie d'activation globale E = Ej,
-1/2 E, qui ne tient compte
que de l'accélération des réactions de propagation et de terminaison
1
-
'
-
—
ff
(voir III-l-D).
C.
— POLYMÉRISATION AUX CONVERSIONS ÉLEVÉES
Au cours de la polymérisation, le polymère formé s'accumule dans le milieu,
mais au lieu de jouer le rôle d'un « diluant inerte » comme dans les polymérisations amorcées par catalyseurs, il pourra être lui-même réactivé par le rayonnement et participer ainsi à la réaction d'amorçage. Il faudra donc tenir compte
de deux réactions radiochimiques primaires
:
Radiolyse du monomère
Radiolyse du polymère
:
:
M
P
>
R*GÎ!l(M)
— P
y
#
G|!l(P)
et la vitesse d'amorçage totale sera donnée par
:
V = I[GÏ(M) +GÏ(P)]
Il
en résulte
1°
que la vitesse de la réaction doit augmenter avec la conversion car le
:
polystyrolène dont la structure chimique est voisine de celle de l'isopropyl-
benzène (ou de Téthylbenzène) a un G R plus grand que le styrolène qui
fortement stabilisé par sa double liaison conjuguée avec
le
est
noyau benzé-
nique.
2°
que la masse moléculaire moyenne du polymère formé doit augmenter,
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
92
car les radicaux macromoléculaires P" formés à partir du polymère initiale-
ment présent continueront à croître en donnant des macromolécules ramifiées
de masse très élevée.
Cette augmentation de la vitesse et des masses moléculaires aux conversions élevées a été observée par Landler (7) et par Ballantine
et coll. (2).
La figure 3 représente ces résultats. On voit que pour des conversions de l'ordre
de 50 p. 100 la réaction s'accélère brusquement et que les masses moléculaires
qui étaient constantes auparavant augmentent en même temps. Remarquons
que ce phénomène
1'
«
effet de gel ».
est
probablement encore compliqué par l'existence de
En effet on avait déjà trouvé auparavant qu'en polymérisant
avec des initiateurs classiques certains monomères (méthacrylate et acrylate
30
Fig.
3.
fteures
— Variation de
la vitesse de polymérisation du styrolène et de la masse moléculaire
du polymère formé en fonction du temps d'irradiation.
Intensité 4 100 r/min;
t°
= 72 °C.
(D'après 2).
de méthyle, chloroprène, etc..) jusqu'à des taux de conversion élevés, la vitesse
et la masse moléculaire s'accroissent brusquement. Ce phénomène a été expliqué
par un ralentissement de la vitesse de terminaison (par interaction entre deux
chaînes croissantes) qui est très fortement gênée par la viscosité élevée du
milieu.
On a même réussi à reproduire cet effet en dissolvant dans le mono-
mère (méthacrylate de méthyle) un polymère inerte, ce qui augmente la viscosité du milieu (13); on a observé que dans ce cas 1' « effet de gel » se produit
dès le début de la réaction. L'accélération dans ce milieu visqueux a en outre
pour conséquence une élévation de la température due à l'impossibilité d'évacuer la chaleur de la réaction par convection. Il en résulte une accélération
supplémentaire « thermique » et on peut aboutir ainsi à des explosions.
Dans la polymérisation du styrolène, l'effet de gel n'a jamais été observé,
tout au moins en milieu bon solvant avec des initiateurs classiques. Dans la
polymérisation radiochimique par contre son existence est démontrée par une
élévation de la température qui a bien été observée (2).
On peut donc conclure de tout ceci que l'accélération observée (ftg. 3) est
due à la fois à l'accroissement de la vitesse d'amorçage (Gi'î > GÎ|) et à l'effet
(13)
Trommsdorf (E.), Lagally (P.) et Koehle (H.), Makromol. Chem., 1948, 1, 169.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS
Kt\ ÏSANTES
93
de i^t'i causé par l'augmentation anormale de La viscosité, duc elle même aux
chaînes de polymère très longues formées à partir des radicaux macromoléculaires P*.
D.
L'effet
de
— EFFET DE LA TEMPÉRATURE
température sur
la
vitesse de polymérisation radiochimique
la
du styrolène a été déterminé par Ballantine et coll. (2) à partir des mesures
faites à
18, + 25 et + 72 °G. Ces auteurs ont observé une augmentation
de la vitesse correspondante à une énergie d'activation de 6,7 kcal. Le calcul
de cette énergie d'activation a été effectué en comparant les conversions obtenues pour 1 mégarœntgen, c'est-à-dire en admettant que la vitesse de la poly-
—
mérisation était proportionnelle à l'intensité.
Tableau I.
/
<>c
— Influence de
la tempéralure sur la polymérisation du styrolène (2).
INTENSITÉ
% CONVERSION
r/mn.
en poids
RÉSULTATS RECALCULÉS
pour 4 000 r/mn.
en admettant
V = KI
fl*
— 18°
+ 25°
+ 72o
4 420
3 250
4 090
0,095
0,42
2,54
%
%
%
Si l'on corrige ces résultats
1/2
o/
/o
conversion
T
1/T
0,0911
0,470
2,52
255
298
345
3,92. 10- 3
3,36. 10-'
2,90. 10- 1
66,5
57,0
63,8
en tenant compte de la différence d'intensité
entre les trois expériences et en admettant une loi
rement valable dans ce domaine
I
1/2
qui n'est que grossiè-
expérimentaux se
rapprochent sur le graphique log V g = /(1/T) de la droite déterminant une
d'intensités, les points
énergie d'activation de 7,15 kcal (colonnes 4 et 5 du tableau). En fait le domaine
des intensités est assez mal choisi, car la dépendance de la vitesse globale de
l'intensité varie
que
beaucoup avec la température. Si l'on admet par exemple
V,aF à + 72 °C, V, a 04 à — 18 °C est V, a
I
I
045
à 25 °C, l'énergie
Le calcul exact n'est évidemment pas
possible tant que la variation de V 9 en fonction de I n'est pas connue aux
différentes températures. Tout ce que l'on peut prévoir, c'est que la valeur de
7,15 kcal constitue très probablement une limite supérieure.
Comme nous l'avons vu (Chapitre I-l-C-d) l'énergie d'activation globale E„
d'activation tomberait à 4,9 kcal.
dans le cas d'une polymérisation radiochimique est donnée par
E. = E,
1/2 E,
Dans le tableau suivant nous donnons les valeurs de E„, E
par différents auteurs.
:
t
et
E g trouvées
—
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
94
Tableau
II.
— Énergies
d' activation
dans
la
polymérisation du styrolène.
MÉTHODE
AUTEUR
Ballantine et coll. (2)
Tobolsky et coll. (14)
Radiochimique
Matheson et coll. (15)
Burnett (16)
Morton et coll. (17)
Photo-initiation
Secteur tournant
Ballantine (18)
Id.
1/P» - /(Vg)
Polymérisation en emulsion
E<
E„
__
—
< 7,15
7,76
6,3
7,4-8,4
2,37
1,9
6,57
5,35
—
~
~
3,7
5,9
-
6,3
Amorçage
radiochimique
Taylor et Vernon (19)
E,
Photochimique
On voit que l'accord est satisfaisant et qu'effectivement la valeur de E,
radiochimique constitue une limite supérieure.
RENDEMENT RADIOCHIMIQUE DE LA RADIOLYSE DU STYROLÈNE
Comme la polymérisation est une réaction en chaîne il convient d'abord de
que nous appellerons rendement radiochimique. Ce rendement G
définir ce
désigne ordinairement le nombre de molécules modifiées par 100 eV absorbés
dans le milieu. Une telle définition appliquée à la polymérisation est tout à
fait inadéquate. En effet le nombre de molécules de monomère polymérisées
est directement lié à la longueur de la chaîne cinétique.
Or cette dernière est
fonction à la fois de la température et de l'intensité. Le G basé sur une telle
définition varierait
donc dans une large mesure selon les conditions expéri-
mentales utilisées.
Gomme par ailleurs on connaît la valeur des constantes de vitesse des réactions de propagation et de terminaison (voir plus loin), ainsi que les énergies
d'activation de ces réactions, il suffit de connaître le rendement radiochimique
en radicaux libres de la radiolyse du monomère G« pour pouvoir calculer aisément le nombre de molécules transformées à n'importe quelle intensité et
température. Nous allons donc examiner dans ce qui suit les méthodes qui
permettent de déterminer les rendements radicalaires G R de l'acte radiochi-
mique primaire.
Connaissant la vitesse de polymérisation pour une intensité donnée et les
ktd (de disproportionnement et) k tc (de recombinaison) il est
constantes k P
,
possible de déterminer la vitesse d'amorçage et, partant, le nombre de radicaux
libres produits
dans le styrolène par 100 eV.
Dans le cas du styrolène, la terminaison se fait uniquement par recombiTobolsky (A. V.) et Baysal (B.), J. polym. Se, 1953, 11, 471.
Tobolsky (A. V.) et Offenbach (J.), J. polym. Se., 1955, 16, 311.
(15) Matheson (M. S.), Auer (E. E.), Bevilacqua (E. B.) et Hart (E. J.), J. Am. Chem.
(14)
Soc, 1951, 73, 1700.
(16)
(17)
(18)
(19)
Burnett (G. M.), Trans. Farad. Soc., 1950, 46, 772.
Morton (M.), Salatiello (P. P.) et Landfield (H.), J. Polym. Se, 1952, 8, 279.
Ballantine (D. S.), Rapport B. N. L. 294 (T-50), 1954.
Taylor (H. S.) et Vernon (A. A.), J. Am. Chem. Soc, 1931, 53, 2527.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
95
naison et on peut appliquer directement l'équation (I, 2). On en tire Immédia
tement
:
G ! =,
y u- k
te
,111
M (*,)>
3)
a
où I est exprimé en KM) e"V par seconde, et la seule constante qui- l'on
connaître est le rapport kt9 /kl* Malheureusement ce rapport n'est p;is bien
connu à la température de 19° G à laquelle ont été effectuées les expériences
de Chapiro et Wahl (3) qui seules justifient en toute rigueur L'utilisation de
soit vérifiée.
l'équation (III, 3) car celle-ci présuppose que la loi V^al
Jusqu'en 1955, trois valeurs au moins de k t Jkp étaient proposées, ducs à
Bamford et Dewar (20), Melville et Valentine (21) et à Matheson, Auer,
Bevilacqua et Hart (15). Les valeurs de G„ calculées en parlant de ces
données comportaient une incertitude d'un facteur six (2). Une partie de ce
désaccord était d'ailleurs due au fait que tandis que les deux premiers groupes
d'auteurs admettaient que la terminaison des chaînes se faisait par disproportionnement, Matheson et coll. admettaient une terminaison par recombinaison, mécanisme qui s'est révélé être exact par la suite. Gomme l'a
* i <
1
'
i
2
Valentine (23) si les corrections correspondantes étaient apportées
aux valeurs des autres auteurs, l'incertitude sur G„ devenait de l'ordre d'un
signalé
facteur 2,5.
Depuis, d'une part la méthode de Bamford et Dewar a été très sérieusement critiquée et des doutes ont été exprimés quant à la précision de la détermination des poids moléculaires qui sont à la base des calculs de Melville
et Valentine. D'un autre côté, Tobolsky et coll. (14) ont déduit le rapport
kv jk t à différentes températures à partir des vitesses et des degrés de polymérisation obtenus avec différents types d'amorçage chimiques et photochimiques. On a en effet, dans le cas des terminaisons par recombinaison
v
= ^ + ^-^
=
DP
1
h
h
kv
kl(MY
:
(III, 4)
et en portant 1/DP en fonction de V„ on obtient en absence de transfert par le
catalyseur une droite dont la pente donne ktc /kl(M) 2 et l'ordonnée à l'origine
la
constante de transfert par le monomère.
Tobolsky et Offenbach (14) trouvent ainsi
^? = 5,68. 10
-6
:
exp [12,46/RT]
K
tandis qu'à partir des données de Matheson et coll. (15) on trouve
:
= 2,77. 10 - exp [13,15/RT].
6
7*f
kv
(20)
(21)
(22)
Bamford (C. H.) et Dewar (J. S.), Farad. Soc. Discuss., 1947, 2, 310.
Melville (H. W.) et Valentine (L.), Trans. Farad. Soc, 1950, 46, 210.
Prevot-Bernas (A.), Chapiro (A.), Cousin (C), Landler (Y.) et Magat (M
Farad. Soc. Discuss., 1952, 12, 98.
(23) Valentine (L.), Farad. Soc. Discuss., 1952, 12, 131.
),
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
96
Rendements radiochimiques de la radiolyse du styrolène.
Tableau
INTENSITÉ
AUTEUR
17
Chapiro (*)
Ghapiro
et Wahl
3
(
)
mn
7
ktlkl
a d6)
ib)
&<">
a'
b
W
15°
26 000 15 500 0,83.
0,50
0,39
0,41
0,56
0,72
0,78
1,55
2,25
5,50
19°
21000 12 000 0,55
0,31
0,33
0,54
0,36
0,30
0,33
0,34
0,33
0,35
0,32
0,30
0,30
0,26
0,27
44,2
49,0
71,6
75,2
95,5
25»
705
160
1 680
2 360
3 830
5 150
3 160
1
>)
1
1,08
1,13
1,45
1,57
1,50
2,20
2,71
4,16
5,76
8,0
16,5
21,6
26,4
35,8
480
J
sec
2,0
96
165
285
coll. (*>
x io
Ga
1
>w
1
I
1,13
10
20,8
Ballantine et
u
S
s
&
S h
V
mol.
0,57
0,93
0,64
0,53
0,58
0,60
0,58
0,61
0,56
0,53
0,52
0,45
0,48
13 000
7 300
0,31
0,23
0,34
0,26
0,27
0,28
0,36
115
101
0,17
0,13
0,19
0,14
0,15
0,16
0,20
Nikitina et Bag-
DASARIAN ( 4 )
Chapiro
et
Seb-
'
2 260
84,2
25°
6 300
9 600
169 (?)
143
215
20°
ban-Danon ( 6 ) '19 560
34 000
Seitzer et Tobol-
SKY (
?
0,36
19 000 11 000 0,75(?)
0,35
0,38
228
3,35.10-» mol/sec
0,25
30° 5
4 550
0,20
0,43
0,20
0,22
0,14
0,22
10
Si l'on
)
applique l'équation (III, 4) aux résultats de Chapiro et Wahl (3)
(amorçage par rayonnement à 19°), on trouve que le point correspondant est
en parfait accord avec l'équation de Matheson et coll. et sensiblement plus
élevé que la droite de Tobolsky et Offenbach. Dans l'impossibilité de décider
à priori entre les deux équations nous avons recalculé les valeurs de G R à
partir des données expérimentales disponibles en utilisant les deux séries de
constantes. Ces résultats figurent dans le tableau III.
Plusieurs remarques se dégagent de l'examen de ce tableau
1° La valeur de G R est sensiblement constante pour les intensités inférieures
à 100 r/mn; la dispersion des points est due au fait que dans le calcul de G R
:
la vitesse
de polymérisation intervient au carré.
2° G R décroît pour les intensités supérieures à 100 r/mn environ.
3°
Il
existe une incertitude d'un facteur 1,7 sur la valeur de
G R due à l'in-
certitude sur k t /k'p.
En tenant compte de tout ce qui précède, on peut conclure que la valeur
réelle
du rendement radiochimique de la réaction
M
R#
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
97
ne peut être calculée à L'aide de L'équation (II, 2) qu'à partir des expériences
effectuées aux petites intensités. D'après les données du tableau Mi. Le G,
du styrolène est
éj4al
11 "
g;!
N'dus
à
1
l'une des valeurs suivantes
"""
- 0,60
on
v
verrons ci-dessous (Chapitre V-l) que
çHtyroièm
_ ng
q ui ca<j re
[
e
'" lrl
(;;;
:
"
c'est
0,35.
la
valeur
la
plus élevée
mieux avec d'antres résultats expérimentaux.
variation du g^'" "" en (onction de l'intensité
1
La
figure 5 (p.
des rayons
1<><>)
illustre
la
y-
— POLYMÉRISATION DU MÊTHACRYLATE
//.
DE METH YLE
A.
— GÉNÉRALITÉS. INFLUENCE DE L'INTENSITÉ
La polymérisation de ce monomère par les rayons y a également été étudiée
dans un très grand domaine d'intensités (4, 5, 6, 24). Les résultats sont représentés sur la figure 4. Tous les points expérimentaux ont été recalculés pour
Mn
10 5
10000
Fig. 4.
t,
r/mn
— Vitesses de polymérisation de l'acétate de vinyle VA) et du méthacrylate de méthyle
(
(MM A) et masses moléculaires du polyméthacrylate de méthyle formé en fonction de l'intensité
des
rayons
y.
(Résultats recalculés pour 19° C d'après
1,
4,
5,
6,
24).
19° en admettant pour l'énergie d'activation globale la valeur 4,9 kcal. La
forme de la courbe des vitesses rappelle tout à fait celle du styrolène (figure 2).
Aux intensités inférieures à 75 r/mn environ, la vitesse suit la loi en I
(24)
l/2
;
pour
Chapiro (A.) et Migirdicyan (E.), J. Chim. Phys., 1955, 52, 439.
HAISSINSKY.
III.
7
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
98
des intensités supérieures on observe une déviation de cette loi et la vitesse
croît
En
moins vite que
I
12
.
ce qui concerne les masses moléculaires, les points
—
expérimentaux se
0,26. La déviation de la loi en V est donc
placent sur une droite de pente
ici beaucoup plus nette et apparaît pour des intensités plus petites.
1 '-
La polymérisation du méthacrylate de méthyle a également été étudiée
par Seitzer et Tobolsky (10) avec des rayons (3.
Par ailleurs Nikitina et Bagdasarian (4) ont montré qu'en combinant
les vitesses globales et les masses moléculaires du polymère formé, il était
possible de tracer une courbe sur laquelle se plaçaient tous les points expéri-
mentaux obtenus avec des modes d'amorçage divers (photochimique, catalytique et radiochimique). Ce résultat montre que pour une vitesse de poly-
mérisation donnée, la masse moléculaire du polyméthacrylate de méthyle
formé est « normale ». Dans le cas du styrolène nous avions déjà implicitement
supposé une
relation.
telle
Enfin, Majury (25) a étudié la polymérisation du méthacrylate de méthyle
qui se produit après irradiation sous vide avec des doses assez élevées (10 4
à 10 6 rep), accumulées en un temps très court (quelques microsecondes). Cet
auteur a observé que la polymérisation se poursuivait pendant plusieurs jours
après l'arrêt de l'irradiation. Étant donné que l'irradiation ne conduit qu'à
de faibles degrés de conversion, le phénomène observé ici est très différent de
post-polymérisation que l'on observe lorsque le polymère formé rend le
la
milieu très visqueux (effet de gel).
Une explication possible de cet effet serait,
qu'aux intensités énormes utilisées, certains radicaux primaires se recombinent en donnant des structures instables capables de se décomposer lentement ensuite. Une réaction de ce type pourrait donner par exemple naissance
à un peroxyde par la suite des réactions
:
GH
CH
3
/°
3
GH = C — C yt°
GH, = C -- C(
1
1
CH'
2
0;CH 3
CH
CH
GH = C — C /x
3
2
,o
GH = c— -or
1
2
3
GH
2
O'
3
!
/O
GH = C — Cs.
^0
1
2
encore
:
GH
CH
3
//°
CH = C — CT + GH
CH = C — Gx
2
x/OCH
\'OCH
2
3
1
2
#
3
•
8
3
GH 0* --+ CH — O — O — GH
3
3
3
Mais la confirmation de cette hypothèse nécessite une étude plus approfondie de ce système.
(25)
Majury (T. G.), J. Polym. Se, 1955, 15, 297.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
99
— POLYMÉRISATION AUX CONVERSIONS ÉLEVÉES
B.
Tout comme dans
le
cas du styrolène,
la
polymérisation du méthacrylate
de méthyle s'accélère après un certain degré de conversion (1, 2). Mais le phé
nomène apparaît Ici, pour des conversions beaucoup plus petites en raison de
la
forte tendance de ce
monomère à produire l'effet de gel. Si la réaction est
effectuée en solution dans
ce qui confirme
que c'est
le
benzène, l'accélération ne
l'effet
se
produit
plus (1)
de gel qui est principalemnl responsable de
observée.
l'accélération
C — EFFET DE LA TEMPÉRATURE
Ballantine
méthyle à —
(2)
ont étudié la polymérisation du méthacrylate de
18, 25 et 72°.
A partir des résultats de ces trois mesures, on peut
et
coll.
calculer une énergie d'activation de 4,25 kcal. Cette valeur est en très
bon
accord avec les valeurs déterminées par Magkay et Melville (4 kcal) et par
Matheson et coll. (27) (4,9 kcal), en utilisant des agents d'amorçage convenRappelons toutefois que comme pour le styrolène, la valeur trouvée
tionnels.
à partir des expériences radiochimiques, effectuées à des intensités trop élevées, doit être considérée comme fausse par excès pour les raisons déjà exposées (III-l-D).
D.
— RENDEMENT RADIOCHIMIQUE DE LA RADIOLYSE
DU MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE
Comme pour le styrolène, la valeur du G K pour le méthacrylate de méthyle
peut être calculée à partir de la vitesse de polymérisation à l'aide de l'équation (III, 3).
La constante k'plk du méthacrylate de méthyle a été déterminée par Matheson et coll. (27) et par Baysal et Tobolsky (14) à différentes températures.
L'accord entre les résultats des différents auteurs est ici meilleur que dans le
cas du styrolène. Nous avons rassemblé dans le tableau IV les valeurs de G R
calculées à partir des données expérimentales des différents auteurs.
Nous retrouvons ici un résultat analogue à celui que nous avons déjà observé
pour le styrolène. Le G R calculé d'après l'équation (III, 3) est à peu près constant pour les intensités inférieures à 75 r/mn et égal à 10-15. La dispersion
des valeurs est due au fait que les erreurs expérimentales sont amplifiées par
le calcul, étant donné que le G K est proportionnel au carré de la vitesse. Pour
t
les
intensités plus élevées, le
'
G R décroît régulièrement, conformément à la
théorie exposée antérieurement (I-l-C-c). On peut en conclure qu'il n'y a pas
de divergence importante entre les résultats des différents auteurs.
(26)
(27)
Mackay (M. H.) et Melville (H. W.), Trans. Farad. Soc, 1949, 45, 332.
Matheson (M. S.), Bevilacqua (E. B.), Auer (E. E.) et Hart (E. J.), J. Am. Chem.
Soc, 1949, 71, 497.
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES
100
Rendements radiochimiques de la radiolyse du méthacrylate de méthyle.
Tableau IV.
INTENSITÉ
r/mn
Chapiro ( )
CHAPIROetMlGIRDICYAN ( 24 )
Ballantine et
5
(
)
Nikitina et BagDASARIAN ( 4 )
Chapiro et Seb-
ban-Danon ( 6 )
Seitzer
rS
l
1
sec
w
2,4
3,89
4.15
6,48
13,0
19,5
28,5
38,8
62,1
67,3
75,5
84,0
86,5
99,0
GR
ktlk],
*
x 10 6
233
307
470
470
540
1 000
1 680
2 360
4 160
4 160
650
2 260
6 300
9 600
19 560
To-
et
V mol
1,13
0,58
0,86
1,72
5,05
16,0
26,0
76,0
x
coll.
Pl'RS
W %
a
15°
19°
790
600
(r
'
]
b
W
720
550
25°
470
400
91,3
25°
430
400
143,5
178
20°
570
530
132
152
195
211
a
>
9,8
14,4
11,2
14,0
17,7
13,0
17,0
11,0
9,2
8,4
6,7
8,3
5,5
4,0
4,1
3,8
3,6
4,2
5,3
3,6
2,7
223
238
2,7
1,6
53 x 10- 3 mol/sec
?
<r
30° 5
280
9,0
13,2
10,2
12,8
16,2
11,9
15,6
10,0
8,4
7,7
6,1
7,6
5,1
3,6
3,7
3,5
3,2
3,8
4,8
3,2
2,5
2,5
1,4
3,14
BOLSKY ( 10 )
<
MMA
12,5
•
IL)
*•
•
%•
^--4
^
^W^
St
1
"0,6
A*.*
w
^ ••
•*"ir-]
^%^
r
1
10
100
1000
10000
ir/mn
—
Fig. 5.
Variation des rendements radiochimiques de la radiolyse du styrolène (St) et du
méthacrylate de méthyle (MMA), calculés à l'aide de l'équation (III, 3), en fonction de l'intensité des
rayons
y.
Les Gr ont été calculés en prenant pour kjk'' les
tableaux III et IV).
valeurs de
Matheson
et coll. (voir
Remarquons enfin que les valeurs de G R déduites par nous des expériences
de Ballantine et
coll.
diffèrent sensiblement des valeurs
données par les
auteurs eux-mêmes (2, 5). Gela tient au fait que nous avons calculé les G R en
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
tenant compte du rapport entre
les
terminaisons par recombinaison
KM
e1
par
disproportionnement qui a été déterminé expérimentalement (28, *2 .)).
La figure 5 illustre graphiquement les résultats rassemblés dans
(
le
tableau IV.
La valeur G„ = 3,14 trouvée par Sbitzeb
et
TOBOLSK?
(10) est
trois
;i
quatre fois plus petite que le G„ trouvé à partir des expériences avec les rayons
7 effectuées à la même intensité moyenne. Nous avons vu (pic Les expériences
ont été effectuées avec un très important gradient des intensités et (pie la
dosimetric était incertaine; il est possible d'autre part que le phénomène de
saturation
«
les
il
»
qui apparaît aux fortes intensités se produise également dans
zones de liquide qui se trouvent au voisinage immédiat de la source. Enfin
est difficile de déduire
une valeur de G R des expériences de Majury (25)
avec des électrons puisés en raison des conditions expérimentales très particulières dans lesquelles s'est placé cet auteur.
///.
— POLYMÉRISATION
DE U ACETATE DE VIN YLE
11 n'existe que peu de données expérimentales sur la polymérisation radiochimique de l'acétate de vinyle. Chapiro (1) a décrit quelques expériences
effectuées à
une très petite intensité de rayons y (1,13 r/mn), Nikitina et
Bagdasarian (4) ont polymérisé ce monomère dans un domaine d'intensités
de rayons y assez étendu (28-2 260 r/mn). Quelques expériences ont été dé-
également par des auteurs japonais (30). Ces résultats sont rassemblés
dans le tableau V et sur la figure 4. Rappelons que Chapiro (1) a trouvé pour
la polymérisation de ce monomère un effet de gel très prononcé et a obtenu
un polymère réticulé insoluble, tandis qu'ordinairement la polymérisation de
crites
monomère est exempte d'effet de gel.
Nikitina et Bagdasarian (4) ont déjà observé que le G R de la radiolyse
de ce monomère décroît avec l'intensité. Nous avons recalculé l'ensemble des
ce
résultats en prenant k t /k*
= 58 d'après les déterminations de Matheson et
de Bartlett et coll. (32). Nous avons également tenu compte du
rapport recombinaison/disproportionnement = 40/60 de la réaction de terminaison (33).
coll. (31) et
Bevington (J. C), Melville (H. W.) et Taylor (R. P.), J. Polym. Se, 1954, 12,
449; 1954, 14, 463.
(29) Allen (P. W.), Ayrey (G.), Merrett (F. M.) et Moore (C. G.), ./. Polym. Se, 1956,
22, 549.
(30) Okamura (S.), Yamashita (T.) et Higashimura (T.), Bull. Soc. Chim. Japon, 1956.
29, 617.
(31) Matheson (M. S.), Bevilacqua (E. B.), Auer (E. E.) et Hart (E. J.), J. Am. Chem,
Soc, 1949, 71, 2610.
(32) Kwart H., Smith-Broadbent (H.) et Bartlett, (P. D.) J. Am. Chem. Soc, 1950,
72, 1060.
(33) Burnett (G. M.), George (M.) et Melville (H. W.), J. Polym. Se, 1955, 16, 31.
(28>
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
102
— Rendement radiochimique de
Tableau V.
I
AUTEURS
Chapiro ( )
x
Nikitina
et
_1
sec
-1
radiolyse de l'acétate de vinyle
TEMPÉRATURE
hlkl
GR
15°
25°
220
58
8,6
12,1
11,6
9,1
6,25
13,5. 10- 6
1,13
141. 10- 6
352. 10- 6
642. 10- 6
912. 10- 6
28
187
BagdasaRIAN ( 4 )
V. mol 1
r/min.
la
650
2.260
On peut voir que l'on retrouve le même résultat que pour le styrolène et le
méthacrylate de méthyle
:
G R décroît pour les intensités élevées.
le
La valeur de G R trouvée aux petites intensités
G Acétate
:
10-12.
I!
du Qj elhaap y ,ite Ce résultat peut être considéré comme « normal ».
étant donné que ces deux composés ont une structure chimique assez voisine.
est voisine
IV.
.
POLYMÉRISATION DE L'ACRYLATE
DE METHYLE
La polymérisation de l'acrylate de méthyle n'a été étudiée systématiquement que par Schmitz et Lawton avec des électrons accélérés (800 kV) (34).
Ces auteurs ont observé que la polymérisation était accélérée par l'élévation
de la température, mais qu'elle se produisait également à des températures très
—
81° G). L'irradiation du monodu point de fusion (
mère solide ne conduit pas à une polymérisation immédiate, mais à la forma-
basses, juste au-dessus
tion de radicaux libres qui restent gelés à basse température. Ces radicaux sont
susceptibles d'amorcer la polymérisation lorsque l'on rechauffe
le
système.
A partir des données de ces auteurs Chapiro (35) a calculé une énergie d'activation globale de 5,9 kcal/mol, qui est à comparer à
E„ = E,
1/2 E,
= 4,5 kcal
trouvée par Matheson et coll. (36) pour la polymérisation photochimique.
Étant donné que la variation de la vitesse de polymérisation avec l'intensité
est plus voisine de I 1/2 à haute température et tend vers 1° à basse température (voir la discussion I-l-C-c), l'écart entre les deux énergies d'activation
est normal et son sens est conforme à la théorie.
Le calcul de G R à partir des vitesses de polymérisation obtenues par Schmitz
(34)
Schmitz (J. Y.) et Lawton (E. J.), XII e Congrès International de Chimie Pure
Appliquée, New- York, 1951.
(35)
Chapiro (A.),
Ind. Plast. Modernes. 1956, 8, n° 9, 67.
et
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
et Lawton (34) n'est pas possible en raison de
tante qui suit
thyle, L'effet
c'est
ainsi
les
la
post polymérisation
103
Impor
irradiations très brèves et parce que, pour l'acrylate de tné
de gel Intervient déjà
que Matheson
et
à
des degrés de conversion
ont trouvé que kpl2k
coil. (36)
plus élevé pour une conversion de 3-4
t
100 qu'en dessous de
p.
t
its
était
l
p.
faibles;
deux
fois
100 el ceci
à une température de 50°C, supérieure à celle des expériences de Schmitz
Lawton. Chapiro (1) a effectué une expérience isolée à 15° avec un rayon
nement y de faible intensité. En utilisant les données de MATHESON et coll.
('-
et
(36) (2*|
*•/
200) on peut en déduire
G,V
r>
",c ""
:
" ,x "
8,3.
Matheson (M. S.), Auer (E. E), Bevilacqua (E. B.) et
Soc, 1951, 73, 5395.
<;*(;>
Hart (E. .J.). ./. Am. Chem.
CHAPITRE IV
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
EN MILIEU NON HOMOGÈNE ET A L'ÉTAT SOLIDE
POLYMÉRISATION DE L'ACRYLONITRILE
A.
— GÉNÉRALITÉS SUR LA RÉACTION
Avec Facrylonitrile, nous abordons un monomère dont la polymérisation
est plus complexe. En effet le polyacrylonitrile étant insoluble dans son propre
monomère, il précipite sous forme de poudre fine au fur et à mesure de sa formation et la polymérisation s'effectue en phase hétérogène. Il en résulte un
certain
nombre d'anomalies qui sont caractéristiques des polymérisations en
milieu précipitant.
En particulier, comme nous l'avons déjà signalé (I-l-D),
l'état quasi-stationnaire n'est jamais atteint
ou n'est atteint qu'à des degrés
de conversion élevés. En portant la conversion en fonction du temps d'irradiation on constate que la réaction présente une période d'induction suivie d'une
longue partie linéaire pendant laquelle la polymérisation s'effectue avec une
vitesse constante.
B.
— POST-POLYMÉRISATION
Si l'on arrête l'irradiation à
une conversion donnée la réaction se poursuit
à l'obscurité pendant un temps très long (plusieurs mois) (1, 2). Cette « postpolymérisation » peut s'interpréter en admettant que la réaction de terminai-
son des chaînes croissantes est fortement gênée par la précipitation et que le
dû à la croissance des chaînes « gelées » dans le sys-
post-effet observé est
tème (1, 2). Un phénomène analogue a été observé pour la polymérisation
photochimique de ce même monomère (3 a) et la présence de radicaux libres
de très longue durée de vie a été démontrée directement en étudiant la résoChapiro (A.), J. Chim. Phys., 1950, 47, 747, 764.
Bensasson (R.) et Prevot-Bernas (A.), J. Chim. Phys., 1957, 54, 479.
(3 a) Bamford (C. H.) et Jenkins (A. D.), Proc. Roy. Soc, 1953, A-216, 515.
(1)
(2)
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS ÎONISANTES
L05
nance paramagnétique du s> stème ('A b) et la réaction avec le diphénj Ipicrç Ihj
drazyle (3 c).
La cinétique de la post-polymérisation a été étudiée en faisant
degré de conversion et L'intensité du rayonnement
(2).
varier
Le
Les résultats montrent
que la réaction ne peut s'interpréter qu'en première approximation en admel
tant une croissance « normale » des chaînes occluses.
C.
— INFLUENCE DE L'INTENSITÉ
La polymérisation radiochimique de l'acrylonitrile en masse a été étudiée
par Chapiro (1), Berstein et coll. (4), Prevot-Bernas et coll. (2, 5) et Chapiro et Sebran-Danon (6). Tous ces auteurs ont utilisé des rayons
ou des
rayons X durs et les intensités étaient comprises entre 0,39 et 19 600 r/min.
-.-
Pour comparer les vitesses en fonction de l'intensité du rayonnement, les
—
Vitesse de polymérisation du chlorure de vinyle ( VC) (11) et de l'acrylonitrile AN)
masse moléculaire du polyacrylonitrile formé en fonction de l'intensité des rayons y.
Fig. 6.
et
|
Courbe 1 d'après (5,
Courbe 2 d'après (4).
6).
auteurs ont choisi soit la pente de la partie linéaire de la courbe de conversion (5, 6), soit la conversion pour un
temps d'irradiation donné (1), soit la
pour une dose de rayonnement
donnée (4); aussi est-il difficile de comparer entre eux les résultats des différents auteurs. Néanmoins la loi de variation de la vitesse en fonction de l'in-
vitesse initiale (5), soit enfin la conversion
tensité
semble assez bien établie
Prevot-Bernas et Serran-Danon (5)
08
loi en I
entre 0,39 et 485 r/min (fig. 6), tandis que d'après
:
trouvent une
(3 b) Bamford (C. H.), Jenkins (A. D.), Ingram (D. J. E.) et Symoxs (M. C. H.,) Nature
1955, 175, 894.
(3 c) Bamford (C. H.) et Jenkins (A. D.), Proc. Boy. Soc, 1955, A-228, 220.
(4) Berstein (I. A.), Farmer (E. C), Rothschild (W. G.) et Spalding (F. F.), J. Chem.
Phys., 1953, 21, 1303.
(5) Prevot-Bernas (A.) et Serran-Danon (J.), J. Chim. Phys., 1956, 53, 418.
POLYMÉRISATION DUS MONOMÈRES PURS
1(H)
les résultats deBERSTEiN et coll. (4) on peut calculer une loi en I
07
basée sur cinq
points expérimentaux entre 1,6 et 157 r/min (fig. 6). Des expériences récentes (6)
ont montré que, tout comme pour les polymérisations en milieu homogène,
apparaît une déviation de la droite de pente 0,8 lorsque l'irradiation est
il
effectuée à des intensités élevées, supérieures à 1 000 r/min environ (fig. 6).
La masse moléculaire du polyacrylonitrile décroît lentement avec l'intenon trouve une loi en I -012 (5) (fig. 6).
Une tentative a été faite par Durup et Magat (7) pour interpréter quantitativement ces résultats. Ces auteurs ont admis que la terminaison des chaînes
croissantes se faisait exclusivement par recombinaison avec des radicaux
primaires. Une telle hypothèse paraît justifiée car la recombinaison de deux
chaînes croissantes précipitées est certainement très improbable en raison
de la configuration en pelote compacte des macromolécules précipitées. Les
auteurs ont alors intégré le système des équations différentielles formé par
sité;
les
expressions des vitesses des réactions élémentaires, sans utiliser l'hypo-
thèse de l'état stationnaire pour les radicaux RM*.
Ils
ont ainsi obtenu une
expression qui rend compte de la loi en I0,8 Cependant le domaine de validité
.
de la loi en
ne
I '
8
le laisserait
Il
trouvé expérimentalement est sensiblement plus étendu que
prévoir la théorie
(5).
est possible que le phénomène soit plus complexe et qu'il y ait une contri-
bution d'un autre type de terminaison par « enterrement » des chaînes croissantes dans le polymère précipité comme l'ont suggéré Bamford et coll. (3 a).
Cependant la simple introduction d'un tel mode de terminaison dans le schéma
(4, 8) ne semble pas pouvoir rendre compte des expé-
cinétique classique
riences radiochimiques (5).
— RENDEMENT RADIOCHIMIQUE DE LA RADIOLYSE DE L'ACRYLONITRILE
D.
Étant donné que la cinétique de la polymérisation de l'acrylonitrile n'a pas
encore reçu d'interprétation théorique satisfaisante
il
n'est pas possible de
rendement radiochimique de la réaction à partir de la vitesse de
polymérisation comme nous l'avons fait pour les monomères dont la polymérisation s'effectue en milieu homogène.
Plusieurs évaluations semi-quantitatives sont néanmoins possibles mais
calculer le
les
méthodes de calcul n'étant pas rigoureuses il faut considérer ces résultats
avec la plus grande prudence.
Une première méthode est basée sur l'étude de la polymérisation en soluOn peut en effet déduire le G R relatif du monomère et du solvant à partir
tion.
de la vitesse de polymérisation en admettant un schéma cinétique très simple
appliquant l'hypothèse de l'état stationnaire (voir Chapitre V). Un tel
traitement ne peut s'appliquer à l'acrylonitrile dont la cinétique de polymérisation ne présente pas d'état stationnaire. Cependant si l'on admet en preet en
mière approximation que la perturbation introduite par la précipitation n'est
Ghapiro (A.) et Sebban-Danon (J.), J. Chim. Phys. 1957, 54, 763.
Durup (J.) et Magat (M.), J. Polym. Se, 1955, 18, 586.
(S) Thomas \\
M.), Pellon (.J. J.), /• Polym. Se, 1954, 13, 329.
(6)
(7)
(
.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
pas modifiée sensiblemenl
L07
par l'addition de petites quantités d'un solvant
convenable, on peut espérer obtenir une estimation du rapport des (i en appliquant l'équation (V, 1) au rapport des vitesses obtenues en presence et en
1(
absence de solvant. Des expériences dans ce sens ont été effectuées en ajoutant
p. 100 de methanol (1). On a observé ainsi une augmen
à l'acrylonitrile 20
tation de vitesse d'un facteur
1,8,
Gïéth
En prenant pourle G',"'"
on trouve
'',
ce qui correspondrait
a C,,y,0M,tr,,e
'
/G R
à
un rapport
:
- 10.
rapporté à un G|.v
.
=
,
15,5, la valeur
1
4,7 (9),
:
Gacrvlonltrilo
it
r
= 1,5.
-%
Une deuxième méthode (10) permet de calculer le nombre n de macromodonné à partir du poids du polymère formé P et de sa masse moléculaire moyenne M n Si l'on néglige la réaclécules formées pour un temps d'irradiation
.
tion de transfert,
on a en effet
:
n =
=.N
N est le nombre d'Avogadro.
où
Si la réaction
monomère n'est pas négligeable il faut
de transfert par le
remplacer M n par M n
qui est la valeur qu'aurait la masse moléculaire en
absence de transfert.
Cette méthode également n'est applicable en toute rigueur que
thèse
est
de l'état stationnaire est vérifiée.
si
l'hypo-
En effet, dans le cas contraire M n
une fonction de la conversion et la masse moléculaire mesurée à la fin
de la réaction, correspond à une fonction complexe des M n instantanés. Cependant cette méthode permet d'obtenir une estimation de n.
Si nous prenons les résultats des auteurs cités ci-dessus (5, 10) nous voyons
par exemple, que pour une intensité de 1,15 r/min il se forme en 10 heures
0,42 p. 100 de polymère d'une masse moléculaire de 1 065 000. En tenant
compte de la constante de transfert C tr = 1,8. 10 5 trouvée par ces mêmes
auteurs, on trouve
M B = 2,2.10
6
.
Le poids de polymère formé par minute et
par gramme de monomère est donc
:
0,42
100 x 10 x 60
et le nombre
de chaînes par gramme et par minute
n =
:
.
0,42 x 6.02.10 23
.
no iA12
= ,1,92.
10 12 chaînes.
100 x 10 x 60 x 2,2. 10 6
Bouby (L.), Chapiro (A.), Magat (M.), Migirdicyan (E.), Prevot-Bernas (A.),
Reinisch (L.) et Sebban (J.), Actes de la conférence internationale sur l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques. Genève 1955. Nations-Unies, Genève 1956. Volume 7. Édition française p. 612.
(9)
(10)
Prevot-Bernas (A.)
Thèse, Paris 1956.
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
108
L'énergie absorbée par gramme de monomère et par minute est
1,15
:
x 6 x 10 13 = 6,9. 10 13 eV.
Pour 100 eV et par gramme de monomère, il se forme donc 2,8 chaînes.
Il serait facile de déduire le G R de l'acrylonitrile du résultat précédent si
:
nous connaissions le nombre de radicaux libres primaires par chaîne de polymère.
Or, pour cela il faudrait connaître le mécanisme de la réaction de terminaison.
En effet chaque chaîne de polymère correspond à un radical primaire si la
terminaison se fait par disproportionnement ou par « enterrement » et à deux
radicaux primaires si les chaînes croissantes sont terminées par recombinaison
entre elles ou avec un radical primaire.
Il
y a donc une incertitude d'un fac-
teur deux sur le G R de l'acrylonitrile déterminée par cette méthode; selon la
contribution
G»
iyloni " il ''
des
modes de terminaison on aura une valeur de
différents
comprise entre 2,8 et 5,6.
Ces valeurs sont sensiblement plus élevées que la valeur G» (, y |onit,ilc = 1,5
calculée par la méthode précédente.
//.
POLYMÉRISATION DU CHLORURE
DE Y IN YLE
La polymérisation radiochimique du chlorure de vinyle liquide a été étudiée
par Chapiro (11) quia amorcé la réaction avec des rayons y (voir aussi (12)).
D'autre part Mund et coll. (13) ont étudié la polymérisation de ce même monomère en phase gazeuse avec les rayons a du radon (voir « Actions chimiques
et biologiques des radiations
»,
2 e série).
La polymérisation en phase liquide rappelle par
certains
côtés
la
polymérisation de l'acrylonitrile (voir IV-1). C'est ainsi que le polymère pré-
forme de poudre fine, ce qui perturbe profondément la cinétique
On constate comme pour l'acrylonitrile, que la vitesse n'est
pas constante au cours du temps; mais tandis que dans le cas de l'acrylonitrile
la vitesse tend vers une valeur quasi-constante après une période d'induction r
dans le cas du chlorure de vinyle, l'accélération se manifeste encore pour des
taux de conversion très élevés (supérieurs à 85 p. 100) (11). De même on constate une post-polymérisation mais celle-ci est moins importante que dans le
cipite sous
de la réaction.
cas de l'acrylonitrile. Enfin la
l'intensité est de la
loi
de variation de la vitesse en fonction de
forme V = Kl 0,69 (fig.
6)
tandis que pour l'acrylonitrile
on avait trouvé une loi en I 8
La forme des courbes de conversion expérimentales obtenues en amorçant
»
.
(11)
(12)
(13)
Chapiro (A.), J. Chim. Phys., 1956, 53, 512.
Saint-Gobaix, Brevet Fr. 1.121.084 (1955).
Mund (W.,) Van Meerssche (M.) et Momigny
62, 109.
,
J. Bull. Soc.
Chim. Belg., 1953^
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
la réaction
109
avec des catalyseurs chimiques a pu être Interprétée quantitatl
vement par Magat (14) en admettant que la terminaison des chaînes se rai
sait
par interaction mutuelle
et
système des équations ciné
Il semble doue que
moins entravée dans la polymérisation de ce
en Intégrant
le
tiques sans faire appela l'hypothèse de l'étal stat ionnaire.
la
réaction de terminaison soit
monomère que dans celle de l'acr\ lonit lile. Cette observation doit être rapprochée du
fait que le chlorure de vinyle est un agent de transfert 1res efficace
que par conséquent il existe à chaque instant un nombre élevé de chaînes
très courtes (formées par transfert) qui peuvent plus facilement diffuser dans
et
le
milieu, ce qui favorise la réaction de terminaison.
La masse moléculaire du polymère formé dépend peu de l'intensité du rayonnement car elle est presque entièrement déterminée par la réaction de transfert.
///.
— POLYMÉRISATION DE METHYLENE
La polymérisation de l'éthylène se distingue quelque peu de la polymérisation des autres monomères vinyliques examinés ci-dessus. En effet au-dessus
de 9,7° l'éthylène est un gaz et si l'on veut effectuer la polymérisation avec
des concentrations de monomère suffisamment grandes, il est nécessaire d'opérer sous des pressions très élevées. C'est ainsi que pour la préparation industrielle
du polyethylene, on utilise de petites quantités d'oxygène comme cata-
lyseur et la réaction est effectuée sous des pressions comprises entre 500 et
3 000 atmosphères.
Les premiers essais de polymérisation radiochimique de l'éthylène ont été
effectués avec des rayons a (15) et des électrons (16) (17) à des pressions de
Tordre de 1 atmosphère et en dessous. Dans ces conditions, les auteurs n'ont
obtenu que des produits de bas poids moléculaire qui se présentaient sous
forme de liquides huileux à faible tension de vapeur.
Plus récemment la polymérisation de l'éthylène, amorcée par les rayons X
et y, a été étudiée par de nombreux auteurs dans un très grand intervalle de
températures et de pressions (18-25), et on a obtenu dans certaines conditions
des polymères de masse moléculaire élevée et présentant une grande pureté.
,
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Magat (M.), ./. Polym. Se, 1955, 16, 491.
Lind (S. C.), Bardwell (D. G.) et Perry (J. H.), J. Am. Chem. Soc, 1926, 48, 1556.
Goolidge (W. D.), Science, 1925, 62, 441.
McLennan (J. G.) et Patrick (\V. L.), Can. J. Research., 1931, 5, 470.
Lewis (J. G.), Thèse, 1954. University of Michigan.
(19) Lewis (J. G.), Martin (J. J.) et Anderson (L. G.), Chem. Eng. Progr. 1954, 50,
249.
(20)
Anderson (L. G.), Bray (B. C.) et Martin (J. J.). Conference Internationale sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins spécifiques,
Genève 1955, n° 8-P-168.
(21) Hayward (J. G.) et Bretton (R. H.), Chem. Eng. Progr., 1954, 50, 73.
0-3313.
(22) Hayward (J. C.), Thèse, 1955. Yale University,
(23) Imperial Chemical Industries. Brevet Brit. 714.843 (1952); Brevet Fr. 1.062.004 (1954).
(24) Monsanto, Brevet Fr. 1.096.745 (1955).
(25) Laird (R. K.), Morrell (A. G.) et Seed (L.), Farad. Soc. Discuss., 1956, 22, 126.
NY
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRIÏS
110
r
I>l
RS
Cependant, malgré le nombre élevé de travaux consacrés à la polymérisation radiochimique de ce monomère, le mécanisme de la réaction reste encore
obscur. Ceci résulte d'une part de la complexité de la réaction et du manque
de données expérimentales sur la polymérisation de l'éthylène, avec des modes
d'amorçage conventionnels; mais d'autre part les expériences radiochimiques
étaient, elles aussi, souvent incomplètes ou effectuées avec un monomère
insuffisamment purifié.
Enfin dans le domaine de températures et de pressions généralement étudié,
l'éthylène ne se
comporte aucunement comme un gaz parfait et sa densité,
qui détermine la concentration du monomère, n'est pas une fonction simple
de la pression. Cette circonstance, qui complique souvent le résultat global des
expériences, n'a pas toujours été réalisée par les différents auteurs.
A.
— GÉNÉRALITÉS SUR LA RÉACTION
La polymérisation de l'éthylène s'effectue en milieu non homogène. En effet
le polymère formé se
sépare de la phase gazeuse et se dépose sur les parois du
réacteur. Les chaînes croissantes restent noyées dans ce dépôt et ont une durée
de vie très longue (26). La réaction présente une période d'accélération et
une post-polymérisation comme la plupart des polymérisations en milieu
précipitant (26). Aux températures inférieures à 115° environ, le polyethylene
renferme une proportion importante de zones cristallines. Au-dessus de cette
température les cristallites fondent et le polymère amorphe devient soluble,
ce qui favorise en particulier la pénétration du monomère dans le dépôt de
polymère. Au-dessus de 180° les courbes de conversion sont linéaires (25).
La réaction est inhibée par des traces d'oxygène (22) et peut-être de CO
(19).
B.
— INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DU MONOMÈRE
Pour des concentrations comprises entre 0,0216 et 0,992 mol/1 (6,05. 10~ 4
à 2,78. 10- 2 g/cm3 ), l'éthylène se comporte pratiquement comme un gaz parfait
et dans ce domaine de concentrations l'ordre global de la réaction est compris
entre 1 et 3/2 par rapport au monomère, pour les températures allant de 28
à 200° (22). Dans le cas des concentrations très élevées (0,37 à 0,55 g/cm3 ),
Laird et coll. (25) ont trouvé qu'il était impossible d'obtenir une relation simple
entre la vitesse de la réaction et la concentration mais qu'en remplaçant cette
dernière par la fugacité, on trouvait un ordre global égal à 1,3 par rapport au
monomère en dessous de 125°, et à 1,8 aux températures plus élevées. La justification de l'emploi des fugacités au lieu des concentrations dans ce système
a été discutée (27).
Buchdahl (R.), Farad. Soc. Discuss., 1956, 22, 150.
(27) Voir la discussion faisant suite à la référence (25). Farad. Soc. Discuss., 1956, 22,
147 et suiv.
(26)
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
C.
Il
111
— INFLUENCE DE L'INTENSITÉ
n'existe que peu de données sur l'effet de L'intensité sur La vitesse <!» pol)
mérisation de l'éthylène. C'est ainsi que Hayward (22), qui est
Le
seul à avoir
effectué une dosimetric soigneuse dans ses conditions expérimentales en tenant
compte en particulier des effets des parois, n'a travaillé que dans un Intervalle
d'intensité très limité (1 300 à
9 10 r uni). LAIRD et coll. (25) n'ont pas effectué
de dosimétrie mais ont opéré avec deux sources de 4,2 et 0,45 curies de cobalt
60 respectivement, tout en conservant la même géométrie. Dans ces conditions les auteurs ont trouvé pour la relation V = Kl" un exposant a égal à
0,8 entre 20 et 125° et à 0,0 entre 100 et 200". DERMINASSIAN (28) a trouvé
1
qu'à 19" a - 0,6-0,7.
D.
— EFFET DE LA TEMPÉRATURE
L'énergie d activation de la réaction est fonction du domaine de températures
étudié. C'est
ainsi qu'au-dessus de 120°-125°,
Hayward (22) trouve
E„# 15 kcal et Laird et coll. (25) B = 13,5 kcal. Aux températures plus
g
basses ces mêmes auteurs trouvent E g = 0,5 et E
Le changement brusque de E
monomère (voir
§
ff
ff
= 3,3 kcal respectivement.
et de l'ordre de la réaction par rapport
au
B) au-dessus et en dessous de 120-125° montre qu'il se
produit une modification du mécanisme de la réaction au voisinage du point
de fusion des cristallites du polyethylene. Laird et coll. (25) ont interprété
ce résultat en admettant que sous l'action des rayons y, il se formait des radi-
caux libres peu réactifs (atomes H) qui ne réagissent que très lentement
avec l'éthylène, avec une énergie d'activation élevée. La contribution de
cette réaction serait donc négligeable à basse température et la valeur
l/2E = 3,3 kcal trouvée en dessous de 120° serait d'un ordre
E a = Ep
de grandeur « normal »; au-dessus de 120° l'amorçage par les atomes H pren-
—
t
drait de l'importance et l'accroissement de l'énergie d'activation globale serait
due à l'apparition d'un terme supplémentaire correspondant à l'énergie d'activation de l'addition des atomes H sur la double liaison de l'éthylène (14 kcal).
Cependant cette interprétation ne nous paraît pas satisfaisante. En effet
il est peu probable que la relation « normale » E g = E„
-1/2 E s'applique à la
polymérisation de l'éthylène qui ne s'effectue pas en milieu homogène. D'autre
part l'interprétation proposée ne tient pas compte du fait que, comme le
montrent les résultats expérimentaux, le changement de l'énergie d'activation globale se produit très brusquement et ceci à 120-125°, c'est-à-dire au
voisinage immédiat du point de fusion des cristallites du polyethylene. Nous
sommes plus enclins à penser que cette variation de l'énergie d'activation
globale est due à une modification du milieu réactionnel. En dessous de 120°
la polymérisation aurait lieu essentiellement dans la phase gazeuse car le
monomère ne peut pas pénétrer dans les zones cristallines du polymère. Au-
—
(28)
Derminassian (L.), Communication privée.
t
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
112
.
dessus de cette température la réaction procéderait en partie dans la phase
gazeuse et en partie dans le polymère gonflé. La contribution de cette deuxième
phase à la réaction globale augmenterait avec la température car la diffusion
du monomère exige une énergie d'activation élevée.
La variation de la masse moléculaire du polymère formé avec la température a été étudiée par Anderson et coll. (20). Les auteurs ont trouvé que la
masse moléculaire du polyethylene obtenu sous une pression de 50 à 60 atmosphères, passait par un maximum pour une température de l'ordre de 40° (20).
Ce résultat est probablement dû à la contribution de deux effets agissant en
l'accroissement de la vitesse de propagation avec la tempérasens contraire
ture qui tend à allonger les chaînes et par conséquent à augmenter les poids
moléculaires et la diminution de la densité du monomère qui passe de 0,34
à 13° à 0,06 à 220°. Comme le poids moléculaire du polymère formé doit être
:
une fonction monotone croissante à la fois de la densité et de la température,
on doit donc bien s'attendre à trouver un tel maximum.
E.
— RENDEMENT RADIOCHIMIQUE DE LA RADIOLYSE DE L'ÉTHYLÈNE
Le nombre de molécules d'éthylène « activées » par paire d'ions a été déterminé par Hayward (22) en tenant compte de la masse moléculaire des produits formés à la température ordinaire. Cet auteur a trouvé pour ce rapport
la valeur 0,543. L'énergie moyenne dissipée par paire d'ions a été mesurée dans
les mêmes conditions expérimentales dans l'éthylène et dans l'air et le rapport
Wg| P /Wén,yiènc a été trouvé égal à 1,28, résultat en bon accord avec les déterminations de Jesse et Sadauskis (29).
Si l'on admet que l'énergie moyenne dissipée par paire d'ions dans
l'air est égale à 34 eV, on trouve à partir de ces données pour le rendement
radiochimique de
la radiolyse
gftbyltae
selon qu'une
«
de l'éthylène
=g
ou
:
Qéthylèn.
=4
molécule activée » d'éthylène correspond à 1 ou à 2 radicaux
libres primaires.
IV.
— POLYMÉRISATION A L'ÉTAT SOLIDE
A.
— GÉNÉRALITÉS
Les premières tentatives de polymériser des monomères vinyliques solides
par voie radiochimique ont été décrites par Schmitz et Lawton (30). Ces
auteurs ont en effet observé une polymérisation en irradiant avec des élec(29)
(30)
Jesse (W. P.) et Sadauskis (J.), Phys. Rev., 1953, 90, 1120.
Schmitz (J. V.) et Lawton (E. J.), Science, 1951, 113, 718.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
trous de 800 kV différents monomères
113
acrylate de méthyle (31) et diacrylates
diméthacrylates de glycol (30) à des températures tirs basses. i. vitesse
de la réaction décroissait avec la température el subissait une chute brusque
au passage de la phase liquide à la phase solide voir (31, 32) Si L'irradiation
et
;l
.
une température nettement Inférieure au point de fusion du
monomère, aucune polymérisation n'était observable; mais en réchauffanl
ensuite le monomère, on assistait à une violente polymérisation amorcée par
était effectuée à
les
radicaux libres gelés. In résultat analogue a été observé par
avec
le
MaJURY (33)
mélhacrvlale de méthyle soumis à un faisceau d'électrons puises.
D'autre part, de nombreuses expériences ont été effectuées à la température
ambiante avec des monomères solides dans ces conditions. Nous allons examiner brièvement les résultats ainsi obtenus.
B.
_ AMIDE ACRYLIQUE
La polymérisation de l'amide acrylique (F. F. = 87°) a été étudiée par
Schulz et Henglein (34, 35) et par Mesrobian et coll. (36-38). Lorsque on
1
irradie des cristaux de ce
monomère à la température ordinaire, ceux-ci, tout
en conservant leur forme initiale, prennent un aspect laiteux (34).
Il
est pos-
sible d'extraire le monomère restant dans les cristaux avec du methanol. On ob-
tient alors comme résidu un polyacrylamide dont les grains gardent les contours
des cristaux de
monomère ainsi qu'un certain pouvoir biréfringent (35).
Si
l'on chauffe ce produit, la biréfringence ne disparaît qu'au-dessus de 180°,
nettement au-dessus du point de fusion du monomère. Le polymère fondu ne recristallise plus au refroidissement (35). Le degré de cristallinité, mesuré par diffraction des rayons X, décroît avec le taux de polymérisation mais reste important même pour des taux de conversion élevés (36).
La cinétique de cette polymérisation a été étudiée (36-38). On a trouvé que
la polymérisation à l'état solide n'était pas influencée par la présence ou l'absence d'air pendant l'irradiation, sans qu'il soit possible de dire si l'oxygène
c'est-à-dire
était
effectivement présent à l'intérieur de l'échantillon.
réaction est proportionnelle à l'intensité des rayons
y.
La
vitesse
de la
Cependant pour les
il se produit une déviation de cette relation, le rendement devenant plus faible [voir (32, 38)]. L'énergie d'activation globale est
égale à 4,7 kcal (38). La viscosité intrinsèque du polymère formé croît avec
la conversion et pour des taux de conversion supérieurs à 50 p. 100, il y a
intensités très élevées,
(31) Schmitz (J. V.) et Lawton (I-:. J.), XII e Congrès I. U. P. A.
(32) Chapiro (A.), Ind. Plast. Modernes, 1956, 8, n° 9, 67.
(33) Majury (T. G.), J. Polym. Se, 1955, 15, 297.
(34) Henglein (A.) et Schulz (K), Z. Naturforsch,. 1954, 4 b, (517.
C, New-York,
1951.
(35) Schulz (R.) et Henglein (A.), Angew. Chem., 1955, 67, 232.
(36) Mesrobian (R. B.), Ander (P.), Baixantine (I). S.) el Dienes (G. .1.). ./. Chem.
Phys., 1951, 22, 565.
(37) Restaino (A. .].), Mesrobian (R. B.), Ballantine (I). S.) et Dienes (G. .1.), Symposium International de Chimie Macromoléciilaire. Milan-Turin, 1954. Supplément de
La Ricerca Scientifica, 1955, p. 178.
(38) Restaino (A. J.), Mesrobian (R. B.), Morawetz (II.), Ballantine (I). S.). Dienes
(G. J.) et Metz (D. J.), ./.
HAISSINSKY.
III.
Am. Chem. Soc., 1956, 78, 2939.
8
POLYMÉRISATION DES MONOMÈRES PURS
Ill
tonnât ion de gel. Si l'on arrête la polymérisation à des conversions inférieures
à 15 p. 100, la viscosité intrinsèque du polymère dépend assez peu de la
température et de l'intensité. La vitesse de la réaction est fortement accélérée
par l'addition de petites quantités d'eau aux cristaux de monomère.
Pour interpréter la constance de la viscosité pour des intensités variables
et
la
proportionnalité entre la vitesse et l'intensité, les auteurs (38) ont admis
que la réaction s'effectuait entièrement dans des grappes de radicaux isolées
(voir aussi II-3).
Pour expliquer d'autre part que la viscosité du polymère ne dépend pas
la température, les mêmes auteurs ont supposé que la masse moléculaire
était entièrement contrôlée par transfert et que les énergies d'activation de
la propagation et du transfert étaient suffisamment voisines pour que l'influence de la température soit négligeable (38). S'il en est ainsi, le seul argument qui reste pour soutenir l'hypothèse d'une polymérisation dans des éléments de volume isolés est la proportionnalité entre la vitesse et l'intensité.
Pour appuyer cet argument il faudrait montrer que la polymérisation de l'acrylamide solide, amorcée par un moyen conventionnel, suit la relation classique
en V des polymérisations en phase liquide homogène ou tout au moins une
loi en I* où a est différent de 1. Or ce point reste à prouver. En effet Schulz
et coll. (39) ont démontré que la polymérisation de ce monomère ainsi que
celle de l'amide méthacrylique à l'état solide pouvait être amorcée par l'azobisisobutyronitrile. Mais aucune donnée n'existe sur la relation entre la vitesse
de
-
globale de cette polymérisation et la vitesse d'amorçage.
— STÉARATE DE VINYLE ET AUTRES MONOMÈRES VINYLIQUES
C.
La polymérisation du stéarate de vinyle a été étudiée parallèlement à l'état
solide et à l'état fondu (F
= 34°) (38). On a observé comme pour l'acrylate
de méthyle une diminution brusque de la vitesse globale au passage de l'état
liquide à l'état solide. La viscosité intrinsèque décroît aussi brusquement pour
des polymères obtenus en dessous du point de fusion.
D'autres monomères ont été polymérisés à l'état solide par les rayons
y,
parmi lesquels on peut citer les acides acrylique et méthacrylique et leurs
sels et le vinylcarbazole (37, 38). La polymérisation de l'acrylate de barium
est très rapide et l'énergie d'activation de la réaction est très faible (0,4 kcal)
(38).
D.
Il
est intéressant
l'état
solide
d'un
— HEXAMÉTHYLCYCLOTRISILOXANE
de mentionner également l'étude de la polymérisation à
monomère non
vinylique, l'hexaméthylcyclotrisiloxane,
amorcée par des électrons de 800 kV (40). La polymérisation des composés
(39)
Schulz (R.), Renner (G.), Henglein (A.) et Kern (W.), Makromol. Chem., 1954,
12, 20.
(40)
Lawton (E. J.), Grubb (W. T.) et Balwit (J. S.), J. Pohjm. Se, 1956, 19, 455.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
115
de ce type est généralement amorcée a\ ec des catalyseurs Ioniques e1 on trouve
que ce monomère ne polymerise pas sous L'effet des rayonnements quand il
est
à l'état
liquide.
Ceci est important
On observe par contre mu- polymérisation à L'état solide.
rai-
il
pas impossible qu'il s'agisse là (\'uw exemple de
n'est
réaction Lonique amorcée par
les
radiations. Cette hypothèse peut se justifier
car la durée de vie des ions dans un réseau cristallin doit être sensiblement
plus Longue qu'en milieu Liquide
et
peut devenir suffisante pour amorcer
La
polymérisation de ce composé.
Les caractères cinétiques de cette polymérisation sont
assez particuliers.
que la vitesse de la polymérisation croît avec la température jusqu'au point de fusion du monomère (64°). L'énergie d'aet ivat ion globale es1
de 10 kcal. Cependant au-dessus du point de fusion la vitesse décroît brusquement et seules des traces de polymère se forment au-dessus de 70". A 58° la
C'est ainsi
conversion correspond à
la
polymérisation de 450 molécules de
monomère
par 100 eV absorbés, ce qui prouve qu'il s'agit d'une réaction enchaîne. Pour
uni' dose donnée (2,;J.10 6 r) la conversion à l'état solide esl deux fois plus
grande si L'irradiation est effectuée avec une intensité de 0,0192. 10 6 r/sec
que pour 0,192.10 6 r/sec, ce qui indique que l'exposant de l'intensité dans la
relation
V = Kl" est voisin de 0,7. Enfin le polymère obtenu est
réticulé.
Les mêmes auteurs ont essayé sans succès d'amorcer la polymérisation de
ce
monomère avec l'azobisisobutyronitrile à l'état solide et avec le peroxyde
de benzoyle à l'état fondu (40).
11 est difficile de tirer une conclusion définitive de ces résultats, cependant
on peut y trouver l'indication d'une polymérisation radiochimique procédant
par un mécanisme ionique. Il serait souhaitable que de nouvelles expériences
soient effectuées pour mieux préciser le mécanisme de cette réaction.
CHAPITRE V
POLYMÉRISATION EN SOLUTION
Lorsque l'on soumet à Taction des radiations ionisantes une solution d'un
monomère dans un solvant, on doit s'attendre à observer les effets suivants
a. Une diminution de la vitesse globale due à une diminution de la vitesse
de propagation des chaînes qui est proportionnelle à la concentration du mono:
mère (équation I, 1).
b.
Une diminution de la masse moléculaire du polymère formé due, d'une
part au raccourcissement des chaînes cinétiques et d'autre part à la réaction
de transfert avec le solvant [équations (I, 3) et (I, 5)|.
c. Une complication supplémentaire lorsque le solvant
perturbe le cours
normal de la polymérisation c'est-à-dire s'il précipite le polymère dès sa formation (dans ce cas la polymérisation s'effectue en milieu non homogène) ou
s'il joue le rôle d'un inhibiteur ou d'un retardateur de polymérisation.
d. Une modification de la vitesse d'amorçage car le solvant est radiolysé
au même titre que le monomère.
Les deux premiers effets sont bien connus dans les polymérisations classiques et on peut évaluer quantitativement leur importance en tenant compte
des constantes de transfert k tr Les effets de précipitation et d'inhibition sont
également connus dans les polymérisations classiques bien qu'on ne puisse
.
pas toujours les interpréter quantitativement. Enfin l'influence de la dilution
sur la vitesse d'amorçage est
un phénomène purement radiochimique et c'est
celui-ci que nous allons examiner d'un peu plus près dans ce chapitre.
Le cas le plus simple qui se présente est celui où le solvant et le monomère
sont radiolysés indépendamment l'un de l'autre. Dans ces conditions la vitesse
d'amorçage est une fonction linéaire de la composition du mélange 1) inaire.
L'expérience a montré qu'une telle relation est vérifiée lorsque le monomère
et le solvant ont une structure chimique voisine.
Lorsque la structure chimique du solvant est différente de celle du monomère, on constate généralement que la vitesse d'amorçage n'est plus une fonction linéaire de la composition du mélange et on observe des phénomènes de
«
transfert d'excitation
».
Enfin un cas particulier des polymérisations en solution
est constitué par
les solutions aqueuses de monomères vinyliques qui donnent des renseignements
intéressants sur la radiolysé de l'eau.
POLYMERISATIONS
SOLVANTS
/.
VOISINE
Parmi
les
/)/•:
le
l!M)l\lli)\s
WNISANTES
xylene (1) et
11
STRUCTURE CHIMIQUE
C.EL1J-: DU MONOMERE
A
systèmes étudiés qui rentrenl dans ce groupe on peut
solutions de styrolène dans
et
I'M!
citer les
benzène (1, 2), le toluène (1, 2), l'éthylbenzène
les solutions de mélhaervlalc de métlivle dans l'acétate de
le
méthyle <;*) et l'acétone (2).
Si nous admet tons que le monomère et le solvant sont radiolysés Indépendamment l'un de l'autre nous aurons pour la vitesse d'amorçage
:
V„
où 9 M
et
libres du
<p s
[
9m (M)
sont respectivement les
monomère et du solvant
ils
;
+ 9s(S)]I
(V,
1)
rendements radiochimiques en radicaux
sont exprimés en moles de radicaux libres
par unité de dose incidente (« dose d'exposition »).
Dans ce qui suit, les résultats cinétiques pour les mélanges seront rapportés à la dose
d'exposition (exprimée en rœntgens/sec) car c'est la seule grandeur qui reste constante
au cours de ces expériences. En efïet la dose absorbée est fonction de la nature du milieu
irradié; elle peut varier de façon notable lorsqu'on étudie l'influence de la concentration
sur la vitesse de polymérisation d'un monomère dans certains solvants (solvants chlorés
par exemple). Aussi, le calcul de l'énergie absorbée doit-il être fait pour chaque concentration en tenant compte des coefficients d'absorption réels de chacun des deux composants. L'introduction de ces coefficients dans les formules cinétiques compliquerait inutilement toutes les expressions.
En remplaçant dans l'équation (I, 1) V
geant
les
termes, on trouve (1)
par sa valeur (V, 1) et en réarran-
:
^fl
V, = ^-2 (9 M I) 1/2 (M)^ri +
av
<?m(m)J
L
(V, 2)
9 M peut être déterminé facilement à partir des expériences de polymérisation
du monomère pur. En effectuant ensuite la polymérisation en solution on peut
calculer à l'aide de l'équation (V, 2) le rapport 9 s /<p.M Connaissant ce rapport,
.
ainsi
que la valeur de g',""""""" et le coefficient d'absorption du rayonnement
dans le solvant, on peut en déduire la valeur de Ga' vant Par ailleurs, l'hypothèse
de la relation linéaire entre la vitesse d'amorçage et la composition du mélange
.
peut être contrôlée facilement en étudiant
la
polymérisation à différentes
concentrations et en vérifiant la constance de Gr 1v8iU pour chaque point expérimental.
Cette vérification a été faite dans un grand intervalle de concentrations.
Toutefois
pour
les
solutions très diluées en
monomère ((S)/(M) > 9) on
a
Chapiro (A.), ./. Chim. Phys., 1950, 47, 747, 764.
Seitzer (\V. H.) et Tobolsk? (A. V.), ./. Am. Chem. Soc, 1955, 77, 2(i<S7.
(3) a) Xikitixa (T. S.) et Bagdasarian (Kh. S.), Recueil de travaux sur la chimie des
radiations. Académie des Sciences de VU. H. S. S., Moscou, 1955, 183.
(1)
(2)
b)
Medvedev (S. S.), •/. Chim. Phys., 1955, 52, 677.
1
POLYMÉRISATION EN SOLUTION
1<S
une diminution importante du rapport ç 8 /ç M (1). Ce résultat est
vraisemblablement dû au fait que pour les solutions très diluées, la recombinaison des radicaux primaires entre eux et avec les chaînes croissantes, que
observé
nous avons déjà étudiée (chapitres I et II), se produit même pour les très faibles
intensités.
11
s'agit
d'un phénomène analogue à l'« effet de dilution » des radio-
biologistes. Cette hypothèse a pu être vérifiée expérimentalement en étudiant
l'influence de l'intensité sur la polymérisation des solutions diluées de styro-
dans le toluène (4). Les résultats obtenus avec des solutions renfermant
respectivement 40, 20 et 10 p. 100 de styrolène sont représentés sur la figure 7.
lène
o.i
oO.Ol
r/mn
i
0,001
1
1
0,
Fig.
7.
100
10
1
1000
— Vitesses de polymérisation du styrolène en solution en fonction de
l'intensité des
ni ijons y.
Courbe 1 solution de 40 p. 100 de styrolène dans le toluène
2
:i
4
(4)
i
l)
dans le propanol (13).
On voit que la déviation de la loi en I
plus petites que la concentration de
(5)
—
100
10 p. 100
10 p. 100
2(i p.
1 ''*-
apparaît pour des intensités d'autant
monomère est plus petite, résultat con-
forme à la théorie exposée ci-dessus (I-l-C-c), selon laquelle cette déviation
serait due à une compétition entre les réactions de recombinaison des radicaux
primaires [réactions (5) et (G)] et la capture par le monomère [réaction
(2)].
Nous avons rassemblé dans le tableau VI les valeurs de <p s /<p M ainsi que les G,,
obtenus pour différents solvants dans des conditions expérimentales où
calcul ci-dessus
est
le
applicable.
Dans le tableau ci-contre nous avons choisi pour le styrolène la plus grande valeur de g^"'
G
be»uène
=
1011 ''
^
= 0,60 (voir tableau III). En effet on obtient ainsi pour le benzène
= 0,71 trouvée
valeur en très hon accoro avec a valeur Gll'""
n"
;
i
par la méthode du DPPH sous vide (6). Pour l'acétate de met h vie la méthode
(4)
Ghapiro (A.), Magat (M.), Sebban (J.) et Wahl (P.), Symposium international de
chimie macromoléculaire, Milan-Turin 1954. Supplément à
•
1955, p. 73.
(5)
Sebban (J.), Résultats non publiés.
(6)
Bouby (L.) et Chapiro (A.), ./. Chim. Phys., 1955, 52, 645.
la
Ricerca Scientiflca
»,
POL YMÉRISATIONS PAU RADIATIONS IONISANTES
\i;l
I
MONOMÈRE
i
\\
S()l.\
\i
\
I
1
G„
?g/*M
ii. tin
Styrolène
Benzène '»
Benzène
Toluène (*)
Toluène (")
Ethylbenzène
(
-'>
(
tn-xylène
(
')
Méthacr) lait- de méthyle
')
<
—
(
DPPH
Gr
donne
12,5
culées pour
cOMo
Gr
déduit
G,. v
= 6,7
(6),
0,68
3,1
2.1
î.:»
1.1).-)
1,55
6,5
1,1
3,8
i.:»
2.1
i
1
12.:»
1
12.:»
0,72
1
c0Mc
1
12,5
Acétate de méthyle (»)
Acétate do méthyle ( 6 )
Acétone -)
du
19
valeur
sensiblement
9,5
plus petite que
de la polymérisation. (Toutes ces valeurs sont recal-
s= 15,5.)
Il
est
difficile
de donner pour
le
moment une
interprétation de ce désaccord.
Les
cp s /<p
M
correspondant aux expériences de Seitzer et Tobojlsky
(2)
ont été recalculés directement d'après les résultats de ces auteurs. Nous avons
ensuite calculé les G K correspondants en prenant pour le styrolène et le méthacrylate de méthyle les valeurs 0,6 et 12,5 respectivement. Rappelons que
pour les raisons déjà analysées ci-dessus (III-I-A) les valeurs de G K trouvées
par ces auteurs sont environ 3 à 4 fois plus petites que les valeurs obtenues
avec les rayons y.
SOLVANTS A STRUCTURE CHIMIQUE
DIFFERENTE DE CELLE DU MONOMERE
//.
En étudiant la polymérisation du styrolène et du méthacrylate de méthyle
en solution dans plusieurs solvants dont la structure chimique différait nota-
blement de celle du monomère, Ghapiro (1) et Nikitina et Bagdasarian (3)
ont trouvé que la vitesse d'amorçage, calculée à partir de l'équation (Y, 2).
du milieu. Ce résultat est
styrolène dans
le bromure d'éthyle (1), le chloroforme (1) et le tétrachlorure de carbone (1, 3)
et méthacrylate de méthyle dans le tétrachlorure de carbone (3), mais il apparaît également dans le cas du méthacrylate dans le benzène (1) et du styrolène
en solution dans le diphénylméthane (1). Remarquons que Seitzer et Tobolsky ont signalé une relation linéaire pour la vitesse d'amorçage en fonction
de la concentration dans le cas des solutions de ces deux mêmes monomères
dans le tétrachlorure de carbone, le chloroforme et d'autres solvants halogènes (2). Cependant si l'on examine de plus près ces résultats on voit que les
n'était plus une fonction linéaire de la composition
particulièrement frappant en présence de solvants halogènes
:
POLYMÉRISATION EN SOLUTION
120
points expérimentaux, bien que très dispersés, semblent indiquer dans certains cas une courbure analogue à celle qu'avaient trouvée les auteurs précé-
dents (1, 3) (voir par exemple la figure 1 de la référence (2)). Enfin Bagdasarian a trouvé un résultat analogue en amorçant la polymérisation du styrolène dissous dans le tétrachlorure de carbone avec les rayons U. V. (3 b, 7).
Ces observations montrent par conséquent que l'hypothèse selon laquelle les
deux composants d'un mélange se comporteraient vis-à-vis de la radiolyse
comme s'ils étaient seuls n'est
pas justifiée dans le cas des
mélanges cités ci-
différents
dessus.
Des
observations
analo-
gues ont été faites par Bur-
ton
9)
et
par
Bouby et Chapiro
(6)
sur
binaires
de
des
et
coll.
mélanges
(8,
organi-
solvants
différents
ques. Manion et Burton (8)
ont été les premiers à attirer
l'attention sur la non-additivité
des
miques
effets
dans
radiochi-
mé-
certains
langes binaires (benzène-cy-
clohexane par exemple)
et
Burton et coll. (10), qui ont
étudié la
100*M
luminescence
in-
100*S
duite par l'irradiation y de
Rendement radiochimique en radicaux libres
et de solvant S en
des mélanges de monomère
fonction de la composition du mélange.
mélanges analogues, ont pu
Fig. 8.
—
M
Droite AB
Courbe
Courbe
:
APB
AQB
relation linéaire
effet de « sensibilisation
effet de protection.
:
mettre en évidence directement des processus de transfert d'énergie entre molécules
»
:
excitées.
Ces
processus
de
transfert d'excitation sont discutés en détail dans l'article de M. Burton dans
ce même volume. Nous allons seulement examiner ici les conséquences directes
u
par la méthode de la polymérisation.
de ces processus sur le calcul des G R
Supposons en effet qu'en portant la valeur de V a en fonction de la composensibilisation »)
sition du mélange, on obtienne une courbe de type APB («
dans ces
appliquant
En
(fig.
8).
AB
ou AQB (« protection ») au lieu de la droite
s
'
lv: "
conditions l'équation (V, 1) qui suppose une relation linéaire entre V a (M)
soit trop
et (S) on trouvera des valeurs de <p s soit trop élevées (sensibilisation)
,
basses (protection).
(7)
Bagdasarian (Kh. S.) et Miliutinskaia (P. I.), Zh. fi:. Khim. IL R. S. S., 1954, 28,
498.
Manion (J. P.) et Burton (M.), J. Phys. Chem., 1952, 56, 560.
Burton (M.) et Patrick (W. N.), J. Phys. Chem., 1954. 58, 421, 424.
Phys., 1955, 52, 657.
(10) Burton (M.), Berry (P. J.) et Lipsky (S.), J. Chim.
Berry (P. J.) et Burton (M.), J. Chem. Phys., 1955, 23, 1969.
Berry (P. J.), Lipsky (S.) et Burton (M.), Trans. Farad. Soc, 1956, 52, 311.
(8)
(9)
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
que nous axions trouvé
ainsi
C'est
Gli''* = 1()()
à
partir
de
(1)
pour
polymérisation
la
le
tétrachlorure
<lc
121
carbone
du styrolène tandis qu'avec
le
.s ,2
(il)*.
diphénylpicrylhydrazyle nous axons trouvé Gh"
Nikitina et Bagdasarian ('A) <>nt essayé de tenir compte quantitative
I
nient des
phénomènes de transfert d'énergie en admet tant un échange rêver
deux composés. Le traitement cinétique préet d'évaluer
tonnes des courbes de la figure
Sible entre les états excités des
posé permet d'interpréter
les
«s
partir des données sur la poix
tp
A
6 qp M
mérisation du styrolène dans le tétrachlorure de carbone ces auteurs ont ainsi
les
constantes de transfert d'énergie et
trouvé
.
:
9s/? m
En admettant que Gg> ro,enc
:
0,<>
= 22.
on peut en déduire
1
'
(ili'
13,5.
Cependant dans certains cas le rendement en radicaux libres dans le méde la référence (6)), qui ne
lange suit des fonctions plus complexes (voir ftg.
peuvent être interprétées par le schéma simple basé sur un échange réversible
entre les états excités (12). Les réactions de transfert d'excitation sont donc
(>
en réalité plus complexes et il est difficile pour le moment de déterminer
valeurs des G,{"
U: ""
les
dans les systèmes où ces réactions ont lieu.
Quoi qu'il en soit, l'étude des polymérisations en solution peut donner des
renseignements sur
les
caractères
et
le
mécanisme des
différents processus
mis en jeu.
///.
.SOLVANTS POUVANT PERTURBER
LE COURS NORMAL DE LA POLYMÉRISATION
A.
— MAUVAIS SOLVANTS ET PRÉCIPITANTS DU POLYMÈRE
Si le solvant utilisé est un précipitant
du polymère, on constate qu'à partir
d'une composition donnée du mélange, les chaînes croissantes se séparent de
la solution et la réaction se
poursuit en milieu hétérogène.
Il
en résulte une
perturbation de la cinétique globale que nous avons déjà décrite (I-l-D).
La complexité d'un tel système est illustrée sur la figure 9 où nous avons
représenté la variation de la vitesse globale de la polymérisation du styrolène
dans différents alcools (1).
On peut distinguer sur ces courbes trois domaines distincts
Entre
(*)
(11)
et
:
30 p. 100 d'alcool la vitesse de polymérisation croît rapidement
= 15,5.
Les deux valeurs sont recalculées pour G (V
Bouby (L.), Chapiro (A.), Magat (M.), Migirdicyan (E.), Prevot-Bernas (A.),
Reixiscu (t..) et Sebban (J.), Actes de la Conférence Internationale sur l'Utilisation 'le
l'Energie Atomique à des fins pacifiques, Genève 1955. Nations Unies, Genève 1956,
Édition française, volume 7, p. 612.
(12) Bouby (L.) et Chapiro (A.), Résultats non publiés.
1
POLYMÉRISATION EN SOLUTION
122
avec
la
quantité d'alcool ajoutée, ce qui indiquerait un ç 8 /ç M assez élevé (de
l'ordre de 70).
Entre 30 p. 100 et 70 p. 100 d'alcool le polymère précipite et se rassemble au
bas du récipient d'irradiation sous forme de coacervat plus ou moins visqueux.
En même temps la vitesse de poly25
mérisation diminue, ce qui a été
interprété
II
y
F
20
• Méihanol
o Propanol9 PropanohZ
o Butanol'l
« t-Butanol
a Octanol- 1
v Octanol 2
• AlcrBenzihque
L
/
1
\/
15
y
admettant une
fi/
l\\
1
/
/
/\
p.
sous
100 le polymère
forme de poudre
observe pour
la
ceux que
polymérisa-
du chlo-
constante mais présente l'accélération caractéristique des réactions
r\
/
1
70
à
précipite
En particulier la vitesse n'est plus
?
/
1
Aux concentrations en alcool supérieures
rure de vinyle pur (voir IV- 1 et 2).
/
1
très élevée.
tion de racrylonitrile ou
/
/
/
10
tration locale est par conséquent
l'on
/ y
/s
//
À
/
/
ou dans le coacervat où leur concen-
cinétiques analogues à
V
/
donné que toutes les chaînes croissantes se rassemblent en micelles
fine, la vitesse augmente brusquement et on retrouve des caractères
flf
m
'
/
sans état stationnaire.
De plus, il
apparaît une importante post-poly-
//^^STx
-
en
(1)
accélération delà terminaison étant
-
/
mérisation et enfin la
loi
en
1
I /
2
n'est plus vérifiée, la vitesse étant
f//*^^^^Ar?
proportionnelle à
1° 65
(13) (fig. 7).
On peut voir sur la figure 9 que
^
Il
Y^3
< * —'
'
la vitesse
J
de polymérisation d'une
solution de styrolène à 10 p. 100
V^L^y
dans un alcool est plusieurs
fois
plus élevée que celle du styrolène
«
1
1
en masse ».
i
50
25
7 5
100
% diluant
Fig
— Variation de
la vitesse de
polymérisation du styrolène en fonction de la concentration
dans différents alcools (d'après (1)).
9.
Un cas intéressant apparaît avec
l'alcool
benzylique
9).
Cet
pitant du polystyrolène et la poly-
mérisation
homogène jusqu'à des teneurs en
(fig.
un très mauvais préci-
alcool est
alcool très
s'effectue
élevées,
constantes pendant toute la durée de la réaction.
les
en
milieu
vitesses restant
On voit cependant que
la courbe de la figure 9 correspondant à cet alcool, présente, bien
que très
atténuées, les mêmes anomalies que les courbes obtenues avec les autres alcools.
(13)
Chapiro (A.) et Wahl (P.), Résultats non publiés.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
il
en résulte que
que
la
cinétique de
la
polymérisation
En
séparation des phases ne se produise.
la
esi
L23
déjà perturbée avant
particulier,
valeurs de
u-s
que l'on peut déduire de la première partie de la courbe soul déjà pro
bablement entachées d'une erreur. D'ailleurs les niasses moléculaires des
ele
polymères obtenus dans ce domaine de concentrations sont toutes trop
9^
9,,
par rapport aux vitesses observées (1).
vées
On peut donc conclure que lorsque le solvant S utilisé est un mauvais sol
vaut du polymère formé, toutes
les
valeurs des constantes que Ton pent cal-
culer à partir des équations classiques deviennent incertaines.
Parmi les autres systèmes étudiés qui rentrent dans ce groupe nous pouvons
polymérisation du styrolène dans l'heptane, le cyclohexane et l'acétone (M, celle du méthacrylate de méthyle dans le methanol (1) et celle de
l'acrylonitrile dans l'eau (voir Y-4).
Enfin des résultats analogues ont été obtenus avec des monomères qui
citer la
jouent
le
rôle de précipitants vis-à-vis
de leur propre polymère
et
auxquels
on a ajouté des solvants capables de dissoudre ce dernier. C'est ainsi que les
courbes expérimentales V g = /(S) obtenues en étudiant la polymérisation de
l'acrylonitrile
dans le diméthylformamide (14)
méthacry-
et celle de l'acide
lique dans l'eau (15) sont des répliques des courbes de la figure 9.
B.
— SOLVANTS JOUANT UN ROLE INHIBITEUR OU RETARDATEUR
Certains solvants ajoutés au
monomère peuvent
inhiber ou retarder la
polymérisation par transfert désactivant ou par copolymérisation désacti-
vante (voir chapitre I-l-E). Un exemple de transfert désactivant en chimie
des radiations est fourni par la polymérisation du styrolène en présence des
amines
(1).
En effet en examinant l'effet de l'addition de différentes amines (butylamine, dibutylamine, benzylamine) sur la polymérisation radiochimique du
styrolène, on a trouvé que pour une concentration molaire de 10 à 20 p. 100
en amine, la réaction subit une importante accélération qui correspond à
9a 9 M
la
=60 à 80; mais si l'on ajoute des quantités d'aminés plus grandes,
réaction se ralentit à nouveau. Un effet analogue a été observé avec l'aniline
qui ne produit cependant qu'une accélération initiale plus petite, correspon-
dant à 9s 9m = 20 (1). Ces résultats pourraient s'interpréter en admettant
l'existence d'un phénomène de transfert d'excitation analogue à ceux que nous
avons déjà analysés ci-dessus (V-2). Cependant on a trouvé par ailleurs le
amines dans la polymérisation du styrolène (16,17). Aussi
rôle inhibiteur des
l'interprétation
quantitative
des processus
radiochimiques primaires dans
extrêmement difficile puisque l'effet global mesuré ici
(vitesse de polymérisation relative) est en fait composé de 3 effets élémences systèmes est-elle
taires
(14)
(15)
(16)
(17)
différents
:
accélération
de l'amorçage car GJV"
mo
Prevot-Bernas (A.), C. H., 1953, 237, 1686.
Fox CM.) et Alexander (P.), J. Chim. Phys., 1955, 52, 710.
I-'oord J. Chem. Soc, 1940, p. IS.
Schulz (G. V.), Makromol. Chem., 1947, 1, 9 1.
> GÏ^'"
1
''"'
,
inhibi-
POLYMÉRISATION EN SOLUTION
121
de
lion
la
polymérisation par transfert désactivant,
et
enfin vraisemblable-
ment transferts d'énergie entre états excités des deux composants du mélange.
l'n effet d'inhibition a également été observé dans la polymérisation du
styrolène en présence de sulfure de carbone sans que l'on puisse dire si cette
inhibition est due à un effet de protection ou à une inhibition vraie par le
soufre libéré au cours de la radiolyse
(1).
Enfin, il faut classer dans ce même groupe la polymérisation radiochimique
de l'acétate de vinyle en présence de benzène
(3).
Dans ce cas on doit s'at-
tendre à une diminution de la vitesse car Gk'""""< GR
Cétate dc vinyle
et en outre
benzène peut exercer un effet de protection sur l'acétate de vinyle (3). Mais
on a observé par ailleurs le rôle inhibiteur du benzène dans la polymérisation
de ce monomère amorcée par des méthodes conventionnelles (18-20), probablement par un mécanisme de copolymérisation désactivante (20). Il en résulte
le
que ce système également présente une très grande complexité.
On peut donc conclure que les valeurs de Gr,"
lv;
""
déduites de l'étude de
cinétique des polymérisations ne peuvent conduire à des résultats satis-
la
faisants que dans les cas
où
1° le solvant n'intervient
2°
il
existe
:
pas dans le cours normal de la polymérisation;
une relation linéaire entre la vitesse d'amorçage globale et la
composition du mélange.
Lorsque la condition (2) n'est pas vérifiée, l'étude de la cinétique des polymérisations en solution peut par contre donner quelques renseignements sur
les
processus de transfert d'excitation primaires.
IV.
SOLUTIONS AQUEUSES
DES MONOMÈRES VINYLIQUES
Nous allons examiner plus en détail la polymérisation radiochimique des
monomères en solutions aqueuses en raison des renseignements que peuvent
fournir ces recherches sur la radiolyse de l'eau. Trois questions ont préoccupé
qui ont travaillé dans ce domaine la nature chimique des radicaux produits par la radiolyse de l'eau, leur nombre et leur distribution spatiale.
les chercheurs
:
— NATURE DES RADICAUX PRIMAIRES DE LA RADIOLYSE DE L'EAU
A.
Dainton (21) a été le premier à proposer la polymérisation comme moyen
d'étude des radicaux primaires produits par la radiolyse de l'eau. Cet auteur
a
pu mettre en évidence
à 3 680
(18)
(19)
cm
1
,
l'existence
des bandes
caractéristiques des groupes
d'absorption infra-rouge
OH non-associés, dans le poly-
Burnett (G. M.) et Melville (H. \Y.), Farad. Soc. Discuss., 1947, 2, 322.
GoniX (A.) et Smets (G.), ./. Polym. Se, 1953, 10, 525.
Stockmayeb (W. H.), .]. Ain. Chem. Suc, 1953, 75, 2279.
(21) Dainton F. S.), Nature 1947, 160, 268.
(20)
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
acrylonitrile
et
le
125
polyméthacrylonitrile préparés par irradiation des solutions
aqueuses des monomères correspondants, avec des rayons 7 et \ (22). Il a
ainsi établi par un procédé direct l'existence de radicaux oil parmi les pro
(luiis de la radiolyse de l'eau. Gollinson et Dainton (23) ont pense avoir
mis également en évidence les atomes
II
comme produits de la radiolyse. En
ces auteurs ont irradié des solutions d'aei\ lonit lile dans de l'eau lourde
effet
polymère obtenu une bande d'absorption à 2 2(H) cm
D (23). Cependant des
qu'ils ont attribuée à la présence de groupements C
experiences ultérieures de FlQUET et BERNAS (24) Ont montré que l'ai tribu
lion de celte bande était douteuse car on la trouvait aussi dans le polyacrylonilrile polymerise par des rayonnements en masse ou en solution dans l'eau
et
ont détecte dans
'
le
ordinaire, et on ne l'observait pas dans
merise dans
1
)._,().
le
polymélbaerylale de méthyle poly-
Des expériences ultérieures ont montré que
le
polyacrylo-
polyméthacrylate de méthyle préparés par irradiation des monomères dans l'eau tritiée présentent une radioactivité qui persiste après échange
nitrile et
le
des groupements
OT avec l'alcool (25) (26). Ce résultat démontre l'existence
T dans le polymère, et par conséquent la formation d'atomes
parmi
T
les produits de la radiolyse de HOT. Toutefois la valeur du rapport
de liaisons C
G„/G
B.
()l ,
n'a pas encore été déterminée avec précision.
— RENDEMENT RADIOCHIMIQUE DE LA RADIOLYSE DE L'EAU
Plusieurs tentatives ont été faites pour déterminer le
libres formés
nombre de radicaux
dans l'eau en utilisant des monomères différents. C'est ainsi que
Prevot-Bernas (27) a étudié la vitesse de polymérisation de l' acrylonitrile
en solution aqueuse diluée (0,94 M) induite par des rayons y du Ra,à une faible
intensité (1,14 r/min) de manière à réduire au maximum les effets de « perte »
des radicaux primaires par recombinaison.
En tenant compte de la vitesse de la réaction et du degré de polymérisation
du polymère formé, cet auteur a trouvé qu'il se formait en moyenne 4,2 chaînes
de polymère par 100 eV. Étant donné l'incertitude. sur le mode de terminaison des chaînes de polyacrylonitrile (par occlusion, par recombinaison mutuelle
ou avec des radicaux primaires ou par disproportionnement), on peut seule-
ment déduire de ces mesures que Gl! °
2
^
4,2.
En irradiant des solutions con-
M) ce même auteur a trouvé que
G" ° était au moins égal à 34 (27). Cette valeur « trop élevée » met en évidence
un phénomène de transfert d'énergie entre l'eau et l'acrylonitrile (voir V-2).
Fiquet-Fayard (26) a utilisé comme monomère le méthacrylate de méthyle
centrées d'acrylonitrile dans l'eau (14,75
2
pour simplifier l'étude du polymère obtenu car celui-ci est facilement soluble
dans les solvants usuels. Cet auteur a en outre étudié la variation de la vitesse
(22)
Dainton (F. S.), J. Phys. Colloid Chem., 1948, 52, 490.
Collinson (E.) et Dainton (F. S.), Farad. Soc. Discuss., 1952, 12, 212.
(24) Fiquet (F.) et Bernas (A.), J. Chim. Phys., 1954, 51, 47.
(25) Collinson (E.). Expériences non publiées.
(26) Fiquet-Fayard (F.). Expériences non publiées.
(23)
(27)
Prevot-Bernas (A.).
Thèse, Paris 1956.
POLYMÉRISATION EN SOLUTION
126
de polymérisation en fonction de l'intensité et a utilisé pour les calculs du
G K le domaine d'intensités pour lequel on n'observait pas de déviation de
la loi en
et le
la
I" •".
D'autre part le poids moléculaire a été déterminé par osmométrie
nombre de radicaux primaires par chaîne a été déterminé en amorçant
polymérisation dans les mêmes conditions expérimentales à l'aide de l'azo-
bisisobutyronitrile marqué au
14
C.
Il
a été ainsi établi que le nombre de radi-
caux par chaîne est très voisin de 1, ce qui conduit à G|! ° = 4,7.
Plusieurs objections peuvent être faites à ces déterminations
2
:
La cinétique de polymérisation en milieu précipitant est très complexe.
Une partie des chaînes a pu être terminée par réaction avec un radical pri1°
maire et disproportionnement.
H
H
H
R—C—CI
I
H
+H (ou OH) —> R — C = G + H (ou H 0).
I
I
-
2
H
I
I
CN
2° Les concentrations de l'intercepteur
2
I
GN
employées et qui sont déterminées
par la solubilité limitée du monomère dans l'eau, sont assez faibles et un certain nombre de radicaux « primaires » ont pu se recombiner avant d'être interceptés.
On peut donc conclure de ces résultats que la valeur 4,7 constitue une limite
inférieure
de G"'
.
Pour éviter ces objections, Dainton et coll. (28-33) ont étudié très systématiquement la polymérisation de l'amide acrylique, dont le monomère et le
polymère sont solubles dans l'eau (voir aussi 34).
La cinétique de la polymérisation radiochimique et photochimique de ce
monomère est plus normale que celle des monomères précédents. En effet la
vitesse globale est proportionnelle à I 0,5 (sauf pour les très faibles intensités
où l'on trouve I0,58) et de premier ordre par rapport au monomère entre 0,05
et
1,6
mol/1.
Les seules anomalies persistantes sont
:
une variation anormale du poids moléculaire moyen avec l'intensité
la loi observée étant en I " -' au lieu de la loi « normale » en I~0,6
a.
:
.
b.
Une énergie d'activation globale « trop petite » (1,5 +1,5 kcal).
c.
L'existence d'une post-polymérisation observable pendant plusieurs jours
après l'arrêt de l'irradiation. Dainton et Tordoff (32) expliquent ce dernier
(28) Gollinson (E.), Dainton (F. S.) et McNaughton (G. S.), J. Chim. Phys., 1955, 52,
556.
(29) Collison (E.), Dainton (F. S.) et McNaughton (G. S.), Trans. Farad. Soc, 1957 y
53, 357.
(30) Collison (E.), Dainton (F. S.) et McNaughton (G. S.), Trans. Farad. Soc. 1957,
53, 467.
(31) Collison (E.), Dainton (F. S.) et McNaughton (G. S.), Trans. Farad., Soc, 1957,
53, 489.
Dainton (F. S.) et Tordoff (M.), Trans. Farad. Soc, 1957, 53, 499.
Dainton (F. S.) et Tordoff (M.), Trans. Farad. Soc, 1957, 53, 666.
(34) Schulz (R.), Renner (G.), Henglein (A.) et Kern (W.), Makromol. Chem., 1954,
(32)
(33)
12, 20.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
127
phénomène en admettanl que le radical polymère, initialemenl actif, passe
par plusieurs cycles d'activité et d'inactivité avant sa destruction par recom
binaison
La formation de
mutuelle.
tautomérisation
en
radical
la
forme Inactive correspondrait
glutiramidyle
à
la
(II).
Cil,
Cl
ch
cir
Cil
CONIl,
GONHj
CO
1
Cil,
CO
^N*
(M)
(h
Remarquons qu'une post-polymérisation a également été observée dans la
polymérisation photosensibilisée de ce même monomère et que ce résultat
a été interprété par
une réaction de terminaison gênée par effet stérique (35).
Les résultats obtenus par Dainton et Tordoff (32, '.VA) pour la polymérisation photochimique sont tout à fait parallèles aux résultats obtenus par voie
radiochimique.
•
L'anomalie observée pour la variation du poids moléculaire en fonction de
permet pas de déterminer la vitesse d'amorçage en combinant
du polymère formé. Mais
l'intensité ne
la
vitesse globale avec le degré de polymérisation
Collinson, Dainton et McNaughton (31) ont utilisé une autre méthode
pour déterminer le nombre de chaînes amorcées pour une valeur donnée de
la dose absorbée. Elle consiste à ajouter à la solution d'acrylamide des ions
Fe 3+ qui sont capables de réagir rapidement avec les chaînes croissantes (voir
aussi (36)).
La réaction de terminaison prédominante devient alors
CH.
CH* + Fe3a +
:
CH = CH + FeH+ + H +
I
CONH
CONH,
2
ou
CH
5
CH — CHOH + Fe'J + H
CH* + Fe^
2
I
I
CONH
CONH,
et le
2
nombre de chaînes amorcées peut être déterminé en dosant la quantité
d'ions Fe 3+ convertis en Fe 2+
.
En même temps la vitesse de la réaction devient
proportionnelle à I, et comme le prévoit la théorie dans ce cas, la réaction est
du premier ordre par rapport à M et d'ordre
la
— par rapport à (Fe
1
3
+).
En outre
post-polymérisation est entièrement supprimée.
A partir de ces données, les auteurs ont calculé G"' = 8,2 radicaux/100 eV
avec une concentration de monomère de 0,4 M. Or des travaux antérieurs
(28, 29) ont montré que le « rendement moléculaire » en H 2 2 était fonction
de la concentration de monomère. Si l'on ajoute des quantités croissantes
d'amide acrylique à l'eau on trouve que la quantité de H 2 2 formé croît d'abord
à cause de l'interception des atomes H capables de décomposer le H 2 2 pré(35)
(36)
Oster (G. K.), Oster (G.) et Prati (G.), ./. Am. Chem. Soc, 1957, 79, 595.
Bamford (C. H.), Jenkins (A. D.) et Johnston (R.), Nature 1956, 177,992; Proc.
Roy. Soc, 1957, 239, 214.
POLYMÉRISATION EN SOLUTION
12.S
sent, passe par
un
maximum correspondant à Gh
cause de l'interception des « précurseurs » de
à
H
2 <> 2
2
= 0,9 et décroît ensuite
2
moléculaire et tombe à
0,2 pour une concentration de 1,5 M de monomère. Le G"*lî soustraction faite
des précurseurs de
H aO
Glr
a
intercepté serait d'après ces auteurs (31)
:
= 8,2 — 2 x (0,9 — 0,2) = 6,8.
Cette dernière valeur est en bon accord avec la valeur de G"*
7 déduite à
partir des réactions d'oxydo-réduction.
paraîtrait que cette valeur de 6,8 englobe une certaine proportion de
Il
«
précurseurs » de
à ce sujet.
H (31), mais aucune indication quantitative n'existe encore
2
On peut néanmoins conclure de ce qui précède que les « précurseurs
H
cer
une polymérisation.
de
2 et
2
»
H sont au moins en partie des radicaux libres capables d'amor-
de
2
— DISTRIBUTION SPATIALE DES CENTRES INITIATEURS
C.
Collinson et Dainton (23) ont étudié la variation de la vitesse de polymérisation des solutions diluées d'acrylonitrile dans l'eau en fonction de l'intensité.
Ils
ont trouvé que pour les petites intensités l'exposant de
I
était
voisin de 0,95 et qu'il décroissait régulièrement avec l'intensité jusqu'à atteindre
environ 0,25 pour les intensités les plus élevées. Un tel comportement est très
voisin de ce que l'on peut prévoir lorsque la polymérisation a lieu entière-
ment dans des éléments de volume indépendants qui tendent à s'interpénétrer
lorsque l'intensité augmente (voir 1 1-3).
Cependant cette interprétation s'est révélée injustifiée. En effet Bensasson
et Prevot-Bernas (37) ont étudié la loi Y g = f (I) dans un très grand intervalle d'intensité et ont trouvé qu'il était possible de représenter les résultats
expérimentaux par une loi Y,, = Kl
où
,
= 0,8 pour l'acrylonitrile pur
= 0,85
en solution aqueuse diluée 99,2 p. 100 d'eau
a = 0,75
en solution aqueuse concentrée 7 p. 100 d'eau.
a
a
Comme nous l'avons vu cette valeur anormale de l'exposant de l'intensité
est liée à toutes les polymérisations effectuées en milieu précipitant. Rappelons
aussi que
si
l'acrylonitrile est polymérisé en présence de diméthylformamide
en quantité suffisante pour dissoudre le polymère, a tombe à 0,55 (37).
La décroissance de l'exposant de l'intensité, observée par Collinson et
Dainton aux intensités élevées, paraît être analogue aux déviations que l'on
observe avec la plupart des monomères aux intensités élevées et que nous
avons décrites dans les chapitres précédents.
On peut donc conclure de ce qui précède que la variation de l'exposant de
l'intensité n'est pas due à une distribution inhomogène des centres initiateurs.
(37)
Bensasson (R.) et Prevot-Bernas (A.), J. Chim. Phys..
1956, 53, 93.
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTIJS
D.
129
— AUTRES MONOMÈRES
A côté des études que nous venons de discuter et qui étaient principalement
destinées à éclaircir certains problèmes relatifs à la radiolyse de l'eau, divers
auteurs ont étudié la polymérisation de quelques autres monomères en solution aqueuse.
La polymérisation de la vinylpyrrolidone, en solution aqueuse, a été décrite
par Ballantine et Manowitz (38) (39). Ces auteurs ont trouvé que la vitesse
de la réaction était proportionnelle à la racine carrée de l'intensité entre
110 et 8 800 rcentgensmn, et à la concentration de monomère entre 1 p. 100
et 20 p. 100. L'énergie d'activation globale
de cette polymérisation est égale
à 2 kcal.
Quelques résultats ont été obtenus avec des solutions aqueuses d'acide
méthacrylique (40); enfin on a décrit la polymérisation du styrolène en emulsion (38).
Dans ce dernier cas la réaction est très rapide, 200 fois plus rapide
que la polymérisation du styrolène pur. Cette importante accélération est
due à la fois au fait que le G R est plus élevé pour l'eau que pour le styrolène
et aussi parce que dans les polymérisations en emulsion la réaction de terminaison est fortement ralentie (voir
1-4).
Ballantine (D. S.), Rapport BNL 294 (T-50), 1954.
Ballantine (D. S.) et Manowitz (B.), Rapport BNL 317 (T-53) 1954.
(39 a) Ballantine (D. S.) et Manowitz (B.), Rapport BNL 389 (T-73) 1956.
(38)
(39)
(40)
Alexander (P.) et Fox (M.), J. Chim. Phys., 1953, 50, 415; 1955, 52, 710.
HAISSINSKY.
A
A
B
A
B
A
B
B
CHAPITRE VI
SYNTHÈSE DES COPOLYMÈRES
GREFFÉS PAR VOIE RADIOCHIMIQUE
On désigne sous le nom de « copolymère greffé » un polymère dont les macromolécules sont constituées par une chaîne principale d'un polymère A B por,
tant des branches latérales constituées par un autre polymère B n
.
Une molé-
cule de copolymère greffé peut être représentée schématiquement de la façon
suivante
:
B — B—
A—A—
I
B— B —
A—A—
A—A—
B—B—
!
I
A—A—
I
B
— B—
Grâce à cette structure particulière, formée d'enchaînements longs de deux
polymères différents, les copolymères greffés possèdent des propriétés physicochimiques différentes de celles des autres polymères. En particulier un
copolymère greffé peut posséder à la fois certaines propriétés du polymère
A n et d'autres propriétés de B n tandis que les propriétés des copolymères
ordinaires sont en général intermédiaires entre les propriétés des deux composants.
On sait aujourd'hui préparer un grand nombre de copolymères ordinaires
en polymérisant ensemble deux monomères différents A et B (voir 1-2).
Par contre la synthèse des copolymères greffés reste encore une opération
chimique assez délicate et il existe peu de méthodes générales pouvant s'appliquer à l'ensemble des polymères. (Pour une revue bibliographique de cette
question cf. (1)).
Récemment on a proposé plusieurs méthodes de synthèse des copolymères
greffés
par voie radiochimique (2,
3).
Dans ce qui suit nous allons décrire
(1)
Immergut (E. H.) et Mark (H.), Makromol. Chem., 1956, 18-19, 322.
(2)
Bouby (L.), Chapiro (A.), Magat (M.), Migirdicyan (E.), Prevot-Bernas (A.),
Reinisch (L.) et Sebban (J.), Actes de la Conférence Internationale sur l'Utilisation de
atomique à des fins pacifiques. Genève 1955. Nations Unies, Genève 1956, volume 7. Édition française, p. 612.
(3) Chapiro (A.), Ind. Plast. Modernes. 1957, 9, n° 2, 34.
l'énergie
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
131
méthodes qui dérive directement des polymérisations radiochlmiques que nous avons étudiées dans les chapitres précédents.
l'une de ces
Principe de
la
méthode de greffage
.
Nous avons vu dans le chapitre V que lorsque la polymérisation radioehi
mique d'un monomère vinylique M est effectuée en solution, le solvant S
est radiolysé en même temps que M et la polymérisation est amorcée par les
radicaux libres formés au cours des deux réactions primaires
:
M
De même,
si
l'on
R
S
—
pousse
la
#
GkI(M)
(VI, 1)
GR I(S)
(VI, 2)
polymérisation radiochimique d'un
monomère
~
J
S*
vinylique pur jusqu'à des conversions élevées, nous avons vu qu'il devenait
nécessaire de tenir compte des deux réactions radiochimiques (voir III-l-G)
M
P
R
•
— P
#
#
GÏ!l(M)
(VI, 1)
GÏI(P)
(VI, 3)
:
où P et P* désignent respectivement une molécule de polymère et un radical
macromoléculaire.
Tous les radicaux primaires
R
#
,
S* et P*
amorcent la polymérisation de
M et restent incorporés en bout de la chaîne. Mais comme les radicaux P*
sont déjà des fragments macromoléculaires de M
on obtient finalement des
macromolécules ramifiées qui sont le résultat d'un greffage du monomère M
n,
«
»
sur son propre polymère.
Il
est très facile d'étendre cette réaction à la synthèse des
greffés.
copolymères
En effet il suffit pour cela d'irradier un polymère A n en présence d'un
monomère B, différent de A (4).
On aura dans ce cas les deux réactions primaires
An
B
:
-A;
G,V'I(A n )
(VI, 4)
-*
GSl(B)
(VI, 5)
B*
qui conduiront respectivement à la formation de copolymère greffé et d'homo-
polymère B n
.
Dans un tel système, A n doit être un polymère capable de donner des radicaux macromoléculaires par radiolysé, c'est-à-dire que l'on peut choisir n'importe quel polymère obtenu par polymérisation ou par polycondensation ou
encore un polymère naturel comme la cellulose ou le caoutchouc. B doit être
un monomère vinylique capable de se polymériser par un mécanisme radicalaire.
On voit qu'il est possible de préparer à l'aide de cette méthode un très grand
nombre de copolymères greffés grâce aux combinaisons multiples possibles
entre les polymères A n et les monomères B.
(4)
Chapiro (A.), Magat (M.) et Sebban (J.), Brevet Fr. 1.130.099 (1955).
SYXTHÈSE DES COPOLYMÈRES
132
De plus on peut dans une large mesure éviter la formation d'homopolymère
B n (4). En effet comme B n se forme principalement à la suite de la réaction
d'homopolymère en favorisant la réacPour cela on peut choisir le couple polymère-monomère de manière que G K " soit beaucoup plus grand que G|j. Nous
avons vu dans le chapitre V que les composés halogènes ont en général un G R
(VI, 5), on peut réduire la formation
tion (VI, 4) aux dépens de (VI, 5).
très élevé tandis
que par exemple le Gr^"
mélange de chlorure de polyvinyle
de
est très petit.
styrolène,
on
En irradiant un
obtiendra
donc
—
Échantillons de polyester (à gauche) greffés par irradiation avec de l'acryloniLes échantillons greffés (à droite) renferment 80 p. 100 de polyacrylonitrilc en poids.
Fig. 10.
trile.
et
10 '"'
d'homopolymère.
copolymère greffe avec très peu
on peut réduire dans une large mesure la formation
d'homopolymère en diminuant la concentration de B et en augmentant celle
principalement
le
Mais même si G\\ > G)
11
de A n (voir les équations de vitesse des réactions (VI, 4) et (VI, 5)). C'est ainsi
qu'au lieu de dissoudre A n dans un grand excès de B, il y aura avantage à
ajouter seulement une petite quantité de B, à A n et d'irradier par exemple A „
légèrement gonflé de B.
On peut également à l'aide de cette méthode effectuer la réaction de greffage sur des objets déjà moulés. En effet, l'expérience a montré (4) que si l'on
part d'un polymère A n sous forme de plaque, de film ou de toute autre forme
géométrique bien définie, on peut réaliser le greffage sans modifier la forme
de l'objet et ceci jusqu'à des taux de greffage parfois très élevés.
Pour cela il suffit d'utiliser un couple polymère-monomère dans lequel le
monomère B gonfle le polymère A n sans toutefois le dissoudre entièrement. On
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
133
peut encore ajouter au monomère un solvant convenablement choisi, de ma
nière à empêcher la dissolution totale du polymère.
La figure 10 montre un exemple d'une telle réalisation. Dans cette expé
rience on était parti de grains et d'une plaquette découpés dans une plaque
d'un polyester (pol\ maléate de glycol modifié par du styrolène) sur Lesquels
on a greffé par irradiation de l'acrylonitrile. La figure montre net lenient à
droite l'accroissement en
volume des échantillons après
greffage qui corres-
pond à une augmentation de 5 fois en poids. Les échantillons greffés renferment
par conséquent 80
p.
100 en poids de polyacrylonitrile; malgré
greffage élevé, les échantillons ont conservé leur forme initiale
et
le
taux de
sont restés
parfaitement transparents.
On peut encore limiter volontairement le greffage à la surface d'un polymère (4). Pour cela il suffit d'irradier un objet en polymère A„ humecté superficiellement de monomère B. Ce traitement permet de modifier les propriétés
superficielles (dureté, résistance aux agents corrosifs, compatibilité avec les
colorants et les colles, etc.), sans modifier les propriétés mécaniques dans la
masse du polymère.
De nombreux couples de polymères-monomères ont déjà été greffés par
cette méthode (4, 5, 6, 7) et la réaction semble être d'une application très
générale.
C'est ainsi que l'on a greffé du styrolène sur le polyisobutylène (4), le poly-
méthacrylate de méthyle,
le
polyethylene, le téflon (5) et le nylon (6)
;
l'aery-
lonitrile sur le polyethylene, le chlorure de polyvinyle, le téflon, le polymétha-
crylate de méthyle (4) et le caoutchouc (5); le méthacrylate de méthyle et le
vinylearbazole sur
le
polyethylene
(6).
Quelques propriétés des polymères
obtenus ont été décrites (4, 5, 6). Enfin des membranes échangeuses
d'ions d'une grande résistance mécanique ont été obtenues en greffant du
ainsi
styrolène sur la surface de films de polyethylene, et en sulfonant ensuite
polystyrolène greffé
le
(7).
En raison de son intérêt pratique et des résultats encourageants déjà obtenus,
le
domaine de la synthèse des copolymères greffés par voie radiochimique est
actuellement exploré très activement dans de nombreux laboratoires de recherches tant universitaires qu'industriels et on peut espérer disposer dans un
avenir assez proche d'un grand nombre de données quantitatives sur ces réactions.
Ballantine (D. S.), Glines (A.), Metz (D. J.), Behr (J.), Mesrobian (R. B.) et
Restaino (A. J.), J. Pohjm. Se, 1956, 19, 219.
(6) Ballantine (D. S.), Colombo (P.), Glines (A.), Manowitz (B.) et Metz (D. J.)
(5)
r
Rapport B. N. L. 414 (T-81) 1956.
(7) Chen (W. K. W.), Mesrobian (R. B.), Ballantine (D. S.), Metz (D. J.) et Glines (A.),
J. polym. Se, 1957, 23, 907.
CHAPITRE
VII
CALCUL DES CHAMPS D'IRRADIATION A SOURCES
MULTIPLES DESTINÉS AUX POLYMÉRISATIONS
RADIOCHIMIQUES INDUSTRIELLES
L*exploitation semi-industrielle ou industrielle des polymérisations radio-
ehimiques exige dans chaque cas la connaissance du rendement de la réaction
et de la répartition des poids moléculaires du produit obtenu. Pour déterminer
d'une façon approchée ces deux grandeurs, il est nécessaire de connaître la
distribution des intensités dans le champ d'irradiation utilisé, car comme nous
l'avons vu, la vitesse et la masse moléculaire
moyenne du polymère obtenu
sont toutes les deux fonctions de l'intensité. Pour déterminer la distribution
des intensités dans le champ d'irradiation, on peut soit procéder expérimen-
talement en mesurant point par point le champ d'irradiation d'une source
donnée (1, 2), soit encore calculer ce champ à priori. Cette dernière méthode
donner rapidement les données indispensables sur les champs d'irradiation de différents arrangements de sources.
est actuellement la seule qui puisse
CALCUL DU CHAMP D'IRRADIATION
Sievert (3) a été le premier à effectuer des calculs de ce genre et il indique
notamment les formules qui donnent la distribution de l'intensité pour des
sources ponctuelles, rectilignes, cylindriques pleines, et sphériques. Son mé-
moire contient également les tables numériques des intégrales transcendantes
rencontrées.
Un certain nombre d'auteurs anglo-saxons (1) (4) (5) ont traité
quelques cas particuliers de la source cylindrique creuse. Ce travail a été
repris par Magat et Reinisch (6) qui ont en outre calculé le champ d'irradia-
tion de sources rectilignes multiples, diversement disposées.
(2)
Lewis (J. G.), Thèse Univ. Michig., 1954, 32.
Hayward (J. C), Thèse Yale Univ. 1955; NYO-3313.
(3)
Sievert (R. M.), Act. Radiol. Suppl., 1932, 14.
(1)
Henley (E. J.), Nucleonics 1953, 11, 41.
Grean (L. E.), Isaacs (P. J.), Weiss (G. J.) et Fanhoe (F.), Nucleonics 1953, 11,32.
(6) Magat (M.) et Reinisch (L.), Int. J. of Appl. Rad. and Isotopes, 1956, 1, 194.
(4)
(5)
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
135
Le point de départ de tous ces calculs est constitué par une loi différentielle
qui exprime l'intensité du rayonnement dl en un point Q du milieu absorbant
étudié (de coefficient d'absorption |i), en fonction de la distance p entre Le
point Q et un élément émetteur dx de la source. Cette intensité étant d'une
part inversement proportionnelle au carré de la distance et d'autre pari proportionnelle a e
ir
(loi
de Lambert et Beer), on peut écrire
:
dl = kPdx-^
(où P est l'activité spécifique de l'élément de source dx).
Selon que l'activité de la source est distribuée le long d'une droite
thématique
«
idéale
»),
(source
ma-
rectiligne
sur une surface ou
dans un volume, l'élément émetteur dx à considérer
sera
un
élément linéaire, un élément de
surface ou de volume et l'activité spécifique sera l'activité par
unité
de longueur, de surface
ou de volume. Le calcul conduit
alors selon les cas, à des inté-
grales simples, doubles
ou tri-
ples. Si l'activité est distribuée
dans un volume, il faut en outre
du coefficient de
tenir compte
self-absorption de la source.
Le coefficient k représente
un facteur de conversion numéqui vaut 225 pour le
Go et 65 pour le 137 Gs à con-
rique
60
dition
d'exprimer
I
en r/min
et P en curies.
En ce qui concerne la source
rectiligne
et
la
source
cylin-
drique creuse, de hauteurs suf-
fisamment grandes, on constate
que l'intensité dépend de deux
la distance du
paramètres
—
Fig. 11.
Variation de l'intensité en fonction de
ta distance pour une source rectiligne de cobalt-60,
d'une activité totale de 100 curies, d'une longueur
de 20 cm, immergée dans un milieu de coefficient
d'absorption [x
0,05 cm- 1 (Méthacrylate de
méthyle, styrolène, etc...).
=
A
:
B
:
C
:
D
Intensité dans le plan milieu ft
—
—
—
:
—
—
—
ft
ft
ft
=
= 5 cm
= 10 cm
= 15 cm.
:
point à la source et sa position en hauteur par rapport à la source. Le calcul
montre que I varie beaucoup plus fortement en fonction de la distance qu'en
fonction de la hauteur (fig. 11).
On peut ainsi ne considérer qu'une intensité
moyenne (indépendante de la hauteur) et suivre la variation de celle-ci avec la
distance à la source. Les surfaces d'iso-intensité ou d'isodoses d'une source
linéaire sont alors des cylindres droits à bases circulaires.
On peut conclure de ce que nous avons vu dans les chapitres I à IV, qu'une
polymérisation radiochimique, effectuée avec des intensités trop fortes, ne
présente qu'un intérêt modéré.
En effet
:
CALCUL DES CHAMPS D'IRRADIATION
136
1.
croît
la
vitesse
en
de la réaction
général
avec
1
I /
2
et
exceptionnellement avec un ex-
posant a compris entre 0,5 et 1
2.
au-dessus d'une
;
certaine
intensité limite, la vitesse de la
polymérisation n'augmente plus
que
3.
très
le
lentement avec I;
polymère obtenu aux
intensités très élevées possède
un poids moléculaire
moyen
très petit.
Pour
éviter
les
intensités
locales trop élevées, il est donc
intéressant
de fractionner
les
sources
de
un
et
considérer
assemblage de plusieurs sources
—
Fig. 12.
Courbes isodoses calculées dans le plan
h
5 cm pour 4 sources de cobalt-60, de 25 curies
chacune et de 20 cm de longueur, disposées suivant
un carré de diagonale =10 cm (y.
0,05 cm -1 ).
=
=
à l'intérieur du réacteur. On
peut espérer en outre obtenir
ainsi des
champs d'irradiation
plus uniformes que dans le cas
d'une source unique, ce qui doit entraîner pour le produit final une répartition
plus homogène des poids moléculaires.
Dans ce qui suit nous allons
montrer comment
on
peut
calculer la distribution des intensités
dans
sieurs
sources
le
cas de plu-
rectilignes
et
nous appliquerons ces résultats
à quelques cas concrets (6).
Le calcul du champ d'irradiation
de plusieurs sources
rectilignes
se fait
point par
point en additionnant les intensités moyennes dues à cha-
cune des sources. Les surfaces
d'égale intensité sont encore
cylindriques mais ces cylindres
n'ont plus une base circulaire.
Pour obtenir le volume compris entre deux surfaces d'iso-
—
Courbes isodoses pour 7 sources de 15 curies
Fig. 13.
chacune, disposées suivant un hexagone régulier de
6 cm de côté avec source centrale (pour les autres caractéristiques cf. Fig. 11 et 12).
doses, volume nécessaire au
calcul du rendement, on peut planimétrer les courbes représentant les bases
des cylindres (fig. 12, 13).
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
VM
CALCUL DES RENDEMENTS
II.
Une fois les surfaces isodoses déterminées, on calcule. Le rendement
d'un
réacteur en découpant son champ d'irradiation en domaines d'intensité moyenne
constante et on détermine, à l'aide des courbes de conversion expérimentales,
le poids de polymère formé dans chacun de ces domaines. La somme, étendue
à la totalité du
champ d'irradiation du réacteur, donne la production totale
de ce dernier en tonnes par an par exemple. On obtient ainsi les rendements
indiqués dans le tableau VII, qui a été calculé pour différents réacteurs conte600
^^^^]___
-—~~
^—"^„^ .^-—"^
^^^'~
500
\
—
^--*
'
^ uu
*«*oo
tu
•^*"
6
^300
s^ y
-y .y
<*.
A'* A
°>?nn
100
y
^
y.
S'/
'/
w»*i^^
Fig. 14.
i*0
30
?0
ftayon du réacteur
50
cm
— Rendement d'une source rectiligne centrale immergée dans du méthacrylate de
méthyle, en fonction du rayon du réacteur.
Activités de la source
:
125 curies.
500 curies
(multiplier l'échelle des coordonnées par 2).
2 000 curies.
(multiplier l'échelle des ordonnées par 4).
20 cm). Autres caractéristiques cf. fig. 11, etc.).
—
(hauteur du réacteur
=
—
—
nant du méthacrylate de méthyle. Les trois premières lignes de ce tableau se
rapportent à un réacteur cylindrique de 20 cm de hauteur et de 100 cm de
diamètre contenant une source centrale de 60 Go. Le rendement obtenu dans
ce cas est le rendement limite. La figure 14 montre en effet que le rendement
d'un réacteur cylindrique, à source rectiligne centrale, s'approche asymptotiquement d'une valeur limite qui, dans le cas considéré, est pratiquement
atteinte pour un diamètre de 100 cm.
On n'a donc aucun intérêt à augmenter le diamètre du réacteur au-delà
de cette limite. D'autre part, la même figure indique que, conformément à ce
qui a été dit plus haut, lorsque l'intensité de la source augmente d'un facteur
quantité de polymère formé n'augmente que d'un facteur inférieur à 2
du seul point de vue de l'utilisation des sources, il est donc préférable d'avoir
plusieurs réacteurs avec des sources faibles plutôt qu'un réacteur unique avec
une source importante. En pratique, cependant, le prix de revient de Tins4, la
:
CALCUL DES CHAMPS D'IRRADIATION
138
73
H
* J H
W W
£
S d fc
CD
1^
CO
•o"
o"
CO
"^1
O
oo"
T-l
CM
lO
<*
(O
"t«
03
C35
«o
en
o"
T-l
o"
T-l
o"
co
00
«o
CM
S"B
Si
PARTIELLES
cm
20
CM
o
o
o
o
o
«O
CM
CM
«o
CM
TH
CM
«o
CM
tH
iO
CM
oo
00
CM
CM
TH
CD
CD
CM
00
CM
se
CO
«o
CO
«o
CO
«o
CO
CO
CO
«o
CO
CD*
cd"
CD
CO~
CO
«O
CD
CO
co~
CD*"
cd"
cd"
o
CM
o
CM
o
CM
O
CM
o
CM
O
CM
O
CM
03
43
oo
CM
TH
CO
CO
CO
CD
CM
CO
T-l
T-(
O
O
o
O
c
o
CO
«O
CD
CO
«O
CO
CO
CO
«O
CD
CO
co"
CD*"
O
CM
o
CM
o
CM
O
CM
CM
O
43
43
CM
CM
T-l
CM
o
<
=
CARACTÉRISTIQUE
S
SOURCES
hauteur
c
a»
S-
o
o
O
-03
DES
£
as
S
73
+j
RÉACTEUR
C
<u
a»
DU
«O
«O
S
s
cm
20
i—i
>
=
£
hauteur
S
CARACTÉRISTIQUES
4)
Ci
o
o
o
o
o
o
03
03
03
03
03
tj
'fi
-fi
TJ
-fi
-fi
tH
CM^
CO
CM
co"
CM
£
05
S
e
fi
>>
fi
>»
fi
1>>
o
U
C
%
03
C
C
C
o
03
03
U
o
>>
>>
03
03
03
03
O
C
C
as
as
73
73
'-fi
tS
03
4>
73
"fi
TJ
73
£
O
£
z
H
a
z
H
CO
73
u
o
U
o
o
e
o
£3
03
a
03
03
-c
-c
03
0)
03
TJ
-d
03
03
S-
'es
«03
'as
'03
C
fi
03
03
"3
'as
C
-03
C
»
03
<:
03
o
73
•a
O
03
o
S-,
fi
O
73
fi
o
73
U
h
fi
O
73
O
U,
fi
o
73
03
03
O
O
-as
O
43
03
03
h
C
S-,
43
03
TJ
TJ
TJ
t-03
<3
u
C
43
TJ
73
03
73
03
_s
«a>
«
«03
C
03
03
73
'Ô5
~
3
O
73
%>
03
>>
03
>>
03
U
>^
>>
O
43
O
O
0h
73
73
73 -fi
43
03
«03
73
C
O
-fi
fi
So
«03 tH
_
o 'rt
*,§
1/3
O
o M
S)
O "03
'
03
"«CD
03
rt
73 «03
03
73
03
« SP
W
«03
^
S-O
a?
t>
.£"fi
rt
03
^*
03
03
73
03
03
73
03
03
3
O
73
3
O
73
2 o
CM
CM
*J
8^
73
03
TJ
3
.3. O
73
£
43
43
03
»43
.
y
U
"fi
03
43
'-3
-as
U
O
O
o
fi
U
C
C 43
« «
«03
(h
ce
o
03
TJ
fi
,fi
73
H
C
a
K
2
03
TJ
g
O
73
03
43 130
as
u
O 4)
73^
73
O
O
43
43
U
e
O
U
e
43
43
a
o
03
T3
TJ
X
fi
4>
X
3
fi
4)
S03
03
43
03
4)
43
U,
fc-
ÇJ
43
f-H
h
43
TJ
TJ
X
3
X
3
X
3
03
O
43
(h
03
43
03
43
43
.
O
-fi
TJ
TJ
TJ
TJ
C
fi
C
_fi
C
C
>>
>>
U
U
ts
O
u
o
<e
TJ
%,
O
a
4)
TJ
03
TJ
4)
43
-43
-43
U
a
45
a
C0
POLYMÉRISATIONS PAR RADIATIONS IONISANTES
139
tallation dépend encore d'autres facteurs et le prix de la protection, de la
télécommande des sources, etc.. peuvent au contraire favoriser l'emploi de
sources intenses.
III.
— CALCUL DE LA DISTRIBUTION
DES POIDS MOLECULAIRES
Tour calculer la distribution des poids moléculaires pour différents assemconnaissant
blages de sources linéaires, on procède de la manière suivante
domaine
par
deux
courbes
isodoses
dans
chaque
délimité
voisines,
l'intensité
:
10
6
3xl0 6
2x10*
Ux10'
5xl0 6
Poids moléculaires
Fig. 15.
— Courbes
Cercles noirs
Cercles blancs
Triangles noirs
Triangles blancs
intégrales de répartition du poids moléculaire pour le styrolène dans un
réacteur de 20 cm de hauteur et de 100 cm de diamètre.
:
:
:
Source unique (caractéristiques cf. fig. 11).
Répartition idéale à même poids moléculaire moyen que pour la source unique.
7 sources (caractéristiques cf. fig. 13).
Répartition idéale à même poids moléculaire moyen que pour les 7 sources.
on détermine, à partir de la courbe expérimentale M = /(I), le poids moléculaire moyen M du polymère qui y est formé. Connaissant ce poids moléculaire moyen et admettant que dans chacun des domaines partiels la distribution intégrale des poids moléculaires est
est décrite par l'équation suivante (7)
n,=l
(7)
J
«
idéale
:
exp|^
Schulz (G. V.), Z. phys. Chem., 1935, B 30, 379.
dP
»,
c'est-à-dire qu'elle
140
CALCUL DES CHAMPS D'IRRADIATION
où n p est le nombre de molécules de degré de polymérisation compris entre 1
et P exprimé en moles de polymère de degré de polymérisation moyen P,
on peut calculer la quantité de polymère formé dont le poids moléculaire
est compris entre 1 et 1 000, 1 et 10 000, 1 et 100 000 et ainsi de suite. Pour
déterminer la distribution des poids moléculaires, ce calcul doit être effectué
pour tous les domaines, puis on additionne les poids de polymère pour chaque
degré de polymérisation obtenus dans l'ensemble du réacteur. La figure 15
représente le résultat de ce calcul pour des polystyrolènes obtenus dans différents champs d'irradiation. A titre de comparaison, nous avons porté sur
le même graphique la courbe de distribution intégrale d'un polymère possédant le même poids moléculaire moyen que le polystyrolène produit dans le
réacteur mais dont la distribution est « idéale ». Cette figure montre alors
clairement que la distribution des poids moléculaires obtenue à l'aide des
7 sources se rapproche sensiblement de la distribution « idéale », tandis que
l'emploi d'une source unique entraîne une distribution considérablement différente de la distribution
«
idéale ».
Ill
EFFETS DES RAYONNEMENTS
DE GRANDE ÉNERGIE
SUR LES POLYMÈRES
par
A.
CHARLESBY
Royal Military College of Science
Shrivenham, Witts (Angleterre).
(Traduit de l'anglais par Madame C.
VERMEIL)
CHAPITRE PREMIER
INTRODUCTION
Les radiations employées dans les travaux que nous allons considérer consistent
en rayons
X et en électrons rapides, en neutrons lents et rapides, en protons et en
particules ionisées plus lourdes, aussi bien que dans le rayonnement issu d'une
pile atomique. On peut considérer que ces sources se divisent en deux groupes prin-
cipaux : celles qui dépendent de la fission nucléaire et celles qui, produites dans
accélérateurs électriques, ne comportent aucune transformation nucléaire.
des
Avec les énergies disponibles, la transmutation des éléments a joué tout au plus
un rôle secondaire, les effets principaux étant associés aux déplacements d'atomes,
à leur excitation ou à leur ionisation et à la production d'électrons libres.
Dans le cas des métaux (1, 2), les effets principaux observés peuvent être attribués aux déplacements d'atomes. L'ionisation
et l'excitation,
la
présence d'élec-
trons libres ne peuvent avoir qu'une faible influence sur les propriétés d'une structure métallique, qui contient déjà en général
un nombre considérable d'électrons
libres. Le déplacement d'atomes métalliques par des électrons rapides ou des rayons
y durs est un phénomène relativement peu fréquent et on a observé surtout des
déplacements par des bombardements neutroniques. Un atome qui est déplacé
par collision avec un neutron rapide se meut avec une énergie considérable et peut,
par conséquent, provoquer un réarrangement des atomes voisins, la région affectée étant connue sous le terme de point chaud. L'effet final, qui est un réarrangement des atomes et de la structure locale, dépend de la vitesse avec laquelle l'énergie
de l'atome primaire déplacé est dissipée. On peut peut-être considérer ce processus
comme une élévation localisée et très importante de température suivie d'une dissipation très rapide. En l'absence de rayonnement,
il
existe déjà dans les
métaux
de nombreux atomes déplacés et des trous interstitiels, dont le nombre dépend de
la
température et de l'histoire antérieure de l'échantillon, de telle sorte que beau-
coup des effets produits dans les métaux par les rayonnements sont analogues,
en première approximation, à ceux qui sont causés par des variations de température.
De plus, beaucoup d'atomes déplacés dans le réseau cristallin par colli-
sions avec des neutrons rapides trouvent ensuite à se loger dans des trous équiva-
Glen (J. W.), Advances in Physics, 4, 381, 1955.
Dienes (G. J.), J. Appl. Phys., 24 (6), 666, 1953.
Levy (P.) et Dienes (G. J.), ONR Symposium Report ACR 2, 1954.
(1)
(2)
INTRODUCTION
144
lents, ce
qui fait qu'on n'observe qu'une transformation réduite.
faut des doses
Il
de rayonnements allant jusqu'à 10 20 neutrons lents/cm 2 pour produire des chan-
gements appréciables des propriétés de la plupart des métaux et cette dose représente des mois d'irradiation
dans une pile nucléaire.
En conclusion, la plupart
métaux sont relativement insensibles aux rayonnements atomiques, bien que
la situation soit différente pour les alliages instables ou pour les réseaux cristallins comprenant des arrangements inhabituels d'atomes. Le faible effet des rayonnements de haute énergie sur les métaux est mis en évidence par l'utilisation dans
les tubes à rayons X de cibles métalliques, soumises à des bombardements très
des
importants d'électrons rapides sans que leurs propriétés s'en trouvent modifiées
de façon appréciable.
Lorsque des liaisons homopolaires entrent en feu, des
beaucoup plus
effets
importants peuvent se produire à cause de la part prépondérante de l'ionisation
et
de l'excitation dans l'action des rayonnements. Ces atomes ionisés
et excités
peuvent ensuite réagir pour produire des structures nouvelles de caractère stable.
Cependant les énergies mises en feu dans ces cas peuvent souvent être considérables.
Pour modifier une molécule- gramme de liaisons chimiques, avec une consommation moyenne de 25 eV par liaison, il est nécessaire de dépenser 25
(= 2, X 10
être
13
ergs ou 2,4. 10
6
foules
ou 575
x 6 x 10 23 e V
kilocalories), et cette valeur peut
considérablement augmentée en présence d'un agent protecteur.
Un mégarad
de rayonnement ne libère que 10 8 ergs/g de sorte que les doses nécessaires pour
produire de grandes quantités de matériaux transformés sont extrêmement élevées.
Par exemple, pour un composé de masse moléculaire 100, un mégarad ne
~
x 10 13 soit 4,2 x 10 4 des molécules
modifiera qu'une fraction de 100 x 10 8 /2,4
Bien que des travaux de recherches puissent être effectués dans ces
le prix de revient actuel des rayonnements d'énergie élevée rend leur
utilisation à l'échelle industrielle trop coûteuse pour la plupart des matériaux.
On peut obtenir une utilisation plus efficace des rayonnements des deux façons
présentes.
conditions,
suivantes
1° Les
:
rayonnements peuvent induire des réactions en chaîne en agissant en
quelque sorte
comme un catalyseur. La transformation d'une liaison chimique
par irradiation peut être à l'origine d'une réaction aboutissant à la modification
de plusieurs des molécules présentes initialement. C'est le cas notamment lorsque
des substances sont polymér isées par le rayonnement.
2° La masse moléculaire des molécules irradiées peut être considérable, comme
dans
le
culaire
cas de polymères ou de certains systèmes biologiques.
moyenne d'un polymère atteint bien souvent 106
.
La masse molé-
En supposant qu'on
doive dépenser 25 eV pour modifier par le rayonnement une liaison chimique, le
méqarad
modifiera
y
10 6 x 10 8
soit
2,4
x 10 13
4,2
liaisons
souvent suffisante pour changer complètement
la
par molécule.
H
Cette valeur est
les caractéristiques
physiques de
substance irradiée. Des modifications de propriétés comme la viscosité ont en
effet été observées
dans des solutions diluées pour des doses beaucoup plus faibles,
de l'ordre de 1 000 rads. Cette observation n'est toutefois pas en contradiction
avec le point de vue précédent puisque le rapport entre la quantité totale d'énergie
absorbée par l'ensemble du système et la transformation finale reste élevé. Le rôle
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
L45
principal du solvant est de capter l'énergie et de la transférer à la très petite quantité
de molécules qui y sont dissoutes et </ui sold éventuellement transformées.
Dans cette mise au point, nous avons concentré notre attention sur les change
ments produits dans les polymères à longues chaînes lorsqu'ils sont soumis aux
peut-être nécessaire de faire
remar
effets
de rayonnements d'énergie élevée.
(juer
que les changements chimiques produits ne sont pas spécifiques de ces poly
Il est
mères et qu'on peut en produire de semblables dans des composés organiques de
masse moléculaire plus faible. La différence lient essentiellement au fait que les
propriétés physiques
et
chimiques des polymères sont plus sensibles aux varia-
tions des masses moléculaires.
Par exemple, la viscosité d'un polymère à longue
chaîne dépend beaucoup du poids moléculaire. Si on ne brise (pi' une liaison dans
une seule
parmi les 106 présentes), la viscosité peut s'en trouver diminuée environ
toute la chaîne d'une molécule (la modification peut ne porter que sur
liaison
de moitié. Si des liaisons chimiques se forment entre des molécules de polymère,
il
peut en résulter une structure rendant
le
produit insoluble et non fusible.
Avant d'examiner ces transformations induites par les rayonnements,
il
est
par conséquent nécessaire de considérer les propriétés de ces polymères et la façon
dont
elles
dépendent de
la
masse moléculaire et des liaisons entre les molécules.
Plusieurs de ces propriétés ne dépendent pas de la constitution chimique du poly-
mère, mais surtout du nombre et de la configuration des entités dont la répétition
constitue la chaîne moléculaire.
A l'aide de considérations thermodynamiques,
on a pu prévoir de nombreuses propriétés, telles que le gonflement, l'élasticité et
la solubilité,
sans entrer dans le détail de la constitution chimique des polymères ;
des modifications de la constitution chimique peuvent souvent être représentées
par un simple paramètre dans les équations qui ont été établies.
Les recherches dans ce domaine des effets des rayonnements sur les polymères
ont tendance à différer de l'étude des effets sur des composés de faibles masses
moléculaires
et
du fait qu'elles sont
orientées vers
les
effets
physiques essentiels
accordent moins d'attention aux changements chimiques qui en sont la cause.
On retrouve cette tendance dans la plupart des recherches sur les polymères, où
de nombreux problèmes posés relèvent du domaine de la physique ou de la
Maintenant que beaucoup de
chimie-physique.
ces
transformations physiques
sont mieux comprises, on tend à accorder davantage d'intérêt aux processus chi-
miques dont ils dérivent, et qui peuvent permettre de pénétrer la nature de l'action
des rayonnements sur des composés à liaisons homopolaires. Nous nous limiterons
dans cette revue aux modifications des propriétés de polymères à chaînes longues
soumis aux rayonnements; nous ne nous occuperons pas du mécanisme des polymérisations non plus que de l'action des rayonnements sur les polymères thermodurcissables dont tes effets, pour une même dose de rayonnement, sont beaucoup
plus faibles et, en tout cas, plus difficiles à interpréter.
Si on se limite aux effets des rayonnements d'énergie élevée sur
les
polymères
à longue chaîne, on peut considérer séparément plusieurs phénomènes. Le compor-
tement des polymères qui deviennent par irradiation insolubles
et
non fusibles
peut être expliqué par la formation de liaisons transversales ou ponts inter-moléculaires.
De tels ponts transforment un échantillon contenant des molécules de
HAISSINSKY.
—
-
III.
10
INTRODUCTION
146
Van der Waals peu importantes, en
une substance où les molécules sont liées par des liaisons primaires. On peut
s'attendre à une telle reticulation quand le rayonnement a pour effet de rompre
polymère, liées entre elle par des forces de
des liaisons ailleurs que dans la chaîne principale, formant ainsi des radicaux
libres.
La formation de liaisons par ces radicaux peut avoir pour résultat l'agen-
cement d'un réseau à 3 dimensions accompagné de transformations profondes des
propriétés physiques et chimiques de l'échantillon.
Les caractères principaux des polymères à chaînes linéaires sont résumés dans
chapitre II, tandis que la théorie mathématique des transformations de ces
le
chaînes linéaires en réseaux à 3 dimensions est donnée dans
le
chapitre III.
Le chapitre IV analyse les changements de propriétés qu'on observe effectivement
lorsqu'un tel réseau est produit par irradiation.
En plus de la reticulation, des transformations chimiques spécifiques peuvent
être produites dans les
polymères à chaîne longue; beaucoup de ces changements
ont un effet moins important sur le comportement physique de l'échantillon irradié.
Ce groupe de transformations, qui comprend la formation de gaz, ainsi que des
changements dans le degré d' insaturation de la molécule, est discuté au
chapitre V.
Dans les polymères réticulés, la formation de réseaux à 3 dimensions et l'insolubilité
consécutive constituent une difficulté sérieuse pour l'étude des changements
chimiques et les premiers progrès dans ce domaine ont été lents. Le nombre des
travaux consacrés à ces transformations a cependant augmenté
ainsi de nombreuses informations sur
les
et on dispose
phénomènes fondamentaux en chimie
des radiations.
Des modifications de l'état cristallin ont aussi été observées dans les polymères
en particulier dans le polyethylene. Ils ont été suivis par diffraction
rayons
X et par l'étude de la densité; on trouvera au chapitre VI un compte
aux
rendu des résultats dans ce domaine.
irradiés,
Lorsque les radiations ont surtout pour action de briser la chaîne principale
au lieu des liaisons latérales, il en résulte une diminution des dimensions de la
molécule, c'est-à-dire une dégradation (3). La théorie mathématique des dégradations
de polymères à chaîne longue
chapitre
VIII,
cette théorie
est
est
exposée au chapitre
VII tandis que, dans le
appliquée aux quelques rares dégradations qui
ont été étudiées en détail.
Dans la plupart des polymères, l'énergie moyenne requise pour la modification
d'une liaison est de l'ordre de 20 à 30 eV, mais dans certains cas particuliers, no-
du poly styrolène, des énergies beaucoup plus élevées sont
est transformée. Le chapitre IX
traite de cette question et de résultats analogues dans le domaine de la protection
tamment dans
celui
absorbées chaque fois qu'une liaison chimique
contre les radiations.
(3)
Alexander (P.), Charlesby (A.), Ross (M.), Proc. Roy. Soc. A., 223, 392, 1954.
232, 31, 1955.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
l
17
On n'a pas essayé d'approfondir les mécanismes précis responsables des réticu
lotions OU des ruptures de la chaîne principale, car on peut considérer que cette
question n'est pas spécifique de l'effet des rayonnements sur les polymères à longues
chaines, mois rentre dans le cadre général de la chimie des radiations.
l'analyse des
phénomènes intéressant les polymères
méthode très
efficace d'investigation des réactions
Néanmoins,
une
irradiés peut constituer
généralement induites par
les
rayonnements en phase solide OU liquide.
Il ne nous a pas semblé nécessaire d'introduire ici une description des sources
ou des techniques d'irradiations. Les principales sources employées, radio-cobalt,
électrons accélérés et piles atomiques sont les même que dans les autres études de
chimie des radiations
(4).
Dans la plupart des travaux que nous décrivons, on
a trouvé que les résultats ne dépendaient pas du débit de dose (intensité) du rayon-
nement, mais seulement de l'énergie absorbée
et
différaient en ceci des radio-
polymérisations. Lorsqu'on utilise des réacteurs nucléaires,
sont produites par
les
transformations
un mélange de divers rayonnements et il ne peut plus être
question alors que de dose équivalente, laquelle peut en fait varier d'un type de
polymère à l'autre. Les irradiations effectuées à Oak Ridge sont souvent exprimées
en flux intégré (n v t); les valeurs équivalentes de ces doses ont été calculées à
partir de considérations sur l'absorption de l'énergie par
Bopp et Sisman (5).
L'unité de rayonnement de la pile BEPO d' Harwell a été définie arbitrairement
comme un flux de 10 17 neutrons lents par cm 2 accompagné des rayonnements y
et des neutrons rapides qui lui sont associés. On a trouvé expérimentalement
que cette unité était équivalente à 50 mégarads environ de rayons y pour la plupart des polymères.
A cause de l'analogie de leurs conceptions, les valeurs de ces
équivalents pour les piles
BEPO et d'Oak Ridge ne doivent pas différer de plus
d'un facteur 2, mais des valeurs très différentes risquent d'être obtenues pour des
piles de constructions
moins semblables (6).
(5)
Klein (P. H.), Mannal (C), Rapport KAPL P. 1503; Communie, a Electronics, 1956.
Bopp (C. D.), Sisman (0.), Nucleonics 13 (7) 28, 1955.
(6)
Chapiro
(4)
(A.),
C. R.,
239, 703, 1954.
CHAPITRE
II
PROPRIÉTÉS CARACTÉRISTIQUES
DES POLYMÈRES LINÉAIRES
On obtient des polymères à longue chaîne par la polymérisation d'un grand
d'entités identiques dénommées monomères. On trouvera dans la
nombre
figure 2,1
des exemples de tels polymères qui sont constitués d'une longue
chaîne principale d'atomes obtenue par la répétition d'une séquence déter-
minée avec des groupes latéraux attachés à cette chaîne. Si la plupart des
polymères ont des chaînes principales exclusivement constituées d'atomes de
carbone, cette structure n'est en aucune façon essentielle et on peut en préparer dont les chaînes contiennent d'autres atomes. Dans le cas des silicones,
par exemple, la chaîne principale est constituée par alternance d'atomes d'oxygène et de silicium. On peut amorcer la croissance de la chaîne à partir du
monomère par un catalyseur ou par un mécanisme de transfert de chaîne à
l'aide d'une autre chaîne croissante. La longueur de ces chaînes dépend des
constantes de vitesse des réactions d'amorçage, de propagation et de terminaison ainsi que des processus de transfert de chaîne. Certaines substances
naturelles comme le caoutchouc et le coton peuvent être considérées comme
des polymères linéaires.
Dans un polymère linéaire plusieurs configurations sont possibles. A moins
que les monomères ne possèdent un degré de symétrie suffisant, ils peuvent se
réunir complètement au hasard ou de façon à produire des configurations
« tête à queue » ou « tête à tête » (fig. 2,2). On peut obtenir des propriétés
très différentes suivant l'arrangement des chaînes latérales selon qu'elles sont
distribuées en suites régulières de part et d'autre de la chaîne principale, d'un
seul côté de cette même chaîne ou sans aucun ordre.
On doit considérer aussi comme des polymères des substances de structures
plus complexes. La molécule peut être constituée de deux ou même plusieurs
on dit alors que c'est un copolymère. Dans ce
monomères peuvent par
exemple se trouver distribués au hasard le long de la chaîne, ils peuvent alter-
unités de monomères différents
:
cas des combinaisons variées sont possibles. Les
ner ou présenter des successions alternées d'une chaîne relativement longue
ne comprenant chacune qu'une seule espèce de monomère. Dans ce dernier
cas, on désigne la substance sous le nom de copolymère en bloc.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
Dans de nombreux polymères, des ramifications
1
produisent,
se
à-dire que les monomères sont bien disposés pour La plupart
le
19
c'esl
Long d'une seule
chaîne, mais des chaînes pins indites de monomères en divergent. Ces ramifl
entions sont
tonnés
longs que
groupements latéraux de
les
de
monomère
de
unités
plusieurs
et
sont
ainsi
plus
chaîne principale d'un polymère
la
Monomère
11
11
Il
II
II
—C—G
C
c
C
c
II
II
II
II
II
H
H
11
Il
Potyéthylèm
<:,H«
non bronchi
Il
PolystyroU m
II
Il
II
C
-G
— G — C— C— C—
ClhCII
CH,
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
GH,
Il
I
GH
H
\/
3
— G--G -
-G
C
II
\/
\/
•
Polyméthacrylate
de méthyle
/\ H /\
H
H
Cll 2 -
G(CH,)COOCH,
CH
H
I
H
Il
()
I
H
G = O
G = O
GH,
GH
GH H
H
3
3
H
CH
H
3
H
H
— C — G = C--C — C — C = G--G--C
i
1
Caoutchouc
et
=
polyisoprène
!
H
GH H
H
3
1
1
H
H
H
H
H
Cll
,
:
H
H
H
H
==
C
3
H
—C = c—
1
CH,
H
H
H
— C — G = G--G — C — C = G --C--G--G = C — C —
i
i
i
1
1
H
GH
Polyisobutylène
3
H
1
GH
1
1
1
II
3
1
H
H
H
1
CH = C(CHa ),
2
1
1
GH H
GH H
CII 3
CH
GH,
s
1
1
— Si — O — Si -- O — Si — O -
Dunéthijl-
Siloxane
CH
Fig.
:
H
1
GH
greffé
,
H
— C — G — G-
— G —G —
!
linéaire.
GH
H
2,1.
1
3
CH
1
GH
3
Quelques polymères caractéristiques à longue chaîne.
Une autre variante de ce type est connue sous le nom de copolymère
à l'unité de monomère de la chaîne principale, d'espèce A, sont greffées
des chaînes latérales consistant en plusieurs monomères d'espèce B
(fig.
2,3).
En plus de la production de polymères à longue chaîne par catalyse ou par
polymérisation cationique,
il est également possible d'en produire par condensation. On peut, par exemple, obtenir un polymère en condensant un diacide
et un dialcool, ou une diamine et un acide dicarboxylique. C'est le cas notamment du nylon. A part les différences de leurs masses moléculaires, ces sub-
G
C
PROPRIÉTÉS DES POLYMÈRES LINÉAIRES
150
TÊTE A QUEUE
TÈTE A TÊTE
AU HASARD
:
:
:
— GH — GRjR — CH — CR R2 --GH.— CRiR —
— GH — GRiR — CR R — GH --GH — GRiR —
— GH — GR,R — GH — GR^, -- GRiR - CH — GH, — CR R —
S
2
2
2
a
X
2
2
2
t
X
2
a
2
2
-
2
2
t
t
RÉGULARITÉ DES CHAÎNES LATÉRALES
sans ordre
H
:
H
Ri
R
2
H
R
H
2
Ri
H
R*
— G — G — G — C — G — G--C--G — -G —
1
H
R2
H
Ri
H
Ri
H
R,
H
Ri
H
Ri
H
Ri
H
Ri
Ordonnées
:
1
1
1
1
!
1
1
1
1
R
8
H
R2
H
Rj
H
R..
:
H
R,
H
R
H
R
H
R
1
1
1
1
2
Ri
1
i
1
!
1
1
t
2
1
1
1
1
1
H
R2
Ri
H
R
1
H
2
R,
1
H
1
R*
— Différentes configurations de polymères.
Unité de monomère
branché
H
1
— C — G — G — G — G — G--G--G — — G —
Fig. 2,2.
Polymère
R,
1
H
1
H.
linéaire
H
1
Ordonnées
Polymère
1
— G — G — G — G — C — G--G--G —
1
(alternantes)
1
1
l
(isotactiques)
1
1
— A — A--A--A--A-- A
— A — A- A-- A-- A A
-
1
i
A
A
A
A
A
1
i
:
CH, = CRiR 2
.
A —A—A—A
A
A
1
1
A
A
1
1
A
A
A
1
Copolymère
ordinaire
— A — B- A--B--B--A-- B — A — A —
-
Copolymère
— A — A--A- A--B--B--B— B — B— A — A — A — A — A — A —
Copolymère
A — A — A — -A- -A- -A- -A — A — A — A —
en bloc
greffé
-
1
1
B
B
B
B
B
B
B
B
1
1
1
!
1
1
B
Fig. 2,3.
—
Polymères modifiés et Copolymères.
Unités de monomères A, B.
stances ressemblent à plusieurs égards aux polymères vinyliques monofonctionnels, mais la série dont la répétition constitue le polymère peut être consi-
dérablement plus longue et plus complexe.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
151
ARRANGEMENT MOLÉCULAIRE
Les molécules de polymères peuvent s'agencer selon divers schémas; elles
peuvent être de structure amorphe à la température ordinaire, ou partielle
ment cristallisées. Dans ce dernier cas, les cristaux sont généralement de très
petites tailles, de sorte qu'une seule molécule de
polymère peut se trouver
On peut se représenter
la structure de telles substances comme comprenant un certain nombre de
zones cristallines reliées entre elles par des molécules de polymère amorphe
considérablement plus longue qu'un cristal unique.
qui traversent partiellement ces zones cristallines.
Une même molécule aura
par conséquent une configuration cristalline dans certaines parties de l'échan-
amorphe dans d'autres. Le fait que le corps obtenu soit solide
tillon et sera
peut avoir deux causes différentes.
(de
Il
peut provenir des forces secondaires
Van der Waals) qui retiennent ensemble les molécules voisines dans les
zones cristallisées, ou être dû à la rigidité de chacunes des molécules prises
isolément qui se trouvent enchevêtrées sans pouvoir se dégager. Dans l'un
ou l'autre cas, on peut fondre le corps en élevant suffisamment la tempéraque chaque zone cristallisée fonde isolément, soit que la rigidité
de chaque molécule diminue suffisamment pour leur permettre de glisser et
de se libérer l'une de l'autre. Contrairement à la fusion de la plupart des substances ordinaires, celle des corps en question se produit dans un intervalle
de température considérable qui dépend des dimensions des zones cristallines
et de la durée d'écoulement. Si on prolonge la durée des essais, l'intervalle
de fusion peut s'en trouver réduit. Dans tous les cas, au-dessus de la température de fusion, le polymère se comporte comme un liquide très visqueux, sa
viscosité dépendant de la masse moléculaire. Par refroidissement, l'échantillon récupère sa solidité, soit par recristallisation des zones, soit parce que
ture, soit
les
molécules enchevêtrées retrouvent leur rigidité.
MASSES MOLÉCULAIRES
De nombreuses propriétés des polymères dépendent de leurs masses moléculaires. Il est extrêmement difficile, et dans de nombreux cas impossible,
d'obtenir des polymères où les molécules aient la même dimension et il est
par conséquent nécessaire de considérer la distribution des masses moléculaires, ainsi que l'effet de cette distribution sur la propriété particulière
étudie.
qu'on
Deux modes de distributions moléculaires ont été étudiés de façon
très détaillée
distribution
comme nous
:
toutes les molécules sont de même grandeur (on parle d'une
uniforme);
le
ou
leur
distribution
suit
verrons plus loin (distribution
au
une loi exponentielle,
hasard ou exponen-
tielle).
Pour définir la masse moléculaire moyenne, il faut examiner de quelle façon
moyenne peut être établie expérimentalement. Des méthodes expérimentales différentes conduisent à des valeurs différentes pour un même échancette
PROPRIÉTÉS DES POLYMÈRES LINÉAIRES
152
tillon donné (1) (2). La méthode la plus simple est basée sur la mesure des
groupements terminaux ou sur la détermination du nombre des molécules
présentes sans tenir compte des différences de grandeur qu'elles peuvent présenter. On effectue ces mesures par titration chimique directe des groupes
terminaux ou par osmométrie. La valeur moyenne qu'on obtient s'appelle
masse moléculaire moyenne en nombre (M n ) et se définit ainsi
Soit w la masse moléculaire de l'unité de monomère et u le nombre d'unités
de monomère par molécule, la masse moléculaire de cette dernière est ainsi
uw. Un échantillon comprend généralement un certain nombre de molécules
de différentes tailles et n(u) représente le nombre de molécules, composées
de u unités de monomères, c'est-à-dire de masse moléculaire uw, que compte
l'échantillon considéré. Comme les molécules sont très longues, on peut négliger la perturbation apportée à la masse moléculaire par les groupements terminaux dont la masse peut être différente de celle des unités de monomère.
Soit N le nombre total de molécules de l'échantillon (ou A
selon une terminologie généralisée donnée plus loin), tandis que le nombre d'unités de monomère contenues dans l'échantillon est U (terminologie générale Aj). La masse
moléculaire moyenne en nombre (M n ) est alors définie comme la masse molé:
,
culaire totale de l'échantillon divisée par le
mère
:
Mw =
..,
u-,
,
unîtes de
N
=
l
A
.
nombre de molécules de poly-
Une molécule de masse égale à M n contiendra alors
M
U
N
A
A
monomère avec u,1 = —n- == — = —-,
w
x
Cette façon de définir la masse moléculaire moyenne n'est pas complètement satisfaisante en ce sens qu'elle ne tient pas compte de l'influence différente
des petites et des grandes molécules. Beaucoup de propriétés des polymères
dépendent surtout des plus grandes molécules qui sont essentiellement responsables de propriétés comme la viscosité et la résistance mécanique.
Une
autre définition qui prend davantage en considération les constituants de
poids moléculaires plus élevés est la masse moléculaire moyenne en poids (M w )
qui se définit ainsi
:
M w = Sn(u)u w/2n(u)u = SW(u)uw/5:W(iz)
2
(2,1)
où W(u) est la masse de toutes les molécules contenant u unités de monomère.
On doit comparer cette définition avec celle de la masse moléculaire moyenne
en nombre qui peut être écrite sous la forme
:
M n = Sfi(u)izw/2n(u)
(2,2)
La moyenne en poids tient compte davantage des plus longues molécules par
l'addition de la quantité u à la fois au numérateur et au dénominateur. Cette
moyenne est la valeur qu'on obtient par des mesures de diffusion de la lumière et détermine un grand nombre des plus importantes propriétés d'un
système polymérisé.
(1)
(2)
Frith (E. M.), Tuckett (R. F.), Linear Polymers (Longmans Green) 1951.
Flory (P. J.), Principles of Polymer Chemistry (Cornell U. P. ) 1953.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
153
Le troisième type de niasse moléculaire moyenne, qu'on rencontre dans
de sédimentation, est connu sous le nom de moyenne de type z.
les expériences
On la définit de façon assez analogue par
:
M = Zn^u^w/Zn^u*
(2,3)
z
commode au point de vue analytique d'écrire ces expressions de façon
On peut définir la distribution du poids moléculaire par les
A^ A 2 où A = Y>n(ii), A
paramètres A
2,n(u)u, \,
Zn(u)u % et, de
est
11
plus générale.
,
t
façon générale, A„,
= 2n(li)um
peuvent être notés ulf U s
est
,
Ug.
.
.
Les rapports
.
'
!
'
3
7~? '7~
A A
x
>
A
—
A
e t» en général,
!
2
U m Avec ces définitions la moyenne en nombre
.
:
H» A,
M.
la moyenne
et
AAA
A
celle
en poids
du type z
A =
w—*
M
2
M.w =
:
wux
(2,4)
wu 2
(2,5)
Ai
wA = wu
M == —
A
3
:
z
-
'
s
2
de sorte que u x est le nombre d'unités de monomère dans une molécule de
masse égale à la masse moléculaire moyenne en nombre, u 2 celui dans une
molécule de masse égale à la moyenne en poids et ainsi de suite.
D'après cette série de définitions, on peut considérer des masses moléculaires
moyennes d'ordres plus élevés et définir de façon générale M,, par la relation
:
M = 7^ = wu
*
<2 '
*
6)
•Ar-1
La suite des paramètres A
,
A A
1}
2
...
ou u lt u 2 u 3
,
,
...
suffit à définir la
distribution des masses moléculaires et se trouve en relation directe avec les
résultats expérimentaux.
Il
est par Conséquent préférable de définir une dis-
tribution moléculaire donnée par ces paramètres plutôt que par la relation n{u)
en fonction de u.
Il
est en outre possible de passer des fonctions
distribution des masses moléculaires à partir de la série
A A
lf
2
donnant la
de paramètres A
,
... à la distribution n(u) (3).
Dans le cas d'une distribution uniforme où toutes les molécules ont la même
longueur, n(u) est égal à N(= A ) pour une valeur donnée de u et nul pour
sont
toutes les autres valeurs de u. Dans ce cas, tous les rapports u l9 u 2 u z
,
.
.
.
égaux et il n'y a aucune différence entre les différentes masses moléculaires
précédemment définies. Ceci constitue un cas idéal, malheureusement rarement rencontré au cours de l'étude des polymères. Une distribution plus courante est celle où les longueurs des molécules sont distribuées selon une fonction exponentielle définie par l'équation suivante
n(u) =
:
—«expf^-^
Bamford (C. H.), Tompa (H.), J. Polymer ScL, 10, 345, 1953.
Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A, 222, 542, 1954.
(3)
(2,7)
154
PROPRIÉTÉS DES POLYMÈRES LINÉAIRES
C'est ce type de distribution qu'on obtient si une molécule infiniment longue
coupée au hasard en donnant tout un éventail de masses moléculaires
que les effets produits par les rayonnements sur les polymères se produisent au hasard le long
des chaînes et que la superposition de tels effets peut être traitée aisément
par l'analyse mathématique. La superposition d'événements distribués au
hasard sur un polymère de masse moléculaire initialement uniforme consest
différentes. L'importance de cette fonction est due au fait
titue un problème mathématique beaucoup plus complexe.
On peut facilement calculer pour la distribution exponentielle les équations suivantes
:
M„ =|m„ = |m, =ÎM«
et
(2,8)
1
1
1
= ... ~u
=-u
=-u
Ul
3
2
x.
Une méthode très commode de mesure des masses moléculaires des polymères consiste à étudier la viscosité de leurs solutions. En diluant de plus
en plus ces solutions, le rapport entre le changement de viscosité et le produit
de la viscosité initiale par la concentration tend vers une valeur limite au
fur et à mesure que la concentration est abaissée. Cette valeur limite s'appelle
la viscosité intrinsèque; notée [rj, elle est souvent reliée à la masse moléculaire
moyenne viscosimétrique (M„) par la relation simple
:
fo]
= km;..
Ce rapport peut être considéré comme purement empirique, bien que Flory
une relation modifiée à partir
de données théoriques. Les quantités K et a sont spécifiques d'un polymère
donné, du solvant employé et de la température. Dans de nombreux cas, a
a des valeurs voisines de 0,7; cependant des valeurs beaucoup plus élevées
ne sont pas exceptionnelles. Des valeurs de K et de a pour plusieurs polymères
dans certains solvants ont été obtenues par comparaison des viscosités intrinsèques du produit fractionné avec la masse moléculaire moyenne en poids
obtenue par diffusion de la lumière (cette mesure donne une valeur absolue).
Pour de telles substances, il est possible de passer directement des mesures de
viscosité intrinsèque aux masses moléculaires moyennes viscosimétriques.
En général, cependant cette méthode n'est pas valable pour des polymères
non fractionnés pour lesquels la détermination des masses moléculaires demeure
un problème pratique difficile ou fastidieux.
On peut montrer que la masse moléculaire moyenne viscosimétrique est
reliée à la distribution des masses moléculaires par la formule suivante
et ses collaborateurs (4) aient tenté d'obtenir
:
M, =
et
(4)
uv
)
£n(M)M*+7£n(M)M
M
= -^ =
w
»
£n(u)u
(2,9)
'
j
a+ 72n(u)u
'/«
(
Flory (P. J.) et al., J. Polymer Sci. 5, 745, 1950. J. A. C. S. 74, 195, 1952; 74, 2517,
1952. J. A. C. S. 73, 1909, 1951; 73, 1915, 1951.
A.CTIONS
SUR LES POLYMÈRES
L55
On ne peut transformer la masse moléculaire moyenne viscosimétrique, soit
en moyenne en nombre, soit en moyenne en poids, que si l'on connaît
tribution des masses moléculaires. Pour une distribution uniforme
la
«lis
:
M„ = M n = M w
,
tandis que pour une distribution exponentielle
M,
devient
la relation (2,9)
= M„(a + 1)T(1 + a)
:
"
1
(2,10)
+ a) est la fouet ion gamma. En fait, a est compris généralement
tandis que pour a = 0,8,
1; pour a = 1, M„ = M w = 2 M n
M„ = 0,954 x M w = 1,908 x M n Ainsi M„ est généralement voisin de M w
où T(l
entre 0,o et
,
.
.
De nombreux résultats expérimentaux sont basés sur les modifications de
produites par irradiation. Ces changements doivent
masse moléculaire moyenne en nombre ou en poids
par un traitement mathématique.
Le tableau 2,1 résume les notations dont nous nous sommes servis ici.
la viscosité intrinsèque
alors être convertis en
Tableau 2,1.
— Terminologie
relative
aux masses moléculaires.
w
Masse moléculaire de l'unité (le monomère
Masse de la molécule de polymère
Nombre d'unités de monomère dans la molécule de polymère.
Nombre de molécules contenant u unités de monomère;
ou de masse
M
...
n(u)
M
Paramètres relatifs à la distribution des niasses moléculaires
u(= M/w)
n(M)
.
.
.
.
Ax
A Au A
A x = Zn(u)u*
.
a,
,
.
.
Masse moléculaire moyenne
en nombre
en poids
de type :
M n (= M
M =M
M (= M
de type x
Mx
x)
u>(
*)
z
3)
Nombre de monomères par masse moléculaire
en nombre
en poids
de typez
w /w)
u z (= M./w)
de type x
u x ( = MJiv)
«i(= Mn/w)
« 8 (=
viscosimétrique
Relations générales
M
«v(= M,./iy)
:
Nombre de molécules de polymère de l'échantillon
Nombre d'unités de monomère
Degré de polymérisation
Formules générales
Distributions moléculaires particulières
uniforme
au hasard (la plus probable)
A (= N)
A (= U)
u, = AJAp
u = A /A,
u = A /A
u x = A^/Ao;-.
x
2
2
3
3
2
:
Uj
= u = « =
11
3
2
.
.
il = =-u = -a, =
2
t
3
.
= ux
. . .
1
= -Ua
x
CHAPITim III
THÉORIE GÉNÉRALE DE LA RETICULATION
DISTRIRUÉE AU HASARD
La transformation la plus intéressante qui se produit par irradiation de
nombreux polymères à longue chaîne est due à la formation de ponts entre
les molécules. Tout d'abord, on obtient simplement une masse moléculaire
plus élevée et des branchements plus nombreux, mais après une dose de rayon-
nement suffisante, le polymère devient insoluble et infusible (bien que les
nombre de liaisons
cristaux pris individuellement puissent être fondus). Le
se trouver modifiées pour obtenir cet effet est petit
comparé au nombre de liaisons de l'échantillon, mais est toutefois comparable au nombre des molécules. Ce chapitre présente les résultats des analyses
mathématiques de la transformation d'une structure linéaire ou branchée en
une structure réticulée et reste valable quelle que soit la nature des moyens
par lesquels on l'aura obtenue. Cette analyse est basée sur l'hypothèse que
toutes les unités de monomères sont susceptibles de se réticuler avec la même
probabilité. On n'y tient pas compte de l'influence des groupements terminaux (qui n'ont pas forcément la même structure que les unités de monomères
et peuvent par conséquent avoir une disposition différente à se réticuler),
étant donné que leur nombre est faible en comparaison du nombre des unités
de monomère. Le transfert d'énergie, dans lequel l'ionisation ou l'excitation
produite en un point peut provoquer des transformations chimiques à
d'autres endroits, n'intervient pas de façon importante, puisque la portée du
transfert est petite en comparaison de la longueur de la molécule. Cette simplification ne s'applique pas aux unités du monomère, à cause de leurs dimensions, et des liaisons peuvent y apparaître entre des groupements chimiques
spécifiques bien que l'énergie incidente soit captée au hasard.
La possibilité de transformer un système formé de longues chaînes moléculaires distinctes en un réseau réticulé ou gel a été analysée en détail dans le
cas particulier où toutes les molécules sont de même grandeur (1,2). La théorie
plus générale (3, 4, 5) résumée ci-dessous s'applique à un système où les molé-
chimiques qui doivent
Flory (F. J.), ./. A. C. S., 63, 3096, 1941.
Flory (P. J.), J. Chem. Phys., 46, 132, 1942.
(3) Stockmayer (W. H.), ./. Chem. Phys., 12, 125, 1944.
(4) Flory (P. J.), J. A. C. S., 69, 30, 1947.
(5) Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A, 222, 542, 1954.
(1)
(2)
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
1">7
du polymère peuvent avoir n'importe quelle distribution moléculaire
initiale, définie par la fonction /»(//), comme nous L'avons vu dans Le chapitre
cilles
précédent, ou, de façon plus commode, par les paramètres
tement liés aux diverses niasses moléculaires moyennes,
A
,
A,,
.\ 2 ,
diree
DÉFINITIONS ET SYMBOLES EMPLOYÉS
Chaque pont d'une reticulation relie deux unités de monomère situées sur
et chacun de ces ponts est considéré comme quadrichaînes de molécules prennent naissance à chaque
fonctionnel, puisque
pontage. La proportion d'unités de monomère d'un échantillon qui sont direcdes chaînes adjacentes
1
tement réticulées est appelée la densité de reticulation et représentée par q.
Pour une molécule de masse moléculaire M comprenant M/w, soil u unités
de monomère, le nombre moyen d'unités réticulées est ainsi Mq/w ou qu. Dans
une molécule de polymère dont
la
masse est égale à la masse moléculaire
moyenne en nombre (M„) de l'échantillon, le nombre d'unités réticulées est
en moyenne qu x et s'appelle indice de reticulation y. Ainsi
,
Y = ?"i = ?M n /w
(3,1)
Pour de nombreuses raisons cependant, il est plus important de considérer le
nombre d'unités réticulées dans une molécule de masse égale à la moyenne
en poids (M w ); ce nombre, appelé le coefficient de reticulation 8, est défini par
la relation
:
S
= qu = qM w /w = yu /«,
2
2
(3,2)
La distribution de ces unités réticulées le long de la chaîne se fait complètement au hasard; le nombre moyen d'unités séparant chaque unité réticulée
est de 1/q et la masse moléculaire moyenne de la chaîne de polymère entre
deux ponts successifs est représentée par M c avec M c = w/q.
Lorsqu'une rupture de la chaîne principale est produite par irradiation, il
est possible de définir la densité de rupture p de manière analogue à la densité
,
de reticulation qu'on a à considérer lorsque l'effet principal de l'irradiation
est la reticulation.
On définit p comme le nombre moyen de ruptures de la
chaîne principale par unité de monomère. Pour une molécule de masse égale
à la masse moyenne en nombre, il y aura environ pu x ruptures de la chaîne
principale par molécule (voir chapitre VII).
Diverses études théoriques dé-
crivent les effets simultanés de la reticulation et de la rupture (6,7).
DISTRIBUTION UNIFORME
Si toutes les molécules
du polymère ont initialement la même masse molé-
culaire M, puis se trouvent réticulées au hasard avec une faible densité de
reticulation
(6)
(7)
g,
insuffisante pour former
un réseau complet, il se formera des
Charlesby (A.), J. Polymer Sri., 11, 513, 1953.
Shultz (A. R.), Nuclear Engineering and Science Congress, 12-16 Décembre, 1955
.
THÉORIE DE LA RETICULATION
158
molécules de polymère branché de masses 2M, 3M et en général xM, tandis
que quelques-unes des molécules initiales n'auront pas été modifiées.
Flory (2) a établi une relation donnant les nombres relatifs de ces molécules branchées en fonction de l'indice de reticulation y.
Le rapport en poids
Wjt de chacun de ces constituants s'obtient en multipliant le nombre de molécules de masse donnée par ce poids et en divisant par le poids total du poly-
mère (1)
:
n(xM)xM
W = —Sn(xM)xM
'
xr
-Y" ,e
xîy'
(3,3)
1
2W
pourvu que y soit inférieur à l'unité,
S = 1. Le nombre d'unités simples
du polymère (x = 1) décroît de façon continue depuis sa valeur initiale A
jusqu'à la valeur A e-r, tandis que celui du dimère de masse 2 M augmente^
puis diminue lorsque la reticulation s'accroît
:
n(2 M)
Aoje-r.
(3,4)
Le trimère, de masse moléculaire 3 M, formé par reticulation entre trois
molécules, est donné par
:
7i(3 M)
=A
°3!
e~ 3 '.
(3,5)
La figure 3,1 extraite de l'article de Flory, montre cette suite. On voit
que, pour y < 1,
le
rapport des masses diminue avec l'augmentation de la
complexité.
La valeur y = 1 est une valeur
critique au-dessus de laquelle
il
se forme des
molécules de dimensions théoriquement infinies, qui constituent le gel.
On peut consi-
dérer dans l'échantillon 3 catégories de constituants
:
Des molécules non réticulées ayant
conservé la masse initiale M.
2° Des molécules liées à un nombre fini
d'autres molécules formant des molécules
branchées de masses moléculaires 2 M, 3 M etc.
3° Des molécules liées à un nombre (théo1°
.
,
riquement) infini d'autres molécules ou for-
mant des anneaux fermés.
Les deux premiers constituants, formés de
2
1
Indice de reticulation
Fig. 3,1.
molécules linéaires ou branchées
y
— Reticulation d'une
tion initialement uniforme
frac-
(WJ.
lorsque y est supérieur à
forme le gel. La proportion s
est donnée par l'équation
de
taille
forment la fraction soluble ou sol. Le
troisième constituant, qui ne se rencontre que
finie,
1,
est insoluble et
de toutes les substances qui constituent le sol
:
= exp(— y(l —s))
(3,6)
ACTIONS
LES POLYMÈRES
r
SL l(
qui admet deux solutions, dont l'une est
solution correete n'admet pas s >
1.
Au poinl de vue physique, une
l.
s
L59
< 1, « = 1 et si y > 1, s < 1.
Ainsi, si y
Lorsque y tend vers l'infini, s tend vers o et L'échantillon devient entièrement
no
\\\
60 .20
60 .40
\
£0 _60
,
\
\ \
30 _70
\
\
\
20 .60
«
\
\
\
\
\
s.
\
*
1
s«
\
^10 .90
Se
S 8
\
.92^
\
-*1
\
\
4
.96
3
.97
2
98
\
\
Distrihuhnn mtiale uniforme
du hasard
0^
Fig.
3,2.
— Courbes théoriques montrant
insoluble et réticulé.
3
2
1
Indice de reticulation
la
L
5
6
7
6 9
10
y
diminution de
la fraction soluble pour
ô> 1.
La forme de la courbe donnant la quantité de sol en
fonction de l'indice de reticulation est donnée par la figure 3,2 pour une distribution initiale au hasard. Si g représente la fraction de gel (g = 1
s)
on peut écrire l'équation ci-dessus en fonction de la densité de reticulation q
— exv(—qug)
9
puisque, par définition, y = qu x
,
et que, toutes les molécules
u = ux
taille,
:
(3,7)
ayant la même
.
ÉQUATIONS GÉNÉRALES
On a établi (5) une équation générale donnant la fraction de gel et applicable à n'importe quelle distribution de masses moléculaires.
La fraction de
gel g et la densité de reticulation sont liées par la relation suivante
g = 1
— Z,n(u)u exp(— qug)fLn{u)u
:
(3,8)
THÉORIE DE LA RETICULATION
n><)
On verra qu'on obtient directement l'équation (3,7) dans le cas d'une distribution uniforme à partir de cette équation générale, puisque Sn(u) u est
égal au nombre d'unités de monomères
A de l'échantillon si u = u et à zéro
x
x
dans le cas contraire.
En développant en série l'exponentielle, on peut exprimer la relation généparamètres de distribution A
rale en fonction des
,
A etc.
x
Arf = A qg — Atf V/2 + ArfV/3 —
2
et
puisque le coefficient de reticulation
1
u
.
.
.
qu 2 = qAJA 1
S
S 2 <7 2
S<7
21 u.
(3,9)
3!iz
u,
Pour n'importe quelle distribution donnée on peut calculer facilement les
rapports uju 2 uju 2 etc.; on peut
;
alors calculer la valeur de g pour n'im.
porte quelle valeur arbitraire de 8g et
^jf
obtenir la valeur correspondante de 8
:
par simple division.
Dans le cas d'une distribution uni-
forme par exemple,
_J%)/Mo
\\
:
-
/
1
\
y
\m</Mo
et
*9
— ^*9)*
3!
(W
exp(— 8 g)
Pour une distribution au hasard,
u 3 /u 2 = 3/2; uju 2 = 4/2 et en général
.
u x/ u 2 — x /2; on a alors d'après (3,8)
-
9 =
\V
-
i
0.1
Q?
0.5
I
Fig. 3,3.
i
4
2
Indice de reticulation
5
\
1
1
2
y
— Courbes théoriques pour une
dis-
s
e1
tribution initialement au hasard des masses
moléculaires.
S fraction soluble; y* indice de reticulation du
sol; y,,- indice de reticulation des molécules formantle gel; Ms masse moléculaire moyenne finale
du sol; Mojï masse moléculaire moyenne des molécuies formant le gel;- Mo masse moléculaire
moyenne initiale.
= 1
+ 8<7/2)2
= 1
1/(1 + ygY
1
(1
= (1 + Y — Y s)
2
.
Ce genre de distribution
contre dans de
(3,10)
se
ren-
nombreux systèmes
m
montre les
érisés; la figure
3,3
>
o
variations de la fraction de gel et des
pol
r jy
autres paramètres>
Une expression plus générale de la fonction de distribution peut s'écrire
n(u) =
e-"i"/v 2 T(z
+ 1)
:
(3,11)
où z est un nombre positif et v un facteur de normalisation. Si z = 1, l'équation
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
161
exprime Le cas d'une distribution au hasard (distribution exponentielle); si
z—*oo, celui d'une distribution uniforme ou monodispersée. Pour l'une quel-
conque de ces distributions
:
^3
z
i
+1
+2
z
z
Et portant ces valeurs de u 2 u 3 u 4
,
8
y
Si z
1^2
2!z + 1
= 1-
l+~+
*+2)<z+3)
(z + l)
2
J
(3,13)
:
= 1 - g = (l + |-
2
yj
= (1 + y - Y S)«
comme dans l'équation (3,10), de même, si z -> oo
# = 1
(3,12)
dans L'équation (3,î)) on obtient
.
3!
M
= 1, cette équation devient
.
+ l(
,ay .
^
S
.
,
——7 = v
+x—1
,
elle
devient
:
— exp(— Bg)
comme dans l'équation (3,9). Dans le cas-limite où z = 0, on a
= S-1
s
:
.
En général on peut montrer que, quelle que soit la distribution initiale des
masses moléculaires, s = 1 est une solution de l'équation générale (3,8), tandis
qu'elle admet une seconde solution avec s < 1, si B > 1. Puisque la fraction
de sol s ne peut pas être plus grande que 1, les solutions ayant une signification
physique sont
:
si
8
si
8
<1
> 1
s
s
= 1,
< 1.
Le gel commence toujours à apparaître lorsqu'il y a en moyenne une unité
réticulée (ou 0,5 liaison) par masse moléculaire moyenne en poids.
La pente
de la courbe donnant la fraction de gel en fonction de la reticulation pour des
densités de reticulation élevées ne
dépend que de la distribution des masses
= 1) dépend des rapports u3 /u 2 ou
moléculaires. Sa valeur initiale (pour 8
M /M,,
2
:
^|
= 2 u /u = 2 M w /M
2
3
2,
tandis que la non linéarité de la courbe dépend des rapports plus élevés uju^
u b /u 2
,
etc.
En général, on peut considérer g comme une fonction de S ou de S g
:
g = f(B) = F(Bg)
avec
g =
lorsque
8
= 1
ou
Bg = 0.
La valeur de g pour des densités de reticulation encore plus élevées peut
être obtenue par le
développement suivant
»-«—
HAISSINSKY.
III.
:
wm. if est.-+
«">
11
THÉORIE DE LA RETICULATION
162
Par comparaison ave l'équation (3,9) ci-dessus, on a
:
F(S<7W=0
r
Ydg J,;= o
'
d2F
_2_H» =
_ __2.Mi
2 u2
2 M,
|
!
et ainsi
!
de suite pour toutes les dérivées d'ordre plus élevées.
donc que si on connaît les diverses masses moléculaires moyennes
on peut calculer une relation entre la formation du gel et le coefficient de reticulation. Réciproquement si la fraction de gel est connue en
fonction du coefficient de reticulation (et on peut l'obtenir effectivement pour
de nombreux polymères réticulés par irradiation) on peut calculer les diverses
masses moléculaires moyennes à la seule exception de la masse moyenne en
nombre (M„) qui n'intervient pas dans la formation du gel.
Avant la formation du gel, la masse moléculaire moyenne des molécules
croît par suite du pontage au hasard des molécules de polymère. On peut
montrer (5) que, dans ce domaine, défini par la condition S < 1, les équations
suivantes sont valables quelle que soit la distribution initiale des masses moléIl s'ensuit
M,,,,
M
2
.
.
.
culaires :
M'n = M n l(l— ^B)
M,;
M;
où
M,'„
= MJ(1 — S)
= M /(l — S)
(3,15)
2
2
Mu, M'- sont les masses moléculaires moyennes en nombre, en poids
M
de type z après une reticulation de degré défini par y ou S, et M„, M„,
leurs valeurs initiales. On voit que lorsqu'on approche du point de gel
z
(S
= 1), les masses moléculaires moyennes en poids et de type z tendent vers
et
l'infini;
infinie.
atteint
la moyenne en nombre augmente également, mais ne devient pas
Pour une distribution uniforme, y = 8 = 1 au point de gel, et M„
une valeur maximum égale à 2 M n pour une distribution au hasard
;
y = S/2, et M„ a une valeur maximum de
t
4
M
•
o
Au-delà du point de gel, les valeurs de M',, M[„ et M~ de la fraction de sol
diminuent d'une façon qui dépend de la masse moléculaire initiale.
Une fois que le point de gel est dépassé (S > 1) les densités de reticulation
dans le sol et le gel sont différentes. Cette situation tient au fait que les poly-
mères qui, d'un point de vue purement statistique, n'ont pas d'unités réticulées, forment nécessairement une partie du sol tandis qu'on trouvera de
préférence des molécules contenant des unités réticulées dans le gel. Les densités respectives de reticulation q s et q g du sol et du gel sont liées à la densité
moyenne générale q par des relations simples qui sont valables quelle que soit
la distribution initiale
des masses moléculaires
Qs
= sq
Q9 = (1
+ s)q.
:
\CTIONS SUK LES POLYMÈRES
Ceci peut être vérifié à partir de
Les indices et
8„) doivent
la
163
moyenne globale
q
= sq, + gq = *q% + g(l + s) (1
u-s
coefficients de reticulation pour
s).
a
le
soi e1
le
gel
r
être calculés à partir des densités correspondantes de réticula
tion q 8y q g et de la moyenne des masses moléculaires des molécules du sol et
du gel, respectivement on ne peut pas, dans le cas général, calculer une exprès
;
sion simple de ces dernières.
La figure 3,3 montre les variations de quelques paramètres en
fonction
de y, pour une distribution initiale au hasard. L'indice de reticulation y passe
par un maximum au point de gel puis décroît très rapidement. La masse moléculaire moyenne en nombre des molécules du sol se comporte de façon assez
analogue. L'indice de reticulation y og pour le gel a sa valeur la plus faible
égale à 2 au point de gel et croît ensuite lentement en tendant asympotique-
ment vers y. Le gel attire les molécules les plus longues (celles qui ont une
plus grande probabilité de contenir une unité réticulée).
de considérer la masse moléculaire
Il
n'est pas possible
moyenne des molécules du gel puisqu'il
ne consiste en fait qu'en une seule molécule. Si, cependant, on considère les
masses moléculaires initiales M og des molécules formant le gel, on voit qu'au
point de gel elles deviennent environ le double de la moyenne initiale globale,
mais décroissent ensuite, lorsque le gel renferme de plus en plus de molécules
de polymère.
CHAPITRE IV
POLYMÈRES
RETICULATION DES
Les effets les plus importants qu'on peut observer sur de nombreux polymères soumis à des radiations de haute énergie sont dus à la formation de
ponts intermoléculaires. Ces ponts modifient profondément les propriétés
mécaniques, physiques et chimiques des substances et nous allons examiner
ci-dessous cette question de façon détaillée, grâce à la théorie mathématique
de la reticulation que nous avons exposée au chapitre précédent.
Tous les polymères ne sont pas réticulés sous l'influence du rayonnement.
Lawton et Balwit (1) et
GHR) —
Selon une règle commode formulée par Miller,
par Charlesby, on peut dire que des polymères de la forme (CH 2
Tableau
—
Polymères qui se réticulent ou se dégradent.
Unité de monomère CH 2
CR^j
IV, 1.
—
DÉGRADATION
RETICULATION
R*
Ri
Ri
R*
H
H
H
CH
—
Polyethylene'
Polyméthylène
Polypropylene
3
CH
3
CH3
Polyisobutylène
3
Acide
H
polyacrylique
Polyacrylate de
H
méthyle
GH
3
GH
3
Polyacrylate
d'éthyle
^OC H
2
H
Acide
polyméthacrylique
<°
X
Polyméthacrylate de
méthyle
OCH
\0CH3
H
c/
CH
Polyméthacylate
d'éthyle
3
^OC H
2
5
Polyacrylamide
CH
Cl
Chlorure de
polyvinyle
Cl
5
Polyméthacrylamide
3
^NH
H
3
Cl
2
Chlorure de
polyvinylidène
(1) Miller (A. A.), Lawton (E. J.), Balwit (J. S.), J- Polymer Soi. 14, 503, 1954.
Charlesby (A.), Brevet anglais 732047, 1952.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
L65
(où R représente une chaîne Latérale différente de l'hydrogène) seront réticulés,
tandis que ceux de formule (GH 2
— CR,!!,) seront dégradés par
Le
rayonne
ment. Nous traiterons plus loin (chapitre VIII) le cas des polymères qui se
dégradent. Par exemple, beaucoup de polymères acryliques sont reticules.
tandis (pie les méthacryliques correspondants sont dégradés.
Dans Le tableau
IV, 1 figurent quelques polymères qui sont réticulés et Les polymères correspon
—
subit des
(CF.
Le polvtéliafluoréthylène
CF 9)
du rayonnement comme le fait la cellulose. Toutefois,
tlants qui sont dégradés.
ruptures sous
l'effet
cette règle n'est pas générale et son application peut dépendre de la Longueur
de la chaîne latérale comme de la structure de la chaîne principale. Par exemple
polyisobutylène, de structure
le
diation,
tandis que
le
— (GH — G(CH — dégrade par
— (O — Si(CH — de cons2
3) 2 )
polydiméthylsiloxane,
titution analogue, se réticule.
se
irra-
3) 2)
La différence entre ces deux comportements
peut provenir d'empêchements stériques dus aux chaînes latérales. Quand ces
dernières sont courtes, les fragments de la molécule brisée peuvent se réunir
à nouveau, mais lorsqu'elles sont longues, l'empêchement stérique tend à
rendre la fragmentation permanente.
Wall (2) a établi une relation entre
le comportement radiochimique des polymères et leur chaleur de polymérisation
et a montré que, lorsque les polymères sont réticulés, ces chaleurs sont élevées,
tandis qu'elles sont faibles dans le cas de la dégradation. Il est bien connu que
c'est à cause
les
rable qui les
longue
à
d'empêchements stériques entre les groupements latéraux que
chaînes de polyisobutylène sont soumises à une tension interne considé-
empêche de prendre la configuration habituelle des polymères
chaîne
lorsque
la
chaîne
principale
est
formée d'atomes
de
carbone.
De nombreuses expériences ont été poursuivies en utilisant comme sources
de rayonnement des électrons, des rayons y et le rayonnement d'une pile,
constitué par un mélange d'électrons, de rayons y, de neutrons rapides et
lents.
D'après les résultats, on .peut dire qu'il y a peu ou pas du tout de dif-
férence entre les effets de toutes ces formes de rayonnements, si on compare
les
transformations produites par des quantités égales d'énergie absorbée.
Il
que les différences qu'on a pu observer entre diverses
expériences soient dues aux techniques d'étalonnage des sources utilisées et
de mesures des transformations produites. Il est possible qu'il existe une différence pour des rayonnements à densité d'ionisation très élevée comme les
particules a, mais là non plus on n'a pas encore observé des variations bien
considérables dans les effets des rayonnements sur les polymères.
Ces expériences utilisant des sources différentes mettent en évidence le fait
que le débit de la dose est sans influence sur les résultats produits. Pour parvenir à réticuler 1 p. 100 des monomères du polyethylene on doit l'exposer
pendant 20 heures environ à la pile BEPO avec un débit de dose, exprimée en
équivalents de rayons y, de l'ordre de 3 mégarads par heure. Si les échantillons
sont irradiés par des rayons y purs à 50 000 rads par heure ou par des électrons à plusieurs mégarads par seconde, on n'observe pas de différences significatives entre les nombres de ponts formés par une même dose totale de rayonest plus vraisemblable
(2)
Wall (L. A.), ./. Polymer Sci. 17, 141, 1955.
RETICULATION DES POLYMÈRES
166
Il est ainsi possible d'assigner une valeur au rendement G de reticuPour de nombreux polymères, G est compris entre 3 et 5, à l'exception
du polystyrolène où il est beaucoup plus faible, de l'ordre de 0,05. Cette différence si marquée tient à des phénomènes de radio-protection qui seront dis-
nement.
lation.
cutés au chapitre IX.
On peut estimer la distribution des ponts intermoléculaires autour de la
particule ionisante initiale à partir de la vitesse d'ionisation et des doses de
rayonnements nécessaires pour produire des changements visibles. Par exemple,
un électron de 3 Mev, pénétrant d'environ 1 cm, produira approximativement
10 5 ponts intermoléculaires qui se trouvent par conséquent distants l'un de
l'autre de 10 3
 le long de la trajectoire de l'électron primaire (en négligeant
la diffusion et les effets secondaires).
Pour produire des modifications appré-
ciables dans le polymère, il faut des doses de l'ordre de 1 mégarad, correspon-
dant à une énergie de 0,625 x 10 20 ev/g ou environ 2.10 18 ponts par gramme.
Avec des électrons de 3 Mev, le nombre d'électrons primaires nécessaires pour
céder cette quantité d'énergie est de 2 x 10 13 ils seront alors distants de
seulement 22 Â en moyenne. A cause des doses élevées nécessaires pour parvenir à réticuler des polymères, il est probablement correct de considérer
que les pontages se produisent au hasard. Dans le cas des particules alpha,
à densité d'ionisation beaucoup plus élevée, certains effets statistiques pourraient commencer à apparaître, quoique, dans un travail non publié, nous
n'ayons observé aucune différence marquée. Les expériences sur les polymères ont généralement été réalisées avec des rayonnements de densité d'io;
comme les rayons y ou les électrons rapides, qui conviennent beaucoup mieux au point de vue expérimental à ce genre d'expénisation plus faible,
riences.
MODIFICATION DE LA
FUSIBILITÉ
De nombreuses expériences sur les propriétés mécaniques, la gélification
ou le gonflement de polymères irradiés, montrent que la densité de reticulation (représentée par q) est proportionnelle à la dose de rayonnement. Il
est donc commode de poser q = q Q (Mr), ou (Mr) est la dose exprimée en mégarads et q est une constante ne dépendant que de la structure chimique de
l'unité de
monomère. Un mégarad correspond à l'absorption d'une énergie
de 0,625 x 10 20 ev/g, ou à la production de 6,25 x 10 17 x G ponts intermo17
x G
léculaires par gramme de substance irradiée, ou encore à 12,5 x 10
23
unités réticulées par gramme. Un gramme de polymère contient 6,02 x 10 /w
unités de
monomère de telle sorte que la proportion de ceux qui sont réti-
culés par mégarad est
70
:
= 12,5xlO»Gu, =
10 _ 6 x
Gw
,
(4 ,l)
6,02 x 10 23
L'indice de reticulation y, défini comme le
nombre d'unités réticulées par
molécule ayant une masse égale à la masse moléculaire moyenne en nombre
est
donnée par l'équation
:
6
y = qUx = q (Mr)MJw = 2,08 X 10- (Mr)GM„,
(4,2)
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
tandis que
Le
de reticulation
coefficient
poids
est
S,
c'est-à-dire
masse moléculaire égale à
réticulées par molécule de
donné par L'équation
pour
et
Le
nombre d'unités
masse moyenne en
la
:
8 = qu. = 2,08 x 10- 8 (Mr)GM w
G = 4 et
w = 100,
q = 8 x 10~
8 = 0,24(Mr).
G = 4 et M w = 30 000,
i
pour
11)7
(4,3)
;
4
;
Comme nous l'avons montré plus haut (chapitre III) la formation, à partir
d'une struct me linéaire ou branchée, d'une petite quantité de gel ou d'un
réseau tridimensionnel se produit pour une densité de rayonnement rge cori
respondant à
8
= 1, c'est-à-dire lorsque
:
(Mr) = 1/2,08 x 10- 6 GM
!0
4,8
x 10 5 /GM„
(Mr)M w = 4,8 x 10 /G5
et
(4,4)
Cette valeur correspond à la transformation du polymère initial en une
substance qui est partiellement insoluble et non fusible. On a fait de nombreuses
expériences pour déterminer la valeur de G en fonction de M w Ces expériences
montrent que G est indépendant dans un très vaste domaine de la masse
moléculaire initiale du polymère. On pouvait s'attendre à ce résultat puisque
les molécules sont assez grandes pour que la présence des groupements terminaux ait peu d'effets sur la distribution des ponts intermoléculaires. Il est
parfois difficile, au cours de ces expériences, de déterminer la masse moléculaire moyenne en poids M w en particulier dans le cas du polyethylene. Toutefois, on peut obtenir des valeurs correspon.
,
dantes en
considérant
des paraffines à chaîne
de
des doses variées d'irradiation
(3).
obtenues sont reproduites dans
les
X
~ ^\x C 34 H 70
70
masse moléculaire uniforme. On a
soumis de telles paraffines au rayonnement d'un
réacteur nucléaire et mesuré le point de fusion après
droite
n
>200°C
Xm
Les courbes
5
figures 4,1.
\_
60 -
"5;
Tout d'abord, on observe une légère diminution
du point de fusion, qui passe par un minimum,
puis croît lentement. On atteint un point critique
au-delà duquel une très petite dose de rayonnement produit une substance qui ne fond pas, ou
ne s'écoule plus, même à des températures très
élevées de l'ordre de 200° C. On peut admettre que
ce changement brusque correspond à la formation
tridimensionnel.
Les expériences
probablement
pour la dose de gélification
donnent
une valeur un peu trop élevée, car le point de
d'un réseau
§
£$
^50>
*
j
No
.
^C
24^50
^sM60°C
1
10
Dose de rayonnement
Fig. 4,1
a.
gel correspond à la formation d'une quantité infiniment petite de substance
réticulée, tandis que les résultats
expérimentaux sont relatifs à la formation
d'une fraction de gel suffisamment importante pour absorber la fraction
(3)
Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 222, 60, 1954.
RETICULATION DES POLYMÈRES
168
et l'empêcher de s'écouler. On trouvera dans le tableau IV,2 la
dose de gélification mesurée en fonction de la longueur de la chaîne. Ces
soluble
doses sont mesurées en unités de pile de 10 17 neutrons lents/cm 2
20
10
+ neutrons
30
Dose de rayonnement
Fig. 4,1
Fig. 4,1, a et
b.
b.
— Point de fusion de paraffines normales (dose de rayonnement en unités de pile).
rapides et rayons y associés. Des
expériences complémentaires indiquent
que l'unité de rayonnement de la pile BEPO de Harwell a le même effet
qu'une dose de rayons y de 46 mégarads. Dans la 4 e colonne du tableau IV,2
Tableau IV,2.
— Dose de
gélification
n
M
Rçel
unités de pile
7
100
142
170
338
394
450
478
506
27,3
10,6
9,8
7,2
10
12
24
28
32
34
36
50,2
29
pour les paraffines C„H 2n+2 *
Dose
équivalente
(Mr)
2 310
1 330
1255
6,5
6,9
490
450
330
300
320
(Mr)M
x io- 5
2,31
1,89
2,13
1,66
1,77
1,49
1,44
1,62
* en supposant qu'une unité de pile équivaut à 46 Mr.
les
unités de pile sont converties en équivalents de radiation gamma, tandis
que, dans la dernière colonne, on a effectué le produit (Mr)M, dont la valeur
moyenne est d'environ 1,6. 10 5 Des valeurs plus élevées obtenues pour les
.
paraffines de masses moléculaires faibles peuvent être dues à l'influence des
bouts de chaîne ou au fait qu'une proportion plus forte de gel est nécessaire
pour empêcher l'écoulement. En prenant cette valeur pour (Mr)M, la valeur
de G qu'on peut déduire de l'équation (4,4) est de 3,1. A cause des arguments
précédents, cette valeur est probablement trop faible.
actions sen les poly m fi nus
L69
Lawton, Balwit et Bueche (4) ont défini l'efficacité de reticulation comme
entre Le nombre de ponts produits dans divers échantillons dr polj
ethylene et le nombre de paires d'ions produits par la même dosr de rayon
le rapport
nement dans l'air. Les valeurs obtenues à partir du modale d'élasticité e1
<\c
l:i
courbe d'allongement donnent un coefficient de reticulation de 1,2 environ,
ce qui permet de calculer pour G nue valeur d'environ 3,6. La différence entre
cette valeur
lentes de
et
la
valeur obtenue pour les paraffines
est
probablement dans
des erreurs expérimentales des déterminations des doses équiva
les limites
rayonnement
et
des niasses moléculaires.
De pins,
les
conditions
d'irradiation étaient très différentes. Les paraffines étaient Irradiées à
la pile
avec des doses de l'ordre de plusieurs centaines de mégarads pendanl des
durées d'une semaine ou plus. Les échantillons de polyethylene étudiés par
Lawton, Balwit et Bueche étaient soumis pendant 100 secondes à des électrons avec des doses de 15 mégarads seulement. Un bon accord entre ces deux
valeurs étayerait par conséquent la conclusion selon laquelle il y a peu ou pas
d'effet d'intensité
du rayonnement pour une dose donnée. En comparant les
échantillons de polyethylene avec ceux de cire de paraffines ou d'autres parai
fines de plus faibles masses moléculaires, Lawton, Balwit et Bueche ont
trouvé une variation avec la masse moléculaire qui est de la forme
:
rgeiMaM 32
'
,
mais cette variation de l'efficacité de reticulation avec la masse moléculaire
vient probablement des incertitudes sur la mesure de la masse moléculaire
moyenne plutôt que sur la dose de gélification.
Les résultats expérimentaux sur l'irradiation de polydiméthylsiloxanes
soumis au rayonnement d'un réacteur nucléaire confirment également que G
est approximativement indépendant de la masse moléculaire. Le tableau IV,
Tableau
IV,3.
— Formation de gel dans
les
silicones.
(Irradiation à la pile).
Viscosité totale
(centistokes à 25° C)
Mw
Rgcl
(unités de pile)
100 000
30 000
12 500
1 000
50
10
106 000
80 000
62 000
26 400
3 900
1 200
3,7 Xl0" !
5,1 x 10-'7 X 10~ 2
12 X 10-*
72 X 10~ 2
3,2
(Mr)
(Mr)Mu
Mégarads
1.7
2,35
3,2
5,5
33
147
.
1,8
1,9
2,0
1,5
1,3
1,8
x 10 5
x 10
x 10 5
X 10 s
X 10 5
X 10 5
5
donne la dose de rayonnement nécessaire pour former une petite quantité de
dans des silicones fluides de viscosités variées et, à partir de là, la masse
moléculaire moyenne en poids. Les échantillons étaient soumis dans la pile
BEPO de Harwell à des doses variables et on en extrayait la fraction soluble.
En portant sur un graphique la fraction insoluble en fonction de la dose reçue,
on obtenait par extrapolation la dose limite correspondant au début de la
gel
(4)
Lawton (E. J.), Balwit (J. S.), Bueche (A. M.), Ind. Eng. Chem. 46, 1703, 1954.
17(1
RETICULATION DES POLYMÈRES
formation du gel. La dose de gélification exprimée en unités de pile était convertie en mégarads équivalents, en supposant qu'une unité de pile, définie
comme ci-dessus, est équivalente à 46 mégarads, mais cette équivalence est
sujette à caution parce que l'absorption de l'énergie des neutrons rapides
par le silicium et l'oxygène peut différer de façon appréciable de l'absorption
par le carbone et l'hydrogène.
Le produit (Mr)M w est relativement constant pour des masses moléculaires
allant de 1 200 à 106 000, ce qui indique que l'énergie absorbée par pont intermoléculaire formé est relativement indépendante de la masse moléculaire;
la valeur moyenne de ce produit est de 1,7 x 10 5 ce qui conduit pour G à
une valeur de 2,4. Les mesures sur la formation de gels dans ces substances
,
par les rayons y donnent une valeur légèrement plus élevée de G, probablement à cause de l'incertitude sur la dose équivalente en rayonnement y de
la pile lors de l'irradiation des silicones. Les intensités des rayons y et des
rayonnements de la pile étaient dans le rapport de 1 à 100.
SOLUBILITÉ
Pour de faibles doses de rayonnement correspondant à la formation de moins
d'un pont intermoléculaire par molécule ayant la masse moléculaire moyenne
en poids (8 < 1), les polymères à longue chaîne qui sont réticulés par irra-
.2
ùose
Fig. 4,2.
0.4
de rayonnement en unités de pite
— Modification de
la solubilité des
dimethyls iloxanes.
Les courbes de gauche montrent la solubilité théorique pour des distributions de masses moléculaires initialement uniformes ou réparties au hasard. Les valeurs, exprimées en centistokes (CS),
représentent la viscosité initiale, c'est-à-dire la masse moléculaire des échantillons de départ.
Pour des doses supérieures (S > 1),
forme deux fractions, l'une complètement soluble et l'autre, formée d'un
réseau à 3 dimensions, complètement insoluble. On a montré que le rapport
diation demeurent entièrement solubles.
il
se
entre la fraction de sol s et l'indice de reticulation 8 dépendait de la distribution
initiale des masses moléculaires (chapitre III).
Les modifications de solubilité
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
171
des polymères par irradiation n'ont été étudiées que sur quelques substances
seulement. Le travail
le
plus détaillé est probablement celui concernanl
la
solubilité des diméthylsiloxanes pour lesquelles la masse moléculaire moyenne
en poids peut être obtenue simplement à partir de la viscosité globale qui
caractérise ces polymères (5). La figure 4,2 représente les combes donnanl la
quantité de sol en fonction de
la
dose pour des silicones de masses molécu-
laires variées après irradiation dans un réacteur, la fraction de sol étant extraite
au soxhlel par du benzène à l'ébullition. On y a lait figurer aussi les courbes
théoriques pour des distributions uniformes et au hasard afin de permettre
la
comparaison. La courbe a des ordonnées logarithmiques, de sorte
forme est indépendante
de paramètres tels que
le
\ x
close
00%
de rayonnement.
-t-\
60%
ces
\
quelques coupures dues au rayonn t
\
distribution initiale un/forme
\
\
^
\
|
40*
20*
0,5
1
1
1
I
1.5
2
"^TT^t
1
3
Dose de rayonnement
polymères,
d'une distribution au
hasard que d'une dis-
distribution initiale au hasard avec
\
culaires est plusproche,
pour
distribution initiale au hasard
\
\
A des variations de ces
paramètres correspond
simplement un déplacement
latéral
des
courbes. En comparant
les courbes expérimentales et théoriques, on
voit que la distribution des masses molé-
\
Y
rapport entre S et la
(pie sa
FlG> 43
__ Solubilité du polystyrolène dans
et
le
toluène
le
benzène (B)
(T+).
tribution uniforme.
Une courbe analogue obtenue dans le cas d'irradiation de polystyrolène
montre également un accord satisfaisant avec une distribution au hasard
(fig. 4,3). Dans ce cas, on procédait à deux séries d'extraction avec différents
solvants, mais elles donnaient pour la fraction soluble des résultats identiques,
comme on pouvait s'y attendre du fait de la stabilité des reticulations produites par les rayonnements. Les résultats des irradiations d'échantillons de
polystyrolène sont formellement opposés à l'hypothèse d'une distribution
initiale
uniforme. D'autres résultats de même nature ont été fournis par la
reticulation par irradiation de divers caoutchoucs synthétiques.
Dans tous ces cas, la fraction soluble tend vers zéro lorsque la dose de rayonnement augmente. Dans le cas du polyethylene, la situation se complique du
fait que, outre la
chaîne principale, les chaînes latérales aussi sont scindées,
ce qui produit une reticulation, tandis que la première sorte de coupures dimi-
nue la masse moléculaire moyenne. On peut montrer que lorsque la reticulation et la dégradation se produisent simultanément et proportionnellement
à la dose absorbée, la fraction soluble elle-même ne tend pas vers zéro quand
on fait croître la dose, mais atteint une valeur limite caractéristique du rap<5)
Charlesby (A.), Proc. Roy. Soi: A, 230, 120, 1955.
RETICULATION DES POLYMÈRES
172
port entre la dégradation et la reticulation. Pour le polyethylene, la fraction
soluble tend vers une valeur limite de 10 p. 100 environ pour des doses croissantes, valeur qui correspond à un rapport entre la dégradation et la reticulation de 0,3 environ (3), et qui est en accord avec celle qu'on peut déduire
du comportement radiochimique du méthane et du butane. Une méthode plus
directe, due à Baskett et Miller (6), est basée sur la formation et l'extraction de substance soluble lorsque le gel est irradié séparément. Ces résultats
donnent une valeur un peu plus faible.
GONFLEMENT
Bien que la fraction de gel d'un polymère réticulé ne soit plus soluble, elle
peut gonfler dans une certaine mesure selon le solvant utilisé et la densité q
des unités de monomère réticulées. On peut encore exprimer la densité de
reticulation différemment, en fonction de la masse moléculaire moyenne de
la chaîne entre deux pontages successifs. Soit M c cette masse moyenne, on a
alors
:
M = wjq
(4,5)
c
où w représente la masse moléculaire de l'unité de monomère.
Il est possible, à partir de considérations purement thermodynamiques,,
de déduire une expression donnant le rapport de gonflement d'un polymère
réticulé. Le gonflement atteint un équilibre par suite de deux mécanismes
opposés interaction entre le solvant et le polymère qui tend à isoler chacune
:
des molécules et force élastique de sens contraire résultant de cette séparation même. On peut écrire le rapport de gonflement sous la forme
H -h) + h + $ +Str -£)-°
t
i
:
(4 6)
'
où y. est un paramètre qui définit l'interaction entre le solvant et le polymère.
Dans certaines conditions on peut simplifier cette équation qui devient
:
y6/3
= (0,5
— [x)M
c
pv
où V est le rapport du volume de la substance gonflée à son poids à l'état sec,.
p la densité du polymère et v la fraction molaire du solvant. La densité de
reticulation q est proportionnelle à la dose de rayonnement r (q = q r). En
remplaçant alors M c en fonction de q ou de ç il vient
:
,
pvq
r
En portant en coordonnées logarithmiques V en fonction de r, on devrait obtenir ainsi une droite de pente égale à
(6)
—
0,6 et indépendante de la masse mole-
Baskett (A. G.), Miller (G. W.), Nature, 174, 1954.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
culaire du polymère irradié. Les courbes des figures
l,
I
el
17:;
1,5
pour Le |><>I\ ethy-
winothène (une paraffine de plus faible poids moléculaire) et Les silicones (5) vérifient celte loi dans la plus grande partie du domaine étudié.
lene, le
W polymère de
P
petite masse moléculaire
polymère de grande masse moléculaire
solvant-
xylene à 120° C
courbe de gonflement calculée pour dupolyethylene (P)
en admettant une distribution initiale au hasard
coorbe théorique pour une
^distribution au hasard
ru
0.05
0,15
0.2
Q25
M
Dose
\
0.5
de
5
1
2
1.5
I
rayonnement
50
20
10
100
de reticulation
Effet de la dose de rayonnement et de la masse moléculaire sur le gonflement des
Indice
Fig. 4,4. -
chaînes de polyethylene.
L'accord entre les différentes courbes pour des substances de masses moléque la densité de reticulation est
culaires initialement différentes confirme
o
a
+
•
100000 cS
30000
12500
10000
— vi
,
50
•
IK
0,2
Dose
Fig. 4,5.
— Gonflement de polymères de diméthylsiloxane de
viscocités différentes
dans le
toluène à 20 °C.
indépendante de la masse moléculaire initiale. On a des écarts avec la courbe
théorique lorsque la densité de reticulation est très élevée, ou pour des doses
de rayonnement proches de celles du point de gel. Le premier écart est dû,
RETICULATION DES POLYMÈRES
174
en grande partie, aux approximations faites lors du calcul de la formule théorique (4,6), le second, principalement au fait que le poids moléculaire du polymère original est fini. Le rapport de gonflement V est en rapport avec le poids
initial de matière sèche, mais en fait, il n'y a que la fraction de gel qui puisse
gonfler, de telle sorte qu'on devrait exprimer le rapport de gonflement comme
le rapport entre le volume gonflé et le volume
multiplié par (1
—
s) et
de gel sec, soit le volume gonflé
divisé par le volume initial.
La fraction de gel attire
une plus grande proportion de ponts de reticulation que ne le fait le sol et la
valeur de M est ainsi plus petite que la moyenne que donnerait l'échantillon
tout entier. En faisant une correction pour les groupements terminaux, on
doit tenir compte aussi de la plus grande dimension des molécules de gel et
par conséquent du nombre plus faible de groupements terminaux présents
dans un poids donné de substance. Quand on effectue cette correction, ainsi
que d'autres analogues, on obtient une courbe assez semblable à celle des
figures 4,4 et 4,5. Pour un indice de reticulation S = 1, il n'y a pas de fraction
gel et on n'observe pas de gonflement. Dans ces conditions, la courbe doit
tendre vers zéro pour la dose de rayonnement correspondante.
PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES
De nombreux polymères à chaîne longue se comportent comme des solides
ayant un faible domaine de déformation élastique, des déformations plus
importantes n'étant pas réversibles. On nomme souvent ces polymères plastomères. D'autres polymères présentent un domaine de déformation élastique si
différent de celui de la plupart des solides qu'on les classe à part et qu'on les
nomme élastomères on dit aussi que ces substances ont une élasticité du genre
;
de celle du caoutchouc. La distinction entre élastomères et plastomères n'est
pas très bien définie et peut dépendre de la température des mesures, de la
durée des expériences ainsi que de la présence de ponts de reticulation entre
les molécules.
Dans les polymères à longue chaîne non réticulés, la solidité peut tenir à
l'une des deux causes suivantes
:
à la présence des zones de cristallisation ou
à la rigidité intrinsèque de la molécule de polymère elle-même. Le polyethylene et le nylon, par exemple, sont en grande partie cristallisés à la température
ambiante. Une seule molécule peut se trouver située en partie dans plusieurs
Chaque chaîne moléculaire
régions cristallisées et dans d'autres amorphes.
sera donc liée aux autres molécules, dans les régions cristallisées, par des forces
de Van der Waals et par ailleurs servira à lier entre elles ces diverses zones
cristallines. Les liaisons hydrogène peuvent aussi lier les
molécules entre elles.
Quoique ces liaisons secondaires ne soient pas aussi fortes que les liaisons
primaires de la chaîne principale, elles sont distribuées régulièrement dans le
cristal et se renforcent par conséquent l'une l'autre en formant finalement une
forte liaison. Lorsqu'on augmente la température de l'échantillon, ces régions
cristallisées
fondent et la force élastique ainsi que les propriétés mécaniques
diminuent. A une température suffisamment élevée pour fondre tous les cristallites, il ne reste plus que les forces secondaires pour maintenir les molécules
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
L75
ensemble. Ces forces sont Identiques à celles qui existent entre les chaînes de
paraffine en phase liquide
et
sont
Incapables de s'opposer à une contrainte
extérieure pendant un temps appréciable. Le résultat
est
que ces polymères
comportent, aux températures supérieures à celle de fusion des cristallites,
comme des fluides visqueux. C'est Le cas notamment du polyethylene qui se
se
ramollit à partir de cSO °C et qui est complètement fluide entre
environ, selon la régularité de sa structure, e'est-à-dire
cristallisées.
la
ll.">" et
taille
135 °C
des réglons
Dans d'antres polymères dits amorphes, où des Irrégularités de
structure empêchent
la cristallisation, les
chaînes peuvent être enchevêtrées.
A la température ordinaire, les chaînes sont rigides parce que leur rotation est
gênée parles liaisons de la chaîne principale. Celte rigidité empêche les chaînes
de se démêler et de glisser l'une sur l'autre. A des températures pins élevées.
la probabilité
de rotation autour de chaque liaison augmente et, sons l'action
d'une charge extérieure,
qui dépend de
la
les
molécules peuvent se délover, avec une vitesse
tension appliquée ainsi que de la température, c'est-à-dire
de la rigidité de la chaîne moléculaire. Le polymère se comportera alors connue
un fluide visqueux dont la viscosité varie considérablement avec la température.
Dans aucun cas on n'observe d'empêchement permanent d'écoulement audessus de la température dite de fusion. Cette température
est,
toutefois,
du point de fusion des composés organiques plus simples et est
comprise dans un intervalle qui dépend des conditions de l'expérience. Il se
produit un empêchement à l'écoulement au-dessus de cette température si
les molécules sont reliées entre elles de façon permanente par les liaisons primaires, comme c'est le cas lorsqu'elles sont réticulées par irradiation. Dans ce
cas, lorsque la température croît, le polymère passe de l'état de solide cristallin ou amorphe à celui d'un élastomère dont les propriétés mécaniques
dépendent de la densité de reticulation.
L'élasticité du type caoutchouc a été expliquée en prenant en considération l'entropie (7, 8, 9, 10). Une chaîne longue et flexible dont les extrémités
sont placées à deux points donnés peut prendre un nombre de configurations
qui dépend de la longueur de la chaîne et de la distance entre les extrémités.
Il existe, par conséquent, entre ces deux extrémités, une configuration qui
est la plus probable et, si une charge extérieure leur est appliquée et les sépare,
il en résultera une configuration moins probable. Pour des raisons relatives
différente
à l'entropie,
il
y aura opposition à ces tensions extérieures et retour de la
chaîne à une configuration plus probable lorsqu'on les fera cesser.
établir, sur des bases
On peut
purement thermodynamiques, une expression qui relie
la tension appliquée à la réaction opposée en fonction de la longueur moyenne
des chaînes individuelles. On exprime généralement cette longueur moyenne
par
M
c,
masse moléculaire moyenne entre deux ponts de reticulation. La
théorie élastique des structures réticulées conduit à l'équation fondamentale
Flory (P. J.), Principles of Polymer Chemistry, Cornell 1955.
Treloar (L. R. G.), Physics of Rubber Elasticity, Oxford Clarendon Press 1949.
(9) Flory (P. J.), Chem. Reviews 35, 51, 1944.
(7)
(8)
(10)
Wall (F. T.), J. Chem. Physics, 10, 485 (1942); 11, 527 (1943).
:
RETICULATION DES POLYMÈRES
170
où F est la tension appliquée, p est la densité, a le rapport entre les longueurs
après et avant allongement, R la constante des gaz et T la température absolue.
On suppose que, pendant la déformation, le volume reste constant. Si l'élongation par unité de longueur dans la direction de l'allongement est e, on a
:
a
et
= 1 +e
pour de faibles allongements e
F = 3 P RTe/M
le
module d'élasticité est alors donné par
c
:
E =- = 3 P RT/M
c
(4,8)
.
e
Il
vient, d'après l'équation (4,5)
E = 3pRTg r/w
(4,9)
Pour une substance donnée, on a trouvé que q était constant, de sorte
que pour un corps de type caoutchouc, le module d'élasticité est proportionnel à la dose de rayonnement. Gomme dans le cas du gonflement, il faut
apporter une correction à la masse moléculaire initiale, puisque les fragments
attachés à un seul point du réseau ne peuvent prendre part à la déformation
élastique sauf en agissant comme un plastifiant interne. Le facteur de correction peut approximativement (11) être écrit sous la forme
:
E = 3 9 RTq (r/w)(l—™
= 3pIiTq ~(l— 2-)
1
(4,10)
où M est la masse moléculaire moyenne initiale en poids et y l'indice de reticulation. Pour de faibles valeurs de y, pour lesquelles la plus grande partie
du polymère est encore soluble, la valeur qu'on doit utiliser pour y est celle
du gel, qui est plus élevée que celle relative à l'ensemble de la substance. A
part le cas de faibles densités de reticulation, la correction est généralement
faible.
Une seconde correction est due à l'existence d'enchevêtrements qui peuvent
du point de fusion en diminuant la déformation, d'où
une valeur de E augmentée. Flory a représenté la correction rendue nécessaire de ce fait par un paramètre additionnel g
subsister au-dessus
:
E = 3 gpHTq r/w
(4,11)
avec g >
1. Dans le cas d'une déformation lente ces enchevêtrements ont le
temps de se dénouer, tandis que dans celui d'une déformation rapide, ils jouent
(11) Flory (P. J.), Principles of Polymer Chemistry, p. 463, Cornell University Press,
1953.
ACTIONS SUR J. ES POLYMkliES
177
un rôle plus important. On peut donc s'attendre à ce que g varie avec la vitesse
de la déformation et apparaisse comme un facteur de viscosité dans 1rs défor
mations du genre de celles du caoutchouc.
Une feuille de caoutchouc fumé qu'on a malaxé pour en diminuer in masse
moléculaire moyenne et pour éliminer L'influence des quelques ponts de reticulation qu'elle peut contenir, a
mauvaises propriétés élasSous L'effet d'une tension
appliquée rapidement, elle se
A
de
tiques.
-*/-
20
déforme élastiquement à cause
enchevêtrements, mais la
des
déformation devient rapidement
irréversible Lorsque les molécules
se
délovent
et
comme
Si la môme
J—
10
glissent
dans les plastiques.
substance est réticulée par irra-
Ug
diation, elle acquiert de meilleurs
propriétés élastiques. La figure 4,6
montre le rapport entre le module
2
I
d'élasticité et la dose de
rayon-
nement pour une charge statique.
Module
Fig. 4,6.
On voit que la courbe ne passe
pas par
l'origine,
3
Dose de rayonnement en unités depi/e
d'élasticité
du caoutchouc
irradié.
probablement
à cause des quelques ponts présents initialement, mais l'augmentation du module
d'élasticité est ensuite proportionnelle à la dose conformément à l'équation (4,9).
Si on fait les mesures pendant les quelques secondes que dure l'application
de la
tension, on obtient des valeurs plus élevées du module pour de faibles doses de
rayonnement (courbe en trait plein, fig. 4,6), mais si la tension persiste, on
observe pour le module une valeur plus faible (courbe en pointillé). Pour des
échantillons ayant reçu une dose plus forte, cependant, il n'y a pas de différence entre les deux séries de mesures, le glissement « plastique » étant complètement éliminé. L'équation de la courbe est
:
E = 1,6 x 10 + 7,4 x 10 R
6
6
où R est exprimé en unités de pile valant chacune environ 46 millions de rads
Ainsi
:
E
1,6
x 10 5
(Mr)
(Mr) étant la dose absorbée exprimée en mégarads. Pour le caoutchouc (C 5
H )„,
8
w — 68 et p = 0,92. Si on prend g = 1, c'est-à-dire si on laisse de côté les
enchevêtrements, on a
:
E
(Mr)
qQ
x 10 9
On en tire pour q , qui représente le pourcentage d'unités de monomère
réticulées par unité de dose de rayonnement, la valeur de 0,74 p. 100, si la
HAISSINSKY.
III.
12
RETICULATION DES POLYMÈRES
178
dose est exprimée en unités de pile, et 1,6. 10- 4 en prenant le mégarad comme
en bon accord avec les valeurs déduites des mesures de gonflement (12).
Pour le polyethylene, l'étude de ses propriétés élastiques (13) à la tempéunité,
rature ordinaire est compliquée par la présence de zones de cristallisation et
nous les examinerons dans le chapitre suivant où seront discutés les effets
des radiations sur l'état cristallin. Si on augmente la tem-
pérature au-dessus du point
x dynamique
de fusion, ces zones dispa-
t statique
/ /
/
A
/
/
/
D»
/
/
raissent et les propriétés élas-
' '
//
/ /
//
/
tiques résiduelles sont alors
entièrement dues à la reticulation causée par le rayonne-
// //
/
ment. La figure 4,7 montre
le rapport entre la dose de
/
J* '
// /
[
rayonnement
//
/A
/
//
u
*
I0«
/ /
/
0.5%
q
0,
5x io-
(a)
premiers
étant
supérieurs
aux seconds à cause de la
Ill
2%.
_...!
5
Dose
Fig. 4,7.
=
2
q„= 0,35x10-2 (bj
Pourcentage de carbones réticulés (q
1%
module
mesures tant dynamiques que statistiques, les
(ïPe C3outchouc a/ec
//
//
le
tats de
courbe théorique pour une élasticité de
/y
et
élastique. On y voit les résul-
— Module
de
,1
10%
25%
10
20
50
rayonnement
d'élasticité
présence d'enchevêtrements
=0005)
5»
(13).
100
en unités de pile
du polyethylene irradié
à 150 °C.
La courbe théorique
déduite de l'équation (4,11)
ci-dessus est représentée par
une ligne droite. On obtient
des résultats en bon accord
avec cette droite pour des doses absorbées allant jusqu'à 10 unités de pile, soit
environ 5 p. 100 de reticulation. Au-delà de ce point, les courbes divergent,
le module du polyethylene fortement irradié étant de beaucoup supérieur à celui
auquel on devrait s'attendre pour une élasticité du genre caoutchouc. Cet écart
tient au fait que la longueur de la chaîne entre deux ponts successifs est rela-
tivement petite, ce qui ne permet plus d'appliquer les approximations statistiques. Ces substances fortement irradiées, et par
conséquent à densité de
reticulation élevée, acquièrent de nombreuses propriétés généralement décrite s
comme « vitreuses »; elles deviennent dures, cassantes et se brisent selon des
surfaces conchoïdales. Avant qu'on n'atteigne ce stade, cependant, le polyethylene irradié est passablement flexible, mais a une faible elongation avant de
se fragmenter.
Cet état intermédiaire entre
l'élasticité
type caoutchouc et
un comportement du type du verre est caractérisé par la nature de la cassure qui se trouvera décrite au mieux et de façon imagée si on se la représente
comme celle d'un morceau de caséine. La substance se casse aisément et s'effrite.
(12)
(13)
Charlesby (A.), Atomics, 5 (1) 12 (1954).
Charlesby (A.), Hancock (N. H.), Proc. Roy. Soc. A. 218, 245
1953.
CHAPITRE
V
MODIFICATIONS DE L'ÉTAT CRISTALLIN
Un certain nombre de polymères à longue chaîne peuvent, selon la taille
et la régularité de leurs chaînes latérales, prendre une configuration partielle-
ment cristalline.
C'est
le
cas
notamment du polyethylene, du nylon et du
polytétrafluoréthylène (téflon). La proportion de substance cristallisée dépend
de la température et des traitements antérieurs subis par l'échantillon (qui
déterminent la vitesse à laquelle la cristallisation peut progresser). De plus,
dans le cas du polyethylene, cette proportion dépend aussi de la taille et de
groupements latéraux, chaînes -hydrocarbonées de faibles
masses moléculaires. Quand on forme du polyethylene à des températures
et des pressions élevées, ces chaînes latérales sont assez nombreuses, ce qui
diminue d'une façon appréciable le taux de cristallisation. Le poly méthylène,
de nature essentiellement linéaire, est beaucoup plus cristallisé. Le polyethylene produit sous faible pression et à basse température par des méthodes
catalytiques occupe une place intermédiaire, les chaînes latérales y étant
moins fréquentes que dans les échantillons ordinaires. Dans ces substances,
produites à basse pression, on peut atteindre un degré de cristallisation élevé,
ce qui est mis en évidence par la densité plus forte du produit à une température donnée. De plus, chacune des zones cristallines est plus grande et le
point de fusion s'en trouve augmenté. En général, les propriétés d'un polymère susceptible de cristalliser dépendront à la fois du nombre de cristallites
présents à une température donnée et de leurs dimensions. Quand ces derniers
sont orientés, les propriétés mécaniques peuvent aussi varier selon leurs posila distribution des
tions relatives.
Les radiations perturbent la régularité des régions cristallines et par conséquent diminuent la stabilité thermique des substances. En conséquences,
on peut ainsi transformer un polymère habituellement cristallisé à une température donnée en une substance pratiquement amorphe. La dose de rayonnement nécessaire pour produire cette transformation dépend de la température de l'échantillon durant l'irradiation.
A des températures élevées, les
configurations sont plus désordonnées et ce désordre relatif subsiste dans une
certaine mesure après l'irradiation pendant
le
refroidissement consécutif à
l'irradiation.
Pour déterminer le taux de cristallisation du polyethylene, les méthodes
MODIFICATIONS DE L'ÉTAT CRISTALLIN
180
basées sur l'utilisation des rayons X, sur des mesures calorimétriques et de
densité ont joué un rôle prépondérant. Le diagramme aux rayons
du polyethy-
X
lene à la température ordinaire est constitué par une série d'anneaux minces
superposés à un fond continu contenant un certain nombre de halos diffus.
Les anneaux sont dus à la structure cristalline et sont analogues à ce qu'on
observe pour des molécules de paraffines à chaînes courtes en dessous de leur
point de fusion. Une étude des densités relatives et des positions de ces deux
espèces distinctes de diagrammes permet d'obtenir par conséquent des ren-
seignements utiles sur la structure interne de la substance. Hermans et Wetdinger (1, 2) ont mesuré l'intensité des anneaux à des températures variées
et obtenu pour le taux de cristallisation 54 p. 100 à 18 °C, 23,5 p. 100 à 90 °G
et 8 p.
100 à 115 °C; toutes ces valeurs concernent la même substance, très
ramifiée, qui était disponible à cette époque. Avec un dispositif donnant une
Krimm et Tobolsky (3) ont pu mesurer
du pic de diffraction et observer des déplacements de ce pic
meilleure résolution des rayons X,
les intensités
avec la température. Cette amélioration technique est importante, car la
répartition des différentes tailles de cristallites et l'existence de distorsions
à l'intérieur de chacun d'eux peut entraîner une certaine variation de l'espacement des anneaux. Krimm et Tobolsky ont obtenu des valeurs différentes
pour le taux de cristallisation selon qu'ils mesuraient l'intensité maximum
du pic, l'intensité sous un angle de diffraction donné ou l'aire limitée par la
courbe de diffusion (qui donne la quantité de constituant amorphe). A 20 °C,
ces méthodes ont donné des taux de 26 p. 100, 64 p. 100 et 40 p. 100; à 100 °C,
pour 110 °G. L'écart entre ces valeurs montre bien
il tombait à 5 p. 100 et à
les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on cherche à obtenir des mesures absolues
du taux de cristallisation. Matthews, Peiser et Richards (4) ont employé
également les rayons X pour comparer les constituants cristallisés et amorphes.
Ils ont trouvé une relation entre le taux de cristallisation et la masse moléculaire, la
courbe présentant un maximum vers 77 p. 100 de cristallisation
pour des masses moléculaires très élevées. La structure amorphe peut se produire du fait que des masses moléculaires petites comportent de nombreux
groupements terminaux ou à cause de la présence de chaînes latérales; les
valeurs obtenues par Matthews et ses collaborateurs montrent que ces chaînes
latérales jouent encore un rôle important lorsque les masses moléculaires sont
élevées. Pour d'autres polymères cristallisés, comme le polyméthylène ou
polyfluoroéthylène,
le
il
subsiste toujours
un peu de matière amorphe et la
densité macroscopique n'est jamais celle à laquelle on devrait s'attendre d'après
l'analyse aux rayons X de l'unité cristallisée. Dans ce cas, la présence de substance amorphe peut être due à la vitesse de refroidissement qui permet aux
noyaux cristallins de grossir aux dépens des régions voisines, chaque cristal
venant éventuellement interférer avec ses voisins au cours de leurs développements. Uberreiter et Orthmann (5), par exemple, ont obtenu des
Hermans (P. H.), Weidinger (A.), J. Polymer Sci. 4, 709, 1949; 5, 2(59, 1950.
Hermans (P. H.), Kolloid Z., 120, 3, 1951.
1951. J. Polymer Sci., 7, 57,
(3) Krimm (S.), Tobolsky (A. V.), Text. Res. J., 21, 805,
(1)
(2)
1951. J. Phys. Chem. 57, 14, 1953.
(4)
(5)
Matthews (J. L.), Peiser (H. S.), Richards (R. R.), Acta Cryst. 2, 85, 1949.
Uberreiter (K.), Orthmann (H. J.), Kolloid Z., 128, 125, 1952.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
valeurs de 50
p.
100 pour te polyethylene e1 de <S<S
p.
181
KM» pour des paraffines
non branchées.
Hunter et Oaki.s (6) ont utilisé des mesures de volume pour suivre les
variations de cristallisation du polyethylene en fonction de La température el
leurs résultats expérimentaux les <>ni conduits à des valeurs de 50 p. 1<»ii 6
20 °C, 35 p. 100 à 100 °G et
15 "C. C'est cette méthode (pic CHARLES^!
à
et Koss (7) ont adoptée pour étudier la cristallisation du polyél tiylène Irradié.
à poids moléculaires élevés et
1
Raine, Richards et Ryder (8), et Dole, Hettinger, Larson el Wethe
rington {[)) ont effectué aussi des mesures calorimétriques, ce qui leur a donné
p.
T.")
Plus
100
et
49 p. 100 respectivement pour le constituant cristallisé à 20 °C.
utilisant le rayonnement infra-rouge ont
récemment, des techniques
servi à des études de la cristallisation,
mais n'ont pas encore été appliquées
à des substances irradiées. Résumant ces données, Bryant et ses collègues(lO)
ont observé une relation à peu près linéaire entre le taux de cristallisation et
la densité.
On doit à Nichols (11) une comparaison plus récente de ces diverses
techniques.
Des taux de cristallisation plus élevés peuvent désormais être atteints grâce
nouveaux possédant un moindre taux de
branchement. Richards (12) a pu obtenir un taux de cristallisation de 95 p.
100 dans un échantillon de polyméthylène. La figure 5,1 montre les modifi-
à l'introduction de polyéthylènes
cations d'échantillons de polyethylene irradiés à différentes doses.
Sur le
schéma de diffraction, les anneaux sont dus aux régions cristallines et leurs
espacements correspondent tout à fait à ceux qu'on obtient pour des cristaux
de paraffine ordinaire.
La variation de l'espacement avec la température
montre qu'on passe graduellement d'une structure orthorhombique à une
structure hexagonale par suite de l'amplitude des vibrations thermiques des
chaînes moléculaires, mais l'état hexagonal n'est jamais atteint.
de chaque anneau est définie par les dimensions des cristaux.
La finesse
En outre, on
observe un fond diffus de halos dans le diagramme aux rayons X, ce qui constitue la contribution de la fraction amorphe de l'échantillon de polyethylene.
Par comparaison avec les diagrammes de diffusion de paraffines liquides,
on voit que le polyethylene a la même structure que celles-ci. On peut se le représenter, par conséquent, comme une série de cristallites, de structure identique
à celle des paraffines, immergés dans un pseudo-liquide.
Lorsqu'on augmente la dose de rayonnement, la reticulation et la nonsaturation diminuent la régularité des structures et par conséquent le degré
de cristallisation. Si la présence de ces irrégularités avait pour effet une distorsion de chaque zone cristalline, on devrait s'attendre à un élargissement
des anneaux et à une modification de leur espacement, jusqu'à ce que, pour
Hunter (E.), Oakes (W. G.), Trans. Farad. Soc. 41, 49, 1945.
Charlesby (A.), Ross (M.), Proc. Roy. Soc. A. 217, 122, 1953.
(8) Raine (H. G.), Richards (R. B.), Ryder (H.), Trans. Farad. Soc. 41, 56, 1945.
(9) Dole (M.), Hettinger (W. P.), Larson (N. R.), Wetherington (J. A.), J. Phys.
(6)
(7)
Chem. 20, 781, 1952.
Bryant (W. M. D.), Tordella (C. T.), Pierce (B. H. H.), U8th Meeting of American
(10)
Chemical Society (Chicago 1950).
Nichols (J. D.), J. Appl. Phys. 25 (7), 840, 1954.
Richards (R. B.), J. Appl. Chem. 1, 370, 1951.
(11)
(12)
MODIFICATIONS DE L'ÉTAT CRISTALLIN
182
une disparition complète de l'état cristallin, les anneaux se soient élargis et
déplacés pour se confondre finalement avec le fond de halos. En fait, ce n'est
pas ce que l'on observe; il y a peu de changements de la finesse ou de la position des anneaux au fur et à mesure que la dose croît. Le seul effet produit
est la diminution de l'intensité de ces anneaux, avec une augmentation correspondante de celle du fond contenu. On est donc amené à conclure que,
Fig. 5,1.
a)
— Modifications du diaphragme de
non irradié;
b)
ayant reçu 3 unités de
diffraction aux rayons
pile; c)
X du polyethylene,
ayant reçu 4,ô unités de pile; d) ayant reçu
9 unités de pile.
bien que
le
rayonnement diminue la proportion de substance cristallisée, il
n'y a pas transition continue de l'état cristallin à l'état amorphe. Ceci peut
avoir une répercussion intéressante sur le processus de la fusion.
une température plus élevée, les cristallites
comme on peut s'en apercevoir par
la transparence qu'acquiert, en plus des changements habituels decoloration,
le polymère irradié. A ces températures élevées, les molécules sont moins
ordonnées durant l'irradiation et elles ont moins tendance à se réaligner une
Si
l'irradiation
s'effectue
à
disparaissent pour une dose plus faible,
fois
que l'irradiation a cessé.
On peut suivre quantitativement les variations d'état cristallin du polyethylene irradié par l'étude de sa densité.
Dans la figure 5,2, on a porté les varia-
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
L83
tions de volume spécifique (l'inverse de la densité) en loin lion de
La
tempe
rature pour des échantillons irradiés à 70 °G pendant des temps variables B
de Harwell. La courbe concernant le produit non Irradié esl
la pile
BEPO
de même type exactement que celles qu'ont publiées Huntbb el Oakbs e1
varie légèrement avec les caractéristiques des échantillons considérés, belles
que leur masse moléculaire et
leur taux de branchement.
A la température ordinaire,
le
volume spécifique
valeur
de
1,1
v a
environ.
une
Cette
valeur est due à une fraction
(1
—
/)
en poids de substance
amorphe de volume spécifique v a
et à une fraction / de substance
cristallisée
de
volume
que v c On a ainsi
.
v
spécifi-
:
= (1 —f)v a + fv = v a
—
c
f(v a
-v
c );
v c peut s'obtenir à partir des
mesures aux rayons X de l'unité
cristalline de paraffine ou à
partir du diagramme de diffusion du polyethylene. v a n'est
pas connu, mais peut être déduit
par extrapolation à partir des
valeurs de v au-dessus du point
de fusion, lorsqu'il ne reste plus
de zones cristallines.
déduire
le
taux de
On peut
cristallisa-
des valeurs mesurées
/,
pour v en fonction de la tempétion,
rature et des valeurs de v a et
de v c à la
Température
Fig. 5,2.
en °C.
Volume spécifique du polyethylene irradié.
même température.
L'accroissement du volume spécifique en fonction de la température augmente constamment jusqu'à 115 °G; au-delà de ce point, la variation devient
L'augmentation rapide qu'on observe avant d'atteindre 115 °C est
due à la dilatation thermique à la fois de v a et de v c mais surtout aux variations du taux de cristallisation / qui diminue jusqu'à s'annuler au point de
linéaire.
,
fusion le plus élevé des cristaux.
Le polyethylene irradié a le même comportement. Le volume spécifique
v c des zones cristalline ne change pas, comme on peut le voir d'après les dia-
grammes aux rayons X, mais la valeur de v a diminue à cause de la reticulation,
comme on peut le constater sur la partie linéaire que la courbe affecte audessus du point de fusion. De plus, la fraction cristallisée /, est plus petite à
température ordinaire, pour les échantillons irradiés et, lorsqu'elle s'annule
MODIFICATIONS DE L'ÉTAT CRISTALLIN
184
au point de fusion des cristaux, sa décroissance est moins sensible. Au-delà
du point de fusion, la dilatation thermique est un peu plus faible que pour
polyethylene non irradié, mais correspond alors à celle d'une substance
le
élastique et non plus d'un liquide. La température de transition pour laquelle
tous les cristaux sont fondus n'est pas plus élevée que pour le polyethylene
non irradié, mais au contraire plus basse. Dans un sens, l'irradiation diminue
le point de fusion du polyethylene, mais, en fait, la transformation correspond au passage d'un type de solide complètement cristallin à un autre type
complètement amorphe. Pour le polyethylene irradié, par conséquent, le
point de transition ne correspond pas au passage de l'état solide à l'état liquide,
mais au passage d'un type
de solide à un autre.
/
état partiellement cristallise
\
état amorphe
type verre
I
irradiés ne sont pas les mêmes
pour deux raisons qui jouent
chacune en sens contraire. La
1
/ Courbe
/
\
/
\)
présence de ponts intermo-
/
\
\
théorique
'pour une élasticité
/ de
type caoutchouc
i
i
2
4
Fig. 5,3.
— Module
d'élasticité
cher
chaînes adjacentes
les
et à réduire le volume spéci-
fique
v,
tandis que la dispa-
progressive
cristallin,
10
20
100
dose de rayonnement en unités de pile
du polyethylene
irradié
le
rayonnement tend à rappro-
rition
./
par
induits
léculaires
/
-i
spécifiques
des polymères irradiés et non
type caoutchouc]
\
volumes
Les
/ état amorphe
10*°
de l'état
rendant
la
sub-
stance plus amorphe à une
température donnée, tend à
l'augmenter. Lorsque par une
à 20 °C.
irradiation suffisante, toutes
les
zones cristallines ont disparu,
deux
effets.
Ceci explique la
il
ne
reste
plus
que
le
premier des
complexité apparente de comportement des
propriétés élastiques du polyethylene irradié. Le
module d'élasticité dépend
de la cohésion entre molécules voisines, due soit aux forces secondaires qui
s'exercent entre elles dans les zones cristallisées (ces liaisons étant importantes
parce que leurs effets agissent de façon régulière et s'additionnent), soit aux
liaisons primaires formées par le rayonnement entre des molécules distinctes.
La figure 5,3 montre la variation à la température ambiante des propriétés
augmente la dose, la
augmente aussi (le module de Young décroît). Ceci est dû à la dis-
élastiques en fonction de la dose absorbée. Lorsqu'on
flexibilité
parition des cristallites qui éclipse l'effet renforcé/ de la reticulation.
la
Quand
dose de rayonnement est supérieure à celle qui est nécessaire pour détruire
toutes les zones cristallisées, les forces de liaisons entre les cristaux ne peuvent
être réduites davantage et on obtient alors par irradiation prolongée un poly-
mère plus rigide à cause de l'augmentation du nombre des pontages. Dans
conditions où ces expériences ont été faites, les cristaux avaient complètement disparu pour une dose d'environ 10 unités de pile, correspondant à
un taux élevé de reticulation (5 p. 100 des atomes de carbone). A ce stade,
les
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
le polymère se
comporte comme une substance élastique
delà de cette dose, L'augmentation de La rigidité est
laisse prévoir la théorie, ear les distances entre deux
trop petites pour qu'on puisse appliquer
la
185
très vulcanisée.
le
ponts successifs deviennent
théorie statistique de L'élasticité
type caoutchouc. Les propriétés élastiques du polyethylene ayant
très fortes
Au-
plus grande que ne
reçu
«le
doses de rayonnement se rapprochent donc de celles du verre.
En résumé le comportement élastique du polyethylene irradié à des tempé=
ratures ordinaires suit le schéma suivant
1° Faibles doses, taux de cristallisation moyen, reticulation peu Importante;
:
les
propriétés élastiques sont déterminées surtout par la présence de cristaux.
2° Doses moyennes, taux de cristallisation très faible, reticulation moyenne.
Les propriétés élastiques sont un peu supérieures à celles qu'on peut prévoir
d'après l'élasticité théorique type caoutchouc.
3° Doses élevées, pas de cristaux, reticulation importante; les propriétés
élastiques se rapprochent de celles du verre.
Lorsque
les irradiations
correspondances sont modifiées
sont poursuivies entre 60 et 90 °C, ces
:
1° Doses faibles, peu de cristaux, reticulation faible; les propriétés élastiques
sont un peu au-dessus de celles qui correspondent à l'élasticité type caoutchouc.
2° Doses moyennes, pas de cristaux, reticulation faible à
cité élevée
moyenne; élasti-
comme celle du type caoutchouc.
3° Doses élevées, pas de cristaux, reticulation forte; propriétés élastiques
du type verre.
A
des
températures supérieures au point de fusion, la seconde
région se confond avec la première.
1° et 2° Doses faibles ou moyennes, pas de cristaux, reticulation faible
ou
moyenne; propriétés élastiques du type caoutchouc.
2° Doses élevées, pas de cristaux, reticulation élevée, propriétés élastiques
du type verre.
Les limites précises qui séparent ces différents modes de comportement
dépendent de nombreux facteurs, notamment de la température à laquelle
est faite l'irradiation et probablement du taux de branchement de la substance
de l'initiale.
CHAPITRE
VI
TRANSFORMATIONS CHIMIQUES
Lorsqu'ils sont soumis à des rayonnements de haute énergie, les composés
le plus souvent des transformations chimiques ayant
pour résultat la formation de gaz. Breger et ses collaborateurs (1) ont irradié
des acides gras à chaînes plus ou moins longues et observé la formation d'hydrogène, de G0 2 de GO et d'hydrocarbures en même temps que d'eau. Quoique la
quantité de G0 2 formé décrût lorsque la chaîne s'allongeait jusqu'à C 22 les
volumes dégagés étaient supérieurs à ceux auquels on aurait pu s'attendre
d'après l'importance relative des groupements acides. Ceci indiquerait que les
réactions induites par les rayonnements de haute énergie sont spécifiques, ce
qu'on observe aussi dans l'irradiation des polymères. Pour beaucoup d'entre eux,
l'hydrogène est de loin le plus important des produits formés, bien que dans
le polyfluoroéthylène, par exemple, ce soit GF 4 qui est libéré, et que, dans le
polyméthacrylate de méthyle, il se forme également de grandes quantités
de C0 2 et de CO. On peut établir les transformations chimiques produites
par irradiation de polymères à longue chaîne par d'autres méthodes qui comprennent les variations de poids, la nature des gaz dégagés et les données
des spectres infra-rouge. Les méthodes chimiques directes sont généralement
moins satisfaisantes, car le nombre de liaisons transformées ne représente dans
la plupart des cas qu'une faible fraction de la totalité des liaisons. Pour des
organiques subissent
,
,
doses de rayonnement très élevées, il peut se produire des effets secondaires
des radiations sur les produits formés. En outre, pour les polymères qui sont
réticulés par irradiation, les échantillons deviennent insolubles et ne peuvent
plus être étudiés par les méthodes chimiques habituelles.
Quand on irradie du polyethylene en présence d'air, il se produit des variations de poids (2) qui ne dépendent pas seulement de la masse de substance
irradiée (m) et de la dose de rayonnement (R), mais aussi de la surface irra-
diée (A). L'expression qui donne les changements de poids observés lorsqu'on
irradie du polyethylene à la pile en présence d'air est de la forme
Am = — a,mR + a mR + PiAR —
2
2
(* 2
AR
2
:
(6,1)
Breger (I. A.), J. Phys. Chem. 52 (3), 551, 1948.
Whitehead (W. L.), Goodman (C), Breger (I. A.), J. Chim. Phys. 48, 184, 1951.
(1)
(2)
Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 215, 187, 1952.
ACTIONS SU It LES POLYMÈRES
Si la dose de
rayonnement R est exprimée en unités de pile BEPO, lea va
des paramètres a„ a 2
leurs
1*7
,
fr,
2
sont 7.10- 4
,
5.10 6
,
1,7
Pour des échantillons mimes, cette expression Indique qu'on
10
.
;>
l
et
I
ln\
accroissement
de poids par irradiation, ce qui peut être attribué à une oxydation superficielle.
il se forme à la surface du polyethylene irradié un composé ressemblant
à
de la cire molle, qu'on peut enlever facilement. Cette oxydation superficielle
moins facile à observer si l'irradiation se fait à température plus basse
ou sur des échantillons plus épais; on doit donc s'attendre à ce que Le COeffl
cient (3j qui est relatif surtout au processus d'oxydation, varie avec les condi-
est
tions expérimentales.
Le terme le plus important de l'expression ci-dessus est a
x
et
provient prin-
cipalement du dégagement d'hydrogène. D'autres hydrocarbures peuvent se
former aussi par rupture de la chaîne principale ou par départ de chaînes
latérales.
Krenz (3) par exemple, a montré qu'en irradiant du n-hexane,
du méthane et de l'éthane, tandis que Harlen et ses collabo-
se produit
il
rateurs (4) ont mis en relation
les quantités relatives d'hydrocarbures à
masses moléculaires produits par irradiation de polyethylene avec le
nombre de chaînes latérales présentes dans la substance initiale. On ne doit
donc pas s'étonner des écarts apparents entre les résultats de différents
expérimentateurs concernant le rendement en hydrocarbures. Ces écarts
faibles
peuvent aussi bien provenir de différences entre les échantillons irradiés que
des conditions de l'irradiation comme la température ou le taux de cristallisation. On n'est pas certain que tous les hydrocarbures gazeux formés prennent
naissance dans les chaînes latérales. Comme il se produit aussi, par irradiation
de polyethylene, des coupures de la chaîne principale, on peut s'attendre à
ce que de tels hydrocarbures prennent également naissance lorsque la chaîne
principale est coupée en deux endroits voisins. Dans ce cas, les quantités
dégagées devraient varier comme le carré de la dose absorbée (contrairement
à ce qu'on observe pour le dégagement d'hydrogène). Des ruptures de la chaîne
principale près de ses extrémités ne produiraient des hydrocarbures qu'avec
une très faible probabilité à cause de la longueur de la chaîne. Dans d'autres
polymères, les gaz produits dépendent de la structure des chaînes latérales.
Dans le cas du polyisobutylène, par exemple, il se dégage de l'hydrogène et du
méthane, tandis que pour les silicones, on a observé la production d'hydrogène, de méthane et d'éthane, ce dernier étant probablement dû à l'interaction
de deux radicaux méthyle.
On peut établir un rapport entre les modifications de constitution chimique
de la substance irradiée et le dégagement gazeux. On a porté dans la figure 6,1
la variation du rapport H/C pour le polyethylene en fonction de la dose absorbée. Dans un grand intervalle, ce rapport décroît linéairement avec la dose,
et la pente de la droite correspond au dégagement d'environ 0,7 mg d'hydrogène par gramme de substance irradiée pour une dose d'une unité de pile.
Pour des doses élevées, ce rapport diminue, probablement à cause de réactions
secondaires ou de modifications dans la structure de la substance irradiée.
(3)
(4)
Krenz (F. H.), Nature 176, 1113, 1955.
Harlen (F.), Simpson (W.), Waddington (F. B.), Waldron (J. D.), Baskett (A. C),
./.
Polymer Sci. 18, 589, 1955.
TRANSFORMATIONS CHIMIQUES
188
L'étude des spectres infra-rouge constitue une méthode précieuse pour
les polymères qui
se réticulent par irradiation et deviennent ainsi insolubles. Dole (5), Mesro-
déterminer les transformations chimiques produites dans
bian (6),
la
Lawton (7) et leurs collaborateurs ont appliqué cette méthode à
détermination des transformations produites par irradiation du polyethy-
lene. Parmi les modifications produites en l'absence d'oxygène, les plus impor-
RCH = RCH' de
diminution du nombre déjà faible de groupements
tantes sont l'augmentation du nombre de doubles liaisons
la chaîne principale et la
latéraux méthylène RR'C = GH 2 initialement présents. L'augmentation du
taux d'insaturation de la chaîne principale est mise en évidence par l'augmen-
1.8-
1,6-
m
40
60
Dose en unités de pile
Fig. 6,1.
Variation du rapport HjC pour le polyethylene en fonction de la dose.
tation de l'intensité de la bande d'absorption à 10,37 y. qui correspond à la
forme trans; la forme cis n'apparaît que légèrement, si même elle apparaît,,
dans l'étude aux rayons infra-rouges. Cette diminution de la saturation se
produit aussi lorsqu'on irradie de nombreuses substances à structure paraffinique, de même que des polymères, comme le polyisobutylène, qui se dégradent. Pour un large intervalle de doses absorbées, le taux d'insaturation
croît de façon uniforme;
il
est
indépendant de l'épaisseur de l'échantillon et
de la nature du rayonnement. On doit donc considérer ce phénomène comme
fondamental et admettre qu'il se produit parallèlement à la reticulation ou
à la dégradation. On n'a pas identifié les endroits où se produisent ainsi de
nouvelles doubles liaisons. On peut considérer que l'irradiation produit la
reticulation, la dégradation ou l'insaturation en des endroits qui ne dépendent
que de conditions statistiques; ou encore, on peut envisager que l'insaturation
et la reticulation sont des parties complémentaires du même processus produit par une seule excitation ou une seule ionisation.
(5) Dole (M.), Keeling (C. D.), Rose (D. G.), J. A. C. S.
(6) Ballantine (D. S.), Dienes (G. J.), Manowitz (B.),
J. Polymer Sci. 13, 410, 1954.
76, 4304, 1954.
Ander (P.), Mesrobian (R. B.),
(7)
Lawton (E. J.), Semany (P. D.), Balwit (J. S.), J. A. C. S. 76, 3437, 1954.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
le
189
Lorsqu'on Irradie des molécules formées de Longues chaînes non saturées,
taux d' insaturation n'augmente pas toujours el dans le cas «lu caoutchouc,
par exemple,
il
diminue.
Si
on inadic des oléflnes de masses moléculaires
variation du taux d'insaturation dépend de
variées,
la
initiale,
c'est-à-dire
du rapport
initial
des liaisons C
masse moléculaire
aux liaisons c
C.
la
(^
Tour les oléflnes du type de L'octadécène, par exemple (8), <>ù ce rapport est
proche de 5 p. 100, le taux d'insaturation est relativement peu affecté par le
rayonnement, quoiqu'il se produise des isomérisations. On peut donc consi
dérer qu'il y a doux tendances opposées, l'effet primaire des rayonnements
étant d'augmenter l'insaturation, tandis que le dégagement d'hydrogène,
responsable de l'hydrogénation des doubles liaisons nouvelles, ou d'autres
déjà présentes,
parai uniques,
pendant
fait diminuer. Lorsqu'on irradie des (Unis de substances
taux d'insaturation produit par une dose donnée est indé-
le
le
de l'épaisseur du film.
La quantité d'hydrogène libéré traversant
du film devrait être plus grande pour des échantillons minces et
on devrait observer une relation entre le taux d'insaturation et l'épaisseur
des films. En fait, on n'a rien trouvé de semblable, et on peut probablement
considérer cela comme une indication de la durée de vie très limitée des fragments gazeux,
qui sont responsables de la
atomes ou ions hydrogène
saturation. A moins qu'ils ne soient captés très près de leur lieu de naissance,
les surfaces
—
—
,
ces fragments se combinent et peuvent alors diffuser à travers un film mince
sans avoir aucune action sur son taux d'insaturation.
On a essayé à plusieurs reprises de mesurer le degré de reticulation en fonction de la dose absorbée. C'est un problème plus difficile que la détermination
du taux de dégradation qui se produit dans les polymères qui subissent par
irradiation des ruptures de la chaîne principale. On ne peut pas mesurer la
viscosité intrinsèque due à la formation d'embranchements, puisqu'il n'existe
pas de relation simple entre la viscosité intrinsèque et la masse moléculaire
pour des polymères branchés. En principe on pourrait la connaître par des
mesures de diffusion de la lumière, mais cela n'a pas encore été fait. Une fois
que le point de gélification est dépassé, les techniques physico-chimiques
ordinaires ne sont plus possibles. On a alors utilisé les méthodes suivantes
:
1° Mesures de l'élasticité.
— On suppose que
le module d'élasticité d'un
polymère type caoutchouc est proportionnel à la dose d'irradiation. La théorie
donne la relation exacte, mais les difficultés commencent lorsqu'on essaie
d'évaluer les parts dues respectivement aux enchevêtrements et aux groupements terminaux. Lawton et ses collaborateurs (9) ont employé cette méthode
pour étudier l'efficacité de reticulation dans l'irradiation du polyethylene.
Gharlesby (10) a adopté des méthodes analogues dans le cas des silicones.
2° Mesures
du gonflement.
— Les résultats expérimentaux sur
le
gon-
flement des polymères rendus insolubles par irradiation donnent des infor-
mations sur la masse moléculaire M c de la fraction de chaîne comprise entre
Charlesby (A.), Rad. Res. 2, 96, 1955.
Lawton (E. J.), Balwit (J. S.), Bueche (A. M.), Ind. Eng. Chem. 46 (8), 1703, 1954.
(10) Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 230, 120, 1955.
(8)
(9)
TRANSFORMATIONS CHIMIQUES
190
deux ponts de reticulation. Cependant les mesures de M c comprennent un
paramètre ja, qui correspond à l'interaction entre le solvant et le soluté. On
ne connaît pas toujours les valeurs de y.. L'effet des groupements terminaux,
le fait que la chaîne principale peut non seulement se réticuler mais aussi
se briser et les difficultés expérimentales qu'on rencontre pour mesurer la
vitesse de gonflement avec une bonne précision introduisent également des
incertitudes.
—
Si on connaît la masse moléculaire moyenne en
Point de gel.
dose
de rayonnement nécessaire pour initier la formation
la
polymère,
poids du
réticulée par molécule de masse M u En déterunité
une
correspond
à
d'un gel
minant le point de gel d'un polymère de masse moléculaire connue, on peut
en déduire le rendement de reticulation, c'est-à-dire le nombre de ponts produits par une dose donnée. Les difficultés sont alors surtout d'ordre expérimental et tiennent à l'incertitude sur la mesure de la fraction soluble, puisqu'on
ne peut pas l'enlever complètement d'un polymère réticulé; d'autre part,
un gel très légèrement réticulé est plutôt instable et peut se trouver modifié
par l'extraction elle-même. De toute façon, il faut, pour appliquer cette
méthode, connaître déjà la masse moléculaire moyenne en poids M w et il
3°
,.
,
n'est pas toujours possible de la déterminer expérimentalement.
4°
Évolution de gaz.
— Dans
les
polymères
comme le polyethylene,
formation de chaque pont intermoléculaire correspond au départ d'une
molécule d'hydrogène. Gharlesby (2) a utilisé cette méthode pour obtenir
la
une valeur approchée de la reticulation du polyethylene en supposant qu'on
puisse négliger comme relativement très faible la quantité d'hydrogène pro-
venant de la création de doubles liaisons. Dole, Keeling et Rose (5) ont
mesuré l'insaturation induite par le rayonnement, tant par spectres infrarouge que par bromométrie, et ont trouvé que l'insaturation induite était
responsable d'une grande partie de l'hydrogène dégagé. D'autres expériences
de Black et Charlesby (11) utilisant l'infra-rouge et la iodométrie ont donné
une valeur un peu faible pour l'insaturation, d'où un taux de reticulation
plus élevé.
5°
à
Substances Modèles.
— Dans certains polymères, on peut arriver
évaluer le degré de reticulation d'après l'étude de substances modèles de
petites masses moléculaires. Si elles sont tout de même suffisamment longues
pour qu'on puisse négliger l'action des groupements terminaux, on peut parvenir à l'estimation recherchée en étudiant les transformations chimiques
induites par des doses de rayonnement plus élevées que celles qu'on emploie
dans les travaux sur les polymères. Gomme la masse moléculaire est beaucoup
plus faible, il est possible avec de fortes doses d'observer des transformations
chimiques plus importantes sans qu'il se forme de fraction insoluble.
(11)
Black et Gharlesby, AERE M/R 1818, 1955.
CHAP IT HIC VII
THÉORIE DE LA DÉGRADATION
Lorsqu'on les soumet à des rayonnements d'énergie élevée, de nombreux
polymères accusent une diminution de masse moléculaire due à des coupures
de la chaîne principale. Cet effet est caractérisé par une diminution de la viscosité et de la masse moléculaire moyenne du polymère irradié. Outre ces
ruptures entre des liaisons de la chaîne principale, il se produit un réarrangement des atomes voisins des extrémités ainsi créées, afin que les groupements terminaux deviennent stables. Ce phénomène est nommé dégradation
et diffère essentiellement de la dépolymérisation qu'on observe à haute température
dans ce dernier cas, une modification de l'une des liaisons produit
une substance instable et la molécule de polymère revient, en totalité ou en
partie, à l'état de monomère initial. Dans la dégradation, par contre, il ne se
produit pas, ou du moins peu, de monomères, même après de nombreuses
coupures de la chaîne principale, et, à part la production de quelques molécules très petites et quelques modifications mécaniques légères au bout des
chaînes, le seul effet important qu'on observe est une diminution de la masse
moléculaire moyenne en poids qui reste toutefois toujours élevée. La dépolymérisation thermique peut être considérée comme une réaction en chaîne
mettant en jeu de nombreuses liaisons de la molécule de polymère, tandis
que la dégradation affecte seulement les atomes immédiatement voisins du
:
point de rupture. Les réarrangements d'atomes proches des nouvelles extré-
mités dépendent de la structure chimique de l'unité de monomère; la dimi-
nution de la masse moléculaire ne dépend qu'indirectement de la structure
chimique dans la mesure où celle-ci détermine l'énergie nécessaire à la rupture
de la chaîne principale. On peut par conséquent étudier de façon statistique
la dégradation des polymères sans entrer dans le détail des considérations
sur la nature chimique du polymère.
La théorie mathématique de la dégradation suppose tout d'abord que chaque
rupture de la chaîne principale est due à l'intervention d'un seul événement
radiochimique, soit l'ionisation, soit l'excitation. Le nombre de ruptures de
chaîne principale est par conséquent directement proportionnel à la dose
la
absorbée, comme le montre du reste l'expérience. Puisque l'énergie incidente
est absorbée aussi facilement par toutes les unités de monomère de la chaîne
de polymère, la répartition des ruptures
le
long de la chaîne se produit au
THÉORIE DE LA DÉGRADATION
192
hasard, bien qu'à l'intérieur de chaque unité de monomère certaines liaisons
puissent être plus sensibles à cette action du rayonnement. On peut observer,
en fait, des différences au voisinage des extrémités de la chaîne de polymère,
mais, en l'absence de transfert d'énergie à longue distance, les perturbations
apportées par de tels effets seront très peu importantes. Le but de ce chapitre
est de discuter au point de vue mathématique les modifications de la distri-
bution des molécules et des masses moléculaires qu'engendrent ces ruptures
produites au hasard le long de la chaîne principale (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Dans le cas le plus simple, on suppose que les masses moléculaires du polymère non irradié sont distribuées au hasard selon l'équation (2,7). On pourrait
obtenir, par exemple, une telle distribution initiale à partir d'une molécule
de polymère infinie en coupant sa chaîne principale au hasard un nombre
suffisant de fois pour obtenir la masse moléculaire moyenne voulue.
Les ruptures induites par les rayonnements augmentent alors simplement
le nombre de ces coupures sans changer le type de distribution qui continuera
par conséquent à être au hasard mais aura des paramètres différents.
Dans le cas général, lorsque les masses moléculaires initiales ne sont pas
distribuées au hasard, mais selon une certaine fonction n(u) comme nous l'avons
vu précédemment, l'effet des radiations sera de superposer un certain nombre
d'autres ruptures de la chaîne principale, réparties au hasard. La masse moléculaire moyenne en poids sera par conséquent diminuée, mais en outre, le
schéma de la distribution sera altéré. Éventuellement, la distribution des
masses moléculaires deviendra proche d'une distribution au hasard lorsque
le nombre de groupements terminaux produits par les ruptures de la chaîne
principale induites par le rayonnement, sera supérieur au nombre de groupements terminaux du polymère initial. Ainsi, après l'absorption d'une dose
suffisante, toute trace de la distribution initiale aura disparu et celle que
la substance irradiée aura acquise sera, encore une fois, proche d'une distribution au hasard. On voit par conséquent que, pour une distribution initiale
au hasard,
la
technique analytique se trouve considérablement simplifiée,
car on peut mesurer l'effet du rayonnement par une simple mesure de masse
moléculaire (c'est-à-dire en mesurant la viscosité intrinsèque).
On expose,
dans ce chapitre, comment on peut calculer la dose de rayonnement conduisant à une telle simplification.
DIMINUTION DE LA MASSE MOLÉCULAIRE MOYENNE EN POIDS
On peut évaluer les variations de la masse moléculaire moyenne en poids
subséquentes aux ruptures induites par les rayonnements sans tenir compte
de leur répartition le long de la chaîne principale ni de la distribution initiale
(1)
Gharlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 224, 120, 1954.
(2)
Durup (J.), J. Chim. Phys. 51 (2), 64, 1954.
(3)
Kuhn (W.), Zeits. f. Phys. Chem. A. 159, 368, 1932.
(5)
Montroll (E.), Simha (R.), J. Chem. Phys. 8, 721, 1940.
Sakurada (I.), Okamura (S.), Zeits. Phys. Chem. A. 187, 289, 1940.
(6)
Simha (R.), J. Appl. Phys. 12, 569, 1941.
(4)
;
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
des masses moléculaires.
présentes dans
initialement
A
S'il
193
y a dans l'échantillon A, unites de monomère
moyenne en nombre est
molécules, la masse moléculaire
:
M n = wA u /A
,
(7.1,
Ql
étant le poids du monomère et
le suffixe t représentant L'état Initial. Après
auront
changé, mais non le nombre total d'unités de
ni et A 0<
monomère A x de telle sorte que A lt = A x est une constante pour un échaniv
irradiation,
M
,
tillon
donné. Le nombre de ruptures induites par une dose donnée de rayon
nombre d'unités de monomère A1 irradiées.
nombre de ruptures de la chaîne principale et le
nombre d'unités de monomère; p varie avec la dose absorbée r et on peut
nement
Soit
/>
sera proportionnel au
te
rapport entre
le
montrer expérimentalement que cette variation est linéaire. 11 s'introduit
une constante p qui est le rapport entre le nombre de ruptures induites
par une unité de dose et le nombre d'unités de monomère
ainsi
:
P = Pô?-
(7,2)
Après irradiation, un échantillon qui contenait initialement 2A 0t extré+ 2 A x p. La masse moléculaire moyenne en
poids du polymère irradié s'en trouvera réduite et prendra la valeur ci-dessous,
où le suffixe r indique la valeur après irradiation
mités libres en contiendra 2 A 0ï
:
M nr = wAJiAoi + pA
= M n</(l + P M ni /w)
x)
ou, en fonction
du degré de polymérisation u x
"ir == «k/(1
(7,3)
:
+ pu-u)-
(7,4)
On peut exprimer ce résultat d'une manière plus commode en introduisant
le concept de
dégradation « virtuelle ». Sur le nombre total 2(A oi + pAj) d'ex-
trémités libres de l'échantillon, il y en avait initialement 2 A 0î et l'irradiation
en a créé 2 pA v Si on était parti d'une molécule cyclisée sans extrémités libres,
mais contenant A x unités de monomère, on aurait produit le même nombre
d'extrémités libres par une dose totale de rayonnement r + r définie par
:
2 Po(r
soit
+ r )A! - 2(A 0î + Po^)
Po^oA! = A 0ï
-
(7,5)
de telle sorte qu'on a
«n-
et
=
u lT =
—
1
M ni = w/p r
Po ro
——
-
Po(^
+
•
;
(7,6)
M nr = w/p (r + r = M ni rJ(r + r
)
).
J\>)
Ce résultat ne dépendra pas de la répartition des ruptures le long de la
chaîne principale de l'échantillon avant et après irradiation; il ne dépend pas
non plus de la distribution initiale des masses moléculaires ni de la répartition
HAISSINSKY.
III.
13
THÉORIE DE LA DÉGRADATION
1<»1
des ruptures dans chaque molécule irradiée. On mesure les variations de la
masse moléculaire moyenne en poids par osmomôtrie, ce qui ne conduit qu'à
la
Si
détermination de la densité des ruptures en rapport avec la dose absorbée.
on veut connaître la répartition de ces ruptures, on doit étudier la distri-
bution des masses moléculaires par d'autres méthodes qui dépendent de la
variation de dimensions des différentes molécules. Appartiennent à ce groupe
les mesures de diffusion de la lumière ou de la viscosité intrinsèque qui donnent
masse moléculaire moyenne en poids M„ ou la masse moléculaire viscosimé trique moyenne M„ (qui est généralement voisine de M w ).
la
AU HASARD DES MASSES MOLÉCULAIRES
DISTRIBUTION
INITIALE
Pour une telle
distribution,
il
existe des relations simples entre chacune
moyennes
des masses moléculaires
définies
précédemment (équation
2,8).
Après une coupure au hasard de la chaîne principale, ces équations restent
valables. En employant le concept de dose virtuelle de rayonnement r pour
décrire la distribution initiale des masses moléculaires, on peut écrire le nombre
de molécules de polymère n*(u) formées de u unités que comprend la substance
,
non irradiée sous la forme
:
A
A
U li
U \i
n (u) = -oi exp(— u/u u ) = -f exp(— u/u u )
t
ou encore
(7,7)
:
Ui(u)
= A 0î p r exp(— p r u) = A^r* exp(— p r u)
(7,8)
puisque l/u u = p r (équation 7,6). Après une dose « réelle » de rayonnement
r, la distribution devient
:
n r (u) = AoePo (r + r ) exp
J
—p
(r
+r
)
u
j
= A pl(r + r
t
2
)
exp
J
— p(r +
r ) u
[
(7,9)
La masse moléculaire moyenne en poids de
2 w/p (r
+r
)
et celle de type z est 3 w/p (r
viscosimétrique de la moyenne en
nombre
+r
la
substance irradiée est
On peut déduire la moyenne
).
:
M vr - M Mr (a + 1)T(1 + a)
= M r /(r + r = M*/(l + r/r
1
)
vi
r/r Q
'"
(7,10)
)
représente le nombre de ruptures de la chaîne principale d'une molécule
ayant
comme masse
moléculaire
la
moyenne en nombre.
M, = Mo(l + r/rQ)«.
On
a
alors
(7,11)
Pour cette distribution au hasard, l'inverse de la masse moléculaire moyenne
en poids (1/M W ) est directement proportionnel à la dose absorbée r. La pente
de la courbe représentant 1/M W en fonction de r donne directement p et l'or-
donnée à l'origine r
initiale en poids.
,
ce qui permet d'obtenir la masse moléculaire moyenne
On peut écrire d'une autre façon
J
J_ = £oT
M.„, r
M„„
2w'
:
(712);
K
'
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
Cette fonction linéaire simple de r n'est respectée que
si
une distribution au hasard des niasses moléculaires. Sinon,
tionnelàla dose de rayonnement r
195
on
-
a Initialement
restera propor-
pour de fortes doses (r » r ), niais
l'ordonnée
l'origine
à
1
ne sera plus
Ire
-,
extrapo-
mais -
Al„. j
(flg.
—
1
M
n i
7,1).
CAS GÉNÉRAL
Dans le eas général, on ne peut
faire
aucune hypothèse
distribution
moléculaires.
sur
la
masses
des
initiale
On peut alors cal-
euler la distribution initiale des
masses moléculaires pour n'importe quelle densité de rupture
donnée. Il est toutefois commode
dose réelle de rayonnement r
dose wtuelle
p IG# 7 i.
f
— Variation de
l'inverse
de la masse
moléculaire moyenne en nombre en fonction de la
dose absorbée.
d'exprimer la distribution des
masses moléculaires avant et
après irradiation, par les paramètres A 0t A^ ... (avant irradiation) et A 0r
A lr ... (après irradiation). On a pu montrer (Gharlesby (1)) qu'il existe
une formule de récurrence entre les termes successifs
-,
,
:
dA kr _
k
dp r
le
— A
1
+1
* +,,r
"
On peut, à partir de cette formule générale, calculer la variation de la masse
moyenne en poids d'après n'importe quelle densité en fonction
Dans le cas particulier de
la masse moléculaire moyenne en poids, on peut montrer que
moléculaire
des paramètres relatifs à la distribution initiale.
:
3\w
4\\w'
(7,13)
On peut également calculer des équations donnant n'importe quel paramètre
relatif
aux masses moléculaires en fonction de sa valeur initiale. Dans le cas
particulier où la distribution des masses moléculaires est initialement uniforme,
on peut écrire qu'après irradiation la masse moléculaire moyenne en poids
M wr est
:
M wr = 2 Mw (e
2
P
2
ni
-/'>'nz7
l
1
+ pM ni /w) = 2 M
m
(7,14)
où r et r ont la même signification que précédemment. La figure 7,2 montre
comment, lorsque la dose absorbée augmente, la masse moléculaire moyenne
THÉORIE DE LA DÉGRADATION
196
en poids de la substance irradiée tend, quelle que soit sa valeur initiale, vers
la valeur caractéristique que prend par Taction du rayonnement, une substance
ayant initialement une distribution des masses moléculaires au hasard. Dans
2
1.5
\
v
^
IS
Au tu)
f<
/
(u, 2u
A carré)
u
lu
S?
S
Distribution mitidle uniforme
"
"
»
au hasard
u
:
r
.
Mélange fie 2 distributions uniforn ies(u,2u )Ju,4t
•
5
!
i
4
K. )
i
8
9
Nombre de rupturespar molécu/e ayant la moyenne en nombre (put)
Fig. 7,2.
Rapport entre la masse moléculaire moyenne en poids de la molécule dégradée à la
masse moléculaire moyenne initiale en nombre.
le cas particulier
d'une distribution initiale uniforme, une dose suffisante pour
M
produire 4 à 5 ruptures par molécule de masse égale à
n a pour effet une
distribution des masses moléculaires quasiment identique à celle qu'acquiert
une substance ayant initialement une distribution au hasard.
CHAPITRE
VIII
DÉGRADATION DES POLYMÈRES
De nombreux polymères subissent par irradiation
des modifications qui
ne sont pas dues à la reticulation. Ceci résulte immédiatement du fait que la
solubilité de la substance est dans ces cas au moins aussi grande que celle des
échantillons
non
irradiés.
Plusieurs de ces modifications s'observent aisé-
diminution de la résistance mécanique, dégagement gazeux avec formation de bulles, craquements, augmentation de la solubilité, passage d'un
ment
:
état solide type caoutchouc à un état liquide (dans le cas du polyisobutylène)
ou d'un solide indéformable à une poudre (polytétrafluoréthylène). Davisson
et Geib (1) ont observé de telles modifications pour le caoutchouc butylé,
Bopp et Sisman (2) également pour cette substance et encore pour le polyméthacrylate de méthyle et d'autres polymères. Ross et Gharlesby (3) pour le
polyméthacrylate de méthyle, Saeman, Millett et Lawton (4) pour la cellulose. On peut attribuer tous ces changements principaux à des ruptures
de la chaîne principale sous l'effet du rayonnement ayant pour conséquence
une diminution de la masse moléculaire en même temps que d'autres transformations chimiques comme des ruptures des chaînes latérales. Bien que de
nombreux résultats expérimentaux aient été publiés concernant l'effet des
rayonnements sur la dégradation de nombreux polymères, on n'a effectué
que dans quatre cas seulement des analyses détaillées qualitatives et quantitatives de ces modifications.
DIMINUTION DE LA MASSE MOLÉCULAIRE
ET DU TAUX DE POLYMÉRISATION
La diminution des dimensions moyennes des molécules de polymères exporayonnements de haute énergie est due à un mécanisme différent
sés à des
de celui de la dépolymérisation thermique. Cette différence est mise en évi-
Davidson (W. L.), Geib (V. G.), J. AppL Phys. 19, 427, 1948.
Bopp (C. D.), Sisman (O.), Nucleonics 13 (7) 28, 1955; 13 (10) 51, 1955.
(3) Ross (M.), Charlesby (A.), Atomics, 4, 189, 1953.
Charlesby (A.), Ross (M.), Nature 171, 1153, 1953.
(4) Saeman (J- F.), Millett (M. A.), Lawton (E. J.), Ind. Eng. Chem. 44, 2848, 1952.
(1)
(2)
DÉGRADATION DPS POLYMÈRES
L98
dence par le fait qu'il se produit peu, ou pas du tout, de monomère, même
pour des doses élevées qui entraînent une diminution de la masse moléculaire
d'un facteur 10 ou plus. Pour cette raison, on adopte plutôt dans ces cas le
terme de dégradation que celui de dépolymérisation. On admet que la dégradation procède en deux étapes au moins, la première étant constituée par
des ruptures de la chaîne principale, suivie ensuite de réarrangements atomiques afin de stabiliser les fragments ainsi formés. Les problèmes qui se
posent immédiatement sont de savoir où ces ruptures se produisent, comment
elles
dépendent de la dose
et
de l'intensité du rayonnement, en quoi
elles
varient avec la nature des monomères. On a à connaître en outre leur variation avec la température, ce qui est important dans la discussion des méca-
nismes d'action des rayonnements. L'oxygène joue lui aussi un rôle important,
^-^* x
400-,
^*"
300-
/
,
y
de
dation
polymères
qui se réticuleraient en
/
son
absence, mais ce
phénomène, qui peut
être dû à la formation
de peroxydes instables,
n'a pas encore été com-
/
,'lHl-
^
provoquant ma-
nifestement la dégra-
/
/
plètement envisagé au
point de vue quanti-
4^
17ÎÔ7
(WO
7
flï
io^
dose d'éketrons en reps
Fig. 8,1.
— Dégradation de
la dextrane.
tatif
et
nous ne
considérerons pas
le
ici.
Pour déterminer le
nombre de ruptures de
la chaîne principale provoquées par irradiation, il semble indiqué
de mesurer la
masse moléculaire moyenne en nombre, du fait que l'accroissement de son
inverse 1/M n représente directement le nombre de ces ruptures, quel que soit
l'endroit où elles se produisent dans la chaîne moléculaire principale, ou la distribution initiale des masses moléculaires. On peut également employer dans ce but
l'osmométrie ou l'ébullioscopie, bien que les résultats en soient moins sûrs et
plus limités qu'avec les autres méthodes, ce qui fait que peu d'expérimentateurs
seulement les ont utilisées. Price, Bellamy et Lawton (5) ont étudié la diminution de la masse moléculaire moyenne en nombre du dextrane irradié à l'état
sec par des électrons de grande énergie. A l'aide d'analyses des groupements
terminaux, ils ont trouvé que, pour des doses de rayonnement allant jusqu'à
3
x 10 7 reps, le nombre de ruptures induites est approximativement propor-
tionnel à la dose absorbée, bien qu'il semble diminuer pour des doses plus fortes.
Dans la figure 8,1, 10 6 /M n qui représente le nombre de ruptures par molécule de
masse d'un million, est porté en ordonnées en fonction de la dose absorbée.
L'ordonnée à l'origine donne le nombre initial de coupures pour ce poids
moléculaire et la pente correspond à l'augmentation provoquée par
l'irra-
diation.
(5)
Prick (E.
P.),
Bellamy (W. D.), Lawton (E. J.), ./• Phys. Chem. 58, 821, 1954.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
Selon cotte figure, une dose de ut 7 rads, ou de
L99
108 ergs/g, provoque
(
.»
60 ruptures de la chaîne principale par molécule de masse in 6
10» x 9
x 10 8 x 0,625
10»
..
- = 1;>
()
.
6,02 x 10 23 x 60
ev,
pour
.
la
rupture
,
,.
<l
soit
,
une
.
.
.
liaison.
Dans la plupart des cas, on ne peut pas mesurer chimiquement le nombre
des groupements terminaux et L'osmométrie ne permet pas de déterminations
suffisamment précises. De plus, ces mesures ne fournissent aucun renseignement sur l'emplacement des ruptures. On peut toutefois obtenir ces renseignements par des mesures des masses basées sur la viscosité intrinsèque ou
sur la diffusion de la lumière, qui donnent respectivement la masse moléculaire moyenne viscosimétrique M„ ou la moyenne en poids M w Quoi qu'il en
soit, les modifications produites par irradiation dépendent non seulement
du nombre de ruptures induites, mais aussi de la distribution initiale des
masses moléculaires. Dans le cas le plus simple d'une distribution au hasard
ou exponentielle (selon la définition donnée au chapitre VII), et lorsque les
.
ruptures sont réparties au hasard le long de la chaîne, la distribution des masses
moléculaires après irradiation est aussi au hasard, mais avec des paramètres
Dans le chapitre précédent, on a montré (7,9) que la masse molémoyenne en poids décroît avec la dose absorbée selon la relation
différents.
culaire
:
M w = 2 w/p (r + r
)
p étant la probabilité de rupture par unité de monomère et de dose absorbée
et w la masse moléculaire du monomère. On admet que p est indépendant
de la dose absorbée, comme on le verra ci-dessous. r est un paramètre qui a
les
dimensions d'une dose de rayonnement et qui permet de tenir compte de
la distribution initiale des
initialement infinie, r
le
cas en fait, r
masses moléculaires.
Si la
masse moléculaire est
= 0, tandis que si elle est finie, comme c'est toujours
représente la dose de rayonnement qui serait nécessaire pour
dégrader une molécule infinie jusqu'à ce que la masse moléculaire moyenne
en nombre des fragments soit égale à celle de l'échantillon initial. Si, toutefois,
la distribution initiale des
masses moléculaires n'est pas au hasard, on doit
modifier la relation précédente selon le type de distribution après et avant
La modification rendue ainsi nécessaire a été discutée par Charlesby (6).
Pour la masse moléculaire moyenne viscosimétrique on a (équation 2,10)
irradiation.
:
M = M n (a + 1)T(1 + a)
v
1
-
= (a + 1)T(1 + a)^w/p (r + r
).
Une autre relation est basée sur la viscosité intrinsèque [tj], liée à M„ par
la relation suivante :
M = KM?:
À'
(6)
et
a étant des paramètres
déterminés expérimentalement.
Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A, 224, 120, 1954.
En
fonction
DÉGRADATION DES POLYMÈRES
200
M v0 du polymère non irra-
de la masse moléculaire moyenne viscosimétrique
dié,
on a
:
M, = M,o/(l + r/i-o)
et
M = K«M' rS(r+r
)-«.
Ainsi, en portant sur un graphique le logarithme de
+r
[vj]
en fonction de log
—
a. Le seul paramètre est
on devrait obtenir une droite de pente
qu'on détermine par la masse moléculaire initiale, supposée connue. Sinon,
r
on peut le déterminer en augmentant toutes les doses d'irradiation d'une
(r
),
,
!
*
-»--._
.
*
V
«. __
«s.
-) <•--.
"""—»-
nJ
r-i
^
"î
^PNV
5i.o
M
0,7
0.6
^\
!
0.5
0.4
0.5
0,2
0.1
5
2
I
Dose r ou r+ rQ en millions
[r\]
en fonction de r
[rj]
100
10
en fonction cU
pâte a papier
-f-
pâte à papier: r D=Q75 x 10
X
bourres de coton
X
bourres de coton: r
Fig. 8,2.
[k]]
=
roentgens
10
= i*.9 tr + rV-0,71
— Dégradation de
la cellulose par irradiation.
petite quantité constante jusqu'à ce qu'on obtienne une droite.
part des cas, r
*
de rœntgens
f
—
S\
Dans la plu-
constitue un terme correctif très petit en comparaison de r
en fait que pour les plus petites doses de rayonnement. La
montre les résultats de Saeman, Millett et Lawton (7), dans
le cas de dérivés de la cellulose, portés sur un graphique selon la méthode que
nous venons d'exposer. Si on n'apporte pas de correction r pour tenir compte
des masses moléculaires initiales, on obtient une courbe, tandis que si on en
et n'intervient
figure (8,2)
tient compte, on a une droite bien rectiligne d'équation [yj]
= 4,9 (r -f r
)
— 0,71
avec r en mégareps. On obtient la même droite pour différents types de cellulose, ce qui indique que les résultats
dépendent en fait de la nature du mono-
mère et que la sensibilité de la substance aux ruptures induites par irradiation
est indépendante
(7)
du type de cellulose irradié. Le terme correctif r constitue
Charlesby (A.), J. Polymer Sci., 15, 263, 1955.
„
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
201
évidemment une mesure de la masse moléculaire initiale. Comme L'allure delà courbe est, pour de petites doses de rayonnement, très sensible à l'Influence
une bonne méthode de comparaison des masses moléculaires des échantillons non irradiés, même lorsqu'on ne connaît pas les valeurs
correspondantes de K et de a. En outre, elle permet d'obtenir une valeur de
a dans les cas où on ne peut pas déterminer expérimentalement K et a directement par fractionnement. Pour déterminer le paramètre K, on doit cependant procéder à une mesure absolue de la masse moléculaire, OU encore déterminer l'énergie absorbée par la
de r
,
ce tracé fournit
rupture
d'une
liaison
de
la
chaîne principale. Puisque ces
ruptures se produisent au hasard,
techniques
les
basées
sur
les
rayonnements constituent une
méthode pratique pour obtenir
des polymères à distribution
de masses moléculaires connues,
à partir d'une distribution initiale
quelconque.
Dans
le
cas du polymétha-
crylate de méthyle, pour lequel
K et a relatifs à
on connaît
certains solvants, cette méthode
0.02
permet une détermination précise du nombre et de l'emplacement des ruptures induites par
La
irradiation
(8).
montre
diminution
figure
0.03 0.0(0.05
0.3
0.(
0.5
Rffic
x
barreaux
>
R Q ; 0,007
>
iR o=0.00G)
8,3
°
copeaux détachés a extérieur des barreaux
+
barreaux chauffés à 150 °C après irradiation
ù
poudre
I
>
R
= 0.0175 J
— M v W.tJ.I0 lR-nV
l,
la
de
M„
avec la dose absorbée pour des
masses moléculaires allant de
exprimes en unités de radiation de la pile
ft./f
Fig.
8,3-
— Variation de
la
masse
moléculaire
moyenne viscosimétrique du polyméthacrylate de
méthyle en fonction de la dose absorbée.
En coorà 5 x 10 4
données
logarithmiques,
la
courbe est rectiligne et de pente
1, de sorte qu'on peut la mettre sous la
forme 10 6 /M = 38 (R -f- R ), (R + R ) étant exprimé en unités de pile. Cette
relation est valable pour des échantillons variés de différentes masses molé-
5 x 10 6
.
—
fl
culaires initiales (où par conséquent le
valeurs).
terme correctif R
Dans tous les cas, on peut calculer R
prend différentes
à partir de la distribution ini-
tiale des masses moléculaires et sa valeur est petite
en comparaison de R. On
obtient une relation analogue lorsque des échantillons sont soumis aux rayons
gamma d'une source de 60 Co; on a alors 10 /M W = 0,83 (r r avec r et
en mégarœntgens. En comparant ces deux équations, on obtient l'équivalent en rayons gamma d'une unité de pile; on trouve ainsi 46 x 10 6 rœntgens.
6
:
-f-
)
r
L'irradiation du polyméthacrylate de méthyle, ou d'autres polymères dégra-
rayonnement élevées, de
mégarœntgen ou davantage. La seule mesure nécessaire est celle
dables, offre la possibilité de mesurer des doses de
l'ordre de 1
(8)
Alexander (P.), Charlesby (A.), Ross (M.), Proc. Roy. Soc. A, 223, 392, 1954.
DÉGRADATION DES POLYMÈRES
202
de la viscosité intrinsèque et on peut irradier des échantillons de n'importe
pendant de longues périodes avant de procéder
aux mesures. Pour pouvoir utiliser cette méthode, il serait souhaitable cepenquelle forme et les stocker
dant de connaître avec plus de précision la constante de l'équation et sa variation avec la température.
EFFET DE L'INTENSITÉ
DU RAYONNEMENT
Dans le cas de polymérisations induites par irradiation, la quantité de substance transformée dépend non
seulement de la dose, mais de
son débit. Dans le cas de reticulations,
celui
de
même que dans
de dégradations induites
par le rayonnement, la densité
de reticulation est indépendante
du
Les figures 8,4, 8,5
montrent que le nombre
débit.
et 8,6
de ruptures de la chaîne prin-
par irradiation
dans le polyisobutylène est pro-
cipale induites
portionnel à la dose absorbée
pour
les
rayons
gamma,
les
électrons accélérés et les divers
rayonnements émis par les réacFig. 8,4.
— Dégradation du polyisobutylène par
les
teurs (9).
De plus, cette action
indépendante de l'intensité
et ne dépend que de l'énergie
totale absorbée par la substance. Les irradiations aux rayons y étaient effectuées
rayons y à 20 °C.
est
avec des intensités de l'ordre de 1 million
de rœntgens par jour; les expositions à la
pile distribuaient la
même dose en 20 mi-
nutes environ et le faisceau d'électrons en
quelques secondes. Malgré ces différences
énormes d'intensité, les valeurs obtenues
aux électrons et aux rayons gamma n'ont
que quelques pour cent d'écart
c'est-à-
—
dire tout à fait dans les limites des erreurs
expérimentales.
On ne peut pas obtenir de
déterminations absolues pour
les
irradia-
on peut calculer, par
comparaison avec les irradiations aux électrons et aux rayons y, qu'une unité de pile
a le même effet que 44 mégarœntgens de
tions à la pile, mais
rayons y à 20°, valeur qu'on peut rappro-
5
2
10
20
50
Oose de radiation en mègarad
—
Dégradation du polyisoFig. 8,5.
butylène par un faisceau d'électrons.
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
203
cher des 46 à 50 mégarœntgens obtenus par d'autres méthodes. Comme Le rayonnement de la pile est un mélange de diverses radiations, et en particulier de
neutrons rapides qui réagissent plus aisément avec les atonies très Légers
d'hydrogène, on ne peut considérer cet équivalent que comme une valeur
empirique, qui variera d'une pile à l'autre et à l'intérieur ^'unv même pile.
Les diverses déterminations de la dose équivalente Ont toutes été obtenues dans
la même zone de la pile BEPO à Harwell et leur bonne concordance, malgré
variation
la
considérable
de
la
teneur en hydrogène des échantil1000
lons irradiés, indique que ce sont
gamma
rayons
les
qui
doivent
500
être tenus pour responsables de la
200
plus grande partie des transfor100
mations chimiques observées.
Le domaine des doses portées
dans
figure
la
8,6
s'étend à 10
au
moins,
•
de
unités
5 x 10
pile
soit
rœntgens, et correspond
8
à environ 1 rupture par 10 unités
de
10
150
5
100
monomère; les
comprises
20
intensités,
celles des
y
irradiations
aux rayons y, varient d'un facteur 10 5 Le fait que la partie de
a
3
les cercles indiquent eue /Irradiation a été effectu,
sous vide.
J
I
0.01
0,02
reste constante, autorise à consi-
dérer p Q comme également cons-
0.05
l
l
0.1
0.2
Unités
.
la droite des figures 8,4, 8,5 et 8,6,
XPR0
Fig. 8,6.
0,5
— Dégradation de 3
isobutylène (B 50,
nement de la pile.
1
2
de pile
échantillons de poly-
B 100 et X. PRD)parle rayon-
tant en ce qui concerne la mesure
du rendement en ruptures. D'autres expériences avec le polyisobutylène (9),
irradié à diverses températures, montrent en fait que p varie avec la température d'irradiation. On peut voir en effet dans le tableau VIII, 1 que l'énergie
nécessaire à la rupture d'une liaison de la chaîne principale du polyisobutylène
entre
— 190 °C
et
+ 90 °G varie d'un facteur 4. La valeur de r
,
dose néces-
saire pour amener une molécule infiniment longue à la masse moyenne initiale,
Tableau VII 1,1.
TEMPÉRATURE
°c
—
— 196
80
20
70
90
Effet de la température sur la dégradation du polyisobutylène.
ÉNERGIE ABSORBÉE POUR ROMPRE
UNE LIAISON
DE LA CHAINE PRINCIPALE
45 eV
27
20
rv
observée
calculée
3,4 X 10°
3,55
X 10 6
x io 6
X 10 6
1,05
0,5
x 10"
X 10*
12
1,1
10
0,55
r sont des doses « virtuelles » de rayonnement qui permettent de tenir compte de la valeur
initiale finie des masses moléculaires.
(9)
Alexander (P.), Black (R. M.), Gharlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A, 232, 31, 1955.
DÉGRADATION DES POLYMÈRES
204
variera nécessairement du même facteur,
valeurs calculées et mesurées de r
échantillons.
comme le montre l'accord entre les
portées dans le tableau pour différents
Une variation en fonction de la température du même type se
rencontre aussi dans l'irradiation de certains systèmes biologiques et indique
que le phénomène n'est pas typiquement biologique, mais constitue une pronombreux systèmes organiques.
priété fondamentale de
DÉGAGEMENTS GAZEUX
Outre les modifications de masses moléculaires, l'irradiation de polymères
susceptibles de se dégrader a aussi pour conséquence un dégagement de gaz,
produits surtout à partir des chaînes latérales.
Dans le polyisobutylène, la
plus grande partie des gaz formés est constituée d'hydrogène et de méthane;
des hydrocarbures plus lourds ne se forment qu'en très petites quantités, ce
qui indique que les gaz ne proviennent que des groupes latéraux.
On arrive
à la même conclusion par l'examen des gaz dégagés par irradiation de polymé-
thacrylate de méthyle.
Il
se forme
dans ce cas de l'hydrogène, de l'oxyde de
carbone et du gaz carbonique ainsi que du méthane. Dans le dernier cas, la
rigidité du polymère à la température ordinaire complique la situation en
empêchant les gaz (à l'exception peut-être de l'hydrogène) de diffuser à travers la surface. En conséquence, on n'observe aucun changement appréciable
du polyméthacrylate de méthyle après des doses de 50 mégarœntgens (ou
même plus), si l'irradiation a été faite en dessous du point de ramollissement.
Si
l'échantillon
est
chauffé par la suite, toutefois, les divers gaz retenus
dans l'échantillon peuvent diffuser ensemble vers
la
surface en formant
On peut ainsi
provoquer des dilatations multipliant par 10 le volume initial. Il existe une
relation entre la dose absorbée et la température à laquelle on doit porter les
échantillons irradiés pour y former des bulles; plus la dose est faible et plus
la température minimum nécessaire est élevée. On peut expliquer ce phénomène par le fait que, pour que des bulles se forment, il faut que la pression
interne des gaz occlus soit suffisante pour séparer les molécules de polymère.
Plus la dose d'irradiation est élevée, plus il y aura de gaz dans un volume
donné, en même temps que les molécules de polymère, se trouvant réduites
dans leurs dimensions, seront moins capables de résister à cette pression. Il
est peut-être significatif que, même pour de très fortes doses, il ne se forme
pas de bulles en dessous du point de ramollissement.
On peut montrer expérimentalement que les gaz sont bien produits par le
des bulles
et
le
volume
total
de l'échantillon augmente.
rayonnement et non par le chauffage consécutif, en dissolvant des échantillons
irradiés mais non chauffés. Il se produit un dégagement gazeux considérable,
bien que les échantillons n'aient jamais été portés à des températures supérieures à la température ordinaire. Il est remarquable que dans le polyméthacrylate de méthyle boursouflé de gaz, il ne se forme pas de bulles aux environs
de la surface de l'échantillon qui demeure lisse et ne se fragmente pas. Quand
on expose des feuilles de polymère à une irradiation uniforme et qu'on les
chauffe ensuite pour y produire des bulles gazeuses, on observe une bordure
ACTIONS SUR LES POLYMÈRES
claire où il ne s'est pas formé de gaz (fig. 8,7).
205
On peut supposer que près de
formés par irradiation ont pu diffuser à travers la surface
et que par conséquent la pression y est réduite. Cette frontière claire est formée
au cours de l'irradiation, comme on peut le montrer en cassant L'échantillon
la surface, les gaz
Fie. 8,7.
à)
Plexiglas irradie puis chauffé.
irradié et en chauffant les fragments
La figure montre la zone dénuée de bulles.
séparément pour y former des bulles.
Dans ce cas, on trouve des bulles au niveau des surfaces créées par la cassure
après l'irradiation. L'épaisseur de cette tranche claire est de
valeur en accord avec celle qu'on calcule d'après
Fig. 8,7.
b) Plexiglas irradié
le
1
mm environ,
dégagement gazeux et
par 1\3 d'unité de pile puis chauffé pendant
3,
6,
9
et
12 minutes.
les variations
de poids des échantillons irradiés. Si ces échantillons ont une
épaisseur d'environ 2 mm, les variations de poids dépendent en grande partie
de la surface, tandis que, pour des feuilles plus minces, elles sont proportionnelles à l'épaisseur totale.
semble bien que la formation de bulles dans le polyméthacrylate de méthyle ait beaucoup d'analogies avec celle qui se produit dans l'eau bouillante.
L'irradiation de substances comme le méthacrylate de méthyle peut constituer
une méthode commode d'étude des processus de diffusion et de formation
Il
d'interstices dans les solides; le phénomène peut ainsi être observé au moment
DÉGRADATION DES POLYMÈRES
206
voulu et éventuellement interrompu à n'importe quel stage de son évolution,
ce qui présente des avantages indéniables.
Dans le polytétrafluoréthylène, les rayonnements ont tout d'abord pour
effet d'affaiblir la substance et même éventuellement de la transformer en
une poudre (10). Il se dégage des gaz fluorés, comme CF 4 pendant et après
l'irradiation. Pour des échantillons épais, les pertes de poids mesurées après
un certain temps sont proportionnelles au carré de la dose absorbée et à la
surface. Ce n'est que pour des échantillons très fins que la perte de poids devient
proportionnelle à la masse totale du corps irradié. Des échantillons soumis
à de petites doses de rayonnement de l'ordre du million de rœntgens sont
apparemment inaltérés, mais peuvent néanmoins se briser après plusieurs mois.
On peut considérer que la variation avec le carré de la dose (r 2 ) indique que,
pour produire un gaz, il faut briser deux liaisons voisines de la chaîne. D'autre
part, la variation de la perte de poids en fonction de la surface irradiée pour
montrerait que le phénomène dépend de
des épaisseurs de l'ordre de 0,1
,
mm
la diffusion de ces produits, la distance de diffusion étant de cet ordre de gran-
deur. On constate aussi pour le polyméthacrylate de méthyle l'existence d'un
temps entre l'irradiation et la fragmentation; des échantillons
apparemment intacts se fragmentent par la suite en se lézardant ou
intervalle de
irradiés
en s'écaillant. Cette action peut provenir de tensions internes provoquées
dans la substance par les gaz occlus.
Ryan (11) a mesuré les gaz fluorés dégagés par du polytétrafluoréthylène
irradié et en a déduit la relation suivante
:
AM = 3,78 x ÎO" ^)
18
1 ' 15
AM étant la perte de poids en gramme par gramme et r la dose absorbée en
rœntgens. Cet auteur ne donne pas le rapport entre la surface et le volume
des échantillons qu'il irradiait, de sorte qu'on ne peut pas comparer directe-
ment ses résultats avec des données antérieures. On peut montrer que AM
dépend du laps de temps entre l'irradiation et la mesure, comme on peut s'y
attendre puisque les gaz présents doivent diffuser à travers la surface. Ryan
a aussi étudié par l'analyse infra-rouge et par décoloration de solutions de
permanganate l'insaturation provoquée dans
le
polytétrafluoréthylène.
On
observe des modifications de la structure cristalline probablement dues à
FF
des groupements
F
— C = C — — C = CF La présence de grandes quantités
I
I
I
et
2.
de gaz occlus peut aussi expliquer des modifications des spectres de diffraction des rayons X.
MODIFICATIONS CHIMIQUES
Il
se forme des doubles liaisons dans de nombreux polymères à chaîne longue
lorsqu'on les soumet à des radiations de haute énergie. Dans le cas de polyiso-
butylène, on a employé tant l'analyse infra-rouge que des techniques chi(10)
(11)
(A.), A.E.R.E. M/R 928, 1952.
Ryan (J. W.), Modem Plastics, 30 (10), 152, 1953.
Charlesby
ACT I()\S SUR LES POLYMÈRES
iniques pour mesurer
le
207
taux d'insatu ration induil par Irradiation (9) et on
la dose, saut pour des doses 1res
a trouvé que celui-ci était proportionnel à
élevées de l'ordre de 700 mégarœntgens.
Ou trouve naturellement des résul
Dans le cas
nombre de
doubles liaisons formées est de 1,87 et semble être indépendant de la tempe
tats analogues lorsqu'on irradie des paraffines à chaîne droite.
du polyisobutylène, le rapport entre les ruptures de chaîne et
rature.
le
On n'a pas encore de données expérimentales suffisantes pour savoir
formation de doubles liaisons et les ruptures de chaîne sont deux const
quences indépendantes d'une ionisation ou d'une excitation ou si elles sont
si
la
invariablement liées Tune à l'autre. Dans certaines théories de ces effets, <>n
admet que la chaîne principale se brise, puisque des réactions de dismutation
stabilisent les fragments, mais celte explication ne serait valable que pour
une seule double liaison formée par rupture de la chaîne principale.
Dans leur travail sur la cellulose, Saeman, Millett et Lawton (4) suivaient
les transformations induites par les radiations non seulement par la
diminution
de la masse moléculaire, mais aussi par l'étude chimique des substances irradiées.
La décomposition des hydrates de carbone par un faisceau d'électrons
de 10 8 reps était de 14 p. 100 dans la bourre de coton, de 17 p. 100 dans la
pâte de bois, de 9 p. 100 dans le bois, tandis que pour le glucose elle était de
14 p. 100.
CHAPITRE IX
EFFETS DE PROTECTION DES POLYMÈRES
A CHAINE LONGUE
Quand des radiations de grande énergie traversent des composés organiques,
elles produisent
des ionisations, des excitations et des électrons libres répartis
au hasard. Les molécules peuvent ensuite subir des transformations variées,
comme des ruptures de liaisons, avec formation éventuelle de radicaux libres.
On peut, en général, expliquer l'état final par une suite de réactions chimiques
où ces radicaux réagissent entre eux ou avec des molécules ou atomes voisins.
Contrairement aux atomes ionisés ou excités, ces radicaux ne sont pas répartis au hasard mais se forment d'une façon qui dépend des divers groupements
chimiques que contient la molécule. Le mécanisme par lequel des atomes
excités ou ionisés dispersés au hasard à travers la matière sont transformés
en radicaux localisés constitue un problème fondamental en chimie des radiations. On qualifie souvent ce mécanisme, assez vaguement d'ailleurs, de transfert énergétique mais on ne doit pas conclure de cette expression que l'énergie
en tant que telle est transférée à l'intérieur d'une molécule ou même d'une
molécule à une autre
ce transfert peut s'effectuer par déplacement d'électrons ou d'atomes labiles.
Lorsque l'air est ionisé par des rayonnements très pénétrants, la produc:
tion d'une paire d'ions nécessite l'absorption de 34 ev. Cette
est aussi utilisée pour produire des molécules excitées,
même énergie
en quantité du même
ordre que celle des molécules ionisées. Lorsqu'on irradie des polymères à
longue chaîne, on peut calculer de la
même façon l'énergie nécessaire à la
transformation d'une liaison chimique. Cette énergie est à peu près indépen-
dante de l'intensité des rayonnements et on obtient des valeurs semblables,
que l'ionisation primaire soit due à des électrons libres ou à des rayons X ou
gamma. On n'a pas de données précises sur l'action des particules lourdes ionisantes, mais il ne semble pas que le résultat soit très différent de celui des
rayonnements plus faiblement ionisants. On a porté dans le tableau IX,1
quelques valeurs caractéristiques; les données relatives à la reticulation ne sont
probablement pas aussi sûres que celles relatives à la dégradation à cause des
difficultés qu'on rencontre lorsqu'on veut mesurer avec précision des densités
de reticulation. Outre la reticulation ou la dégradation, le rayonnement produira, naturellement, d'autres modifications chimiques comme des ruptures
DÉGRADATION DES POLYMÈRES
Tableai
POLI mi RI s
si
i;i
nCULANl
i\.
i
IBSORB]
ni ROI!
Polyethylene
timéthylsiloxanes
Polystyrolène
I
i
PAR PON1 DE iti u<
16
il»
9, 7
(2)
l'.t
(3)
22-27
20-30 environ
32
(h
i
i
ni i!(.n
d'i ni.
LATION
ABSORBÉE PAR R] PI R]
HAINE l'itiN. [PALE
liaison DE LA
20*
Gl*
Polyisobutylène
Polyméthacrylate de méthyle
i
(5)
(6) (7)
is»
2
DÉGH \i> an
209
1
Paraffines
Oléflnes
PO] \ MÈRE SE
CHAINE LONGUE
\
i
«
(9)
(10)
•à température ordinaire.
de la chaîne principale, des créations de doubles liaisons et des isomérisations.
On remarquera dans ce tableau que, dans la plupart des cas, le nombre
de transformations chimiques produites (reticulation ou dégradation) est du
même ordre
seraient
de grandeur que
produites dans
l'air.
le nombre d'ionisations ou d'excitations qui
Pour le polyméthacrylate de méthyle, il est
possible que l'énergie nécessaire à la rupture d'une liaison de la chaîne principale soit plus élevée, à cause de l'absorption,
pour une rupture de chaîne
latérale, d'une énergie supplémentaire.
Le cas du polystyrolène constitue une exception remarquable, car le nombre
total de transformations chimiques produites est très petit comparé au nombre
d'ionisations. S'il se forme, pour une dose donnée, le même nombre de molé-
cules ionisées ou excitées
1
que dans d'autres paraffines, il n'y a environ que
sur 50 ionisations qui conduise à une reticulation. On ne peut pas expliquer
cette différence par d'autres modifications chimiques et on doit envisager des
processus par lesquels l'énergie absorbée par le système est dissipée sans produire d'effets chimiques.
Il
est possible
qu'on puisse établir un rapport entre
ce type de dissipation et la présence de groupements susceptibles d'entrer
en résonance et ayant la forme d'anneaux benzéniques.
On sait d'après des études radiochimiques sur de petites molécules organiques que l'anneau benzénique est peu sensible lui-même aux rayonnements
et confère
une protection considérable aux groupements chimiques voisins,
voire même à d'autres molécules. Ainsi, si on irradie un mélange de cyclohexane
et
de benzène, les modifications produites dans le cyclohexane sont beaucoup
Charlesby (A.), Rad. Res. 2, 96, 1955.
Lawton (E. J.), Zemany (P. D.), Balwit (J. S.), J. A. C. S., 76, 3457, 1054.
(3) Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 222, 60, 1954.
(4) Lawton (E. J.), Baltwit (J. S.), Bueche (A. M.), Ind. En g. Chem. 46 (8), 1703, 1954.
(5) Charlesby (A.), Atomics 5 (1), 12, 1954.
(6) Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 230, 120, 1955.
(1)
(2)
Warrick (E. L.), Ind. Eng. Chem., 47, 2388, 1955.
Charlesby (A.), J. Polymer Sci., 11, 513, 1953.
(9) Alexander (P.), Black (R. M.), Charlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 232, 31,
(10) Alexander (P.), Charlesby (A.), Ross (M.), Proc. Roy. Soc. A. 223, 392,
(7)
(8)
HAISSINSKY.
1955.
1954.
M
DÉGRADATION DES POLYMÈRES
210
moins importantes que si le cyclohexane seul est irradié (11). Cet effet de protection se produit bien que l'énergie soit absorbée au hasard par tout le sys-
tème et que, par conséquent, les ionisations et les excitations initialement
le cyclohexane ne puissent pas se trouver beaucoup modifiées
par la présence de benzène. Il y a donc lieu de considérer ce phénomène comme
un transfert d'énergie. On peut expliquer de la même manière la grande résistance du polystyrolène aux rayonnements. La présence d'un anneau de benproduites dans
zène dans la molécule ne protège pas seulement la fraction benzénique, mais
atomes voisins, des transformations chimiques généralement consé-
aussi les
cutives à l'ionisation ou à l'excitation. De la même façon, les silicones liquides
contenant des groupements phényle latéraux sont beaucoup plus résistantes
aux rayonnements que les dérivés diméthylés correspondants.
On peut montrer que cette protection provient surtout de la résonance
de l'anneau benzénique et non du fait qu'il est cyclisé. On peut facilement
calculer la dose de rayonnement nécessaire pour former en moyenne une liaison réticulée par molécule aliphatique d'après le point où débute la gélification (chapitre IV).
liée à la
Quand une structure susceptible d'entrer en résonance est
chaîne aliphatique, la dose minimum nécessaire pour produire le gel
consédirablement accrue (12), tandis que si le groupement correspondant
un
cycle saturé, on n'observe peu ou pas d'augmentation de cette dose
est
minimum. De même, lorsqu'on irradie des copolymères du styrolène (qui est
est
réticulé par le
rayonnement) et de l'isobutylène (qui se dégrade par contre
très aisément) (13), la présence d'un anneau benzénique confère une protection
efficace, à la fois
au monomère aromatique et aux molécules d'isobutylène
voisines.
Pour qu'on ait protection en radiochimie, il n'est donc pas essentiel que
groupement protecteur soit présent dans chaque molécule; il peut aussi
agir efficacement sur les molécules voisines, ce qui montre qu'un transfert
d'énergie, quel que soit son mécanisme, peut se produire entre des molécules
distinctes. On a observé des phénomènes de protection dans les cas de polymères qui se dégradent comme le polyméthacrylate de méthyle. Quand on
incorpore 10 p. 100 d'un agent protecteur à du polyméthacrylate de méthyle
le
qu'on l'irradie en couches solides, le nombre de ruptures de la chaîne prin-
et
cipale induites par l'irradiation peut se trouver réduit au quart de la valeur
mesurée pour l'échantillon non protégé (14). On n'a pas encore mis en évidence
de phénomène de protection dans le cas de polymères qui se réticulent lorsqu'on les irradie à l'état solide. Le tableau IX, 2 indique l'effet de protection
d'un certain nombre de tels agents dans le cas de l'irradiation de polyméthacrylate de méthyle.
La protection d'un polymère contre le rayonnement par addition d'une
substance protectrice peut être due à plusieurs mécanismes différents. La
substance ajoutée peut absorber l'énergie en excès sans s'en trouver elle-même
affectée; elle peut subir des transformations, de préférence au polymère irra-
Manion (J. P.), Burton (M.), ./. Phys. Chem. 56, 560, 1952.
Alexander (P.), Ciiarlesby (A.), Nature 173, 578, 1954.
Alexander (P.), Gharlesby (A.), Proc. Roy. Soc. A. 230, 136, 1955.
(14) Alexander (P.), Charlesby (A.), Ross (M.), Proc. Roy. Soc. A. 3, 392, 1954.
(11)
(12)
(13)
nos DES POLYMÈRES A CHAINE LONGUE 2
DÉGU.\l).\
Tableau
1
Diminution de lu dégradation <lu polyméthacrylate de méthyle pur a idition
\. 2.
de diverses substances.
(Dose de rayonnemenl
M.l NI
>'
1
\
1
HH
1
|D\
Aucune addition.
im:i."i
unités de pile soil 6,2
I0*r).
M,
11)"
5,4
10
"„
diméthyl-tolyl-thiourée
1.72
lu
",,
benzoquinone
1,82
10
",,
8-hydroxyquinoléine
1,96
1(1
",,
aniline
12,
10
"„
allyl-thiourée
2,56
dié,
l
l
de sorte que la protection ne sera efficace que jusqu'à une certaine dose
de rayonnement. Ou encore, ce transfert peut intervenir dans la suite des réactions chimiques en réunissant
ensemble deux fragments formés par la dégra-
dation du polymère et en lui restituant ainsi sa masse moléculaire initiale.
Dans ce dernier cas, la molécule du protecteur se trouvera incorporée dans le
polymère et on pourra facilement en déterminer la présence, par exemple
par l'emploi d'indicateurs radio-actifs. Quel que soit le mécanisme impliqué,
il
est tout à fait significatif que des quantités relativement petites de ces sub-
stances puissent conférer une protection considérable. Ceci est
un argument
de plus en faveur de la suggestion selon laquelle l'énergie peut se trouver
transportée à travers des distances interatomiques relativement importantes.
Bien que
la
molécule du polymère lui-même puisse apparaître inaltérée
après l'irradiation, la substance ajoutée peut subir des transformations particulières;
il
serait
donc préférable de lui donner le nom d'agent additionnel
plutôt que celui d'agent protecteur et de continuer à nommer ainsi les agents
additionnels qui ne subissent, sous l'effet du rayonnement, aucune transformation chimique, mais absorbent simplement l'énergie par un « effet d'épongé ».
Les agents additionnels efficaces sont souvent les mêmes qu'en radiobiologie
où ils confèrent un certain degré de protection à l'organisme irradié. En étudiant le mécanisme de protection contre le rayonnement de systèmes polymerises variés on pourra peut-être parvenir à déterminer le mécanisme de
la
protection des systèmes biologiques, qui sont plus complexes.
INDEX DES AUTEURS
101, 121. 12
Burnett ((.. M.), 07. 9
Burr (.1. (..). 54,
Burrell <!'..). 50.
Burton (M.), i.
7-9, 12, 13, L6, 20, 22. 23,
1,
1.
.">.">.
Aqeno
Ai
i
(M.),
13.
xandeh (P.),
209,
Ali îîi.v
Allen
Allen
123,
146, 201, 203,
129,
:».
25, 20. 31. 38-43, If.. 55. 57, 59, 120. 210.
Burton (Y. I..). 58.
210.
(T.). 80.
(A.
().). 20.
(P. W.), LOI.
Allsopp (C. P.). 39, L6.
Ander (P.), 113, 188.
Anderson (l.. P.). ion. 112.
Auer (I-:. E.), 94-96, 99, 101-103.
Ayri.y (G.), LOI.
Chalmers (T.), 3.
Chang (.1.), 20, 30, il.
Chapiro (A.), 33-37,
15, 59, 73, 76, 83-85,
87, 89, 90. 95-97, 100-108, 113, 117-122,
17.
130, 131,
Charlesby (A.), 25, 20, 141, 146, 15:5. 156,
157, 164, 107, 171. 178, 181. 18(5, 189,
190, 192. 197. 199-201, 203, 206, 209, 210.
Cheinker (A. P.), 80.
Chen (W. K. W.). 133.
Cole (S.), 57.
Gollinson (E.), 4, 85, 125-128.
Golombo (P.), 83, 87, 92-94, 96, 99, 133.
1
Bach (N. A.), Hi. 53, 55. 57.
Bagdassarian (Kh. S.i. <S7. 90, 98, L 00-102,
117.
119-121.
Ballantink (I). S.). S3. 86, 87, 92-94, 96,
99, 100, 113, 129, 133, 188.
Balwit(J. S.). 111. ICI. 169, 188, 189,209.
Bamford (C. H.), 76, 95, 104-106, 127, 153.
Bardwell (1). C). 82, 109.
Bartlett (P. 1).). loi.
Baskett (A. C). 172, 187.
Bawn (C.
1-:.
Condon (1-:.
P.),
7.
Gonix (A.), 121.
Cousin (G.), 33, 88,
CUMMINGS (X.), 80.
95.
H.). 33.
Baysal (B.), 94, 95, 99.
Behr (J.), 86, 87, 96, 100.
Bellamy (W. 1).), 198.
Bennett (W.), 57.
Dainton (F. S.), 82, ^^, 124- 128.
Davidson (W. P.), 197.
Derminassian (P.), IIP
Devins (J. C.), 8.
Bensasson (B.), 76, 85, 104, 128.
Benson (S. W.), 70.
Bernas (A.), voir Prévùt-Bernas.
Dewar (J. S.), 95.
Berry (P. J.), 39, 45, 120.
Berstein (I. A.), 105, 106.
Beyilacqua (E. B.), 94-96,
Bevington (J. P.). loi.
Blacet (F. E.), 7, 39.
Dewhurst (H. A.), 20, 38, 11
99,
101-103.
Black (B. M.), 190, 203, 209.
Blake (X.), 24.
Boag (J. W.), 34, 58, 84, 85.
BODENSTEIN,
Dienes (G. J.), 113, 143, 188.
Dole (M.), 181, 188.
Duggan (P. B.), 58.
Durup (J.), 95, 192.
70.
Bonet-Maury (P.), 17.
Boozer (G. E.), 36.
Bopf (C. 1).). 147, 197.
Bouby (L.), 36, 45, 59, 107, 118, 120, 121,
130.
Bray (B. C), 10'.). 112.
Breger (I. A.), 56, 58, 186.
Bretton (B. H.), 86, 109.
Ebert (M.), 34, 84, 85.
Egorova (Z. S.), 48. 19.
Eigen (M.), 66.
Einstein (A.), 7.
Essex (H.), 3.
Evans (M. G.),
79.
Fnyart (B. H.), 80.
Briggs (E. B.), 80.
Brown (D. E.), 83.
Bryant (AV. M. I).). 181.
Buchdahl (H.). 110.
Bueche (A. M.), 169, 189, 209.
Burhop (E. 11. S.), 10.
Fanhoe (F.), 131.
Fano (U.), 5.
Farkas (P.), 10.
INDEX DES AUTEURS
214
Farmer (E. C.)i 105, 106.
Fellows (G. H.), 18-20.
Fessenden iR. W.) Jr., 29, 32.
Jenkins (A.
Field (F. H.), 3.
Fielding (G. H.), 7.
Jesse (W. P.), 112.
Joliot (F.), 82.
104-106, 127.
76.
S.),
Fiquet-Fayard (F.), 125.
Firestone, 47.
Fischer (K.), 56.
Flisky (M. M.), 46.
Kailan (A.), 59.
Flory (P. J.), 152, 154, 156, 158, 175, 176.
Forsyth (P. R.), 31, 32.
Fox (M.), 123, 129.
Franck (J.), 7, 9, 16, 22, 78.
Franklin (J. L.), 3.
Kalm (M.), 24.
Kamen (M. D.), 9.
Fricke (H.), 36, 48.
Frilley (M.), 47.
Frith (E. M.), 152.
Kern (W.), 114, 126.
Klein (P.
Kwart (H.),
Glines (A.), 83, 86, 87, 92-94, 96, 99, 100,
133.
Lagally (P.), 92.
Laird (R. K.), 109,
Goodman (C.), 56, 186.
Gordon (S.), 20, 24, 43, 51, 52.
Gray (L. H.), 5, 8, 34, 84.
Grean (L. E.), 134.
Landler (Y.), 33, 80, 82, 83, 88, 89, 92, 95.
Larson (N. R.), 181.
Lawton (E. J.), 83, 102, 103, 112, 114, 164,
169, 188, 189, 197, 198, 207, 209.
Griffith (L. R.), 36.
Lea (D. E.), 5, 6.
Lefort (M.), 47.
Grosmangin (J.), 83.
Grubb (W. T.), 114.
Lemmon (R. M.), 4, 19, 26, 51.
Levy (P.), 143.
Lewis (F. M.), 80.
Lewis (J. G.), 83, 134.
Lind (S. C), 6, 82, 109.
Lindsey (H.), 83.
Lipsky (S.). 3, 39, 44, 45,
Hamill (W. H.), 3, 27-29, 31, 42, 48.
Hammond (G. S.), 36.
Hancock (N. H.), 178.
Hannan (R. S.), 58.
80.
Hayward (H. R.), 57.
Hayward (J. G.), 109,
111,
113, 114, 126.
Henley (E. J.), 134.
Hentz (R. R.), 20, 26, 31.
Hermans (P. H.), 180.
Hess (D. N.), 52.
Hettinger (W. P.), 181.
Heydrich (H.), 13, 60, (il
HlGASHIMURA (T.), 101.
112,
Henglein (A.),
120.
M
Harlen (F.), 187.
Hart (E. J.), 94-96, 99, 101-103.
E.),
111.
Landfield (H.), 94.
Landis (P. W.). 58".
GOLDFINGER (G.), 80.
134.
McClure (D. S.), 9.
McDonell (W. R.), 50-51.
Mac Kay (M. H.), 99.
McLennan (J. G.), 109.
McNaughton (G. S.), 126, 127.
Magat (M.), 33, 37, 73, 76, 82, 90, 95, 106,
107, 109, 118, 121, 130, 131, 134.
Magee (J. L.), 5, 9, 11-14, 35, 38, 78.
Majury (T. G.), 98, 101, 113.
Malger (L.), 66.
Manion (J. P.), 20, 39, 40, 42, 43, 120, 210.
Mannal (C.), 147.
Manowitz (B.), 83, 86, 87, 92-94, 96, 99,
79.
Honig (R. H.), 56.
129, 133, 188.
Hopwood (F. L.), 82.
Hunter (E.),
101.
Lampe (F. W.), 3.
Goeckermann (R. H.), 83, 88.
Hornig (J.), 47.
Horrigan (R. V.),
147.
Kuhn (W.), 192.
Gibson (G. E.), 9, 24.
Gilmore (E. H.), 9.
Glen (J. W.), 143.
Higginson (W. G.
Hirota (K.), 52.
H.),
188.
Kusumoto (G.), 52.
George (M.), 101.
Gevantman (L- H.), 28, 49, 50.
D.),
Kasha (M.), 7.
Keeling (C. D.),
Koch (W.), 82.
Koehle (H.), 92.
Krenz (F. H.), 187.
Krimm (S.), 180.
Garrison (\V. M.), 57.
Geib (V. G.), 197.
Harkins (W.
Kara-Michailova (E.), 6.
Mark (H.), 130.
Martin (J. J.), 109, 112.
Massey (H. S. W.), 10, 13.
Matheson (M. S.), 94-96,
86.
181.
99,
101-103.
Matthews (J. L.), 180.
Mayo (F. R.), 80.
Medvedev (S. S.), 80, 87, 117.
Immergut (E. H.), 130.
Imperial
Chemical
Industries,
Ingram (D. J. E.), 105.
Isaacs (P. J.), 134.
109.
Mellish (S. F.), 33.
Melville (H. W.), 95, 99, 101, 124.
Merrett (F. M.), 101.
Meshitsuka (G.), 52.
INDEX DES AUTEURS
Mesrobian
Metz
(R, B.), 86, 87. 96,
100,
113,
(D.
86,
J.),
Migirdicyan
(E.),
87, 96,
36, 97,
100,
100,
113,
107.
133.
121,
130.
Mu ni [NSK \u (P.
I.),
(
M.),
181,
lii,
l
(
W. G.),
197, 201,
105, loi;.
210
Ryan <.i. W.), 206.
Rychkov (K. S.). Ki.
Ryder (H.). 181.
it
S \i> AUSKIS (.!.).
12.
S mi. AND E.), 17.
1
(
MlNDEH (W.). L3, 00. (il.
MOMIGNY (.).). 108.
Saeman (.1. F.), 197, 207.
Mon sam u>,
Mon iKoi.i.
109,
Sakurada
192.
Moore (C. ('..). 101.
MORAWETZ (H.). N0, 113.
MORRELL (A. (..), 10!». 111.
Morton (M.). 94.
(W.». :;. t. 82, L08.
Salatiello
Sami i.i. (A.
Saint Gobain,
E.),
(
SCHMITZ (J.
N
Nash 31.
\i WTON (A. S.), 50, 53-50, 59.
Nichols (J.
Nikitina (T.
I).),
181.
00, 98, 100-102, 117,
S.). 87,
121.
Nosworthy (.1. M.), 3, 32, 45.
Noyés (W. A.). Jr., 7.
Oakes (W. G.), 181.
Offenback (J.), 94-96.
Okamura (S.), 101, 192.
Orthmann (H. J.), 180.
Oster (G. K.), 127.
Ouchi (K.), 52.
Patrick (W. L.), 109.
Patrick (W. N.), 20, 22, 25, 26, 41, 43, 59,
00.
Paul (B.), 60.
Peiser (H.
S.),
l.),
108.
192.
(P. P.), 94.
M.».
13. 38, 78.
1
I
10.
S3.
102. 103,
12.
SCHOEPFLE (C S.), 18-20.
Schubert (G C), 29, 31.
SCHULER (H. M.). 13. 20. 29-32, H, IN.
Schulti: (.1. W.), 19, 01.
Schltlz (G. V.), 123, 139.
Schulz (H.), 113, 111, 126.
Sebban-Danon (.).). 30. 73, 85. 87, 90, 90.
100, 105-107, 118, 121, 130, 131.
Seed (L.), 109, 111.
Seitzer (W. H.), 83, 88, Si». 96, 98, 100,
101, 117, 119.
Selwood (P. W.), 32.
Semany (P. D.), 188.
Sen (J. N.), 36.
Sheppard (C. V.), 55.
Shultz (A. R.), 157.
Sievert (R. M.), 134.
Simha (R.), 192.
Y.),
1
Simpson (W.), 187.
Sisman (O.), 147, 197.
Skraba (W. J.), 52.
Smets (G.), 124.
Smith (W. V.), 80.
Smith-Broasbent (H.), 101.
Sorokine (Yu. L), 53, 55.
Spalding (F. F.), 105, 106.
Stearns (R. S.), 80.
Stephenson (D. P.), 3.
Stern (O.), 38, 39.
Stockmayer (W. H.), 124, 156.
Sue (P.), 47.
Suttle (J. F.), 49, 01.
180.
Pellon (J. J.), 106.
Perry (J. H.), 109.
Petrey (R. C), 48.
Phillips (J.
(
Saraeva (Y. Y.), 57.
SCHENCK (G. ().), 39,
Mund
119,
209,
L20.
Mni.
(A. A.), L64.
Miller (C. W.), 172.
Milleb (W. M.). 50.
MlLLETT (M. A.). 197, 207.
i
lioss
Rothschild
188.
133,
T.), 82.
Swallow (A. J.), 4.
Phung (P. V.), 39-41.
Pierce (R. H. H.), 181.
Sworski (T. J.), 20, 23.
Platzman (R. L.), 9-11, 78.
Pletcher (D. W.), 83.
Popov (N. I..), 46.
Szigeti (B.), 39.
Symons (M. C. R.), 105.
SZILARD (L.), 3.
Prati (G.), 127.
Prkyôt-Bernas (A.), 33, 76, 85, 95,
105, 107, 121, 123-125, 128,
Price (E. P.), 198.
104,
130.
Rarinowitch (E.), 8, 9, 16, 22.
Taylor (H. S.), 94.
Taylor (R. P.), 101.
Thomas (W. M.), 100.
Tobolsky (A. V.), 83, 88, 89, 94-96, 98-101
117, 119, 180.
Rack (E. P.), 50.
Tolbert (B. M.), 4, 19, 26, 51.
Raine (H. G.), 181.
Tompa (H.), 153.
TORDELLA (C. T.), 181.
Tordoff (M.), 126, 127.
Treloar (L. R. G.), 175.
Trommsdorf (E.), 92.
Trumbore (C. N.), 50.
Tuckett (R. F.), 152.
Reddy (M.
38.
Reinisch (E.), 36, 107, 121, 130, 134.
Renner (G.), 114, 126.
Restaïno (A. .).), 86, 87, 90, 100, 113, 133,
Richards (R. H.), 180, 181.
Rollefson (G. K.), 7, 31.
Roof (J. G.), 7.
Rose (D. G.), 188.
P.),
Turkeyitch (J.), 32.
Turner (L. A.), 31.
INDEX DES AU TE U
216
Uberreiter
(K.)>
11
S
u
Weeks (B.
180.
Weidinger (A.), 180.
Weiss (G. J.), 134.
Weiss (J.), 9, 10.
M.), 57.
West (W.), 60.
Wetherington (J. A.), 181.
Whitehead (W. L.), 56, 186.
Wiener (H.), 8.
Wild (W.), 36.
Valentine ..), 95.
Van Dyken (A. H.), 24.
Van Meersche (M.), 108.
1
1
Wiliielm
Vernon (A. A.), 94.
VOLMAN (I). H.), 39.
Volmer (M.), 38, 39.
Wooding (X.
S.),
3,
79.
187.
Wahl ^R), 73, 87, 90, 95, 96,
Waldron (J. 1).), 187.
Wall (F. T.), 80, 175.
Wall (L. A.), 165.
Walling
Warrick
49.
Williams (R. R.),
Wilson (J. E.), 7.
W
Waddington (F. B.),
(R.),
Willard (J. E.), 47.
(C), 80.
(E. L.), 209.
Weber (E. X.), 31, 32.
118,
122.
Yamashita (T.),
101
Zemany (P. D.), 209.
Zimine (A. W), 48, 49.
27-29,
42,
49,
50.
.
INDEX DES MATIERES
Acétaldéhyde, 53.
Acétate de méthyle, 45, 59, 119.
Acétate de vinyte, 101, 102.
Acétone, 57, 59, 61, 119.
Acide acétique, 56, 57.
—
—
—
•
—
acrylique, 113, 111, 126.
métliacrylique, 114, 123.
oléique,
58.
propionique,
stéarique,
Acides
(/ras.
A croie ne,
186.
56, 58,
Acrylonitrile, 104, 105, 107, 108, 123, 125.
Alcools, 50, 51, 61.
Aldéhydes,
Amide
59.
211.
acrylique,
113,
126.
Aniline, 211.
Anthracene, 38, 43.
Azo-bis-isobutyronitrile,
36.
Benzène,
7, 8, 18-27, 30, 32, 39, 40, 42-46,
119, 209, 210.
Benzène-d 6 19, 21, 27, 41, 43, 60.
Denzène-peroxydyle, 39.
Denzoquinone, 211.
Bozs, 207.
59,
,
Hromobenzène, 48.
liromure d'éthyle, 48.
—
—
—
d' ethylene,
rie
19,
L50.
Cofo/l,
148,
207.
Crotonaldehyde, 7, 39.
Cyclohexane, 18-31, 23, 29, 30, 32, 41,
14-46,50,209,210.
12.
.
Cyclohexène, 20, 21, 23, 42.
Cyclopentane, 32.
n-Décane, 19, 26.
n-Décanol, 51.
DécèneA, 26.
Acrylatc de méthyle, 102, 103.
Allyl-thiourée,
i
Copolymérisation, 79.
57.
58.
7.
i
Copolymère greffé, 130,
48.
phényle, 45.
de trichlorométhyle, 47.
Butanol, 51.
t-Butylbenzène, 19, 21-23.
Butylmercaptan, 36.
Caoutchouc, 148, 149, 171,
174, 176, 177,
189, 197.
Cellulose, 165, 197, 200, 207.
Cétones, 59.
Chaleur de polymérisation, 165.
Chloroforme, 49.
Chlorures d'alcoyle et d'aryle, 60, 61.
Chlorure d'éthylène, 48.
tfe ymy/e, 105, 108.
—
Décyne-1, 26.
Dégradation (de polymères), 146, 164,
1(15.
190, 193, 197-210.
Degré de polymérisation, 72.
188,
Densité (de polymères), 183.
Densité de reticulation, 157, 159, 161. 172,
173, 202, 208.
Densité de rupture (de polymères), 157. 195.
Déplacement d'atomes, 143, 208.
Dépolymérisation, voir Dégradation.
Désactivation, 7.
Dexlrune, 198.
Dianthracène, 38, 43.
Diffusion de la lumière (par des polymères),
194, 199.
2,2-Diméthylbutane, 32.
2,3-Diméthylbutane, 32.
2,5-Diméthylhexadiene-\,5, 26.
Diméthylhexane, 19, 32.
Diméthylpentane, 32.
Diméthylsiloxane, 149, 170, 171, 173, 209.
Diméthyl-tolyl-thiourée, 21 1
Diphénylbutadiene, 45.
Diphénylpicrylhydrazyle, 27, 32.
Distribution des centres actifs (polyméri128.
moléculaire (de polymères), 151,
153-155, 157, 159, 160, 163, 170, 171,
194-196, 198, 199, 201.
sation),
84,
Docosyne-\\,
Dose
virtuelle,
£«//,
125.
26.
194, 203.
Dotriacontane, 26.
Dotriacontyne-\6, 26.
DPPH, voir Diphenylpycrylhydrazyle.
Coefficient de reticulation, 157, 160, 162, 163,
167.
Conversions élevées, 91, 99, 131.
Conversion interne, 7, 30.
Copolymère, 148-150, 210.
£//e/ rfecawe, 8, 9, 16, 22.
E/Jfe/ d'intensité du rayonnement, 87-91, 97,
101, 105, 108, 111, 113, 118, 126, 202.
INDEX DES MATIÈRES
218
Effets physiques primaires, 5, 6, 8.
Elasticité (de polymères), 174-178, 184, 185,
Linoléate de méthyle, 58,
Luminescence,
12,
43.
L89.
Elastomères,
Electrons,
174.
Masse moléculaire moyenne (de polymères),
29.
12,
—
Emulsion (polymérisation en
Entropie (de polymères),
Esters,
175.
58.
Métaux,
179-185.
(de polymères).
8-10, 17.
53-55.
cristallin
/*,7f//
Etafe
151-155, 157, 162, 163, 167, 171, 175, 190,
192-19(5, 198-200.
Mésitylène, 19, 21, 22.
80.
),
;
<\iv/7< .s.
Ethanol, 51,
E/ner de dibutyle, 59.
Etfier de diisopropyle,
144.
Méthacrijlate de méthyle, 97, 99, 117,
121, 137.
5;i.
59.
/i//nt.s,
143,
Methanol, 51, 52.
Ethylbenzène, 19, 21-23, 32, 119.
Ethylene, 109, 111, 112.
Excitation, 8-11, 13, 17, 38, 41, 12, 60, 61.
Méthylcyclohexane, 19, 20, 23, 32.
Méthylcyclopentane, 32.
Méthytpentane, 32.
Milieu précipitant ( polymérisation en
—
119,
),76.
Neutralisation, 12-14, 29, 31.
n-Nonane, 32.
Fluorescence, 7.
(de polymères),
Fusibilité
182.
A'y/on, 149, 174, 179.
151,
(de polymères),
207.
166-168,
Gélification
Glucose,
166,
167,
189.
Gonflement (de polymères), 166, 172, 171,
189.
Grappes,
6,
52.
Halogènes, 27-29, 36, 42, 49.
Halogénures d'alcoyles, 27, 28, 47, 4!).
57, 58,
Heptadécyne-1, 26.
n-Heptane, 19, 20, 31, 32, 46.
Hexachlorobenzène, 48.
Hexachloréthane, 48.
n-Hexane, 19, 32, 43, 187.
Hexamélhylcyclométhyle, 111,
115.
21)!).
Hydrocarbures acétyléniques, 26.
18-20.
aromatiques,
18-22,
Polyethylene, 146, 149,
175, 178-190, 209.
27.
18.
Polyisobutylène,
Hydrogène atomique, 27, 31, 40, 41.
S-Hydroxyquinoléiné, 211.
171),
de
reticulation.
157-159,
103.
52.
d'i-butyle,
47.
48, 50, 60.
de méthyle, 47, 48, 50.
de méthylène, 48.
de n-propyle, 48, 50.
d'i-propyle, 47.
d'éthyle,
17,
—
Zons (décomposition des
13.
), 8,
(réactions avec molécules), 3.
/o/;
négatif,
12-14, 29, 31, 42.
posi/z/,
13.
10.
164,
187,
188,
197.
202-204, 206, 207, 209, 210.
Polyisoprène, 149.
l(i(i,
174.
lodure de n-butyle, Al, 50.
149,
L65, 167, 169, 172-
Polymères acryliques, 164, 165, 205.
Inhibiteurs de polymérisation, 70.
Intercepteurs, 20, 27-29, 32, 36, 38, 42, 49,
—
Peroxydes, 39, 198.
Photochimie, 7, 8, 21, 22, 39.
Plastomcres, 174.
PozTd de 0c/ (de polymères), 190.
Plexiglas, voir polyméthacrylate de méthyle.
Polydirnéthylsiloxane, 165, 169.
aliphatiques,
oléfiniques, 25, 26, 189, 209.
Indice
198.
Paraffines, 167-1(59, 175, 181. 188, 189,207,
209.
Pentane, 28, 32.
Hexène-1, 54.
Hydrocarbures, 18-22, 25-27, 39, 43, 46. 189,
linéaires,
Octacosane, 26.
Octacosyne-9, 26.
Octudécane, 26.
Octudécènes, 26.
Octadécyne-1, 26.
Octane, 32, 46.
n-Octanol, 51.
Oléate de méthyle, 58.
Oxydation, 39, 58, 187.
Oxygène (effet d'— ), 36, 45, 46, 49, 5 1. 55,
—
—
(fraction gel), 158, 160, 162, 172.
(fraction sol), 158, 161, 162, 170.
Polymérisation en solution, 116, 121, 126.
ionique, 77-79.
radicalaire, 36, 67-77.
Polyméthacrylate de méthyle, 119, 164, 165,
186, 197," 201, 201, 205, 209-211.
P<dy méthylène, 16 1, 179-181.
Polypropylene,
164.
P(di)siyrolène, 166, 171, 209, 210.
Poiyté'lrafluoréthylène,
165,
179,
180,
186,
197, 206.
Polyvinyle, 164.
Polyvinylidène, 164.
Pontages, voir Reticulation.
Post-poli/mérisation, 98, 103, 104, 108, 110.
122, 126, 127.
INDEX DES MATIÈRES
Principe de Franck et Condon,
Propanol, 51.
Propionaldéhyde, 41, 59, 60.
i-
Propyl benzène,
Protection. 27, 30,
Température, effet sur limdéate de
7.
<7/r/
!)!),
L66, 208-211.
10-42,
Réacteurs de polymérisation industrielle, 138.
Réaction Stern-Volmer, 38, 39.
Rendements qujantiques en radicaux libres,
7. 27. 3*, 32.
Reticulation, 25, 26, 146,
181,
184,
inétln/le.
58.
21-23.
19,
219
102,
JUT /« polymérisation, 93,
113-1 lf),
111,
126.
Tétrabromure de carbone.
18,
Tétrachlorure île carbone, 18, 19, 121.
n-Télrudécane, H).
1!».
Toluène, 19-23, 32, 12, I."», 16,
1
2,
2,
\-Trimétlitjlpe.ntune,
19,
31, 32.
2, 5-Triméthylhexane, 32.
m-Triphényle, 1.3.
p-Triphényle, 43-45.
2,
162, L64, 165,
188-190, 2(12. 208, 210.
15(1.
Tritium, 5 I.
Silicones.
IIS.
L69,
171.
173,
187,
189.
Solubilité (de polymères), 170.
Sources multiples, 131.
Stéarate de met lu/ le. 58.
Stéarate de vimjle,
111.
Styrolène, 86-91, 03, 94, 100, 11 7-1 H), 121,
123, 129.
Suif ure de carbone, 50.
(
'/;/7c'
dg pi/e,
17.
Vinylpyrrolidone,
1
20.
Viscosité (de polymères), 145, 151, 175, 189,
194, 199, 21)2."
Vitreuses (propriétés
des polymères),
-
178.
Winothène,
voir Polytétrafluoréthylène.
Température, effet sur la dégradation, 201.
1
173.
Téflon,
Xylene, 32, 119.
•
6
TABLE DES MATIÈKES
Pages
Radiolyse de liquides org iniques, par M. Burton
1
Introduction
3
Théorie
5
Effets physiques
5
Processus chimiques
Observations et interprétations
[ydrocar bures
[alogénures
Alcools
1
:,
!
n
l,s
l
17
1
,-,(1
•
Acides
Esters
Ethers
5(5
58
Aldehydes et cétones
59
59
.Mélanges variés
59
Polymérisations amorcées pab les radiations ionisantes, par A. Ghapiro
M. Magat
et
1;;;
-
Introduction
(i. )
Eléments de la théorie des polymérisations
67
67
77
79
80
Ciné tique des polymérisations radicalaires
Polymérisations ioniques
Copolymérisations
Polymérisation en emulsion
Généralités sur les polymérisations radiochimiques
Historique
Mécanisme des polymérisations amorcées par radiations
Effet de la distribution non homogène des centres actifs
82
82
83
8 1
Polymérisation des monomères purs en milieu homogène
Polymérisation du styrolène
Polymérisation du méthacrylate de méthyle
Polymérisation de l'acétate de vinyle
Polymérisation de l'acrylate de méthyle
102
Polymérisation des monomères purs en milieu non homogène et à l'état solide
Polymérisation de l'acrylonitrile
Polymérisation du chlorure de vinyle
Polymérisation de 1' ethylene
Polymérisation à l'état solide
104
108
109
112
87
S7
97
101
loi
Polymérisation en solution
Solvants à structure chimique voisine de celle du monomère
Solvants à structure chimique différente de celle du monomère
Solvants pouvant perturber le cours normal de la polymérisation
Solutions aqueuses des monomères vinyliques
124
Synthèse des copolymères greffés par voie, radiochimique
130
1
1
117
119
121
222
TABLE DES MATIÈRES
Calcul des chumps d'irradiation à sources multiples destinés aux polymérisations radiochimiques industrielles
Calcul du champ d'irradiation
Calcul des rendements
Calcul de la distribution des poids moléculaires
1
3
I
134
137
139
Effets des rayonnements de grande énergie sur les polymères, par A. Charlesby
Introduction
Propriétés caractéristiques des polymères linéaires
Théorie générale de la reticulation distribuée au hasard
Reticulation des polymères
Modifications de l'état cristallin
Transformations chimiques
Théorie de la dégradation
Dégradation des polymères
Effets de protection des polymères à longue chaîne
141
143
148
156
164
79
186
1
191
197
208
Index des auteurs
213
Index des matières
217'
W-o\
\1
Libraires
120,
de
boulevard
Dépôt
légal
ET C le
ÉDITEURS
,
L'Académie de Médecine
n°
Saint-Germain,
2975,
1
er
Paris
trimestre
VI e
1958
MARCA REGISTRADA
Printed
I
in
France
par Brodard-T a upin
mprimeur-Relieur, Coulommiers-Paris 52432
THE LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
San Francisco Medical Center
THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW
Books not returned on time are subject to fines according to the Library
Lending Code.
Books not in demand may be renewed if application is made before
expiration of loan period.
2*791.6
m
MÈl
mm
'
:
i
I;