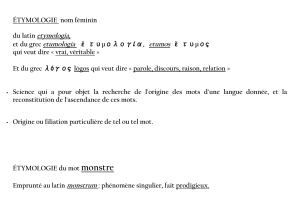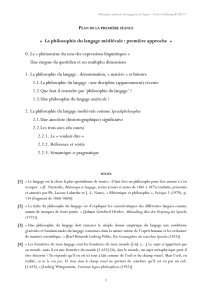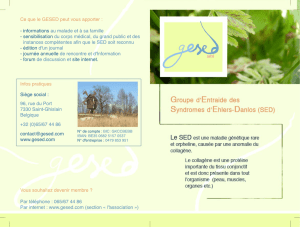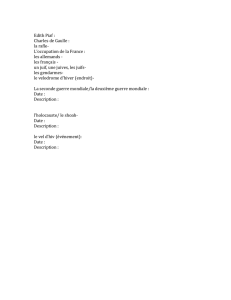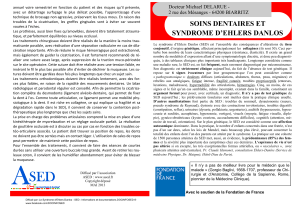Le jugement
Notion
De l’appréhension au jugement
1°) La simple appréhension ne nous donne qu’une connaissance fragmentaire est très
imparfaite des choses :
– connaissance vulgaire de l’être concrétée à la quiddité sensible, connaissance des propriétés,
accidents, relations qui entourent l’essence (ST1 q85 a5) ;
– appréhension de ces propriétés chacune pour soi, à part : « intelligendo quid sit homo, non ex
hoc ipso alia quae ei insunt intelligimus, sed secundum quamdam sucessionem » [ST1 q14 a14]
– Enfin : construction de la proposition ou énonciation :
Respondeo dicendum quod, cum formare enuntiabilia sit in potestate intellectus
nostri;
[Deus autem scit quidquid est in potentia sua vel creaturae, ut supra dictum est; necesse est quod Deus sciat
omnia enuntiabilia quae formari possunt. Sed, sicut scit materialia immaterialiter, et composita simpliciter, ita]
scit enuntiabilia non per modum enuntiabilium, quasi scilicet in intellectu eius
sit compositio vel divisio enuntiabilium; sed unumquodque cognoscit per simplicem
intelligentiam, intelligendo essentiam uniuscuiusque.
Sicut si nos in hoc ipso quod intelligimus quid est homo, intelligeremus omnia quae
de homine praedicari possunt. Quod quidem in intellectu nostro non contingit, qui de
uno in aliud discurrit, propter hoc quod species intelligibilis sic repraesentat unum,
quod non repraesentat aliud.
Unde, intelligendo quid est homo, non ex hoc ipso alia quae ei insunt,
intelligimus; sed divisim, secundum quandam successionem.
Et propter hoc, ea quae seorsum intelligimus, oportet nos IN UNUM REDIGERE
PER MODUM COMPOSITIONIS VEL DIVISIONIS, ENUNTIATIONEM FORMANDO.
[Sed species intellectus divini, scilicet eius essentia, sufficit ad demonstrandum omnia. Unde, intelligendo
essentiam suam, cognoscit essentias omnium, et quaecumque eis accidere possunt]. [ST1 q14 a14]
2°) Donner son assentiment à cette énonciation, c’est juger. D’où la définition :
Judicium est actus intellectus componentis et dividentis, affirmando vel negando
Responsio. Dicendum, quod Augustinus, sufficienter describit credere; cum per
huiusmodi definitionem eius esse demonstretur, et distinctio ab omnibus aliis actibus
intellectus: quod sic patet.
Intellectus enim nostri, secundum philosophum in lib. De anima, duplex est
operatio.
– Una qua format simplices rerum quidditates; ut quid est homo, vel quid est
animal: in qua quidem operatione non invenitur verum per se et falsum, sicut nec in
vocibus incomplexis.
– Alia operatio intellectus est secundum quam componit et dividit, affirmando vel
negando: et in hac iam invenitur verum et falsum, sicut et in voce complexa, quae est
eius signum.
(...)
Intellectus autem possibilis, cum, quantum est de se, sit in potentia respectu omnium intelligibilium
formarum, sicut et materia prima respectu omnium sensibilium formarum; est etiam, quantum est de se, non
magis determinatus ad hoc quod adhaereat compositioni quam divisioni, vel e converso. Omne autem quod
est indeterminatum ad duo, non determinatur ad unum eorum nisi per aliquid movens ipsum.
Intellectus autem possibilis non movetur nisi a duobus; scilicet a proprio obiecto, quod est forma intelligibilis,
scilicet quod quid est, ut dicitur in III de anima, et a voluntate, quae movet omnes alias vires, ut Anselmus dicit.
Sic igitur intellectus noster possibilis respectu partium contradictionis se habet diversimode.

– Quandoque enim non inclinatur ad unum magis quam ad aliud, vel propter defectum moventium, sicut in
illis problematibus de quibus rationes non habemus; vel propter apparentem aequalitatem eorum quae movent ad
utramque partem. Et ista est dubitantis dispositio, qui fluctuat inter duas partes contradictionis.
– Quandoque vero intellectus inclinatur magis ad unum quam ad alterum; sed tamen illud inclinans non
sufficienter movet intellectum ad hoc quod determinet ipsum in unam partium totaliter; unde accipit quidem unam
partem, semper tamen dubitat de opposita. Et haec est dispositio opinantis, qui accipit unam partem
contradictionis cum formidine alterius.
– Quandoque vero intellectus possibilis determinatur ad hoc quod totaliter adhaereat uni parti; sed hoc est
quandoque ab intelligibili, quandoque a voluntate.
• Ab intelligibili quidem quandoque quidem mediate, quandoque autem immediate.
Immediate quidem quando ex ipsis intelligibilibus statim veritas propositionum intellectui
infallibiliter apparet. Et haec est dispositio intelligentis principia, quae statim cognoscuntur notis terminis, ut
philosophus dicit. Et sic ex ipso quod quid est, immediate intellectus determinatur ad huiusmodi
propositiones.
Mediate vero, quando cognitis definitionibus terminorum, intellectus determinatur ad alteram
partem contradictionis, virtute primorum principiorum. Et ista est dispositio scientis.
• Quandoque vero intellectus non potest determinari ad alteram partem contradictionis neque statim per ipsas
definitiones terminorum, sicut in principiis, nec etiam virtute principiorum, sicut est in conclusionibus
demonstrationis; determinatur autem per voluntatem, quae eligit assentire uni parti determinate et praecise
propter aliquid, quod est sufficiens ad movendum voluntatem, non autem ad movendum intellectum, utpote quia
videtur bonum vel conveniens huic parti assentire. Et ista est dispositio credentis, ut cum aliquis credit dictis
alicuius hominis, quia videtur ei decens vel utile. Et sic etiam movemur ad credendum dictis Dei, inquantum nobis
repromittitur, si crediderimus, praemium aeternae vitae: et hoc praemio movetur voluntas ad assentiendum his
quae dicuntur, quamvis intellectus non moveatur per aliquid intellectum. Et ideo dicit Augustinus, quod cetera
potest homo nolens, credere non nisi volens.
Patet ergo ex dictis, quod
– in illa operatione intellectus qua format simplices rerum quidditates, non
invenitur assensus, cum non sit ibi verum et falsum; non enim dicimur alicui
assentire nisi quando inhaeremus ei quasi vero. Similiter etiam dubitans non habet
assensum, cum non inhaereat uni parti magis quam alteri. Similiter etiam nec
opinans, cum non firmetur eius acceptio circa alteram partem. Sententia autem, ut dicit
Isaac et Avicenna, est conceptio distincta vel certissima alterius partis contradictionis;
assentire autem a sententia dicitur. Intelligens habet quidem assensum, quia
certissime alteri parti inhaeret; non autem habet cogitationem, quia sine aliqua collatione
determinatur ad unum.
Sciens vero habet et cogitationem, et assensum; sed cogitationem causantem
assensum, et assensum terminantem cogitationem. Ex ipsa enim collatione
principiorum ad conclusiones, assentit conclusionibus resolvendo eas in principia, et ibi
figitur motus cogitantis et quietatur. In scientia enim motus rationis incipit ab intellectu
principiorum, et ad eumdem terminatur per viam resolutionis; et sic non habet assensum
et cogitationem quasi ex aequo: sed cogitatio inducit ad assensum, et assensus
cogitationem quietat.
Sed in fide est assensus et cogitatio quasi ex aequo. Non enim assensus ex cogitatione
causatur, sed ex voluntate, ut dictum est. Sed quia intellectus non hoc modo terminatur
ad unum ut ad proprium terminum perducatur, qui est visio alicuius intelligibilis; inde
est quod eius motus nondum est quietatus, sed adhuc habet cogitationem et
inquisitionem de his quae credit, quamvis eis firmissime assentiat. Quantum enim est ex
seipso, non est ei satisfactum, nec est terminatus ad unum; sed terminatur tantum ex
extrinseco. Et inde est quod intellectus credentis dicitur esse captivatus, quia tenetur
terminis alienis, et non propriis. II corinth. X, 5: in captivitatem redigentes omnem
intellectum etc.. Inde est etiam quod in credente potest insurgere motus de contrario eius
quod firmissime tenet, quamvis non in intelligente vel sciente. Sic igitur per assensum
separatur credere ab operatione qua intellectus inspicit formas simplices quidditates, et a
dubitatione, et opinione; per cogitationem vero ab intellectu; sed per hoc quod habet
assensum et cogitationem quasi ex aequo et simul a scientia [QD De Ver. q14 a1]
Les quatre moments conduisant au jugement
1°) appréhension d’un objet, soit singulier (« cette chaise ») soit universel (« l’âme
humaine »).
2°) appréhension de quelque propriété de cet objet : « en bois », « rationnelle ».
[peu importe qu’il s’agisse de la première appréhension de ces propriétés ou que ce soit le résultat de cogitations
antérieures]

3°) appréhension de ces concepts comme connectés entre eux ; on fait la comparaison
(collatio) d’un extrême avec l’autre :
– « cette chaise » avec « en bois » ;
– « âme humaine » avec « rationnelle ».
C’est là l’énonciation .
4°) Vient alors le jugement, qui « établit la comparasion et le rapport de cette proposition [=
énonciation] composée à ce qui est dans la réalité » :
– « Cette chaise est en bois » ;
– « L’âme humaine est rationnelle ».
La nature du jugement
Exposé général
1°) Conclusion :
Le jugement de notre intelligence affirme [ou nie] l’identité réelle [= « extramentale »] de
deux choses présentées dans des concepts distincts.
→ Cette doctrine essentielle du réalisme modéré est niée tant par les positivistes que par les
Kantiens et les idéalistes ; et en général par tous ceux qui nient que l’appréhension des concepts
précède le jugement.
2°) Le fait lui-même est une suite de l’imperfection de la connaissance de l’objet formel
propre de notre intellect dans la première opération :
– notre intellect qui travaille par abstraction à partir du sensible doit élaborer plusieurs
concepts au sujet de la même réalité : d’où la nécessité du jugement pour composer ces concepts.
– cette composition se fait par le moyen d’une comparaison :
a) l’intellect réfléchissant sur ses appréhensions conaît que les concepts de ces
appréhensions sont conformes à la réalité, puisque par l’essence de l’acte de l’intellect ils sont
ordonnés aux choses.
b) appréhender deux concepts en tant que conformes avec la même réalité [ou en
tant que non conformes], c’est les comparer.
– la composition du jugement ne peut se faire autrement : l’ « instinct aveugle » de Reid est
contraire à la nature de l’esprit qui, en tant que spirituel est capable de réfléchir sur ses actes. Il agirait
contre sa nature s’il composait ses concepts par un instinct aveugle.

Distinction entre le jugement et l’appréhension de la convenance du
sujet et du prédicat
Avec les anciens docteurs et contre plusieurs modernes à la suite de Suarez, il faut tenir que
l’appréhension de la convenance des extrêmes se distingue formellement de l’assentiment constituant
le formel du jugement.
1°) Cette distinction apparaît manifestement à la conscience :
– quand je dis « chaise en bois » j’appréhende « cette chaise » comme le même individu que
ce que j’appréhende comme « en bois », et en raison de cette identité, j’appréhende que « en bois »
convient à « cette chaise »
– et même, cette appréhension est déjà fondée in re, dans cette chose individuelle qu’est la
chaise en bois physiquement perçue.
– cependant la seule appréhension de cette convenance fondée in re ne constitue pas
formellement le jugement. Ce dernier a lieu lorsque j’assentis à cette appréhension complexe en disant
[d’abord comme verbe intérieur] « cette chaise est en bois ».
La distinction des deux se manifeste, selon Maquart, en ce que je peux m’abstenir, après
l’appréhension, du jugement... ce serait à préciser !
2°) Cette distinction doit être bien comprise :
– Il ne suffit pas de dire que l’assentiment ajoute à l’appréhension de la convenance des
extrêmes la conformité de la comparasion avec la chose : car elle se trouve déjà dans l’appréhension
de la convenance des extrêmes. Elle est en effet cause de la convenance.
Donc cette comparaison avec la res se trouve dans les deux actes (appréhension de la
convenance et assentiment), mais aliter et aliter.
– Dans l’appréhension : « chaise en bois », la conformité avec la res est appréhendée per
modum quidditatis. C’est-à-dire que « chaise en bois », en dehors de l’assentiment judicatifn n’est
qu’un nom complexe qui donc signifie sine tempore
1
, c’est-à-dire encore « par mode d’essence ».
– Dans l’assentiment : le verbe « est » signifie « cum tempore » c’est-à-dire « par mode
d’acte ». Alors la conformité des extrêmes avec la chose est affirmée dans l’assentiment judicatif par
mode d’exercice de l’existence [actuelle ou possible, réelle ou idéale].
Celui qui ne voit pas cela n’atteint pas l’essence du jugement.
3°) On voit par là que le jugement est bien l’acte le plus noble de notre intellect, et qu’il
consiste bien en un assentiment cognoscitif, vraiment appréhensif [Suarez reprochait à cette théorie
de mettre l’élément le plus noble en dehors du domaine du connaître].
Mais le jugement affirme et connaît la conformité des extrêmes avec la chose par mode
d’exercice ou d’acte, alors qu’avant elle n’était connue que par mode de quiddité.
1
Cf. I Periherm. leç. 5 n°7. Le nom est défini comme « vocem significativam ad placitum, sine tempore, cuius nulla pars
separata significat, finita et recta ». Le verbe se distingue du nom surtout en cela qu’il signifie cum tempore, c’est-à-dire
qu’il signifie l’action ou la passion, non pas comme une certaine chose qui pourrait recevoir un nom, mais comme
mouvement (action) mesuré par le temps.
[cf. Maquart Tome I p. 63 ; et p. 64 pour la présence de « est » dans tous les autres verbes].
1
/
4
100%